|
|
La
littérature féminine en Chine continentale, d’hier à
aujourd’hui (1919-2019)
I. La
littérature féminine en Chine : bref parcours historique
(1919-1976)
par Brigitte Duzan, 10 février
2019, actualisé 14 mai 2022
Lorsqu’on feuillette
des ouvrages sur l’histoire de la littérature chinoise, on
trouve très peu d’écrivaines citées. Et en général, elles le
sont comme en marge, dans un petit chapitre à part. Les raisons
en sont à la fois sociales et politiques.
Pour ne citer que
quelques chiffres, à sa création au début de la République
populaire, en 1949, l’Association nationale des écrivains (alors
« travailleurs de la littérature ») ne comptait que treize
femmes ; leur nombre avait plus que quadruplé en 1966, à la
veille de la Révolution culturelle, mais cela n’en faisait
toujours qu’une grosse quarantaine ; en 1982, l’Association
comptait 140 femmes, sur un total de 2000 membres, soit 7 %.
Aujourd’hui, le pourcentage a doublé, mais les femmes restent
sous-représentées dans les instances officielles, bien que
l’Association ait une présidente,
Tie
Ning (铁凝),
depuis la mort de
Ba Jin
(巴金),
en 2006.
La littérature féminine
a en fait en Chine une histoire très récente. Pour reprendre le
titre d’un ouvrage de deux critiques littéraires féminines
chinoises, Meng Yue et Dai Jinhua (孟悦、戴锦华),
elle a émergé « de la surface de l’histoire »,
ou plus précisément du silence de l’histoire.
1.
Emergence
de la littérature féminine aux lendemains de 1919
Avant 1919
Pendant toute la
période impériale (jusqu’à la chute de la dernière dynastie en
1911), les femmes n’avaient pas accès à la sphère publique ;
leur domaine était la sphère familiale ; un vieux précepte
disait : « Les hommes n’ont pas leur mot à dire à l’intérieur,
les femmes ne disent rien à l’extérieur ». Si éducation il y
avait, elle avait lieu dans la maison, « dans le boudoir ».
Quelques poétesses sont cependant devenues célèbres et ont vu
leurs œuvres publiées, c’étaient des épouses de lettrés ou de
grandes courtisanes, qui étaient des artistes ; leur célébrité
ne dépassait pas le cercle des lettrés autour d’elles, et leur
poésie répondait aux critères de la poésie lettrée.
Un mouvement de réforme
mené par Kang Youwei (康有为)
a émergé à la fin de l’empire, en 1898, inspiré de la réforme
Meiii au Japon. Ce petit groupe de réformateurs ont fait de
la littérature un élément essentiel des réformes
socio-politiques qu’ils préconisaient, avec en particulier
l’abandon de la langue classique ou wenyan (文言),
et son remplacement par une langue proche de la langue parlée,
le baihua (白话),
pour briser le phénomène de tour d’ivoire que constituait
l’écriture en langue classique.
|
Parallèlement, ces mêmes réformateurs se sont
exprimés en faveur de l’émancipation de la femme et
de son éducation, la condition de la femme en Chine
apparaissant comme un signe d’arriération et un
facteur de retard du pays. Mais c’était un mouvement
mené par des hommes, où les femmes n’avaient pas
leur place, il fallait d’abord les « libérer », ce
qui passait d’abord par leur éducation. De toute
façon, la réforme a échoué, et l’empereur Guangxu (光绪帝)
qui l’avait soutenue a été écarté du pouvoir. C’est
ce qu’on a appelé la « Réforme des Cent Jours » (戊戌变法).
Au début du
20e siècle sont apparues des femmes hors
du commun qui ont œuvré pour l’éducation et
l’émancipation des femmes, certaines en créant les
premières revues pour femmes. L’une d’elles, la plus
célèbre, calligraphe, poète et écrivaine, est une
personnalité de la trempe des révolutionnaires de la
Révolution française : c’est
Qiu Jin (秋瑾),
née en 1875. Mariée en 1896, elle abandonne mari
|
|

Le Journal des femmes chinoises
《中国女报》, n° 1 (janvier 1907) |
et enfants en 1903
pour aller étudier au Japon, puis mène à son retour une
action clandestine pour renverser la dynastie des Qing qui
lui vaut d’être décapitée en juillet 1907. Avec plusieurs
amies, elle avait fondé au début de cette même année un
journal intitulé « Journal des femmes chinoises » (《中国女报》)
dans lequel elle appelait les femmes à lever la tête et à
prendre leur destin en main, et s’élevait en particulier
contre la pratique des pieds bandés…
|

Chinese Girls’ Progress (Nüxuebao),
n° 1 |
|
C’est l’une
de ses amies, Chen
Xiefen (陈撷芬),
qui édita son œuvre après sa mort. Elle était la
fille de l’éditeur d’un journal nationaliste dans
lequel elle a commencé à insérer de brefs articles
sur l’éducation et les droits des femmes, rubrique
dont elle fit un mensuel à part entière en 1899,
intitulé « Journal des femmes » (《女报》).
C’est un précurseur des revues féminines qui vont se
développer par la suite, le premier en date étant le
Journal d’étude des femmes ou Nûxuebao
(《女学报》)
créé en 1898, avec le titre anglais Chinese Girls’
Progress. Ces revues s’adressaient à la frange des
étudiantes et femmes éduquées des grandes villes
formant un premier embryon de lectorat féminin.
C’est à
partir de ce moment où les femmes s’expriment
elles-mêmes sur les sujets qui les concernent que
les mentalités évoluent et que peut émerger une
littérature féminine. Mais, au début du 20e
siècle, il n’y avait même pas encore de terme pour
la désigner
.
|
Pourquoi 1919 ?
|
Il faut
attendre ce qu’il est convenu d’appeler le
mouvement du 4 mai (五四运动)
pour
que les choses changent. Ce mouvement est né d’une
explosion de colère nationale suscitée par la clause
156 du traité de Versailles qui accordait au Japon
le Shandong qui avait été sous contrôle allemand à
la fin du 19e siècle, mais avait été
occupé par le Japon pendant la guerre. Or la Chine
était entrée en guerre en 1917 aux côtés de la
Triple Entente |
|

Manifestations du 4 mai : les femmes
en première ligne |
à la condition de
pouvoir récupérer ce
territoire, et avait fourni un important contingent de
soldats et de travailleurs, dont on a fini aujourd’hui, en
France et ailleurs, par reconnaître l’importante
contribution à l’effort de guerre. Cette clause était
ressentie comme une nouvelle humiliation nationale.
Les manifestations se
sont étendues à tout le pays et toutes les classes sociales, y
compris les ouvriers, et a réussi ce que les réformateurs du
siècle précédent avaient échoué à réaliser : à mobiliser les
forces politiques et les intellectuels pour promouvoir un vaste
mouvement de réformes visant à faire sortir la Chine de son
retard et de son enfermement, et d’abord en contestant les
fondements de la culture traditionnelle. C’est ce qu’on appelé
le mouvement de la nouvelle culture.
C’est dans ce contexte
que l’émancipation des femmes est devenue une priorité et qu’a
pu se développer une littérature féminine, les femmes pouvant
dès lors accéder aux grandes universités.
Le premier pas vers des universités mixtes eu lieu en 1920 quand
deux étudiantes furent admises à l’université de Pékin. Mais,
dans le secondaire, les filles avaient des cours de couture, de
broderie, et même parfois de tissage, et la pratique des pieds
bandés subsista encore longtemps. L’émergence de la littérature
féminine s’est donc faite dans un pays encore fortement marqué
par la tradition, et elle apparaît d’autant plus remarquable.
2.
Années
1920-1935 : efflorescence de la littérature féminine
|
La
littérature féminine se développe ainsi au début des
années 1920 dans un contexte de branle-bas culturel
et d’effervescence littéraire, avec une floraison de
sociétés littéraires dotées de leurs revues
reflétant une multiplicité de courants d’idées et
permettant la publication d’essais et de nouvelles.
La littérature féminine est née de ce mouvement
iconoclaste qui a ébranlé le socle de la tradition
patriarcale qui régissait toute la société –
mouvement mené par les grands intellectuels,
Lu Xun (魯迅)
en
tête, couronné « père de la nouvelle littérature ».
Mais les femmes y ont eu une part bien plus
importante qu’on ne le dit couramment.
A côté
du père, la mère de la nouvelle littérature
Lu Xun a
été intronisé « père de la nouvelle littérature »,
c’est-à-dire celle écrite en langage vernaculaire,
|
|
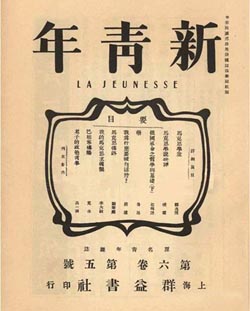
Le journal La Jeunesse (Xin
Qingnian),
mai/juin 1918 (n° 5/6) |
ou baihua, et non plus en
langue classique, en raison de sa nouvelle devenue
emblématique de tout le mouvement : « Le Journal d’un fou »
(《狂人日记》),
publié dans la revue « La Jeunesse » (《新青年》)
en mai/juin 1918.
|

La future écrivaine Chen Hengzhe en
1914 |
|
Ce qu’on
omet de dire, c’est que, en juin 1917, une jeune
étudiante chinoise du Vassar College aux Etats-Unis
a publié dans la revue trimestrielle des étudiants
chinois (Chinese Students Quarterly) une
nouvelle intitulée « One Day » (《一日》)
dans laquelle elle décrivait une journée d’un groupe
d’étudiantes dans un college américain. Elle
s’appelait
Chen Hengzhe
(陈衡哲)
et
c’est la première véritable nouvelle en baihua,
près d’un an avant celle de Lu Xun.
Amie de Hu
Shi (胡适)
qui était l’un des maîtres à penser du mouvement du
4 mai, auteur d’un essai publié en janvier 1917
préconisant une « révolution littéraire » libre des
conventions du passé, et d’une langue classique
considérée comme « morte »
,
Chen Hengzhe a
accompli en juin 1917 ce que les intellectuels
chinois se bornaient encore à théoriser. Briser la
tradition était sans doute plus facile pour elle que
pour ses confrères masculins qui, malgré la
suppression des |
examens impériaux
en 1905, étaient encore marqués par
l’esthétique et la culture des lettrés traditionnels pour
lesquels la maîtrise de la langue classique était une
condition de leur place dans la société.
C’est cependant
Lu Xun qui est devenu le
symbole de la littérature moderne. Les écrivaines, quant à
elles, ont émergé peu à peu du terreau universitaire au début
des années 1920.
L’université comme
espace social
Dans un pays à 95 %
analphabète, l’éducation des filles ne concernait que l’élite
aisée et se heurtait aux mentalités et aux traditions
confucéennes. Une fille ne sortait de chez elle que pour se
marier, et aller habiter dans la famille de son mari d’où elle
ne sortirait, éventuellement, qu’en se suicidant. Les lettrés
avaient des précepteurs pour leur fils, les filles étaient
rarement admises à participer aux leçons. On leur apprenait
surtout les règles de l’étiquette les concernant.
Les premières écoles
pour filles ont été des écoles de missionnaires (la première en
1842), suivies par une première école chinoise fondée au sud de
Shanghai en 1898. Pour l’université, les progrès seront encore
plus lents. Après l’ouverture graduelle des grandes universités
aux étudiantes, à commencer par celle de Pékin en 1920
, il n’y
avait encore en 1923 que 2.5 % d’étudiantes au niveau
universitaire dans tout le pays, proportion passée à 15 % en
1934 (mais bien plus dans les établissements de missionnaires).
Il fallait que les filles se battent, et parfois menacent de se
noyer, pour obtenir d’aller étudier hors de chez elle.
Mais, si la littérature
féminine émerge et se développe, c’est en grande partie grâce
aux Ecoles normales de filles, et en particulier les
Ecoles normales supérieures des grandes villes comme Pékin,
Shanghai ou Wuhan, qui forment des bouillons de culture et
d’idées d’où émergent des talents inédits, tout en étant aussi
des viviers de jeunes activistes en révolte contre le système. A
l’Ecole normale supérieure pour filles de Pékin, lors du
mouvement du 4 mai, les étudiantes ont brisé les grilles qui les
retenaient enfermées pour aller participer aux manifestations
dans les rues de la capitale, suivies par une foule de femmes et
de filles des écoles autour de Pékin.
Dans les mois qui
suivent le 4 mai, des groupes féministes se constituent et des
dizaines de nouveaux journaux apparaissent, offrant des forums
de discussions aux femmes pour débattre des problèmes les
concernant, bientôt désignés sous le terme global de « Question
féminine ».
Nora et la question
féminine
|
Le journal
« La Jeunesse » (Xin Qingnian
《新青年》)
consacre une section spéciale à cette question, avec
des introductions à la pensée de féministes
occidentales comme Alexandra Kollontaï ou Emma
Goldman
,
et des traductions d’écrivaines étrangères. C’est ce
journal qui lance une polémique qui marquera les
esprits pendant longtemps en publiant en 1918 une
traduction en |
|

Une maison de poupée |
chinois de la
pièce d’Ibsen « Une maison de poupée ». Le personnage
de Nora bravant les conventions pour abandonner mari
et enfants devient instantanément le sujet de toutes les
discussions et l’emblème de l’émancipation de la femme.
Dans les années qui
suivent, une profusion de nouvelles, d’essais, de poèmes et de
pièces de théâtre mettent en scène des Nora sinisées se
révoltant contre leurs familles. Mais, dès lors, le discours
n’est plus monopolisé par les hommes, les femmes écrivent. Et ce
qu’elles écrivent, ce sont leurs propres sentiments, leurs
émotions, leurs difficultés pour s’évader du carcan de la
famille et des conventions qui les empêche de sortir et de
s’exprimer. L’acte d’écrire devient un acte de rébellion et de
revendication identitaire.
Le plus intéressant est
que les écrivaines qui émergent sur la scène littéraire ces
années 1920 sont elles-mêmes des Nora, et que leurs récits,
souvent autobiographiques, sont des commentaires sur le thème de
l’émancipation de la femme, ainsi que des réflexions sur le coût
de cette émancipation pour celles qui ont décidé de s’affranchir
des conventions. Une anecdote est significative : pour son
premier article publié dans la presse, dans lequel elle explique
que le premier pas qu’il lui faut faire est de s’affranchir de
sa famille, l’une des nouvelles écrivaines en herbe a dû
demander l’autorisation de son frère aîné.
|
Mais, en
même temps, écrire, et publier dans la presse, peut
permettre à ces jeunes écrivaines de gagner de
l’argent et d’accéder à l’indépendance économique,
l’autre alternative étant l’enseignement, y compris
alors à l’université : en 1920, de retour des
Etats-Unis où elle a fait des études d’histoire,
Chen Hengzhe
est la première femme à devenir professeur
d’université en Chine. L’université devient un
vivier.
Peinture
des sentiments et écrits autobiographiques
Ces
nouvelles écrivaines tendent à rester en dehors des
grands débats de l’époque, et en particulier des
débats théoriques entre différentes factions
littéraires, sur l’art pour l’art ou les mérites du
romantisme par rapport au réalisme ; si elles font
partie des grandes sociétés littéraires, leurs voix
sont personnelles et individuelles. Ce qui les
intéresse, c’est la direction que la littérature
|
|

Su Xuelin en 1922 |
chinoise
peut prendre à ce tournant de son
histoire, et le rôle que les femmes peuvent y jouer. Elles
constituent leurs propres associations littéraires, et
forment des petits groupes très soudés dans les Ecoles
normales pour femmes où elles étudient et où elles restent
enseigner ensuite, la principale étant celle de Pékin qui a
été le vivier du groupe d’écrivaines le plus important et le
plus intéressant des années 1920-1930 :
Lu
Yin (庐隐),
Su Xuelin (苏雪林),
Feng Yuanjun (冯沅君),
Shi PIingmei (石评梅)….
|

Un manuscrit de Shi Pingmei |
|
Elles
participent aux bouleversements socio-politiques de
leur époque et à leurs répercussions sur la
littérature. Ce qu’elles écrivent ne sont plus des
histoires, souvent tragiques, de femmes contées à la
troisième personne par des narrateurs masculins,
c’est leur réalité intérieure et subjective, leurs
émotions intimes et leurs difficultés personnelles,
de femmes aspirant à autre chose |
que la vie
d’épouse et de mère qui était
le destin tout tracé des femmes chinoises depuis l’aube des
temps. Ce qui les intéresse, c’est leur identité de femme
moderne, étroitement liée aux questions de famille et de
mariage – elles ont toutes eu à lutter contre des mariages
arrangés.
|
Leurs
récits sont donc très souvent autobiographiques, ou
semi- autobiographiques, traduisant leurs espoirs
mais aussi leurs frustrations, de plus en plus vives
à partir du milieu de la décennie, quand elles
réalisent qu’un mariage choisi et une carrière
réussie comportent difficultés et déceptions. C’est
le cas de
Lu Yin, par
exemple, qui exprime ses espoirs sur l’émancipation
des femmes dans sa longue nouvelle « Les amies du
bord de mer » (Haibin
guren《海滨故人》)
-écrite sous forme épistolaire - publiée en 1923,
suivie deux ans plus tard d’une nouvelle amère
intitulée « Après la victoire » (《胜利以后》),
où elle exprime ses doutes et ses appréhensions sur
le rôle de la femme dans la société chinoise
moderne. Ces récits féminins sont généralement
désignés du terme de « récits à problèmes » (wenti
xiaoshuo
问题小说),
caractéristiques de la période.
La
malédiction de Nora |
|

Les amies du bord de mer, de Lu Yin |
Une grande partie de
ces femmes, en fait, ont eu des destins tragiques : elles sont
souvent mortes très jeunes, de maladies, voire en couche. Leurs
récits sont donc d’autant plus le reflet de leur vie : elles
incarnent les ambivalences de la femme moderne chinoise à
travers leur personnalité d’écrivaines. Finalement, malgré tous
les discours, leur sort ne s’est pas tellement amélioré.
Dans une conférence
désormais célèbre prononcée en décembre 1923,
«
Qu’arrive-t-il à Nora, une fois partie de chez elle ? »,
Lu Xun
montre bien à quel point, finalement, les esprits étaient restés
très conservateurs quant aux possibilités d’émancipation
féminine ; il dit textuellement que Nora, après avoir quitté sa
maison, n’a au bout du compte que deux possibilités : revenir
chez elle ou se prostituer
. Et, comble de provocation, il
prononce ce discours à l’Ecole normale supérieure pour femmes de
Pékin.
Il évoque bien une
autre option : que la femme acquière une indépendance
économique. Mais l’expérience de ces écrivaines a bien montré
que c’était encore un miroir aux alouettes car cela ne prenait
pas en compte les contradictions vécues par les femmes entre
carrière et vie personnelle. Et ces contradictions seront,
malgré les apparences, toujours aussi vives pendant la période
maoïste et après.
3.
1937-1949 : Les années de guerre
Ces années 1920 en
Chine voient donc l’émergence en littérature de plumes féminines
inédites, mais ces voix nouvelles se trouvent dès le début des
années 1930 en butte au développement d’un mouvement littéraire
dit « de gauche », né de la montée des risques de guerre,
entraînant un appel à une littérature de défense nationale. La
guerre est déclarée en 1937, le Japon envahit la Chine, et,
après la défaite du Japon, la Chine vit encore quatre années de
guerre civile. Jusqu’en 1949, l’heure n’est plus à l’expression
des sentiments intimes et des difficultés existentielles.
Les années 1930-1945
|

Xiao Hong et Ding Ling (à g.) |
|
Les
écrivaines ne sont pas nombreuses à publier pendant
cette période de guerre. Pourtant, quelques-unes
continuent d’écrire, dans un style autobiographique
proche de leurs consœurs des années 1920, bien
qu’avec des nuances, et ces récits sur fond de
guerre sont d’autant plus étonnants. L’une des plus
connues est
Xiao Hong (萧红),
dont la vie est aussi tragique que nombre de ses
consœurs de la décennie précédente.
Mais il en
est deux, moins connues mais pourtant
particulièrement remarquables, chacune dans un style
personnel, qui représeneant comme deux extrêmes de
l’écriture féminine de la période. |
|
- L’une,
Xie Bingying (谢冰莹)
a un parcours révélateur. Née en 1906 dans une
famille traditionnelle où elle avait eu les pieds
bandés et avait été promise dès trois ans à un ami
de son père, elle s’est engagée dans l’armée en 1926
pour échapper à son mariage arrangé. Elle envoie des
dépêches du front qui sont publiés dans la presse à
partir de 1927, puis édités sous le titre « Journal
de guerre » (《从军日记》),
actualisé en 1938. Et ce sont les royalties touchées
sur ces écrits, complétés par de l’argent
|
|

Journal de guerre, 1937 |
offert son frère, qui lui
permettent de faire des études : elle est admise en 1930… à
l’Ecole normale supérieure pour filles de Pékin.
Elle est restée célèbre
pour ses deux principaux livres, où elle témoigne de son
expérience personnelle : « Dans une prison japonaise » (《在日本狱中》)
publié en 1940, et surtout son « Autobiographie d’une femme
soldate » (《一个女兵的自传》)
publiée en 1936.
- L’autre, dans un
style intime tranchant sur les impératifs de la période, est
Bai
Wei (白薇). Contrairement aux idées reçues, elle
montre la persistance, pendant les années de guerre, d’une
littérature féminine qui n’a pas abandonné les thèmes féministes
des années 1920 : lutte pour l’indépendance, liberté sexuelle,
égalité socio-économique, droit de choisir son partenaire dans
la vie, contre la tradition des mariages arrangés.
S’enfuyant de chez ses parents pour faire des études, puis de
l’Ecole normale de Changsha pour éviter d’être mariée contre sa
volonté, elle fait de sa vie une triste épopée et de son corps
malade le symbole de l’époque. Ayant contracté la syphilis par
son mari, un poète de son choix, elle consigne dans un roman
autobiographique écrit sur son lit d’hôpital les affres de sa
situation où se mêlent souffrances physiques et douleur morale,
emblématique des souffrances des femmes qu’elle a pu observer et
qu’elle décrit dans ses nouvelles.
Ecrit entre 1934 et 1936, le roman est intitulé
« Une
vie tragique » (《悲剧生涯》),
avec quelque chose de théâtral dans ce titre. D’une forme aussi
intéressante que le fond, c’est un ovni sur la scène littéraire
de l’époque. Sa publication est due à un grand passeur de la
littérature chinoise, en particulier féminine, de l’époque, Lin
Yutang (林语堂),
qui en avait en fait commandité la première partie.
Les oubliées du Manchukuo
-
La littérature féminine du Manchukuo.
-
L’exemple de
Mei
Niang
梅娘
……………………
Les années 1940 à
Shanghai
|
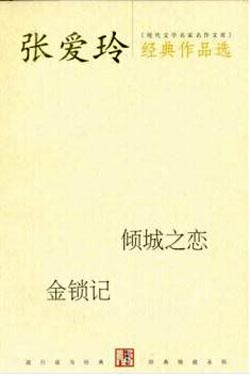
Zhang Ailing, Love in a Fallen City |
|
Après
l’occupation de Shanghai par les Japonais en 1937,
les intellectuels se replient vers l’intérieur.
L’occupation de Shanghai, en ce sens, crée un espace
déserté propice à l’émergence de nouveaux auteurs,
et ce sont surtout des femmes.
La plus
connue est
Zhang Ailing (张爱玲)
dont la célébrité médiatisée a cependant eu pour
conséquence de reléguer dans l’ombre nombre de ses
consœurs qui jouissaient pourtant, à la fin des
années 1940, d’une popularité au moins égale à la
sienne. Il est vrai que, dans ses nouvelles des
années 1943-47, Zhang Ailing s’affirme dans un style
percutant. Mais son chef d’œuvre reste le roman « La
Cangue d’or » (《金锁记》),
où elle distille une satire de la famille et de la
société avec une cruauté sans égale, dans un format
de saga familiale très classique. La traduction
française est malheureusement indisponible
. |
|
De son
vivant, cependant, il y avait des écrivaines qui lui
disputaient le devant de la scène, dont
Su Qing (苏青) ;
victime d’une purge politique dans les années 1950,
puis de persécutions pendant la Révolution
culturelle, elle est morte dans la misère en 1982 et
n’a été redécouverte que dans les années 2000.
Son roman
autobiographique « Dix ans de mariage » (《结婚十年》),
initialement paru en 1943 dans la revue Vent et
pluie (《风雨谈》),
a eu un tel succès qu’il en était fin 1948 à sa 18e
édition. Elle y décrit sa vie de femme mariée,
puis divorcée, ses accouchements, ses relations
extraconjugales et ses états d’âme : il a fait
sensation. Elle en a publié une suite en 1947 (《续结婚十年》),
et même encore une séquelle avec « Une beauté égarée
» (《歧路佳人》)
– on dit que ce livre « provoqua une pénurie de
papier », ancienne expression pour signifier qu’il a
été un bestseller. Il a été réédité en 2006. |
|

Su Qing, Dix ans de mariage, éd. 2016 |
Mais, là encore, ce
sont des existences tragiques, y compris celle de Zhang Ailing
qui a souffert d’un mariage désastreux et, exilée aux Etats-Unis
après 1950, y est morte dans la solitude et l’isolement en 1995.
Pour la plupart de ces écrivaines, la malédiction de Nora se
poursuit : il n’y a pas d’amour heureux comme il n’y a pas de
bonheur durable.
Cependant, à côté
d’elles, et de manière étonnante, il y a eu aussi, pendant les
années 1940, une écrivaine dont les comédies ont eu énormément
de succès à Shanghai : c’est
Yang Jiang (杨绛),
une écrivaine qui, après avoir étudié à Oxford et à la Sorbonne,
était rentrée à Shanghai fin 1938 pour s’occuper de son vieux
père, alors que toute la ville fuyait vers Wuhan, Chongqing ou
Kunming.
Ajoutons, dans le
registre humoristique, la nouvelle de
Fengzi (凤子)
« Le Portrait » (《画像》), publiée en 1947, où l’auteure ne questionne pas l’avenir de Nora une
fois partie de chez elle, mais le sort des hommes autour d’elle,
désorientés après son départ…
Le sort de la femme
reste pourtant toujours aussi problématique que celui de Nora,
malgré les promesses initiales faites par Mao. On retrouvera le
thème dans la littérature féminine dès les lendemains de sa
mort, montrant que, si le statut de la femme a certes évolué,
son émancipation reste une illusion.
4.
1949-1976 : les années Mao
Ces années commencent
par ce qu’on appelle en Chine, autant pour la littérature que
pour le cinéma, « les dix-sept années », et elles sont suivies,
de 1966 à 1976, de dix ans de Révolution culturelle qui sont un
trou noir pour la littérature, surtout féminine.
La grande illusion
A partir de 1949, la
littérature devient affaire d’Etat, comme tous les arts, Mao a
annoncé le programme dès 1942 au fameux Forum sur la littérature
et les arts de Yan’an : tous les arts doivent servir le peuple
et œuvrer à l’avancement du socialisme, le peuple étant entendu
comme le trio paysans-ouvriers-soldats. Les écrivains deviennent
des travailleurs au service de la cause nationale ; en retour
ils ont droit à un salaire : ils sont organisés en une
association dont les membres sont rétribués, troquant sécurité
matérielle contre liberté.
Les femmes sont censées
être les grandes bénéficiaires du nouveau régime. Mao proclame
qu’elles sont « l’autre moitié du ciel », cette nouvelle
promotion égalitaire signifiant qu’elles ont le droit de
travailler à l’égal des hommes. Les écrivaines acquièrent donc
théoriquement un nouveau statut qui les met à l’abri des aléas
économiques de leurs consœurs des années 1920, dépendantes de
publications dans des revues fragiles.
Mais elles ne sont pas
nombreuses à être adoubées par le régime : treize écrivaines
sont membres de l’Association des écrivains à sa création ;
elles ne seront encore qu’une grosse quarantaine en 1966, à la
veille de la Révolution culturelle. Et en dehors des
institutions officielles, il n’y a plus de presse ou d’édition
libre où pouvoir publier.
Deux grands romans
C’est donc une poignée
d’écrivaines qui peuvent continuer à publier ; beaucoup se
replient sur des travaux de recherche ou d’enseignement. Parmi
celles qui avaient commencé à acquérir une certaine notoriété
avant 1949, la plus connue est sans doute
Ding
Ling
(丁玲)
qui s’était fait connaître dès la fin des années 1920 et avait
fait de la propagande pour la guérilla à Yan’an dans les années
1940. C’est la grande auteure des années 1950, avec des
nouvelles essentiellement. Elle subira bien des persécutions
politiques mais son œuvre reste fondamentale pour comprendre la
période.
D’autres femmes qui
avaient travaillé dans l’édition de revues reprennent du
service, en particulier Shen
Zijiu (沈兹九),
qui avait édité plusieurs revues de femmes dans les années 1930,
dont La vie des Femmes (《妇女生活》)
éditée par la Librairie des femmes basée à Shanghai. Elle est
recrutée pour diriger la section Education et propagande de la
Fédération nationale des femmes à sa création ; elle deviendra
en même temps rédactrice en chef de la revue qui lui est liée :
Femmes de la Chine nouvelle (《新妇女》).
Mais son heure de gloire s’achèvera en 1956.
En fait, les écrivaines
sont dans une impasse : le régime les a comblées, elles peuvent
à la limite se lamenter sur la condition des femmes avant 1949,
mais plus après. L’une des premières lois du nouveau régime, en
1950, est la loi sur le mariage qui interdit les mariages
arrangés et les pratiques qui lui étaient liées. La femme est
libérée, comme le pays. Plus question de critiquer les
discriminations fondées sur le genre. Ding Ling qui avait écrit
un article sur l’attitude sexiste des dirigeants du Parti dès
1942 à Yan’an en fera les frais lors de la campagne
anti-droitière de 1957 : elle sera condamnée pour idées
subversives et envoyée réformer sa pensée dans le Grand Nord
d’où elle ne reviendra que douze ans plus tard.
Cette campagne massive
contre les intellectuels dits « droitiers » a touché une grande
partie des écrivaines de la période pré-1949 qui n’étaient pas
parties à Taiwan : elles ont, pour beaucoup, à des degrés
divers, subi le même sort que Ding Ling. Certaines ont même
commencé à être attaquées dès le début des années 1950, comme Su
Qing, arrêtée en 1955 pour activités contrerévolutionnaires, le
grand chef d’accusation de la période maoïste.
Finalement, à côté des
nouvelles de
Ru
Zhijuan (茹志鹃),
il reste deux grandes œuvres devenues des classiques de la
littérature féminines des années 1950 : deux romans publiés en
1957 et 1958.
|
- L’un est
« Le Chant de la jeunesse »
(《青春之歌》), de
Yang Mo
(杨沫),
qui connut la gloire quand son roman fut publié, en
1958. C’était
le premier roman chinois – largement
autobiographique - à décrire un mouvement
d’étudiants patriotes et d’intellectuels
révolutionnaires pendant la guerre, sous la
direction du Parti communiste. Le personnage féminin
est une intellectuelle vouée à une existence terne
d’épouse à l’ancienne qui, s’étant enfuie de chez
elle et prête à se suicider, est sauvée par un
étudiant poète avec lequel elle finit par se
marier ; mais, alors qu’elle s’ennuie chez elle en
cherchant vainement du travail, elle est gagnée par
la ferveur révolutionnaire d’un leader étudiant et
renaît en rejoignant « l’armée des ombres » luttant
contre le Japon et pour la défense nationale.
Le succès
du roman sera accru encore quand il sera
adapté au cinéma,
dès 1959, et coréalisé par les deux |
|
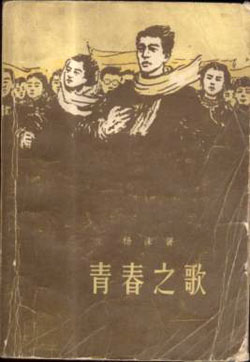
Le chant de la jeunesse |
grands cinéastes
Cui Wei (崔嵬)
et Chen Huai’ai (陈怀皑),
le film entrant de son côté
dans les grands classiques du cinéma chinois. C’était au
début du Grand Bond en avant, et la mobilisation des esprits
était plus nécessaire que jamais.
Yang Mo n’aura plus le
même succès avec ses publications ultérieures, mais elle est
quand même l’un des rares écrivains qui aient publié pendant la
Révolution culturelle, en 1972, bien que ce soit un récit des
luttes internes dans le Parti.
|
- L’autre
grand classique, publié en 1957, est la nouvelle
« moyenne » « Les
haricots rouges » (《红豆》)
de
Zong Pu
(宗璞),
qui rejoint la peinture des sentiments et du désir
féminins des écrivaines des années 1920. Zong Pu
décrit les tensions ressenties, à la fin des années
1940, par une jeune étudiante partagée entre son
amour romantique pour un camarade de classe et ses
convictions politiques ; à la fin elle finira par
rompre avec l’objet de son désir – qui, lui, part à
l’étranger - pour s’engager dans la lutte
révolutionnaire.
C’était
audacieux, même si le récit reste dans la ligne
idéologique ; le roman sera vivement critiqué, en
particulier pour l’accent mis sur le conflit
intérieur de la jeune fille et le désordre de ses
sentiments. Le récit étant construit en flash-back,
comme souvenir remontant du passé en 1949, il est
imbu d’une aura nostalgique pour un amour de
jeunesse en contradiction avec l’atmosphère |
|

Littérature du peuple 1957/7,
Les haricots rouges |
de
l’époque. Réédité par la suite, il reste
l’une des plus belles œuvres « féminines » de la période
moderne.
C’est une exception dans la production littéraire
de la période. Zong Pu reviendra sur le devant de la scène après
la Révolution culturelle qui, de 1966 à 1976, marque un trou
noir dans la production littéraire, d’où émergent à peine
quelques noms, mais pas de femmes à part Yang Mo.
Il n’y avait même pas de pronom personnel troisième
personne au féminin. Le caractère a été inventé, en
changeant la clé du pronom masculin, par Liu Bannong (刘半农),
un linguiste proche de Hu Shi, qui l’utilisa dans un
poème écrit en 1920 : « Apprenez-moi comment ne plus
penser à elle »
《教我如何不想她》
La
Cangue d’or, trad. Emmanuelle Péchenart, Bleu de Chine,
2000, 105 p.
|
|

