|
|
Tie Ning 铁凝
Présentation
par Brigitte Duzan, 29 mai 2012
|
Réélue en novembre 2011,
Tie Ning (铁凝) est depuis 2006 la présidente de
l’Association des écrivains de Chine. Elle a été la
première femme à accéder à cette fonction, à l’âge de
quarante neuf ans.
Elle était non
seulement la première femme, mais aussi la plus jeune
élue à la présidence de cette association. C’était un
immense honneur, qui la plaçait à un rang comparable à
Mao Dun et Ba Jin, ses prédécesseurs. Mais c’était aussi
une lourde charge à laquelle elle a sacrifié son œuvre
littéraire. On ne peut pas dire qu’elle n’écrit plus,
comme on le dit souvent, mais il est vrai que
l’essentiel de son œuvre de fiction date d’avant 2006.
Heureusement, elle avait commencé à écrire jeune…
Ecrivain
précoce |
|

Tie Ning en 2006 |
Tie Ning est née en
1957 à Pékin, dans une famille originaire de Zhaoxian (赵县),
dans la province du Hebei. Ses parents étaient tous deux des
artistes : son père est Tie Yang (铁扬),
peintre
connu pour ses aquarelles et des peintures à l’huile où se
reflète l’influence de Cézanne, mais aussi diplômé de
l’Institut national
d’art dramatique (中央戏剧学院) ;
sa mère était professeur de musique, diplômée du conservatoire
de Tianjin.
Première nouvelle à
la fin du lycée
|
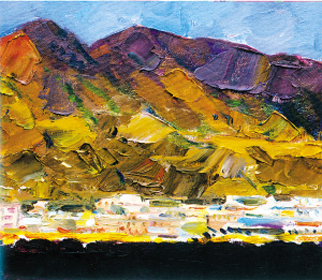
Un paysage de Tie Yang |
|
En 1961, quand
Tie Ning a quatre ans, ils reviennent dans le Hebei, à
Baoding (保定) ;
c’est là qu’elle
fait toute sa scolarité, perturbée par la Révolution
culturelle. A l’issue de ses études secondaires, en
1975, elle est envoyée travailler à la campagne (1) dans
le cadre du mouvement des Jeunes instruits, mais
toujours dans le Hebei, dans une ferme au sud de
Baoding, à Boye (博野县).
Elle a dix-huit
ans et a déjà commencé à écrire : elle vient de publier
sa première nouvelle, « La faucille volante »
(《会飞的镰刀》),
dans la Revue des lettres et des arts de Baoding |
(《保定文艺》).
Elle continue à écrire tout en travaillant à la ferme. Elle
publie quelques nouvelles : « Nuit » (《夜晚》),
« Funérailles » (《丧事》),
« Un cadeau non désiré » (《不受欢迎的礼物》)…
En 1979, elle est
affectée, comme assistante de rédaction pour la rubrique
littéraire, à la revue La Montagne fleurie (《花山》),
publication de la Fédération des lettres de Baoding (保定文联).
Pendant
l’hiver, elle participe
au Congrès de la littérature pour enfants.
En 1980, elle participe
à l’atelier littéraire organisé par la province du Hebei, puis
publie la nouvelle « Histoire de fourneau » (《灶火的故事》)
dans le supplément littéraire du quotidien de Tianjin. Son
premier recueil de nouvelles sort cette année-là.
Premier succès à
vingt-cinq ans
|
En 1982, la
nouvelle « Ah, Neige parfumée » (《哦,香雪》)
fait sensation : elle est couronnée du Prix des
meilleures nouvelles de Chine pour 1982 (全国优秀短篇小说奖).
Elle est en général considérée, dans les biographies de
Tie Ning, comme le point de départ de son œuvre.
Neige parfumée
(香雪)
est le nom d’une jeune fille d’un village reculé où le
passage du train en provenance de la capitale est
l’événement de la journée. Les petites villageoises,
parées de leurs plus beaux atours, y découvrent des
nouveautés formidables et échangent œufs et jujubes
contre des menues choses introuvables au village :
boites d’allumettes,
spaghettis, épingles à cheveux, voire, luxe suprême, des
bas de nylon. Montée dans un wagon, Neige parfumée y
découvre un jour un plumier extraordinaire, avec une
fermeture aimantée, et réussit à l’échanger pour son
panier d’œufs, laissé à une étudiante pékinoise qui n’en
a que faire et lui aurait volontiers fait |
|
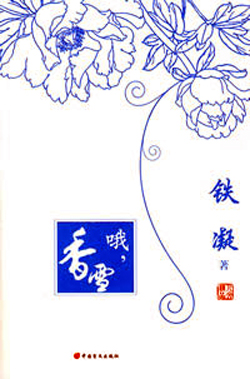
Ah Neige Parfumée |
cadeau d’un objet pour elle sans grande valeur…
Descendue à l’arrêt suivant, Neige parfumée doit ensuite faire
trente lis à pied dans la nuit pour rentrer au village avec son
trésor.
Cette nouvelle est un
parfait exemple du style et de la thématique de Tie Ning à ses
débuts, dans les années 1980 : empreint d’un sentiment très
profond pour la vie rurale né de son expérience personnelle, ce
récit décrit avec une émotion discrète la simplicité naïve de
jeunes villageoises rattachées au monde extérieur par le frêle
cordon ombilical des rails du train, et émerveillées par
« l’accent de Pékin » et les gadgets de la capitale considérés
comme trésors quasiment magiques.
Le style est d’un
réalisme teinté de poésie, loin de la littérature engagée, au
même moment, d’un écrivain comme Bai Hua (白桦),
par
exemple
(2). Tie Ning
va, de là, évoluer vers
un réalisme plus tranché, décrivant le sort malheureux des
femmes dans la société chinoise, mais sans jamais tomber dans la
critique,et encore moins la dénonciation : elle a une position
de plus en plus officielle et ses nouvelles font l’objet
d’adaptations cinématographiques et télévisées qui les rendent
encore plus populaires.
Années 1980 :
Popularité croissante et position de plus en plus officielle
Peintre du monde
féminin rural
|
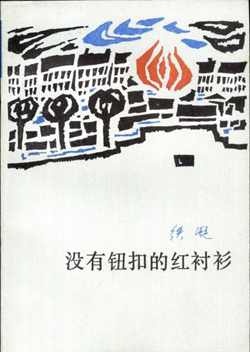
Le chemisier rouge déboutonné |
|
En 1983 paraît
dans la revue Octobre (《十月》)
sa première longue nouvelle (中篇小说) :
« Le chemisier rouge déboutonné » (《没有纽扣的红衬衫》). Nommée en 1985 dans la liste des meilleures nouvelles de l’année, elle
est, cette même année, adaptée au cinéma par une
réalisatrice dont la carrière n’a malheureusement été
au-delà de 1989,
Lu Xiaoya (陆小雅) :
le film sera couronné des prix
du Coq d’or et des Cent fleurs (3).
En 1984, la
nouvelle « Sujet de conversation de juin » (《六月的话题》),
publiée dans La montagne fleurie (《花山》), est
adaptée à la télévision. Cette année-là, Tie Ning est
élue vice-présidente de la Fédération des
lettres du Hebei (河北省文联副主席).
Début 1985,
lors du quatrième Congrès de l’Association des écrivains
de Chine, elle est élue membre du conseil de |
|
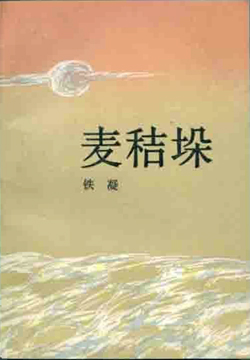
La meule de paille de blé |
|
l’association.
En mai, elle fait partie de la délégation
d’écrivains
chinois envoyée aux Etats-Unis pour participer à
un colloque littéraire à l’université Columbia.
En 1986, une
autre longue nouvelle est publiée dans la revue
littéraire Shouhuo (《收获》) :
« La meule de paille de blé » (《麦秸垛》).
C’est
encore une histoire de femmes, et toujours à la
campagne. La nature y est dépeinte sur un ton qui reste
idyllique ; mais c’est aussi une description de mœurs
paysannes qui n’évoluent pas, où les femmes sont
toujours assujetties aux mêmes contraintes sociales et
familiales, sans échappatoire. Tie Ning, cependant, ne
se fait pas défenseur des droits des femmes : elle
décrit sans prendre parti des mentalités et des modes de
vie qui font obstacle au développement social.
|
|
L’année
suivante, en 1987, est publiée une autre longue
nouvelle, « La route me ramène à la maison »
(《村路带我回家》),
qui est adaptée l’année suivante au cinéma. Dans cette
nouvelle, une jeune veuve, ancienne « jeune instruite »
qui n’a plus de hukou urbain pour pouvoir revenir en
ville, est partagée entre deux hommes qui souhaitent
l’épouser, son
choix pouvant lui permettre de quitter la campagne. Tie
Ning continue ici dans sa ligne thématique : elle oppose
un monde masculin complice de l’idéologie du pouvoir, et
un monde féminin plus subjectif, guidé par ses désirs et
ses envies.
Le tournant
de 1988
En 1988 paraît
son premier roman, « La porte des |
|
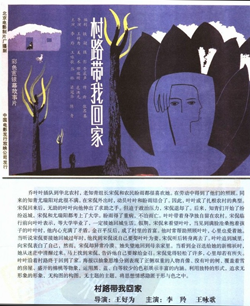
La route me ramène à la maison |
|
roses »
(《玫瑰门》),
aux éditions de l’Association des écrivains. Il marque un tournant dans
son style : elle passe ici d’un ton poétique pour
décrire le monde rural, à la description plus sombre de
destinées de femmes sur plusieurs générations, doublée
d’une réflexion sur l’histoire et la culture qui se
prolonge dans l’écriture d’essais et de critiques d’art.
L’année suivante, en 1989, est publiée dans la revue
Littérature du peuple (《人民文学》) une autre longue nouvelle qui forme avec le roman de 1986 comme le second
volet d’un diptyque : « Le tas de fleurs de
coton » (《棉花垛》).
L'histoire se
déroule dans la Chine des années 1930, toujours à la
campagne. La culture du coton forme la base de toute la
vie, pour les adultes dont le statut est proportionnel à
la qualité des fleurs qu’ils produisent, mais aussi pour
les enfants qui
jouent au marchand de coton. |
|

Rose Gate |
|
Le récit est centré sur
l’histoire tragique de deux jeunes couples, une histoire
qui se déroule en même temps que la guerre contre le
Japon, avec tous les drames que comporte une guerre.
Quarante-cinq ans plus tard, un voyage en train rappelle
ses souvenirs du passé au dernier survivant. Tie Ning
joue sur la nostalgie pour atténuer la dureté de son
récit, mais fait aussi une peinture, par touches
successives, de l'éveil du désir chez ses jeunes
adolescents, trait récurrent dans ses nouvelles.
Les événements
de 1989 n’affectent en rien sa production, qui ne fait
au contraire qu’accélérer. En 1990, sa nouvelle « Ah,
Neige parfumée » est adaptée au cinéma, et le film
tourné au Studio des films pour enfants.
Années
1990 - 2000 : Consécration |
|
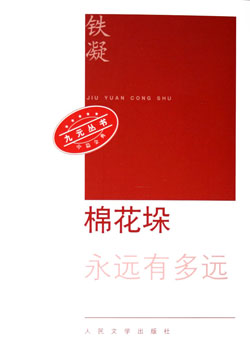
Le tas de fleurs de coton |
Encore deux romans
|
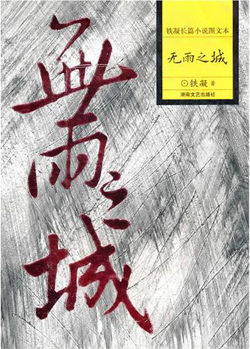
La ville sans pluie |
|
Tie Ning publie
son second roman en 1994 : « La ville sans
pluie » (《无雨之城》). Mais elle est de plus en plus prise par ses fonctions officielles.
En 1995, elle
participe à un voyage officiel aux Etats-Unis où elle
parcourt treize Etats en prononçant autant de discours.
Pendant l’été, elle est à Taiwan et en septembre un
recueil de ses nouvelles est publié à Tokyo. En octobre
1996, à l’âge de
trente-neuf ans, elle est élue présidente de
l’Association des écrivains du Hebei, et
parallèlement à la vice-présidence de l’Association des
écrivains à l’échelon national.
En 1997 est
publiée une autre nouvelle qui sera adaptée au cinéma un
peu plus tard : « La soirée d’Andrei » (《安德烈的晚上》). La nouvelle est par
ailleurs primée par l’équivalent chinois du Reader’s
Digest, tandis qu’un |
|
recueil d’essais, « Les
nuits blanches d’une femme » (《女人的白夜》), est couronné du prix Lu
Xun, premier prix Lu Xun à être décerné. Et elle
continue les voyages officiels : en février 1998 à Hong
Kong, en mars en Israël, en mai en Corée, cette fois
avec son père, pour participer un colloque sur l’art.
Au début du
nouveau millénaire, elle publie cependant son
troisième roman : « Femmes au bain »
(《大浴女》),
qui a également été adapté en série télévisée.
Le récit couvre la vie de trois femmes, deux sœurs et
leur amie d’enfance, sur une période d’une quarantaine
d’années, de leurs jeunes années, au début du régime
maoïste, à leur maturité dans les années 1990, en
passant par leur adolescence pendant la Révolution
culturelle. Chacune d’entre elles se débat au sein de
difficiles relations, familiales et sentimentales, tout
en cherchant à conquérir finalement sa liberté. Le titre
est emprunté aux célèbres Baigneuses de Cézanne, sans
doute sous l’influence de son père, mais avec une
connotation symbolique : |
|

Femmes au bain |
|
il
s’agit du bain de l’âme (“灵魂的洗浴”),
a expliqué Tie Ning.
En 2001, la
longue nouvelle « L’éternité, c’est loin ? » (《永远有多远》) reçoit une seconde fois
le prix Lu Xun, ainsi que le prix Lao She et plusieurs
autres prix de revues littéraires. La nouvelle est
adaptée en 2002 en une série télévisée en quinze
épisodes. Tie Ning publie encore un recueil de
nouvelles, traduit en français,
« La douzième nuit »
(《第十二夜》),
puis multiplie les compilations d’essais, nouvelles et
textes divers, dont un recueil de nouvelles et autres
textes, dont des critiques d’autres auteurs, avec une
vingtaine de photos d’elle depuis l’enfance : « Qui peut
m’intimider ? » (《谁能让我害羞》).
Un quatrième roman différent |
|
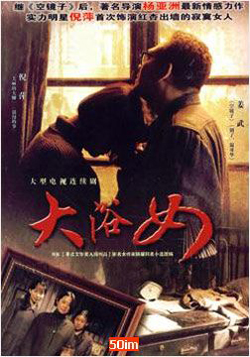
Femmes au bain, la série télévisée |
Enfin, en 2005 sort son
quatrième roman, sur lequel, selon ses propres dires,
elle a travaillé six ans : « [Le village de] Benhua »
(《笨花》).
C’est une saga villageoise dans la lignée de ses trois précédents
romans, mais plus complexe -
il
comporte plus de quatre-vingt dix personnages, et surtout ce
sont en majeure partie des personnages masculins : le monde
habituel de Tie Ning a basculé, et son regard est résolument
tourné vers la peinture de l’histoire, de la culture et des
coutumes locales.
|
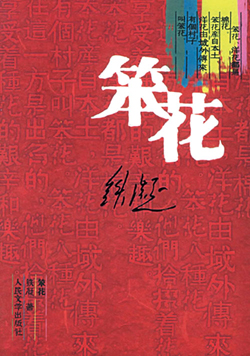
Le village de Benhua |
|
Le titre même
est significatif, Tie Ning l’a longuement expliqué lors
de ses interviews à la sortie du livre : les deux
caractères 笨花
bènhuā
signifient normalement ‘fleur d’idiot’, mais ils ont ici
un sens dialectal. Le terme désigne le coton cultivé
localement (花
huā
étant pris pour
棉花),
opposé à 洋花
yánghuā
le
coton importé.
Tie Ning
revient ici à la région d’où est originaire sa
famille et où son grand-père était cultivateur de coton,
d’où
l’importance du
thème dans son œuvre. L’histoire se passe en effet dans
la plaine de Jizhong (冀中平原),
dans le Hebei,
des débuts de la République de Chine, vers 1912, à la
fin de la guerre contre le Japon, vers 1945. Elle
retrace les événements historiques vus localement, à
travers l’histoire
d’une famille
du village de Benhua.
Mais il ne
s’agit pas d’un roman historique : l’attention est
|
portée sur la
description des coutumes locales, et l’analyse des modes de vie,
avec une saveur locale transmise par des expressions
dialectales, et même de plusieurs dialectes du Hebei. On sent
cependant l’écriture retenue, la
touche se fait ici discrète sur les sentiments des personnages,
et surtout sur leurs émois sexuels. Elle a dit avoir
effectivement bridé son langage « pour ne pas détourner
l’attention de l’essentiel »,
l’essentiel étant le caractère éthique de ses personnages, leur
préservation des grandes valeurs morales même au sein de la
guerre et de l’adversité. On ne peut s’empêcher de voir là un
discours très officiel.
Présidente de
l’Association des écrivains
|
En novembre
2006, à l’issue du septième congrès de
l’Association
des écrivains de Chine, elle fut élue présidente de
l’Association.
Elle était non
seulement la première femme, mais aussi la plus jeune
élue dans l’histoire de cet organisme créé
cinquante-sept ans auparavant. Elle succédait à deux des
écrivains les plus importants de la littérature chinoise
moderne,
Mao Dun (茅盾)
et
Ba Jin (巴金).
Elle fut saluée comme un espoir de changement. En tant
que présidente de l’Association
des écrivains du Hebei pendant une dizaine
d’années, elle
s’était créé une image de sérieux et de pragmatisme et
avait ses preuves.
Elle a été
confirmée à ce poste en novembre 2011, à l’issue du
huitième congrès de l’Association.
|
|
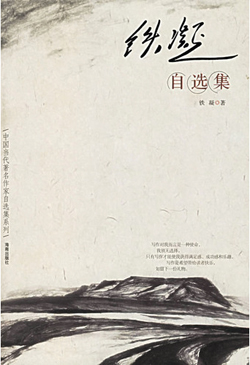
Recueil de nouvelles 2006 |
On peut néanmoins
regretter qu’elle ait été élue si jeune à une présidence aussi
lourde : sa créativité
s’en est trouvée
bridée. Ses prédécesseurs avaient été élus à un âge plus avancé
(Ba Jin à
quatre-vingts ans, Mao
Dun à cinquante-trois ans, mais dans des circonstances
politiques différentes). Tous deux avaient une œuvre importante
déjà derrière eux. Il est vrai que Tie Ning a commencé à écrire
très jeune, mais c’est dans les années 1990 qu’elle a vraiment
commencé à mûrir son style.
|
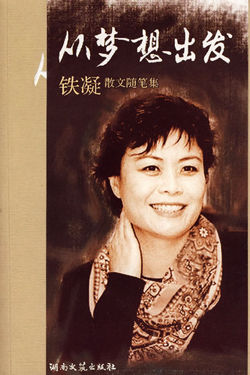
Recueil d’essais 2007 |
|
Sa position
officielle a non seulement limité son temps libre pour
l’écriture, mais l’a obligée à des compromis sur les
thèmes, le style et le ton de ses écrits. Elle continue
à publier à peu près une nouvelle par an qui fait
aussitôt partie de la sélection du recueil des
meilleures nouvelles de l’année. Mais elles restent
assez décevantes. La dernière en date, publiée en
septembre 2011, dans la revue littéraire de l’Association
des écrivains, justement, en est un exemple.
Son titre,
« Le distillateur volant » (《飞行酿酒师》),
peut être un clin d’œil à celui de sa toute première
nouvelle, « La faucille volante » (《会飞的镰刀》),
mais l’analogie s’arrête là.
Il s’agit d’une nouvelle « urbaine » satirique, qui se
moque de la nouvelle passion des Chinois aisés pour le
vin ; l’histoire est celle d’un soi-disant créateur d’un
vin chinois qui cherche un investisseur. On lit les sept
ou huit pages en appréciant quelques traits amusants,
mais en se |
demandant comment
cela va se terminer ; et la fin n’est pas à la hauteur d’une
nouvelle vraiment réussie (4).
Ses essais critiques et
réflexions « au fil de la plume » sont finalement ce qu’elle
écrit aujourd’hui de plus intéressant. Mais il ne faut pas
négliger pour autant le reste de son œuvre.
Tie Ning reste
l’écrivain de la ruralité chinoise et a toujours été une voix
très orthodoxe, Bonnie Mc Dougall parle même de son « orthodoxie
fondamentale » (5). Ce n’est pas un défaut rédhibitoire, il faut
juste le savoir pour ne pas chercher dans ses écrits ce qu’on ne
peut y trouver et se concentrer sur leurs qualités propres,
celles de la tradition littéraire chinoise la plus classique.
Un mot sur ses
nouvelles
Tie Ning est une
spécialiste de la nouvelle, c’est d’ailleurs un genre pour
lequel, dit-elle, elle a un « penchant quasiment monomaniaque »
(“近乎偏执的喜爱”).
On n’écrit
pas un roman comme on écrit une nouvelle, et, dans son cas, la
différence est nette :
“当我写作长篇小说时,我经常想到的两个字是‘命运’;当我写作中篇小说时,我经常想到的两个字是‘故事’…”
Quand j’écris un roman, je pense généralement "destin" ; quand j’écris
une nouvelle, je pense plutôt "histoire" …
Notes
(1) Comme il est dit
dans sa brève présentation dans le recueil de 1989 de la
collection Panda où a été publiée la traduction de « Ah, Neige
parfumée » : elle est partie « appréhender la campagne au lieu
d’entrer à
l’université ».
(2) L’attaque contre
l’adaptation cinématographique de sa nouvelle « Un douloureux
amour » (《苦恋》)
avait été le signal d’une campagne qui se poursuivit pendant
tout l’année 1982.
Voir :
Repères historiques, les années 1980.
(3) Il s’appelle « La
fille en rouge » (《红衣少女》) :
c’est un exemple des très bons films chinois des années 1980 qui
ont été éclipsés par la vogue de la cinquième génération.
Voir sur chinese movies : ….à venir…
(4)
On trouve le texte en ligne :
http://read.360buy.com/10915/523604.html
(5) The Literature
of China in the Twentieth Century, Bonnie S. McDougall-Kam
Louie, Columbia University Press, 1997, p. 419.
De manière
significative, Tie Ning ne figure pas dans le Petit précis à
l’usage de l’amateur de littérature chinoise contemporaine, de
Noël Dutrait (1976-2006), Philippe Picquier, 2ème
édition, 2006.
Traductions en
français
Ah, Neige Parfumée (《哦,香雪》),
in Les meilleures oeuvres chinoises 1949-1989, Littérature
chinoise, collection Panda, Pékin 1989, p. 267
Le corsage rouge (《没有纽扣的红衬衫》),
Editions en langues étrangères, janvier 1991
Fleur de coton (《棉花垛》),
traduit du chinois par Véronique Chevaleyre, Bleu de Chine,
janvier 2004
La douzième nuit (《第十二夜》),
traduit du chinois par Prune Cornet et Yan Liu, Bleu de Chine,
mars 2004*
A noter :
Un numéro spécial de
la revue Littérature chinoise, 4ème trimestre 1988 :
Tie Ning, Femme écrivain.
* Notes sur « La
douzième nuit »
Il s’agit d’un recueil
de cinq nouvelles qui sont parmi les meilleures de Tie Ning, et
parmi les plus
connues :
-
La
douzième nuit (《第十二夜》) ;
-
La
solitude [de Chang’E] (《寂寞嫦娥》) :
-
Le
sourire du papillon (《蝴蝶发笑》) ;
-
La soirée
d’Andrei (《安德烈的晚上》)
– traduit « Amitié, coton et raviolis »
-
Petit
Millet glutineux (《小黄米的故事》)
1. La douzième nuit
|
Divisée en sept
« nuits », cette nouvelle, écrite à la première
personne, a le petit côté satirique habituel chez Tie
Ning : satire des nouvelles mœurs citadines, de
l’affairisme paysan, de l’engouement pour la peinture
contemporaine chinoise… On sent une histoire vraie,
racontée à l’auteur ou plus ou moins autobiographique ;
c’est un drame de village synthétisé en quelques pages,
sur fond de coutumes, de non-dits, de
préjugés, et un superbe portrait d’une vieille femme, à
peine suggéré.
Première
nuit :
une jeune femme peintre arrive dans un village de
campagne à une petite heure de la ville où elle habite
parce qu’elle y a acheté une vieille maison. Le village
a déjà attiré quelques peintres, dont son ami Lao Qin a
été le précurseur :
用老秦的话说,农民正一步步挪下山来向城市靠拢,城里人却渴望一步步奔出城去要在山上占领一席之地。也算是当下的一种时髦吧。
Selon Lao
Qin, les paysans quittent la montagne
|
|

La douzième nuit |
pour se rapprocher peu à
peu de la ville tandis que de plus en plus de citadins meurent
d’envie de quitter la ville pour aller s’installer à la
campagne. C’est une sorte de mode, à l’heure actuelle.
Lao Qin est devenu
l’agent immobilier du village. Tout le monde sait que ces
transactions sont illégales car les paysans n’ont pas le droit
de vendre les terres, elles appartiennent à l’Etat, mais
personne ne veut rater une affaire. La narratrice a jeté son
dévolu sur une maison, le propriétaire a fait traîner la
négociation, mais Lao Qin a fini par emporter l’affaire pour
douze mille yuans.
Au moment de payer,
cependant, le propriétaire, Ma Laomo (马老末),
n’est pas là ; l’acheteuse passe la nuit chez Lao Qin en
attendant.
Deuxième nuit :
le lendemain matin, quand apparaît Ma Laomo, c’est pour annoncer
qu’on vient de lui offrir quinze mille yuans pour sa maison. Le
prix est finalement négocié à treize mille. Une fois la
transaction terminée et réglée, cependant :
当他把钱装进一只粗布小面口袋时,他说还有个事儿,他说他的大姑眼下还在那院里住着。
不过老太太七十好几,一直病着,已经活不了多大工夫了,她一死,我立刻就能搬进去。
Après avoir mis
l’argent dans un sac de farine en toile grossière, [Ma Luomo]
annonça qu’il y avait encore un problème : sa tante habitait
toujours la maison.
Mais elle avait plus
de soixante-dix ans, était malade depuis une éternité et n’en
avait plus pour très longtemps ; je pourrais emménager dès
qu’elle serait morte.
Voyant l’air désemparé
de ses interlocuteurs, Ma Laomo les emmène voir la vieille femme
pour qu’ils voient qu’il ne ment pas : elle est bien mourante.
La narratrice s’endort apaisée, en pensant aux toiles qu’elle va
bientôt pouvoir commencer de peindre dans sa nouvelle maison.
Troisième nuit :
le
lendemain, la narratrice va voir « sa » maison, et a la surprise
de trouver la vieille femme assise sur son kang, en train
de se peigner. « Bah, dernier sursaut de vie, » dit Ma Luomo.
Quatrième nuit :
Ce
matin-là, la vieille tante est fièrement assise sur les marches
devant la porte quand la narratrice arrive. Des jeunes du
village, élèves de Lao Qin, lui apprennent son histoire. La
vieille tante, dans sa jeunesse, était tombée amoureuse d’un
facteur d’orgue venu réparer celui du village ; elle était la
plus jolie fille du coin, Il repartit en la laissant enceinte ;
l’enfant ne vécut que trois jours, mais elle resta fidèle toute
sa vie sans se marier.
Pendant la guerre, elle
fabriqua comme les autres des chaussures pour les soldats de la
8ème Armée ; les siennes étaient les plus belles,
avec une croix brodée sur la semelle, pour porter chance, mais :
到了交鞋的时候,大姑也怀抱鞋包袱兴冲冲地去交军鞋,村妇救会主任举着大姑的鞋对在场的妇女们说:“咱们能让前方的战士穿‘破鞋’1做的鞋吗?咱们不能啊!”于是,新鞋被扔回到大姑怀里,从此她再也没有开口说过一句话。她在娘家度过了一生,她本是那院子真正的房主。
1.
破鞋
pòxié
chaussure abîmée, usée – au sens figuré : femme dépravée,
dévergondée
Quand arriva le
moment de remettre les chaussures, la tante s’en fut, toute
joyeuse, un gros paquet dans les bras, apporter les siennes ;
mais la responsable du Comité de sauvegarde nationale des femmes
du village brandit l’une des chaussures de la tante devant les
femmes réunies là en leur disant : « Pouvons-nous permettre que
nos combattants, sur le front, portent des chaussures fabriqués
par une dévergondée ? Non, ce n’est pas possible. » La femme lui
avait remis son paquet de chaussures dans les bras, et la tante
n’avait plus jamais ouvert la bouche. Elle avait passé le reste
de sa vie dans la maison de ses parents, en devenant ainsi la
véritable propriétaire.
Sur ces entrefaites, la
narratrice doit s’absenter quelques jours, mais le drame entrevu
dans le passé de la tante a changé sa perception des choses.
Dixième nuit :
quand la
narratrice revient, elle apprend que la tante s’est remise à
coudre des chaussures, en continuant de broder des étoiles sur
les semelles.
Onzième nuit :
la
narratrice tente d’annuler la transaction et de récupérer son
argent, mais il a déjà été investi, dans une mine de fer.
Douzième nuit :
la
narratrice va voir la vieille femme pour lui dire qu’elle ne
veut plus de la maison,
qu’elle préfère la voir
en bonne santé, au milieu de ses arbres superbes. La tante
continue de piquer ses semelles sans broncher… et meurt quelques
instants plus tard. Le sort de la maison reste irrésolu…
Texte chinois :
www.shuku.net:8080/novels/tiening/tiening03.html
2. La solitude de
Chang’E
Voilà un autre superbe
portrait de femme et un autre clin d’œil ironique sur la société
chinoise. Chang’E (《嫦娥》) est
une jeune paysanne devenue veuve un an après son mariage, et
restée avec un
|
enfant à élever. Elle
part travailler en ville chez un écrivain qui finit par
l’épouser, attirée par sa robuste santé et son teint
épanoui. Rejetée par la famille et par l’entourage de
l’écrivain sans
que cela semble trop la perturber, elle fait la
connaissance d’un vendeur de fleurs, divorce et se
remarie avec lui ; ils fondent ensemble une pépinière
florissante sur un terrain initialement destiné à la
construction d’un musée… La solide personnalité de
Chang’E finit par s’imposer.
Texte chinois :
www.shuku.net:8080/novels/tiening/tiening15.html
3. Le
sourire du papillon
Cette nouvelle
a été publiée en Chine en 1999 dans un
recueil
bilingue : « Selected Stories by Tie Ning », mais elle
reste
assez rare dans les recueils de l’auteur. Tie Ning y
fait, pour une fois, le portrait d’un homme, d’un
tempérament poète, excentrique et un peu fou, condamné
dans une société où la norme ne permet guère de
fantaisie. |
|

Selected stories of Tie Ning
(bilingue anglais-chinois) |
4. La soirée
d’Andrei
|
Cette nouvelle
est l’une des plus célèbres de Tie Ning. Le personnage
principal est un ancien ouvrier d’une conserverie qui
réussit brillamment sa reconversion au moment de
« l’ouverture », quand sa vieille usine de conserves est
condamnée à fermer ses portes. C’était une vieille usine
« offerte » par les Soviétiques du bon temps de l’amitié
avec le grand frère, l’usine, mais aussi tout le
quartier autour, et jusqu’au nom d’Andrei – en quelques
lignes, Tie Ning dresse le tableau d’une époque, le
début des années 1950 :
安德烈1姓安,名叫德烈。安德烈的出生年月大概是1954年3月左右。安德烈这名字是父亲为他所起,名字本身也是当年中苏友好的一种体现。安德烈的父母就是响应政府的号召,由上海搬入这里支援城市建设的,他们都是中学教师。父亲穿过苏联印花布衬衫,母亲也穿过苏式“布拉吉”1。当年他们都向往过苏联老大哥的美妙生活,他们也希冀着小安德烈长大之后能够去苏联留学。
1. 安德烈
Āndéliè
et
布拉吉
Bùlājí
sont des
|
|
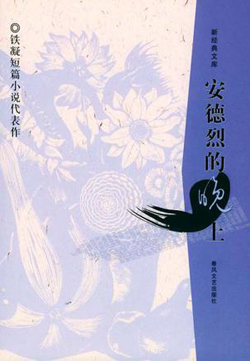
La soirée d’Andrei |
transcriptions
phonétiques de termes russes, le premier du prénom Andrei (Андрей)
et le second de plat’ie (платье),
robe traditionnelle à petites manches, en tissu imprimé très
coloré.
Andrei, nom An,
prénom Delie, né en 1954, vers le mois de mars. Si son père lui
avait donné ce nom, c’était en une sorte d’hommage à l’amitié
sino-soviétique de l’époque*. Tous deux professeurs de collège,
ses parents avaient répondu à l’appel du gouvernement et
déménagé de Shanghai pour venir là aider au développement de la
ville. Tous deux étaient habillés à la mode soviétique, son père
portant des chemises en tissu imprimé, et sa mère des robes
dites
« plat’ie ». Ils
aspiraient alors à mener la vie merveilleuse du grand frère
soviétique, et espéraient pourvoir envoyer un jour le petit
Andrei étudier là-bas.
* le traité d’amitié ou pacte sino-soviétique a été signé en février
1950 ; malgré les frictions,
l’amitié entre les deux peuples a été renforcée par la visite de
Krouchtchev, en 1954, justement.
Andrei était un fort en
récitation, en classe, mais sa vie est réduite au travail à
l’usine, avec de lourdes responsabilités familiales, sa femme
étant cardiaque et sa petite fille également affectée d’une
cardiopathie. La seule personne dont il se sente proche est son
inséparable ami d’enfance, Li Jingang (李金刚).
A l’usine même, son
monde est restreint à l’ouvrière qui travaille en face de lui, à
la chaîne, Yao Xiufen (姚秀芬).
Au fil des ans, ils ont fini par tout savoir l’un de l’autre,
mais leur relation s’arrête là. Jusqu’au jour où, l’usine devant
fermer, et au moment de quitter les lieux, premier ouvrier à se
« reconvertir », Andrei ait un pincement au cœur à l’idée de ne
plus jamais la revoir. Li Jingang est encore là pour lui donner
les clés de son appartement, et lui fournir trois heures
d’intimité.
Mais, arrivant avec
Xiufen, Andrei, brusquement troublé, ne retrouvera jamais la
porte ; ils seront réduits à manger dehors, dans la nuit, les
raviolis que Xiufen avait apportés dans une vieille gamelle…
Promu chroniqueur dans la station de radio locale, il gardera le
souvenir de cette soirée qui aurait pu être et n’avait jamais
été :
他骑上车往家走,车把前的车筐里摆着姚秀芬那只边角坑洼的旧铝饭盒1。安德
烈准备继续用它装以后的午饭。他觉得生活里若是再没了这只旧饭盒,或许他就被
这个城市彻底抛弃了。
1. 铝饭盒
lǚfànhé gamelle en
aluminium 坑洼
kēngwā
trou (dans une route,
etc…)
2. 抛弃
pāoqì
abandonner
Il enfourcha son
vélo pour rentrer chez lui, avec, dans le panier à l’avant, la
vieille gamelle en aluminium aux coins cabossés de Yao Xiufen.
Andrei avait décidé de la garder pour transporter son déjeuner.
Il pensait que, sans cette vieille gamelle, il se serait senti
complètement abandonné dans cette ville.
Texte chinois :
www.shuku.net:8080/novels/tiening/tiening14.html
5. Petit millet
glutineux
Petit Millet glutineux
est le nom d’une jeune fille de dix-sept ans qui monnaye ses
charmes aux clients d’un petit restaurant, sur le bord d’une
route. Passe un photographe qui cherche des modèles plus
naturels que ceux qu’il trouve en ville. Il ne se passe rien :
il repart en ayant gâché sa pellicule et Petit Millet a raté son
coup…
Texte chinois
:
www.shuku.net:8080/novels/tiening/tiening12.html
A lire en complément
Une nouvelle de 2005 :
« Au pied de l’arbre » (《树下》)
|
|

