|
|
Yang Mo 杨沫
1914-1995
Présentation
par Brigitte Duzan, 25
décembre 2010, dernière
révision 23 octobre 2014
|
Si Yang Mo (杨沫1914-1995)
a marqué la littérature chinoise des années 1950 d’une
encre indélébile, on a du mal à imaginer aujourd’hui la
gloire qu’elle connut à partir de 1958, lorsque fut
publié son roman « Le chant de
la jeunesse »
(《青春之歌》),
et surtout lorsque celui-ci fut adapté au cinéma l’année
suivante. C’était
le premier
roman chinois à décrire un mouvement d’étudiants
patriotes et d’intellectuels révolutionnaires sous la
direction du Parti communiste.
Ce roman, comme les nouvelles qui l’ont précédé, tout en
restant globalement conforme aux critères stylistiques
fixés par Mao dans les
|
|

Yang Mo adulte |
« Causeries
sur
la littérature
et
les arts
à Yan’an », en 1942,
représente
un précurseur d’une tendance littéraire que Mao formulera en un
nouveau slogan au troisième Congrès national des travailleurs
des lettres et des
arts,
en
1960, appelant à remplacer le « socialisme réaliste » par « une
combinaison de réalisme révolutionnaire et de romantisme
révolutionnaire » (1).
|
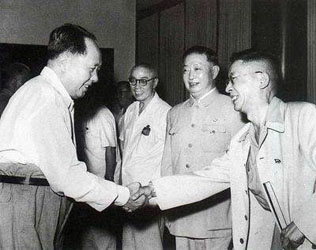
3ème congrès national des lettres et des
arts |
|
Yang Mo en est devenue le fer de lance, se posant en
héritière de Ba Jin dans la description des vies
turbulentes des jeunes révolutionnaires chinois au cours
de la période où elle-même a partagé leurs idéaux et
leurs combats : de 1931 à l’avènement de la République
populaire. C’est son thème de prédilection.
Il est significatif que son œuvre ait connu un bref
regain d’intérêt à la fin des années 1970, mais surtout
au début des années
1980, alors que les écrivains chinois en revenaient aux
succès oubliés des quinze premières années |
de la République comme base
du renouveau littéraire de ces années-là (2). « Le chant de la
jeunesse » est même explicitement cité au début de la nouvelle
de
Lu
Xinhua
qui marque le début de
la « littérature des cicatrices »,
« La cicatrice »
(《伤痕》).
Dans le climat de
reconstruction spirituelle et morale de l’époque,
« Le chant de la jeunesse » évoquait une période quasiment
mythique, où les idéaux révolutionnaires avaient encore toute
leur pureté et leur ferveur.
Enfance solitaire et morne adolescence
Yang Mo est née en août
1914 à Pékin, dans une famille de fonctionnaires originaire du
Hunan.
|
Elle s’appelait
en réalité Yang Chengye (杨成业)
mais a utilisé divers noms de plume, comme autant de
mues successives à la recherche d’une identité : Yáng Jūnmò
(杨君茉), le ‘jasmin blanc du seigneur’, mais, parce que trop « parfumé » à son
goût, bientôt changé en
杨君默,
ce caractère
mò
(silencieux) étant plutôt à prendre ici au sens
dérivé de ‘écrire de mémoire’, ce premier pseudonyme
étant finalement simplifié en Yáng Mò :
杨默 puis
杨沫
,
mò
pour l’écume, comme
l’écume des jours chère à Boris Vian, emblème dans l’un
comme l’autre cas d’une œuvre « vraie puisque
imaginée ».
La famille de
Yang Mo était certainement un environnement favorable à
l’éclosion de talents artistiques. Son père était un
intellectuel qui avait créé une université privée. Sa
troisième sœur, Yang Chengyun (杨成芸),
née en 1920, |
|
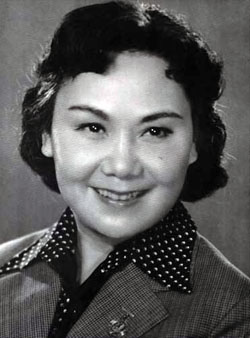
Bai Yang |
devint
une actrice célèbre, de théâtre, d’opéra mais aussi de cinéma,
qui tourna une vingtaine de films avec la société Lianhua (联华公司)
sous le nom de Bai Yang (白杨).
Malheureusement, les
parents ne s’entendaient pas, et le climat familial était
totalement dénué de chaleur et d’affection. Yang Mo a grandi
dans une atmosphère délétère qui forçait l’enfant solitaire à se
réfugier, pour tout lot de consolation, dans la lecture et la
musique, et en particulier le kunqu (昆曲), qui est à l’opéra de Pékin ce que Puccini est au Cirque du Soleil : un
raffinement subtil.
|

Yang Mo enfant |
|
En 1928, à quatorze ans, alors qu’il ne lui restait plus
qu’un an pour terminer ses études secondaires, elle
préféra éviter les scènes du foyer familial en se
réfugiant dans un lycée de filles du côté des Collines
de l’Ouest, dans la banlieue de Pékin (西山温泉女子中学).
Ses devoirs de classe expédiés, il lui restait encore du
temps pour lire : elle se plongea à corps perdu dans les
œuvres chinoises récentes, représentant l’émergence
d’une nouvelle littérature chinoise après 1919, et dans
celles des grands auteurs européens et japonais du 18ème
et 19ème siècle. C’est à cette époque que
naquit son amour de la littérature.
En 1931, son père fit faillite ; il partit sans laisser
d’adresse et la famille se désintégra. Sa mère fit
revenir Yang Mo à Pékin ; à seize ans, elle se trouva
prise au piège
d’un |
mariage arrangé
avec un officier du Guomingdang. Elle s’enfuit, revint au lycée
des Collines de l’Ouest puis fugua à Beidahe, sur quoi sa mère
lui coupa les vivres. Elle fit alors la connaissance d’un jeune
étudiant en littérature chinoise du nom de Zhang Xuan (张玄)
qui s’apitoya sur son sort. Comme elle était obligée de gagner
sa vie, il lui obtint un poste d’institutrice à Xianghe, dans le
Hebei (河北香河) ;
rappelée par sa mère malade, elle revint cependant à Pékin en
novembre 1932, et alla vivre avec lui. Mais elle était souvent
en proie à des crises de dépression.
Initiation au marxisme et engagement révolutionnaire
|
La fin de l’année 1932 lui apporta une occasion
inespérée d’apercevoir enfin le bout du tunnel. Invitée
pour la soirée du Nouvel An chez sa sœur Bai Yang, elle
s’y retrouva au milieu d’un groupe de jeunes étudiants
que l’occupation japonaise avait chassés du Dongbei
après l’incident de Mukden, ou incident du 18 septembre
[1931] (“九·一八”事变).
Il y avait quelques membres du Parti communiste, mais
c’étaient en majorité des membres d’organisations
satellites du Parti (共产党外围组织“剧联”成员).
|
|

Shenyang occupée fin septembre 1931 |
L’idéalisme de ces étudiants viscéralement patriotes la secoua
profondément. Elle affirmera plus tard :
“听到他们对于国内国际大事的精辟分析,使我这个正在寻求真理,徘徊歧途的青年猛醒过来——啊,
人生并不都是黑暗的,生活并不都是死水一潭!原来,中国共产党人为了拯救危亡的祖国,为了一个
美好的社会的诞生正在浴血奋战!”(《青春是美好的》)
« En entendant leurs
analyses pénétrantes de la situation politique tant
intérieure qu’extérieure, j’eus un soudain
sursaut de conscience, réalisant
que, dans ma recherche de la vérité et mes
hésitations sur la voie à suivre
– ah, tout n’était pas sombre, que la vie
n’était pas seulement une immense
étendue d’eau stagnante ! Ainsi, pour
sauver la nation en péril, pour créer
une société radieuse, les militants du Parti
communiste chinois s’apprêtaient
à se battre et sacrifier leur vie ! » (« La
jeunesse est belle »)
|

Livre de Song Zhide (« Les envahisseurs »
《打击侵略者》) |
|
Cette soirée
fut un tournant déterminant dans sa vie, et elle l’a
repris sous une forme idéalisée pour en faire un passage
fondamental de son roman « Le chant de la jeunesse »
(《青春之歌》),
par ailleurs largement autobiographique. C’est à partir
de cette soirée que les jeunes étudiants qu’elle y avait
rencontrés, et en particulier l’écrivain Song Zhide (宋之的),
l’initièrent au marxisme-léninisme, lui insufflèrent
leur ferveur révolutionnaire, leur patriotisme
anti-japonais et leur mépris du Guomingdang. Outre les
livres de théorie, elle lut aussi
|
beaucoup de romans soviétiques en
vogue à l’époque, dont « La mère » de Gorki, qui la marqua
profondément.
|
Elle supportait
de plus en plus mal la dépendance qui était la sienne
dans son ménage, et tenta de se libérer de ces liens en
cherchant du travail. De 1932 à 1936, elle occupa ainsi
plusieurs postes d’institutrice dans des écoles
primaires, de tuteur privé chez des particuliers et même
de vendeuse dans une librairie. En même temps, elle
suivait des cours à
l’université de
Pékin. Elle alla même visiter en prison des membres du
Parti qui avaient été arrêtés et leur rendit divers
services.
Premiers pas d’écrivain
Le 15 mars 1934
paraît sa première œuvre, dans la revue
bi-mensuelle
‘Noir et Blanc’ (《黑白》)
éditée par des réfugiés du Dongbei : un essai intitulé
« Esquisse
de la vie des habitants de la région montagneuse au sud
de la province de Rehe » (《热南山地居民生活
素描》) ; elle y expose en
particulier la réalité des exactions commises à l’égard
de la population paysanne par |
|

« La mère » de Gorki, édition chinoise
|
les propriétaires terriens
de cette province qui s’étendait alors sur une partie des
provinces actuelles du Hebei, du Liaoning et de Mongolie
intérieure.
Recoupant des souvenirs
d’enfance, l’essai témoigne de sa nouvelle conscience de classe,
nimbée de
chaleur humaine. Elle
utilise alors le nom de plume Xiao Hui (“小慧”)
pour publier, dans
diverses revues, des essais, reportages et nouvelles. L’une
d’une série de quatre nouvelles, publiées en 1937, s’intitule
« Vagues de colère » (《怒涛》) :
elle y décrit l’histoire d’une jeune étudiante nommée Meizhen (美真)
qui ne peut se satisfaire de l’amour de son mari et de ses
enfants, et abandonne la chaleur de son foyer pour aller lutter
et se sacrifier pour le bonheur du peuple, sur fond de
résistance des jeunes intellectuels chinois à l’envahisseur
japonais.
La
nouvelle a un côté autobiographique, et son héroïne annonce et
préfigure, en une sorte de modèle miniature, le personnage
principal du roman
« Le chant de la
jeunesse » publié près de vingt ans plus tard.
La guerre et après
En 1936, Yang Mo devint
membre du Parti communiste.
Activités pendant la
guerre
|
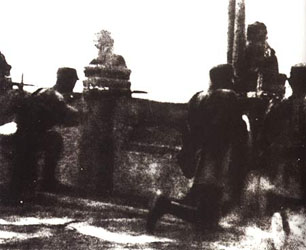
La défense du pont Marco Polo par les
soldats chinois |
|
Quand commença
la guerre de résistance contre le Japon, le 7 juillet
1937, après l’incident du pont Marco Polo (卢沟桥事变),
encore appelé « incident du 7.7 » (七七事变),
Yang Mo partit dans la région frontalière
Shanxi-Chahar-Hebei (晋察冀 Jìn-Chá-Jì) où elle devint directrice de l’Association des femmes pour la
sauvegarde nationale (妇救会)du
district
d’Anguo (安国),
dans le Hebei, et directrice du bureau d’information de
la même association pour la zone du centre du Hebei (3).
En 1942, elle
devint rédactrice du Quotidien de la
Lumière de l’Aube (《黎明报》),
du Quotidien
|
de la
région
Shanxi-Chahar-Hebei (《晋察冀日报》)
et du Quotidien du Peuple (《人民日报》)
de la région, en charge également des suppléments de ces
quotidiens.
En mai 1949, elle fut
nommée chef du service d’information de la Fédération des femmes
de Pékin (北京市妇联宣传部副部长),
mais, en 1952, pour raisons de santé, fut mutée au bureau des
scénarios du Bureau central de l’administration
cinématographique, continuant là son activité de rédactrice.
En 1950,
elle publia la nouvelle ‘de taille moyenne’ « Chronique du Lac
aux Ajoncs » (《苇塘纪事》)
qui est un témoignage dans un style très réaliste, conforme aux
prescriptions des « causeries de Yan’an », sur la Guerre de
Résistance contre le Japon. Elle y décrit la campagne
d’encerclement menée par les Japonais contre la Huitième Armée
dans la région du lac Weitang (ou lac aux ajoncs) dans la région
de Suzhou : le groupe de guérilla local, sous la conduite du
secrétaire du Parti du village, sert d’appât aux Japonais pour
que l’armée puisse lancer une contre-offensive.
Le Chant de la
jeunesse
|
C’est en 1958
que fut publié son roman
“Le
chant de la jeunesse ” (《青春之歌》),
qui, tiré à cinq millions d’exemplaires, devint l’un des
plus gros succès de librairie de la Chine nouvelle. En
septembre 1959 sortait une adaptation cinématographique
éponyme, tournée pour le dixième anniversaire de la
fondation de la République, qui devint à son tour l’un
des grands classiques du cinéma de la période et
paracheva la célébrité de Yang Mo et la carrière du
roman.
On
a peine à imaginer l’influence qu’a exercée ce roman et
l’aura qu’il a longtemps conservée. Au début des années
1950, il était en phase avec les sentiments des Chinois
qui avaient vécu les événements difficiles des années
1930 et 1940, et en gardaient un souvenir très vivant ;
l’idéalisme révolutionnaire appelant à l’autosacrifice,
dépeint en termes passionnés dans le roman, répondait au
leur ; c’était une adhésion spontanée et vibrante. Il
faudra la |
|
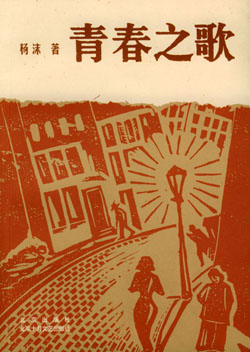
“Le chant de la jeunesse
”
(《青春之歌》) |
campagne
contre les droitiers en 1957, puis les absurdités du Grand Bond
en avant et la famine résultante, pour que cet idéalisme
enthousiaste soit remis en question.
Les deux
romans généralement considérés comme les plus populaires dans
les années 1950 et au début des années 1960 sont « Red Crag » (《红岩》)
de Luo Guangbin (罗广斌)
et Yang Yiyan (杨益言),
sorti en 1961, et « Le Chant de la jeunesse » (4). Ce dernier
roman n’arrive qu’en quatrième position parmi les tirages de la
période des « 19 années », mais il a continué à avoir une
popularité et une influence bien plus longtemps que les autres.
Il
circulait sous le manteau pendant la Révolution culturelle,
alors même que Yang Mo était sérieusement dénoncée, et il
retrouva une nouvelle vie lorsqu’il fut réédité, après la
Révolution culturelle, au début de la période d’ouverture, avec
nombre d’autres œuvres du réalisme socialiste des années
1949-1966. Les autorités chinoises soutenaient ces rééditions,
car elles voulaient faire renaître l’esprit d’adhésion spontanée
aux idéaux du régime que dépeignent ces romans. Les tirages au
début des années 1980 sont frappants : « Le Chant de la
jeunesse » vient en seconde position, avec « Le Voyage en
Occident » (derrière un recueil de pièces de Shakespeare !).
(5) En 1980, une enquête auprès d’étudiants à Canton révéla
qu’il était leur roman favori. En 1983, aux termes d’une enquête
auprès d’étudiants universitaires à Pékin, il est arrivé en 3ème
position d’une sélection de 55 célèbres œuvres mondiales.
Sa
popularité et son impact pendant les années 1980 tiennent d’une
nostalgie du passé embaumée dans des souvenirs de jeunesse. On
en a des témoignages dans la littérature.
Outre le cas de
Lu
Xinhua déjà mentionné, c’est celui, par exemple, de
Liu
Xinwu (刘心武)
qui cite le roman parmi les œuvres retenues dans sa nouvelle
« Le professeur principal ». Il souligne dans ses
Mémoires
l’influence qu’a exercée le roman sur lui : c’est l’un des
romans cités parmi ceux des « 19 années » qui l’ont le plus
influencé (6).
Et
après…
Yang Mo
publia par la suite une série d’autres romans qui portent le
titre « Chant de… » (《…之歌》),
mais dont aucun n’a l’attrait fascinant du premier. Un recueil
de nouvelles sortit en 1964 : « L’étoile du matin rouge » (《红红的山丹花》).
Elle est l’un des rares écrivains qui ait publié de la fiction
pendant la Révolution culturelle. Elle refit en effet surface en
1972 en publiant « Aurore à l’Est » (《东方欲晓》) :
un récit des luttes internes dans le Parti et une description
des changements d’allégeance des intellectuels pendant la guerre
de Résistance. La nouvelle fut rééditée dans une version révisée
en 1979.
Une suite au roman « Le
chant de la jeunesse » parut encore en 1985, mais sans susciter
d’intérêt. Ses œuvres complètes sont
désormais publiées en sept volumes, comprenant nouvelles et
romans, essais et textes divers.
Elle est
décédée, de maladie, à Pékin, le 11 décembre 1995.
Eléments autobiographiques dans son œuvre
On ne peut
cependant en rester là pour comprendre Yang Mo. Sa vie privée et
affective ne doit pas être négligée, car elle a une incidence
sur le ‘décodage’ de son œuvre en général, et de son premier
roman en particulier. A partir de sa première nouvelle,
en 1934, elle n’a fait, grosso modo, que se raconter et se
mettre en scène, sous une forme ou une autre.
Marquée comme au fer rouge, dans son enfance, par la désunion de
ses parents et le manque d’amour maternel, c’était un personnage
complexe, légèrement névrosé. Elle ne supportait pas le bruit et
les pleurs, et c’est l’une des raisons pour lesquelles elle
laissa ses quatre enfants (survivants, le premier étant mort à
l’âge d’un an) à la charge de nourrices successives. C’était
aussi la condition nécessaire à la préservation de sa liberté,
liberté de femme moderne dans une Chine en train de s’émanciper
du ‘féodalisme’.
|
Son caractère libertaire et passionné se retrouve dans
celui de nombre de ses héroïnes, mais les deux hommes
qu’elle a connus et aimés sont aussi les modèles, entre
autres, des deux héros de son roman « Le chant de la
jeunesse ».
Zhang Zhongxing
Le
premier homme dans sa vie s’appelait Zhang Xuan
(张玄),
mais est plus connu sous le nom de Zhang Zhongxing
(张中行).
Né en
1909, c’était un personnage de la « vieille Chine »,
comme on dit de la vieille école. Il avait été marié à
l’âge de trois ans à une fillette du même village qu’il
épousa ensuite en 1926, à l’âge de dix-sept ans, et avec
laquelle il
finira ses
jours : épouse |
|
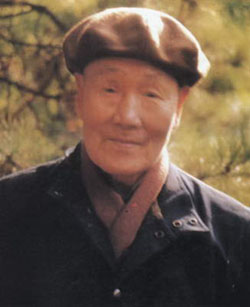
Zhang Zhongxing (张中行) |
effacée dans
la grande tradition confucéenne, qui ne lui reprochera jamais son affaire
avec Yang Mo.
Il connut celle-ci
alors qu’elle avait dix-sept ans et venait de fuir le mariage
arrangé par sa mère. Il l’a décrite ainsi :
“她17岁,中等身材,不胖而偏于丰满,眼睛明亮有神。言谈举止都清爽,有理想,不世俗,像是也富于感情。”(张中行《流年碎影》)
Elle
avait 17 ans, était de taille moyenne, pas vraiment grosse mais
bien ronde, avec des yeux brillants et expressifs. Sa façon de
parler, de se comporter, tout chez elle était d’une paisible
fraîcheur, d’un idéalisme hors du commun, et elle donnait
l’impression d’une grande émotivité.
(Zhang Zhongxing,
« Ombres brisées du temps passé »)
On n’a pas l’impression
de quelqu’un de follement amoureux, on sent plutôt un ton
légèrement protecteur. Il commença par lui trouver, grâce à son
frère, un poste d’enseignante à Xianghe (香河),
dans le Hebei, d’où il était originaire ; elle débuta au début
de septembre 1931. Mais ils s’étaient vus plusieurs fois avant
qu’elle parte, et ils continuèrent une liaison épistolaire. Au
bout de deux mois, cependant, la mère de Yang Mo tomba malade,
et elle envoya quelqu’un demander à sa fille de revenir à Pékin.
Lorsque Yang Mo revint,
sa mère était déjà gravement malade et alitée. Comme elle
s’était fâchée avec son mari et son frère, elle était seule avec
les deux petites sœurs de Yang Mo. Celle-ci, cependant, toute à
sa passion pour Zhang Zhongxing, alla
vivre avec lui, au comble du bonheur, sans s’occuper de sa mère.
Mais elle
tomba vite enceinte, ce qui n’eut pas l’heur de plaire à Zhang
Zhongxing. Il s’en est expliqué un jour à la fille aînée de Yang
Mo, Xuran (徐然) :
“你妈只看表面,不是我负心冷淡,当时生活艰难,加上她怀孕,就更困难,心情沉重,你妈就以为我冷淡她……”
Ta mère
s’en est tenue aux apparences, je n’ai pas été froid ou sans
cœur, simplement, à
l’époque, la vie n’était pas facile, avec
elle enceinte, c’était encore plus difficile, alors j’avais le
cœur lourd, et ta mère a pris cela pour de la froideur…
Quoi qu’il
en soit, leur relation commença à se détériorer. Lorsque la mère
de Yang Mo mourut fin 1931, faute d’argent pour la procession
funèbre, son cercueil resta près de deux mois dans sa chambre
avant que l’argent des funérailles ait été rassemblé, grâce à un
oncle qui vendit des terres…
Quant à
Yang Mo, elle alla accoucher seule, l’été 1932, chez la nourrice
de sa sœur Bai Yang, dans le village de Xiaotangshan (小汤山),
dans la banlieue nord de Pékin.
Mais elle
dut en partir précipitamment douze jours plus tard, pour fuir
une épidémie de choléra qui s’y était déclarée, emportant son
bébé dans une charrette tirée par un âne. Elle laissa l’enfant à
une nourrice qu’elle paya de ses propres deniers sans rien
demander à
Zhang
Zhongxing.
Celui-ci
eut cependant des remords et revint vivre avec elle. Ils étaient
extrêmement pauvres, mais Zhang Zhongxing lui écrivait des
poèmes, et lui donnait le sentiment d’une vie intellectuelle
raffinée qui compensait les déficiences de la vie matérielle.
Yang Mo savourait le plaisir de cette chaleur partagée qui lui
faisait oublier la carence affective dont elle avait souffert
toute son enfance.
Quand
elle mourut, il refusa d’assister à ses obsèques, mais c’est lui
qui lui a quand même rendu le plus bel hommage, lorsqu’il la
défendit pendant la Révolution culturelle :
“她直爽,热情,有济世救民的理想,并且有求其实现的魄力。”
Elle
était droite et passionnée, avait pour idéal de secourir le
peuple et sauver le monde, et le courage de le réaliser.
Ma Jianmin
|

Yang
Mo et son
époux Ma Jianmin |
|
Le
deuxième homme fut
son époux Ma Jianmin (马建民).
Originaire, lui aussi, d’un village du Hebei, son
parcours fut totalement différent. Né en 1911, il
s’engagea dès quinze ans dans les forces
révolutionnaires, en 1927, se joignit aux jeunesses
communistes, et, en 1930, devint membre du Parti.
C’était un authentique révolutionnaire et leader
étudiant, aux antipodes du poète épris de tradition
qu’était Zhang Zhongxing.
Après 1949, il occupa
|
diverses
fonctions officielles dans
l’enseignement et la recherche historique.
Il
accompagna Yang Mo dans la deuxième partie de son existence,
après la réunion du Nouvel An 1932 chez sa sœur, qui détermina
son engagement révolutionnaire.
L’un l’avait sauvée de
la solitude et du désespoir, l’autre la conduisit sur les
sentiers de la révolution, et l’accompagna dans sa
quête idéaliste d’une société meilleure. Il mourut dix ans avant
elle, en 1985, au moment où ses œuvres avaient été brièvement
remises à l’honneur. Mais une autre époque avait commencé, une
époque de progrès matériel où l’idéal révolutionnaire n’était
plus de mise, sauf dans quelques esprits perdus dans le siècle
et leurs souvenirs…
Notes
(1) Voir Repères
historiques 1937-1965 (chapitres en préparation)
(2) Voir Repères
historiques (La littérature
chinoise après 1979 : I. Les années
1980 : renaissance)
(3)
晋Jìn :
le Shanxi -
察
Chá
le Chahar
(察哈尔),
couvrant trois anciennes subdivisions administratives de
Mongolie intérieure -
冀Jì
le Hebei.
(4) D’après The
Uses of Literature, Life in the Socialist Chinese Literary
System, Perry Link, Princeton University Press, 2000, p. 250.
(5) Id, p. 170.
(6) Liu Xinwu, Je suis
né un 4 juin, traduit du chinois par Roger Darrobers,
Gallimard/Bleu de Chine, 2013, pp 288-89.
On trouve peu de choses
sur Yang Mo en français, et même en anglais :
- une référence dans le
Que sais-je de Paul Bady sur « La littérature chinoise moderne »
(1993), p. 87.
- une entrée dans le
« Dictionnaire de littérature chinoise » d’André Lévy, PUF,
novembre 2000, p. 366.
- une notice
biographique dans « The Literature of China in the 20th
Century », de Bonnie S McDougall et Kam Louie, Columbia
University Press, 1997, pp 243-245 (la moitié consacrée à “Song
of Youth”).
A ma connaissance,
aucune de ses œuvres n’a été traduite.
A lire en
complément :
« Le
chant de la jeunesse »
(《青春之歌》) : le
roman et l’adaptation cinématographique.
|
|

