|
|
Mei Niang
梅娘
1920-2013
Présentation
par
Brigitte Duzan, 6 mai 2019, actualisé 7 août 2023
|
Qui connaît Mei Niang aujourd’hui ? Pourtant, à
l’apogée de sa carrière, dans les années 1940, elle
était aussi célèbre que
Zhang Ailing (张爱玲).
En 1942, lors d’un sondage réalisé auprès de
lecteurs à Pékin et à Shanghai, à la question
« quelle est votre auteure préférée ? », les
réponses les avaient données toutes les deux à
égalité dans le cœur des lecteurs. Dès lors on a
dit : « [Il y a] Ling au sud et Mei au Nord » (“南玲北梅”),
car, si Zhang Ailing régnait sur Shanghai, Mei Niang
dominait dans le Nord-Est.
Mais elle a ensuite été accusée de trahison car elle
fait partie des écrivains qui ont fait carrière et
sont devenus célèbres dans le nord-est de la Chine
sous l’occupation japonaise, soit entre 1931 et
1945. Il aura fallu près de cinquante ans après la
fin de la guerre pour que Mei Niang sorte de l’oubli
auquel elle avait été condamnée. Ce n’est |
|

Mei Niang jeune |
qu’en 1997 que l’on
trouve son nom dans un classement des cent meilleurs auteurs
chinois modernes.
Entre Chine et Japon
Mei Niang est née en décembre 1920 à Vladivostock, mais a grandi
à Changchun, dans une certaine aisance contrairement aux autres
écrivaines chinoises de la même époque en Mandchourie, ce qui ne
veut pas dire pour autant une vie heureuse et sans soucis. Son
père, Sun Zhiyuan (孙志远),
était un brillant homme d’affaires du nord-est de la Chine qui
parlait le chinois, le russe et l’anglais ; elle-même s’appelait
Sun Jiarui (孙嘉瑞).
Mais sa mère n’était qu’une concubine, que son père a renvoyée
en l’acculant au suicide quand Jiarui n’avait que deux ans. Elle
est restée aux soins de la première épouse qui ne la portait pas
dans son cœur. Plus tard, elle a adopté le pseudonyme de Mei
Niang (梅娘),
homophone de Mei Niang (没娘),
c’est-à-dire « qui n’a pas de mère ».
Après l’incident de Mukden, que les Chinois appellent « Incident
du 18 septembre » (九一八事变),
en 1931, les Japonais envahissent la Mandchourie et, en mars
1932, établissent l’Etat fantoche du Manchukuo. Les Japonais
invitent alors Sun Zhiyuan à devenir ministre du nouvel Etat et
vice-président de la Banque centrale. Il refuse et déménage avec
sa famille dans le nord de la Chine. Mais il se heurte là à
l’interdiction de transfert et de conversion de la monnaie du
Manchukuo, ce qui a un impact drastique sur ses finances et
l’oblige à revenir à Changchun au bout d’un an. Ayant perdu tous
ses biens, il gagne misérablement sa vie et meurt en 1936.
Un de ses amis persuade alors la famille d’envoyer Mei Niang
étudier au Japon. C’est ainsi que l’adolescente va étudier le
japonais dans une école fondée par un sinophile, opposé à
l’invasion de la Chine. Mei Niang a raconté qu’il lui disait que
l’invasion de la Mandchourie était comme voler des offrandes au
Bouddha pendant son sommeil. Elle pensait pouvoir faire ensuite
des études de médecine, mais elle ne put en fait que terminer le
secondaire.
Au cours de ces deux ans au Japon, en 1940 et 1941, elle
améliore ses connaissances de la langue japonaise qui lui
permettent de traduire des ouvrages féministes japonais. Par
ailleurs, émue par la pauvreté du peuple, elle refuse de
condamner la nation japonaise dans son ensemble. Elle tire un
autre profit de son séjour : le monde littéraire jouissant au
Japon de plus de liberté qu’au Manchukuo, elle découvre la
littérature occidentale, mais aussi des auteures chinoises, dont
Xiao Hong (萧红).
Finalement, cette intrusion dans le monde japonais lui permet de
mieux articuler sa critique.
Au Japon, enfin, elle rencontre un étudiant chinois, Liu
Longguang (柳龙光),
qui travaille à mi-temps dans une librairie ; ils tombent
amoureux, mais la famille de Mei s’oppose fermement à cette
relation et menace de lui couper les vivres. Mei Niang choisit
malgré tout de l’épouser.
Il se font des amis dans les cercles sino-japonais hostiles à
l’invasion ; Mei, quant à elle, exprime sa tristesse pour sa
patrie dans ses écrits, mais aussi sa virulente opposition au
pouvoir colonial japonais qui ne fait que renforcer le système
patriarcal chinois.
Après la célébrité la tourmente
Œuvre dans la mouvance du 4 mai
Elle commence à écrire très jeune : son premier recueil de
nouvelles – « Les Demoiselles » (Xiaojie ji
《小姐集》)
- est publié en 1936, alors qu’elle a juste seize ans. La
plupart des personnages de ses nouvelles suivantes sont des
femmes prises, comme elle, dans la tourmente de la guerre ; ce
sont toutes des victimes, à un niveau ou un autre.
En 1942, les librairies Madezeng de Pékin (马德增书店)
et Vent universel de Shanghai (宇宙风书店)
réalisent ensemble une enquête auprès d’un panel de lecteurs :
Mei Niang est déclarée être leur auteure favorite avec Zhang
Ailing – Zhang Ailing née la même année, et partageant avec Mei
Niang des antécédents familiaux proches ainsi qu’un
environnement socio-politique similaire, dans Shanghai occupée.
|

Les trois nouvelles les plus célèbres
de Mei Niang : Poisson, Palourde, Crabe |
|
Les nouvelles "moyennes" de Mei Niang comme
« Poisson » (Yu《鱼》),
« Palourde » (Bang《蚌》)
ou encore « L’arrivée du printemps parmi les
hommes » (Ren dao renjian
《人到人间》)
offrent des tableaux d’un monde où la conscience
féminine commence à émerger comme phénomène
socio-culturel malgré le climat social oppressant.
Ce sont autant de nouvelles écrites dans un style
réaliste reflétant l’influence du
mouvement du 4 mai
qui a marqué la jeunesse
de leur auteure.
Dans
« Poisson », nouvelle ouvertement anti-patriarcale
publiée en 1943, le personnage féminin condamne une
société centrée sur les hommes. Dans une lettre
ouverte à l’écrivaine Wu Ying (吴瑛)
en 1943, Mei Niang déclare que la souffrance causée
par cette société misogyne rendait les femmes plus
conscientes et plus progressistes que les hommes, en
leur donnant le sentiment de responsabilités
spéciales : « Seules les femmes peuvent faire de ce
monde un paradis ». |
« Poisson » est couronnée en 1943 du second prix littéraire du
Grand Est asiatique (“大东亚文学赏”的“副赏”)
sponsorisé par les Japonais, mais la nouvelle est en même temps
condamnée par un grand spécialiste japonais de littérature
chinoise, Yoshikawa Kojiro, comme étant « l’une des œuvres les
plus dégénérées » qu’il ait jamais lues. Cela ne l’’a pas
empêchée d’avoir un immense succès : elle a eu six tirages en
six mois.
Dans « Palourde », publiée la même année, c’est la promotion de
la vertu et de la chasteté féminines comme emblèmes éminents de
moralité qui est vivement contestée. La jeune protagoniste Meili
déplore que la virginité d’une femme soit la base essentielle du
jugement porté sur elle et revendique la sexualité comme élément
naturel de la vie d’une femme : tant pis pour sa virginité. Elle
répond en cela à Wu Ying et à sa « Rebelle » (《女叛徒》)
de 1939 : mais il est vrai qu’elle paie sa liberté en mourant
des suites d’une tentative d’avortement.
|
En 1944, « Crabe » (Xie《蟹》)
est une nouvelle "moyenne" semi-autobiographique sur
la désintégration d’une famille traditionnelle,
autre thème cher aux écrivains du 4 mai que l’on
retrouve chez
Lao She ou
Ba Jin.
Outre les nouvelles, Mei Niang a aussi commencé à
écrire deux romans qui traitent de la recherche par
des femmes de la sécurité et de l’amour dans leurs
relations avec les hommes : « Fleurs de lotus
épanouies dans la nuit » (Ye hehua kai
《夜荷花开》)
et « Humbles épouses » (Xiao furen
《小夫人》).
Mais ils sont restés inachevés.
Mei Niang dépeint avec une note de tristesse la vie
des Chinoises dans les zones occupées par les
Japonais pendant la guerre, dans une atmosphère de
domination semi-coloniale des élites locales par
l’occupant avec des conséquences pour les femmes, en
termes de préjugés et d’asservissement à l’autorité
patriarcale. Ecrits à la seconde personne, ses
textes donnent une voix particulière à l’expression
des sentiments féminins, entre |
|

Mei Niang avec sa collègue Lei Yan 雷妍
lors de la réunion du prix littéraire du
Grande Est asiatique à Nankin
en 1944 |
émotion et
douleur. Ce n’est pas de l’auto-narration, plutôt un
dialogue avec ses personnages.
Vie tourmentée
|
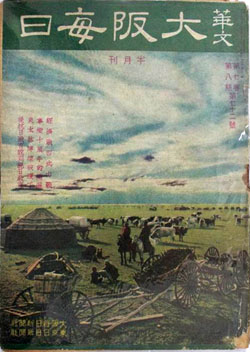
Le Journal d’Osaka (octobre 1941) |
|
En 1942, Mei Niang déménage à Pékin avec Liu
Longguang et elle est embauchée comme rédactrice par
la Revue des femmes (Funü zazhi
《妇女杂志》).
Liu Longguang travaille de son côté au comité de
rédaction d’un journal japonais, le Journal
chinois d’Osaka (《华文大阪每日》).
En 1945, ils reviennent dans le nord-est, puis en
1948 vont à Shanghai et de là à Taiwan. En 1949,
cependant, Liu Longguang meurt au cours d’un voyage
en mer : son bateau fait naufrage. Mei Niang se
retrouve seule, enceinte, avec deux petites filles.
Elle revient en Chine continentale et travaille
pendant deux ans comme professeure de chinois. En
1951, elle est embauchée par le ministère de
l’Agriculture et affectée à leur studio de cinéma,
le Studio de l’Agriculture (农业电影制片厂).
Elle publie aussi des albums pour enfants. |
|
Malheureusement, comme la plupart de ses consœurs
ayant vécu dans les zones sous occupation japonaise,
elle est bientôt condamnée comme traître à la patrie
(hanjian
汉奸)
et, en 1957, comme droitiste. En ce sens, là encore,
son sort est à rapprocher de celui de Zhang Ailing
qui a elle aussi été condamnée comme traître pour
ses activités sous l’occupation japonaise de
Shanghai et ses relatons avec le gouvernement de
Nankin. Mais Zhang Ailing est alors aux Etats-Unis.
Mei Niang, elle, est en Chine : il lui est interdit
d’écrire et elle est envoyée en rééducation dans une
|
|

En 1962 Mei Niang (au centre) avec
son fils Sun Xiang 孙翔 et sa fille Liu
Qing 柳青 |
ferme dans le district de
Changping (昌平区)
près de Pékin. Elle met sa fille cadette dans un foyer pour
enfants en pensant qu’elle y sera plus en sécurité, mais
l’enfant y meurt peu de temps plus tard, faute d’attention
et de soins. Sa fille aînée et son fils restent chez eux,
mais son fils meurt d’hépatite en 1972.
Réhabilitation et redécouverte
|

Recueil de nouvelles et essais (1997) |
|
En 1978, elle est réhabilitée et revient travailler
dans le studio de l’Agriculture. Cependant, pendant
longtemps, aucun de ses collègues ne saura qui elle
est. Il faudra encore une dizaine d’années pour que
quelques chercheurs redécouvrent son œuvre et
qu’elle redevienne peu à peu connue dans les cercles
littéraires.
Son œuvre, comme celle de ses consœurs du Manchukuo,
est à réévaluer et repenser comme critique, et
critique de l’intérieur, du système colonial mis en
place par les Japonais. C’est comme à Shanghai :
l’analogie est claire si l’on se réfère à l’ouvrage
précurseur de Poshek Fu revisitant ce qu’il était
courant d’appeler « la littérature sous l’occupation
ennemie » (沦陷文学) :
Passivity, Resistance and Collaboration :
Intellectual Choices in Occupied Shanghai,
1937-1945
.
Un parallèle analogue pourrait être fait avec Taiwan
où la littérature sous l’occupation japonaise a
|
longtemps été condamnée comme
« littérature asservissante » (nulihua
de wenxue
奴隶化的文学).
|
Mais, dans
le cas des écrivaines du Manchukuo, cette critique
est subjective : la critique du pouvoir colonial
japonais rejoint et sous-tend celle du système
patriarcal ainsi que l’idéal d’émancipation
féminine, tous deux influencés par les idées du
mouvement du 4 mai.
Cette critique a des échos au Japon même où un débat
a fait rage sur le statut de la femme après
l’apparition dans la presse, dans les années 1910,
du terme de « femmes nouvelles » (atarashii onna).
Mais les critiques contre ces « femmes nouvelles »
au Japon étaient aussi bien dirigées contre leurs
homologues en Chine. La femme émancipée chinoise
était un danger pour l’instauration des « belles
mœurs » des femmes japonaises
qui allait de pair avec l’acceptation du système
colonial.
Dès le début des années 1940, Mei Niang a tout
spécialement critiqué le système éducatif japonais
mis en place dans le Manchukuo. Outre des classes de
japonais, |
|

L’offrande du crépuscule (1997) |
il
comportait pour les filles des cours d’étiquette, d’hygiène,
de nettoyage et de blanchissage afin de former d’excellentes
domestiques et maîtresses de maison. Dans les écoles d’Etat,
le cœur du programme était constitué des classiques
confucéens, comme dans la Chine républicaine au même moment.
A la fin de leur cursus, les filles étaient encouragées à
« revenir à la cuisine » (走回厨房)
ou à choisir des emplois dans l’enseignement ou la garde des
enfants. Mei Niang a explicitement condamné la nature
restrictive de l’éducation des filles ainsi conçue,
enseignant, comme dans la société traditionnelle chinoise,
l’obéissance, la docilité et la soumission.
|

Mei Niang en 2010 |
|
C’est donc, en fait, le rejet de l’autocratie
impérialiste japonaise, liée à la défense du
patriarcat comme « voie royale » (王道),
qui a nourri dans l’ancienne Mandchourie une
littérature féminine chinoise extrêmement vivante,
avant d’être longtemps étouffée. En fait, les œuvres
de ces écrivaines témoignent de la persistance de la
critique de la vie sous l’occupation japonaise,
malgré l’instauration en février 1941 d’une censure
– appelée « Les huit interdictions » (八不)
– qui n’a, fort heureusement jamais été strictement
appliquée. Il n’est pas anodin de remarquer que les
grands écrivains de cette période 1937-1945 au
Manchukuo sont uniquement … des écrivaines
.
Mei Niang a été graduellement redécouverte. En août
2005, elle publie un dernier ouvrage, « Œuvres
récentes et lettres de Mei Niang » (《梅娘近作及书简》),
dans lequel sont compilés 60 essais et 88 lettres
traitant d’écrivains et de sujets littéraires.
|
Elle est décédée en mai 2013, à l’âge de 93 ans.
Traduction en anglais
Mei Niang’s Long Lost First Writings, Young Lady’s Collection,
by Norman Smith, Routledge, 2023.
Traduction
d’un recueil intitulé Xiaojie ji (《小姐集》)
publié en 1936 alors que Mei Niang n’avait que 19 ans. Longtemps
considéré comme perdu, il a été redécouvert en 2019.
https://u.osu.edu/mclc/2023/08/05/mei-niangs-long-lost-writings/
A lire en complément
Disrupting Narratives: Chinese Women Writers and the Japanese
Cultural Agenda in Manchuria,
1936-1945, Norman Smith,
Modern China,
Vol. 30, No. 3 (July 2004), pp. 295-325
A lire en ligne :
https://www.jstor.org/stable/3181312?seq=1#metadata_info_tab_contents
En analysant les vies, les carrières et l’héritage littéraire de
sept des principales écrivaines chinoises du nord-est chinois
pendant la seconde période de l’occupation japonaise de la
Mandchourie*, cet article souligne les frustrations des femmes
vivant et travaillant au sein des institutions coloniales
japonaises dans la région. En butte à des politiques misogynes
fondées sur le principe « épouse vertueuses, bonnes mères » (xianqi
liangmu
贤妻良母)
renforçant les traditions patriarcales chinoises, elles ont dans
leurs écrits exposé l’aspiration des femmes à l’émancipation
sous l’influence des idéaux du 4 mai. Leur critique de la
politique socio-culturelle japonaise dans ce contexte est
aujourd’hui considérée comme un facteur ayant contribué à saper
les efforts des Japonais visant à couper les liens de la
Mandchourie avec le reste du pays.
* C’est-à-dire, outre Mei Niang, par ordre alphabétique :
Dan Di (1916-1995), Lan Ling (1918-2003), Wu Ying (1915-1961),
Yang Xu (1918- ), Zhu Ti (née en 1923) et Zhuo Di (1920-1976).
Toutes sept ont fait leurs études et ont fait carrière sous
l’occupation japonaise. Leur poids littéraire est attesté par
les neuf volumes de leurs œuvres publiées du temps du Manchukuo.
Mais elles ont été persécutées d’abord par les Japonais quand, à
partir de 1943, la nature subversive de leurs écrits a commencé
à être perçue…
|
|

