|
|
Zong Pu
宗璞
Présentation
Par Brigitte Duzan, 30 décembre
2018, actualisé 31 août 2022
|
Zong Pu
est l’une des grandes écrivaines chinoises de la
seconde moitié du 20e siècle : elle a
commencé sa carrière dans les années 1950, l’a
poursuivie après la Révolution culturelle, avec des
œuvres marquantes à partir de 1978, et a encore été
couronnée du prix Mao Dun en 2005
.
Issue
d’une grande famille d’intellectuels, elle a dès
l’enfance été nourrie dans son environnement
familial même d’une double culture traditionnelle et
étrangère qui en a fait une personnalité
inhabituelle parmi les écrivains de sa génération.
Aujourd’hui, à la fin des années 2010, elle continue
une œuvre qui parcourt plus de six décennies.
Une
enfance privilégiée
|
|

Zong Pu |
Née en
juillet 1928 à Pékin, de son vrai nom Feng Zhongpu (冯钟璞),
elle est la fille du grand philosophe Feng Youlan (冯友兰),
frère de l’écrivaine
Feng Yuanjun (冯沅君).
Né en 1895, formé à Wuhan et à l’université de Pékin, puis à
l’université Columbia, Feng Youlan a exercé une influence
déterminante sur la pensée chinoise à partir de la fin des
années 1930, en la revitalisant dans un sens
néo-confucianiste. Feng Yuanjun, quant à elle, était une
autorité en matière de littérature et théâtre classiques.
|

L’université fédérée du Sud-ouest à
Kunming pendant la guerre |
|
Quand
Zhongpu avait trois mois, son père a accepté un
poste à l’université Qinghua, et c’est là qu’elle a
grandi. Elle garde un souvenir heureux des neuf
premières années de sa vie, mais, quand la guerre
éclate en 1937, elle doit arrêter l’école et, en
1938, fuir avec sa mère et ses trois frères à
Kunming où son père est parti enseigner à
l’Université nationale fédérée du Sud-Ouest (西南联合大学),
regroupant les deux principales universités de Pékin
(Qinghua et Beida) et celle de Tianjin (Nankai) qui
ont été transférées là. |
|
Zong Pu ne
retournera à Pékin qu’à la fin de la guerre, en
1946, quand les trois universités revinrent dans
leurs lieux d’origine. Mais elle a bénéficié d’une
solide formation culturelle dans son environnement
familial, développant un intérêt pour la littérature
dès son plus jeune âge grâce, d’après ses propres
dires, à son père qui était aussi un lettré épris de
poésie classique.
Elle
étudie pendant deux ans à l’université Nankai à
Tianjin, puis, en 1948, est admise dans le
département des langues étrangères de l’université
Qinghua dont son père a accepté provisoirement la
présidence de décembre 1948 à janvier 1949, avant de
repartir aux Etats-Unis
.
Pendant la guerre de Corée, elle fait de la
propagande anti-américaine dans les usines de la
capitale. Cette même année 1948, elle publie sa
première nouvelle dans le Dagongbao (《大公报》) |
|

Zong Pu jeune |
à Tianjin : « AKC » (un
jeu de mots sur le français « a cassé »).
Cette nouvelle,
a-t-elle expliqué,
elle l’a écrite alors qu’elle était étudiante et apprenait le
français. Le personnage principal de l’histoire offre à la jeune
femme qu’il aime une porcelaine qui porte gravées ces trois
lettres, mais la jeune femme ne se résout pas à briser le vase,
et ne trouve donc pas la lettre cachée à l’intérieur lui
révélant les sentiments du donateur. C’est ainsi qu’ils se sont
manqués, conclut Zong Pu, et l’ont regretté toute leur vie.
Elle sort diplômée de
littérature anglaise en 1951, mais a continué à s’intéresser à
la littérature française, participant dans les années 1950 aux
multiples discussions sur un personnage qui fascinait le monde
des lettres chinois à l’époque : Julien Sorel.
1957 : Les
Haricots rouges
En septembre 1953, la
Seconde Conférence sur la Littérature impose un rôle idéologique
et didactique à la littérature qui devient un objet au service
de la promotion du socialisme et de l’éducation des masses. Elle
arrête d’écrire et, de 1956 à 1958, devient rédactrice pour la
littérature étrangère de la revue Lettres et arts (Wenyibao
《文艺报》).
Mais elle revient sur
sa décision au moment de l’éphémère mouvement d’ouverture des
Cent Fleurs : elle écrit la nouvelle « Les Haricots rouges »
(《红豆》).
Mais, publiée en juillet 1957, alors que le vent avait déjà
tourné, elle vaut à son auteure d’être attaquée et condamnée
comme droitière, l’exaltation des sentiments n’étant pas dans la
ligne idéologique du début du Grand Bond en avant. C’est en
effet une histoire d’amour qui oppose aspirations individuelles
et idéaux collectifs, la jeune héroïne étant obligée de renoncer
à l’amour pour privilégier l’engagement révolutionnaire.
La peine que Zong Pu
doit purger n’est cependant pas trop lourde. En 1959, elle est
envoyée travailler dans une ferme du Hebei. Elle rentre
provisoirement en grâces pendant la brève période d’ouverture au
début des années 1960 et entre alors au comité de rédaction de
la revue Littérature du monde (《世界文学》)
de l’Institut de recherche sur la littérature étrangère.
1979 : retour à
l’écriture
Zong Pu n’a plus rien
publié jusqu’aux lendemains de la Révolution culturelle. Puis
soudain, elle publie coup sur coup deux nouvelles remarquées et
primées : « Le rêve de l’archet » (littéralement le
rêve sur une corde – une corde de violoncelle《弦上的梦》)
en 1978 et « Qui suis-je ? » (《我是谁》)
en 1979. La première, couronnée du prix de la meilleure nouvelle
de l’année, traitait de la condition des intellectuels pendant
la Révolution culturelle, mais c’est surtout la seconde qui a
fait de Zong Pu l’une des écrivaines les plus en vue de la fin
des années 1970 en Chine.
1. « Le rêve de
l’archet » dépeint l’évolution des rapports entre
une violoncelliste d’âge moyen, professeure de musique, qui a
été persécutée pendant la Révolution culturelle et une jeune
étudiante dont les parents ont été tués pendant la même période
et qui vient se réfugier chez elle (une ancienne amie de sa
mère) car la tante qui l’hébergeait l’a mise dehors par crainte
qu’elle ne lui attire des ennuis ; Zong Pu dépeint le mur de
froideur et de cynisme que la jeune fille s’est bâti dans un
réflexe d’autoprotection et que la musicienne tente peu à peu de
briser.
Le spectre de la Révolution culturelle plane sur le récit, non
tant pour les atrocités commises, que pour les dommages profonds
infligés aux relations entre individus, amis ou famille, et
surtout pour les conséquences désastreuses sur la mentalité des
jeunes, qui ont perdu tout idéalisme et foi dans l’avenir.
Contrairement à bien des récits de la
« littérature
des cicatrices »,
il n’y a aucun romantisme ni sentimentalisme chez Zong Pu, on
sent juste affleurer une grande tristesse.
|
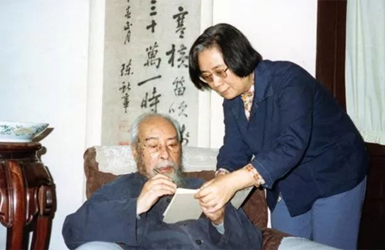
Avec son père Feng Youlan |
|
La nouvelle se termine par la description des
manifestations spontanées place Tian’anmen au début
de 1976, quand la mort de Zhou Enlai a déclenché un
phénomène de ferveur populaire. Zong Pu nous décrit
une foule où les individus communient dans leur
douleur et leur attachement au premier ministre
disparu. Ce n’est plus un collectif aveugle
obéissant aux mots d’ordre, c’est une conscience
collective qui vaut par la somme des consciences
individuelles. |
2. « Qui suis-je ? »
est l’histoire d’une jeune femme que le suicide de son
compagnon, persécuté pendant la Révolution culturelle, a rendue
folle de douleur. Elle s’imagine transformée en démon, puis en
fleur, et enfin en un énorme vers, chaque transformation donnant
lieu à des doutes sur son identité. Kafka n’est pas loin, mais
la réflexion est à replacer dans le cadre de la période
post-maoïste qui voit un retour aux valeurs humaines, retour
cependant contesté car ces valeurs sont toujours l’objet de
critiques virulentes contre leur caractère petit-bourgeois.
|
Les
différentes métamorphoses de la jeune femme
reflètent la fragmentation de son moi
profond, sa quête identitaire pour retrouver un être
indemne et entier, après les persécutions subies.
Mais finalement elle se suicide elle aussi, en se
jetant dans un lac glacé, tandis qu’un vol d’oies
sauvages passe dans le ciel en dessinant un V à
l’envers, c’est-à-dire le caractère rén
人,
celui désignant l’homme, laissant présager qu’il est
en train de retrouver sa place dans un monde qui
l’avait écrasé.
Le récit
de Zong Pu est précurseur : il annonce tout un
courant « humaniste » qui va se développer au début
des années 1980, en littérature comme au cinéma,
mais sera vivement attaqué, toute tentative de
restaurer des valeurs humanistes étant considérée
comme un rejet implicite de la théorie de Mao selon
laquelle il n’y a pas de nature humaine, seulement
une nature de classe. L’image des oies sauvages
décrivant |
|

Livre à la mémoire de son père
|
le signe rén dans le ciel se
retrouve même au début du
film emblématique « Unrequited Love » ou « Douloureux amour
» (Kulian《苦恋》),
adapté d’une nouvelle de
Bai Hua (白桦)
en hommage au peintre Huang Yongyu (黄永玉)
persécuté pendant la Révolution culturelle.
Mais, au-delà du
contexte de l’époque, cette revendication humaniste est chez
Zong Pu le reflet d’une culture familiale profondément ancrée
dans la culture traditionnelle chinoise, tout en étant
influencée par la pensée humaniste de l’Occident.
Nouvelles,
essais et contes
|

Zong Pu avec Bing Xin |
|
Dans les
années 1980 et 1990, elle a développé un style
original empreint de poésie et de philosophie.
Elle a
écrit dans les genres les plus divers : des
nouvelles "moyennes" comme « Le rocher immortel » (《三生石》)
ou « Le brillant passage des saisons » (《四季流光》),
ou encore des essais poétiques empreints de son
amour de la nature, comme ses « Notes sur le lac de
l’Ouest » (《西湖漫笔》).
|
Mais elle a aussi
écrit des notes de voyage, des souvenirs comme « En mémoire de
la fête des Fleurs » (《花朝节的纪念》)
ou « Bribes de souvenirs de la Salle des Trois Pins » (《三松堂的断忆》),
et même des contes pour enfants comme « A la recherche de la
Lune » (《寻月记》)
publié en 1957 ou « Paroles de fleurs » (《花的话》)
publié en 1978 dans la revue Littérature du peuple.
|
En 1996,
elle a publié ses œuvres complètes en quatre
volumes. Mais elle est aussi en train de terminer le
dernier volume d’une tétralogie romanesque dont les
trois premiers volumes ont été publiés aux éditions
Littérature du peuple (人民文学出版社).
La
tétralogie de la Gourde sauvage
Ce roman
en quatre volumes, « Prélude de la Gourde sauvage »
(《野葫芦引》),
est une sorte d’autobiographie romancée de ses
années de guerre. C’est l’œuvre majeure de toute la
seconde partie de sa vie, après la Révolution
culturelle.
1. Le
premier volume, « Chronique du passage vers le Sud »
(《南渡记》),
achevé en 1987 et publié en septembre 1988, commence
pendant l’été 1937. Zong Pu y dresse le portrait
d’une mère de trois enfants soudain prise dans
l’engrenage de la guerre, qui doit quitter la
capitale menacée par l’armée japonaise. Lü Bichu (吕碧初)
est la plus jeune de la famille Lü, elle-même mère
de trois enfants et prête à tout pour sauver ce qui
lui est cher. Mais la voie est étroite entre un
gouvernement corrompu, les Japonais d’une cruauté
sans merci, et, pour couronner le tout, le désespoir
des Chinois autour d’elle
.
2. Le
second volume, « Chronique du refuge de l’Est » (《东藏记》),
est sorti en avril 2001. Il s’agit d’une chronique
de la vie à l’Université fédérée du Sud-ouest à
Kunming pendant la guerre, avec des portraits très
vivants des intellectuels réfugiés là, dans une
atmosphère de résistance à l’ennemi décrite en
termes affectifs, dans un style raffiné. Dans le
contexte de la guerre, certains se conduisent en
héros en continuant leurs cours sous les
bombardements, tandis que d’autres en profitent pour
faire fortune.
Le roman a
été couronné du prix Mao Dun en 2005.
3. Dans le
troisième volume, « Chronique de la marche vers
l’Ouest » (《西征记》), publié
en mai 2009, la narration s’évade du cadre de
l’université et de la vie sur le campus pour
englober la réalité qui la cerne avec un tableau
coloré de paysans, de généraux, de combattants de la
guérilla ou encore des chefs de minorités de la
région. C’est tout un monde de souvenirs vibrants
que l’on trouve rarement sous d’autres plumes et
même au cinéma.
4. Le
quatrième volume, « Chronique du retour dans le
Nord » (《北归记》),
a été publié en octobre 2018 et a obtenu le prix Shi
Nai’an (施耐庵文学奖). |
|
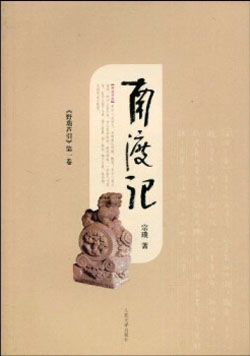
1er volume de la tétralogie (vers le
sud)

2ème volume (vers l’est)
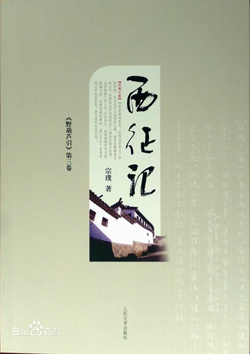
3ème volume (vers l’ouest) |
|
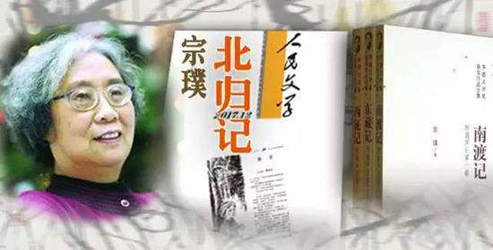
Zong Pu à 90 ans, lors de la
publication de la 4ème partie de la tétralogie (vers
le nord) |
|
Au-delà de
l’intérêt documentaire du contenu, les quatre
volumes ont une qualité littéraire unanimement louée
par la critique, d’un style raffiné qui est celui
des essais sanwen de l’auteure. Le roman est
conçu sur le modèle des grands romans de la
tradition chinoise. On |
pense bien sûr au
« Voyage vers l’Ouest » (《西游记》),
mais ce n’est pas pour rien, non plus, que le quatrième
volume de la tétralogie a été couronné du prix Shi Nai’an,
du nom de l’auteur du grand classique « Au bord de l’eau » (《水浒传》)…
Une écrivaine
hors normes
Zong Pu est retraitée
depuis 1981 de l’Institut de littérature étrangère de l’Académie
chinoise des sciences sociales et, à plus de 90 ans, continue
d’écrire malgré des problèmes de santé et une mauvaise vue.
Elle est d’autant plus
remarquable qu’elle avait une solide formation en littérature
étrangère, à une époque où ce n’était pas courant. A huit ans
elle avait lu David Copperfield, puis, adolescente, elle se
passionna pour Dostoïevski et Thomas Hardy, sujet de sa thèse de
fin d’études à Qinghua. Au début des années 1960, une campagne
fut lancée contre des auteurs occidentaux, dont Kafka. Comme
elle travaillait alors à la rédaction de la revue « Littérature
mondiale », elle en profita pour lire ses œuvres, et en fut
fortement influencée.
Cette solide formation
ne l’a pas empêchée d’avoir aussi un penchant pour la
littérature chinoise classique. Enfant, elle devait tous les
matins réciter quelques poèmes Tang à sa mère avant d’aller à
l’école, et sa tante Yuanjun était elle-même professeure et
spécialiste de littérature, poésie et théâtre classiques. Ses
connaissances se reflètent dans son style, ses images poétiques
et ses citations.
Enfin, elle était
aussi passionnée de musique, intérêt renforcé par son mari, Cai
Zhongde (蔡仲德),
professeur au Conservatoire central de musique et auteur de
plusieurs ouvrages sur l’histoire de l’esthétique de la musique
chinoise, qu’elle épousa en 1969.
La musique est un thème récurrent dans son œuvre.
Traductions en
français
Deux traductions de référence :
-
Qui suis-je ? 《我是谁》,
trad. Catherine Gipoulon, Europe n° 672, avril 1985.
-
Le rêve de l’archet 《弦上的梦》,
trad. Liu Hanyu et Liu Fang, in : La Chine des femmes,
Mercure de France, coll. Mille et une femmes, 1983, pp. 181-210.
- Le sacrifice du cœur, Beijing
Ed. Littérature chinoise, 1992, 214 p.
Six nouvelles :
i. Haricots rouges, décembre
1956, trad. Catherine Toulsaly, p. 7
ii. Le rêve de l’archet,
automne 1978, trad. Liu Fang/Liu Hanyu, p. 67
iii. Le sacrifice du cœur, juin
1980, trad. Catherine Toulsaly, p. 111
iv. Lulu, juin 1980, trad. Wang
Anwei/Zhang Lei, p. 139
v. Pattes d’ours, juin 1981,
trad. Catherine Toulsaly, p. 169
vi. La tragédie du noyer,
décembre 1981, trad. Catherine Toulsaly, p. 187
Introduction : Aux lecteurs français
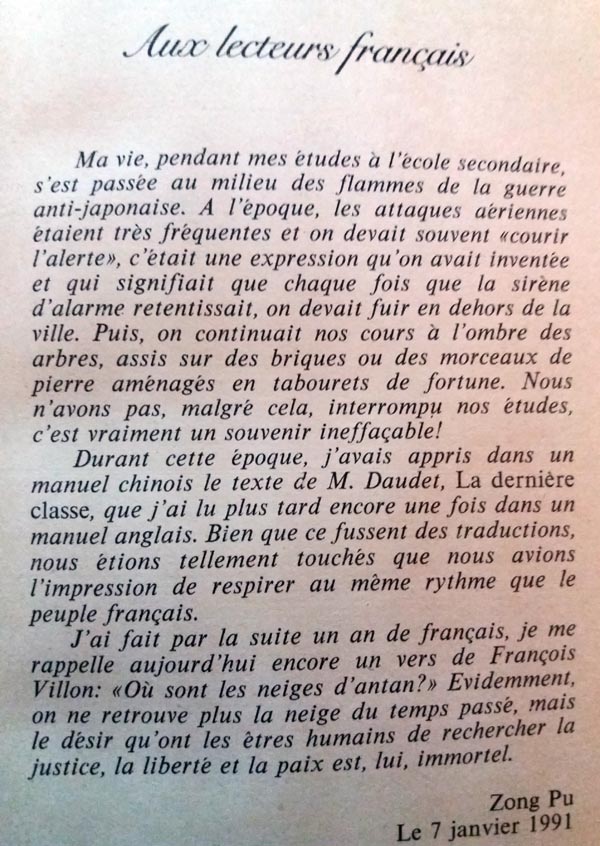
Traductions en
anglais
- Melody in Dreams
《弦上的梦》,
in : Seven Contemporary Chinese Women Writers. Short
stories by Ru Zhijuan, Huang Zongying, Zong Pu, Shen Rong, Zhang
Jie, Zhang Kangkang, Wang Anyi.
Préface Gladys Yang. Chinese Literature, Panda Books, 1982,
280p.
- The Tragedy of the Walnut Tree (1984), in : The Serenity Of
Whiteness, Stories By and About Women in Contemporary China,
11 short stories selected and translated by Zhu Hong, Ballantine
Books, 1991, pp. 282-299.
- Red Beans
《红豆》,
tr. Geremie Barme, in : Fragrant Weeds, W.J.F Jenner ed., HK
Joint Publishing 1983, pp. 195-228 – rep. in :
Writing Women in Modern China :The Revolutionary Years 1936-1976,
Amy D. Dooling ed., Columbia University Press 2005, pp. 247-274.
- Lulu 《鲁鲁》,
tr. Taylor Brady, Haiyan Lee and Sylvia Yang, 2013.
(Publication initiale :
Littérature du peuple, 1990)
A lire en ligne sur le site du MCLC Resource Center :
http://u.osu.edu/mclc/online-series/lulu/
- The Everlasting Rock
《三生石》,
publié sous le nom Feng Zong Pu, Three Continents Press, 1998,
181 p.
- Wild Gourd Overture, 1.
Departure for the South《南渡记》tr.
Wen Lingxia, Alain
Charles Asia Publishing 2018
Il était professeur invité à l’université de
Pennsylvanie quand les nouvelles venues de Chine firent
présager l’arrivée prochaine des Communistes au pouvoir.
Malgré les conseils de prudence de son entourage, il
repartit en Chine. Mais il se trouva bientôt obligé de
répudier une grande partie de ses travaux, et même de
réécrire certains de ses ouvrages pour les mettre en
conformité avec l’idéologie du régime. Constamment
attaqué, il refusa cependant de quitter le pays.
Zong Pu lui a
d’ailleurs rendu hommage en écrivant une biographie,
publiée en 1991.
Bai Hua
sera le bouc
émissaire d’une campagne contre « l’humanisme » menée
à partir de l’automne 1980, dans laquelle seront aussi
impliquées les écrivaines Yu Luojin (遇罗锦)
et Dai Houying (戴厚英).
Voir : The
Uses of Literature, Perry Link, Princeton University
Press, 2000, pp. 27-30.
|
|

