|
Club de lecture du
Centre culturel de Chine
Année 2019-2020
Compte rendu de la
première séance
et annonce de la
séance suivante
par Brigitte
Duzan, 21 octobre 2019
La première séance de l’année 2019-2020 du Club de lecture du
Centre culturel de Chine s’est tenue le mardi 15 octobre 2019
dans la médiathèque du Centre ; elle était consacrée à
l’écrivain
A
Cheng (阿城).
Figuraient au programme les
principales œuvres d’A Cheng traduites en français, par Noël
Dutrait :
-
Les Trois Rois (Le Roi
des échecs
《棋王》/
Le Roi des arbres
《树王》),
Le Roi des enfants
《孩子王》)
,
éditions de l’Aube 1998, 243 p.
- Perdre son chemin (Milu《迷路》),
recueil de textes du genre « écrits au fil du pinceau »
(笔记),
l’Aube 1996, l’Aube poche 2001, 118 p.
- Le Roman et la Vie (Xianhua Xianshuo《闲话闲说》)
,
essais, l’Aube 1995, l’Aube poche 2005,
215 p.
Les membres du Club ont ajouté à leurs lectures deux recueils de
nouvelles :
- Injures célestes (《天骂》),
tr. Noël et Liliane Dutrait, l’Aube
1992 (également paru sous le titre « Chroniques », rééd. poche
2004)
-
Un recueil traduit en anglais : Unfilled Graves (《空坟》),
préface de
Wang Zengqi (汪曾祺),
tr. Bonnie McDougall, Chinese Literature Press (Panda books),
1995, 170 p.
Recueil de dix nouvelles - essentiellement des portraits de
femmes aux marges de la société :
Unfilled Graves / The Kind-Hearted Prostitute / Six New Year
Sketches / Speaking of the Wangs /
Lao Liu / The Drowning in the Pond / Story of the Liangs /
Northeasterners / Salt Flats / Jiazi.
-
Sept de ces nouvelles sont reprises dans le recueil traduit en
français : La Prostituée innocente (《良娼》),
éd. Littérature chinoise, coll. Panda, 1998, 233 p.
De
nombreux membres du Club présents à la séance avaient lu la
totalité des œuvres ci-dessus, et en avaient en outre lu
certaines en chinois, dont Xianhua Xianshuo. en s’aidant
au besoin de la traduction en français.
Impressions de lecture
et commentaires
Belle découverte, mais
difficultés initiales
L’impression d’ensemble manifestée par les membres présents est
celle du bonheur d’une découverte – ou redécouverte pour
certains qui avaient lu quelques-uns de ces textes il y a une
quinzaine d’années - mais bonheur mitigé parfois par la
difficulté de compréhension des subtilités du texte dans le cas
de Xianhua Xianshuo.
Une lectrice semble résumer la réaction de beaucoup : déroutés
dans un premier temps, l’intérêt venant à la lecture dans un
second temps, Xianhua Xianshuo apparaissant comme œuvre
de référence. L’intérêt, pour certains, s’est trouvé accru par
l’impression personnelle de retrouver une Chine disparue qu’ils
ont connue lors de voyages ou séjours à la fin des années 1970.
Ces réserves faites, l’impression dominante est le bonheur de la
lecture. Bonheur qui répond très bien à la définition qu’en a
donnée Michèle Gazier sur France Culture lors de la Nuit de la
lecture 2019 : « C'est
cela le bonheur de la lecture : être toujours en relation avec
le monde, un autre monde, et son propre monde. »
Bonheur de lecture
|
1. La
Trilogie des Rois
a fait l’unanimité, bien qu’avec une ou deux
réserves : l’une des lectrices a commencé ses
lectures par « Le Roi des échecs », n’a pas
accroché, est passée au « Roi des arbres » qu’elle a
beaucoup aimé, a poursuivi avec le « Roi des
enfants » avant de revenir au « Roi des échecs ». Il
fallait sans doute un temps d’accoutumance
(plusieurs personnes disent avoir trouvé les textes
« dérangeants ») : quand elle a lu ensuite « Perdre
de son chemin », elle a beaucoup apprécié le côté
poétique de ces « petites vignettes », dit-elle,
poétique mais humoristique aussi.
Une autre
lectrice a aimé l’empathie de l’auteur avec les
personnages modestes qu’il dépeint dans ses
nouvelles, ainsi que les liens étroits entre la
nature et les hommes. Un peu dans le même ordre
d’idées, le lecteur suivant a souligné la position
singulière de l’auteur : à la fois critique, donc
distancié, mais partie prenante dans son histoire,
proche de ses personnages, d’où un ton empreint de
chaleur humaine. |
|
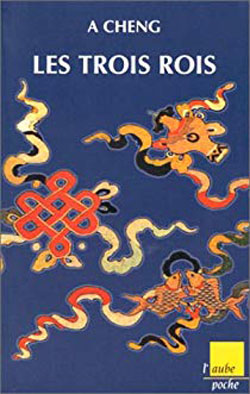
Les Trois Rois |
Une lectrice témoigne de son intérêt particulier pour « Le Roi
des enfants » : étant elle-même enseignante, elle y a retrouvé
bien des souvenirs, en particulier l’embarras du premier jour
devant une classe inconnue dont on se demande comment on va
l’approcher.
Le
« Roi des arbres » a été particulièrement apprécié, pour son
actualité encore aujourd’hui, où l’on voit la Chine tenter de
reboiser les zones désertifiées par les nécessités de politiques
de développement accéléré qui ont ruiné l’écologie. Un lecteur y
voit aussi une atmosphère un peu gothique, rappelant le « Roi
des Aulnes »
.
Les lecteurs ont aussi fait des rapprochements avec des lectures
antérieures et des films. D’une part, le « Roi des arbres » a
été rapproché de l’univers de
Jia Pingwa dans sa symbiose du naturel et du
surnaturel – commentaire d’autant plus pertinent qu’A Cheng
considérait Jia Pingwa comme représentatif de cette littérature
« populaire » qu’il prônait (voir commentaires ci-dessous). Mais
A Cheng a été jugé plus facile à lire, sans doute parce que le
roman de référence évoqué était « Les fours anciens ».
D’autre part, un
parallèle a été fait entre « Le Roi des enfants » et « Pas un de
moins » (《一个都不能少》),
le film de 1999 de Zhang Yimou qui, dans une approche
différente, a également pour sujet les difficiles conditions
d’enseignement en milieu rural, dans les zones reculées du pays.
2.
Les autres nouvelles ont été très appréciées
par ailleurs
Au
passage, un lecteur demande : mais où a-t-il trouvé toutes ces
histoires ? C’est là tout son art de conteur, sachant magnifier
des récits entendus de-ci de-là, qu’il a développé pendant la
Révolution culturelle, auprès de ses camarades, à la campagne.
Le
recueil qui n’était pas au programme a rencontré le plus grand
succès : soit en traduction anglaise, « Unfilled Graves », selon
le titre de l’une des nouvelles, soit en traduction française
« La prostituée innocente » selon le titre d’une autre
(traduction contestée, à juste titre, voir commentaires
ci-dessous).
Enthousiaste, une lectrice fait au passage un résumé vivant de
trois des nouvelles de ce recueil, à la manière des conteurs :
|
- « Unfilled
Graves » (les tombes vides,
kōngfén《空坟》)
se passe, raconte-t-elle, dans un petit village de
montagne habité uniquement par des femmes : l’eau
est toxique pour les hommes qui doivent aller vivre
ailleurs ; un jeune homme, s’étant perdu, est
recueilli dans le village, prend femme, et repart
après avoir conçu un enfant, mais il aura
entre-temps appris aux femmes comment recueillir
l’eau de pluie afin de ne plus être dépendant de
l’eau des puits ; les hommes pourront rester.
La nouvelle a déjà un peu de l’atmosphère du « Roi
des arbres ».
- « La
prostituée innocente » ou plutôt « au bon cœur » (liáng
chāng《良娼》),
est l’histoire d’une femme qui se prostitue par
nécessité, pour élever son fils infirme.
- La
dernière nouvelle est l’histoire d’un village
d’idiots et d’handicapés de toutes sortes, dont la
règle veut que les mariages soient uniquement
consanguins. Une femme enceinte qui a eu une |
|
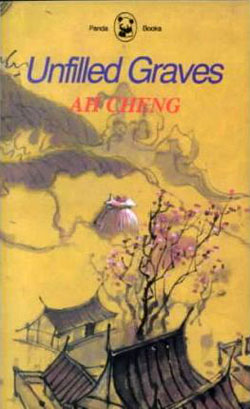
Unfilled Graves |
liaison
dans un village voisin se voit condamnée à mort, par son propre
grand-père qui est le chef du village ; elle sera exécutée et
enterrée avec son chat qui a commis une faute semblable.
La question qui se pose donc : qu’est-ce qu’un homme, un être
« normal » ? (voir commentaires ci-dessous)
3.
Xianhua Xianshuo a très souvent posé des
problèmes de compréhension (et même une réaction de rejet) en
raison de l’immense culture dont témoignent ces essais, qui
apparaît là dans toute sa subtilité dans un style concis à
l’extrême ; A Chen prend plaisir à laisser souvent à la charge
du lecteur le soin de compléter, voire interpréter sa pensée au
gré de digressions interrompues en prétextant parfois le
hors-sujet. Comme l’indique le titre, où xián (闲)
signifie tout à loisir, en toute quiétude, A Cheng
prend la position (traditionnelle) du lettré oisif discutant ou
disputant nonchalamment de choses et d’autres.
|

Xianhua Xianshuo |
|
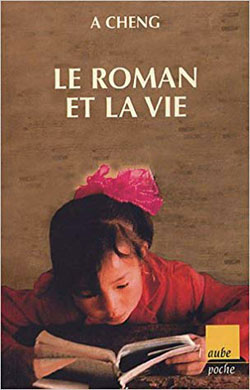
Le Roman et la Vie |
Beaucoup de lecteurs ont trouvé que la traduction aurait
nécessité bien plus de notes pour que les références
littéraires, au moins, puissent être bien comprises du lecteur
insuffisamment averti. Des questions précises ont été posées sur
quelques références jugées obscures : la littérature pure, la
nouvelle « Ordination » (voir les réponses et commentaires
développés ci-dessous).
|
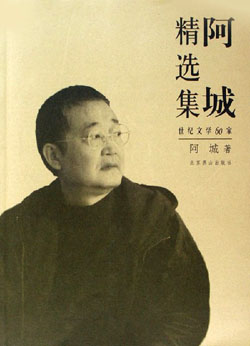
Œuvres choisies d’A Cheng,
Beijing Yanshan chubanshe,
2006 |
|
Un lecteur souligne l’humour latent dans le texte,
en citant un passage typique (chapitre 32) où A
Cheng explique une expression fondée comme souvent
sur un épisode historique :
wàngbā
忘八,
expression devenue une injure avec une autre
orthographe, et qui a toute une histoire, méritant
quelques précisions.
De manière significative, l’explication donnée par A
Cheng se trouve à la fin du chapitre 32 du texte
original qui comporte au début une satire de Mao et
une critique de la théorie de la lutte des classes :
il est supprimé des éditions des œuvres d’A Cheng
éditées en Chine continentale, dont les œuvres
choisies éditées en 2006 dans la série des grands
classiques du 20ème siècle par les
éditions pékinoises Beijing Yanshan chubanshe
(《阿城精选集》北京燕山出版社).
Le
chapitre se trouve dans la version de l’ouvrage
éditée à Taiwan
. |
Questions, remarques et
commentaires
1.
Sur les coutumes séculières chinoises
Il ne faut pas négliger le sous-titre de Xianhua Xianshuo :
« propos sur les coutumes séculières et la fiction en
Chine » (中国世俗与中国小说)
.
C’est le thème de tout l’ouvrage, qui est une apologie des
coutumes séculières (shìsú
世俗),
à travers le taoïsme populaire érigé en fondement de la pensée
et de la vie du peuple qui y trouve refuge et consolation ;
partant de là, il se livre à une défense de la littérature
populaire qu’il désigne du même terme (世俗小说).
|
Ce retour aux coutumes traditionnelles comme fondement de la vie
du peuple est ce qui a fait de A Cheng un précurseur du courant
littéraire dit « de recherche des racines » (“寻根小说”)
qui va se développer à partir d’un article publié en décembre
1984 par
Han Shaogong (韩少功)
et intitulé « Les "racines" de la littérature » (《文学的“根”》).
C’est un véritable retour aux sources dans le contexte de crise
née du vide culturel engendré par la Révolution dite culturelle.
|
|
 |
Han Shaogong publie aussitôt après une nouvelle qui devient le
symbole du nouveau courant littéraire : c’est « PaPaPa » (《爸爸爸》),
écrite dans une langue allégorique, dont le personnage principal
est un idiot, né de père inconnu dans un village aux mentalités
conditionnées par les superstitions d’autrefois au point de
vouloir en faire une divinité capable de faire tomber la pluie.
Cette figure de l’idiot amène une réflexion sur le sujet à
propos des remarques faites au cours de la séance à partir des
nouvelles d’A Cheng.
2.
La figure de l’idiot,
du simple d’esprit, du fou
A travers son personnage d’idiot, Han Shaogong montrait la part
d’irrationnel et le poids des traditions dans les mentalités
chinoises, et
combien la civilisation chinoise est conditionnée par l’histoire
et la culture populaire, par ses « racines », avec tout leur
poids de merveilleux et de fantastique. A Cheng a fait de même,
dès le début des années 1980.
|
La nouvelle « Perdre son chemin » (《迷路》)
a pour personnage principal un jeune garçon qui a eu
une méningite quand il était petit et en a gardé des
séquelles : on l’appelle l’Idiot (shǎzi
傻子),
mais il ne l’est pas autant qu’il y paraît : il
devient « infirmier aux pieds nus ».
Des lecteurs remarquent qu’il y a des personnages de
ce genre – un peu étranges, en marge de la
« normalité » sociale - dans d’autres nouvelles d’A
Cheng : ainsi, la « prostituée au grand cœur » se
prostitue pour élever son fils, Petit Trésor (宝子),
qui est infirme (瘸子).
Dans la dernière nouvelle du même recueil, c’est
tout un village qui est peuplé d’idiots et de
simples d’esprit, condamnés à se reproduire comme
tels car seuls sont permis les mariages
consanguins.
Mais le plus beau de ces personnages est « le fou
d’échecs » (“棋呆子”),
et l’on touche là à la folie au sens de passion
absolue et obsessive, le terme de
dāizi
(呆子)
|
|
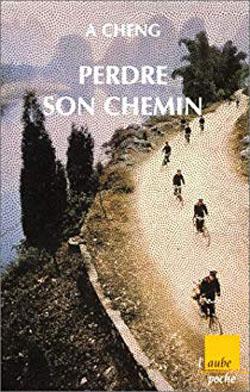
Perdre son chemin |
suggérant l’image de cette obsession maladive : dāi
呆
désigne étymologiquement une personne qui reste stupide, bouche
bée, le regard dans le vide, sans expression, avec le caractère
kǒu
口
suggérant la bouche ouverte. Mais ici encore le « fou » est en
fait un être d’exception, formé aux pratiques taoïstes de
méditation et concentration qui sont à la base de son art des
échecs.
Le personnage de l’idiot, ou du fou, est courant dans la
littérature chinoise
:
être en marge, qui n’est pas conforme aux règles usuelles ; il
peut aussi bien inquiéter qu’être respecté pour une forme de
savoir irrationnel, ou apparemment tel. Plusieurs lecteurs et
lectrices ont cité l’exemple des
« Fours
anciens » (《古炉》)
de
Jia Pingwa (贾平凹),
dont le personnage principal est le jeune Pissechien (狗尿苔)
qui sait communiquer avec les animaux et les plantes autour de
lui, tandis que sa grand-mère est aussi un peu bizarre, car elle
a des pouvoirs quasi magiques. Quant aux habitants du village,
la Révolution culturelle les rendra hystériques : fous à lier (狂人).
C’est un exemple d’autant plus judicieux que, dans Xianhua
xianshuo, Jia Pingwa est cité par A Cheng, aussitôt après
Wang Zengqi (chapitre 65), comme un écrivain
du terroir dont « l’arrière-plan culturel est constitué par les
coutumes rurales » (平凹的文化功底在乡村世俗)
et dont les romans sont tous populaires (平凹的作品…都是世俗小说。).
|

Photographie
d’Henri Cartier-Bresson,
prise à Pékin en
décembre 1948 |
|
On pourrait poursuivre l’exercice en relevant les
« idiots », « fous » et anormaux de toutes sortes de
la littérature chinoise, à commencer par « Le
Journal d’un fou » (《狂人日记》)
de
Lu Xun (魯迅),
mais en continuant aussi avec le cinéma chinois,
dont les films de wuxia. On trouve maintenant
des idiots aussi dans la littérature de
science-fiction chinoise : récemment, lors d’un
colloque au Leeds Centre for New Chinese Writing,
l’écrivaine
Xia Jia (夏笳)
a fait une courte présentation du personnage du
« fou comme héros » dans la science-fiction : qu’ils
soient combattants, scientifiques ou enfants, leur
caractéristique commune est d’agir de manière
anormale.
Enfin, voici une belle illustration : une
photographie d’Henri Cartier-Bresson, prise à Pékin
en décembre 1948, d’un simple d’esprit embauché pour
escorter le palanquin des jeunes mariées lors de
cérémonies de mariage.
|
3.
Le titre « La
prostituée innocente ».
Une lectrice trouve – à juste titre – la traduction en français
contestable : le titre original chinois étant liáng
chāng
《良娼》,
le sens est donc plutôt « La prostituée au grand cœur », ou « au
bon cœur » (comme en anglais « The Kindhearted Prostitute »).
Comme l’indique le caractère, le terme chāng
désignait plus précisément, dans la Chine ancienne,
une chanteuse d’opéra, souvent courtisane plutôt que prostituée
(唱戏的女子) ;
c’était une artiste (歌舞女艺人).
Le
choix de ce terme n’est sans doute pas anodin. On peut y voir
une référence
à une pièce du dramaturge de la dynastie des Yuan Guan Hanqing (关汉卿),
célèbre auteur de pièces zaju qui sont pour la plupart
des histoires de femmes. Eminent représentant d’un courant dit
de la « couleur naturelle » (‘bense’ pai
“本色”派),
il incarne un courant populaire semblable à celui défendu par A
Cheng : dans le Xianhua xianshuo, il consacre un
chapitre, le 41, au théâtre zaju des Yuan.
Un
simple titre peut parfois être révélateur de significations plus
profondes qu’il n’y paraît, surtout chez A Cheng dont les
subtilités d’écriture ne sont pas toujours faciles à déchiffrer,
en particulier dans le Xianhua xianshuo. Les lecteurs
présents ont soulevé quelques points qui méritent quelques
commentaires, en particulier autour du concept de « littérature
pure » et de la nouvelle « Ordination ».
4.
La littérature « pure »
Le
Xianhua xianshuo est écrit en partie en défense du roman
populaire, dont il parle après les « coutumes séculières »,
comme il l’annonce au début du chapitre 38
:
大致观过了世俗,再来试观中国小说。
Traduction de Noël Dutrait : « Maintenant que j’ai parlé des
coutumes séculières, je vais essayer d’examiner le roman
chinois » – traduction qui pose le problème déjà mentionné de la
traduction de xiaoshuo, mais qui peut se justifier dans
ce cas car A Cheng se propose ici, après un bref historique, de
parler du roman populaire en tant que genre né des histoires
étranges et contes merveilleux des Tang et jusqu’aux Ming, en
passant par les huaben des Song et des Yuan
.
Or, ce sont justement ces origines « impures » qui faisaient du
roman un genre méprisé des lettrés dont les genres de
prédilection étaient la poésie et l’essai, genres non
fictionnels dont la maîtrise était la clé de la réussite aux
examens mandarinaux. A Cheng souligne bien, au chapitre 41, que
le théâtre zaju est un important développement dans l’art
populaire chinois car, les lettrés se voyant refuser l’accès aux
examens mandarinaux, donc ne pouvant accéder aux postes
officiels (不能科举做官),
ils n’ont eu d’autre alternative que d’écrire des zaju,
genre qui dénotait jusque-là surtout des zashua (杂耍),
c’est-à-dire des vaudevilles et autres divertissements
populaires
.
A Cheng souligne bien les liens entre roman et théâtre, y
compris dans sa version opéra qui a toujours été un art
populaire en Chine. C’est quand le roman se développe, sous les
Ming, que le genre du zaju commence à décliner, comme par
un effet de balancier : ils d’adressaient au même public, en
langue vulgaire, comme il montre dans ses chapitres sur les
grands romans, et surtout sur le Hongloumeng, le Rêve
dans le pavillon rouge (《红楼梦》),
dont il fait l’œuvre-type du roman populaire (chapitre 46).
Ses brefs développements sur ce roman sont d’une extrême
richesse dans leur concision ; il capte l’esprit du roman quand
il dit (chapitre 47) :
我既说《红楼梦》是世俗小说,但《红楼梦》另有因素使它成为中国古典小说的顶峰,这因素竟然也是诗,但不是小说中角色的诗,而是曹雪芹将中国诗的意识引入小说。
« Même si j’ai dit que "Le Rêve dans le pavillon rouge" est un
roman populaire, il est un autre facteur qui en a fait l’un des
sommets du roman classique chinois, c’est bien sûr la poésie, et
ce non tant en raison des poèmes des personnages, mais pour la
conscience poétique que Cao Xuequin a introduite dans son
roman. »
C’est cette « conscience poétique » (诗的意识)
dont A Cheng fait le point fort du roman. Il fait aux chapitres
suivants un développement complémentaire sur la poésie pour en
expliquer les origines et l’importance, avant de revenir à Cao
Xuequin. Il pose la poésie chinoise comme l’émanation de
l’esprit le plus raffiné (中国艺术的高雅精神传之在诗。),
puis fait participer le roman de cet esprit :
小说要入诗的意识,才可能将中国小说既不脱俗又脱俗,就是一种理性…
Ce n’est qu’en
pénétrant la conscience poétique que le roman chinois peut se
détacher du vulgaire tout en continuant de s’y rattacher.
Une fois « réhabilité » le roman classique, il fait de même pour
la littérature de l’école dite des
« canards
mandarins et papillons » (鸳鸯蝴蝶派)
de la fin des Qing, en liant le développement de ces romans
éminemment populaires à la suppression des examens mandarinaux
(en 1905), donc en reprenant son argumentation pour le
développement du zaju sous les Yuan. Mais s’y ajoutent
alors l’essor de l’imprimerie (et des journaux) et la croissance
d’une population urbaine avide de lectures nouvelles.
Au total, ce qu’il défend là, c’est le roman populaire (世俗小说)
opposée au « roman pur » (“纯”小说)
(fin du chapitre 53), relevant de ce qu’il est
traditionnellement convenu de désigner du terme de « littérature
pure » (纯文学)
(chapitre 62), c’est-à-dire la poésie, apanage de l’esprit
lettré le plus noble et le plus raffiné.
5.
Ordination
Dans le même ordre d’idées, à partir du chapitre 60, il poursuit
l’analyse de l’évolution de la littérature chinoise après la
mort de Mao. Citant
Wang Zengqi (汪曾祺)
comme auteur de référence, il dit au début du chapitre 64
:
八十年代开始有世俗之眼的作品,是汪曾祺先生的 《受戒》。
Au début des années
1980, il y a une œuvre à une coloration populaire, c’est [la
nouvelle] « Ordination » de Wang Zengqi.
Plusieurs lecteurs se sont arrêtés sur cette phrase, à juste
titre, en se demandant de quelle nouvelle il s’agissait
exactement. C’est un récit écrit en 1980, et traduit
« Initiation d’un jeune bonze » dans un recueil de onze
nouvelles de Wang Zengqi (outre un texte de présentation
autobiographique) paru en 1989 dans la collection Panda
.
C’est
une nouvelle
touchante dans sa simplicité : un jeune garçon devenu moine par
nécessité alimentaire suit sans se poser de questions le chemin
qui lui a été tracé par sa famille, mais accepte tout aussi
naturellement l’offre de mariage d’une ancienne compagne de jeux
de son enfance, Xiao Yingzi, rencontrée par hasard sur le bateau
qui l’emmène au monastère où il doit prononcer ses vœux, et
qu’il revoit régulièrement en marge de sa vie au monastère.
La nouvelle dépeint la vie des moines aussi bien que celle de la
famille de Yingzi, sans faire de séparation nette entre les
deux : toutes deux sont marquées par les mêmes fêtes et
traditions, rites religieux et gestes quotidiens. C’est en ce
sens qu’A Cheng peut en faire une nouvelle représentative du
renouveau de la littérature populaire après la mort de Mao.
« Pour moi, a dit Wang Zengqi, la nouvelle devrait ressembler à
une conversation que l’on peut avoir avec un ami sur des sujets
familiers. »
- xianhua xianshuo, aurait dit A Cheng…
On aura l’occasion de revenir sur Wang Zengqi lors de la
troisième séance de l’année du Club de lecture consacrée à
Shen Congwen (沈从文) :
Wang Zengqi était un de ses élèves et disciples.
Chaque page de Xianhua xianshuo se prêterait à des
analyses et commentaires du même ordre, du fait de leur
concision même.
Séances complémentaires de cinéma
Nous aurons en novembre deux séances de cinéma adaptées de deux
des nouvelles de la Trilogie des Rois, ce qui permettra de
revenir sur ces deux récits ; les projections auront lieu dans
la médiathèque du Centre culturel, dans le cadre des séances de
cinéma du samedi à 15 heures, et elles seront également ouvertes
à tous :
-
Le samedi 9 novembre :
Le
Roi des échecs《棋王》
de Teng Wenji
滕文骥,
1988.
-
Le samedi 16 novembre :
Le Roi des enfants
《孩子王》
de Chen Kaige
陈凯歌,
1987.
Il manquait jusqu’ici une adaptation de la troisième nouvelle de
la trilogie, Le Roi des arbres (《树王》).
Tian Zhuangzhuang (田壮壮)
est en train de la tourner !
Prochaine séance
La prochaine séance du Club de lecture aura lieu le mardi 3
décembre et sera consacrée à l’écrivain
Lu
Wenfu (陆文夫),
auteur d’une œuvre tournée vers la peinture et la défense de la
culture raffinée des lettrés chinois qui était aussi la sienne
et qu’atteste son nom même : wenfu
文夫,
le maître des lettres !
Lectures proposées
Deux nouvelles moyennes (中篇小说)
traduites par Annie Curien et Feng Chen, parues chez Philippe
Picquier :
- Vie et passion d’un gastronome chinois (《美食家》),
roman, préface de Françoise Sabban, 1994, Picquier poche 1998,
187 p.
- Le Puits (《井》),
1998, 192 p.
Aux éditions Littérature chinoise de Pékin :
- Le Puits, éditions Littérature chinoise, collection Panda,
1998, recueil de six nouvelles :
Au fond de la ruelle《小巷深处》/
Le Puits《井》/
Le Gourmet《美食家》/
Le Mur《围墙》/ Une
ancienne famille de colporteurs《小贩世家》/
La sonnette《门铃》
Lecture complémentaire :
-
Nid d’hommes《人之窝》, roman
traduit du chinois par Chantal Chen-Andro, Seuil 2002, 720 p.
Séance complémentaire de cinéma
-
Le samedi 7 décembre, 15 h :
Le Puits《井》de
Li Yalin
李亚林,
1987.
Traduit « attractions » par Noël Dutrait.
|

