|
|
Brève histoire du
xiaoshuo et de ses diverses formes, de la nouvelle au roman
IV. Du chuanqi
des Tang au chuanqi des Ming
par
Brigitte Duzan, 28 novembre 2018
1.
Généralités
Sous les Ming, le chuanqi se mue en genre théâtral,
succédant au zaju (杂剧)
des Song et des Yuan : théâtre du Sud (nanxi
南戏)
aux mélodies plus douces qui se serait développé sous les Song
du Sud au 14e siècle, mais sans rupture avec le
zaju du Nord.
|
Il s’agit d’un théâtre littéraire. Si la pièce la
plus ancienne, « L’histoire du luth » (Pipa ji《琵琶记》),
est d’un auteur connu, Gao Ming (高明
1307-1371), qui fait la transition avec la période
Yuan, les premiers textes n’ont pas de
paternité définie, ce qui rapproche le genre de la
littérature populaire, et orale. Le sujet de ces
pièces est le plus souvent une histoire d’amour, les
dramaturges portant une |
|
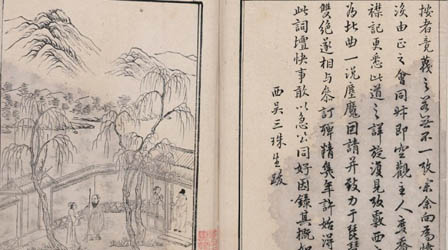
Histoire du luth |
attention particulière à la qualité littéraire des passages
chantés : l’écriture pour le théâtre devient un genre prisé
des lettrés, qui occupent souvent d’importantes fonctions
officielles.
Les pièces étaient ainsi conçues autant pour la lecture que pour
la représentation, et appréciées en tant qu’œuvres littéraires :
elles donnaient lieu à des éditions soignées, souvent
illustrées, tandis que, en général, seuls des extraits étaient
joués en raison de leur longueur.
|
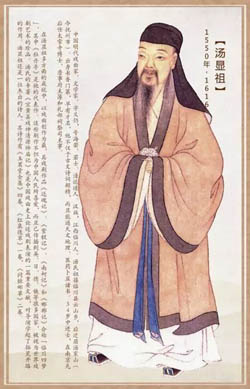
Tang Xianzu |
|
Deux écoles se sont ainsi constituées : l’une
attachée surtout à la prosodie et à la musique,
diverses adaptations musicales donnant naissance à
des variantes régionales. Ces opéras régionaux sont
désignés par le terme de qiang (腔),
littéralement « sonorité ». La synthèse de ces
différents styles donnera la forme la plus
prestigieuse et la plus raffinée, en lien étroit
avec la littérature : le kunqu (昆曲).
Pour l’autre école, c’est le texte qui primait. Elle
a connu son apogée au 17e siècle avec des
dramaturges célèbres, dont Tang Xianzu (汤显祖
1550-1616), mort la même année que Shakespeare,
auteur des « Quatre rêves de Yumintang » (玉茗堂四梦),
du nom de son studio, ou « Quatre rêves de
Linchuan » (临川四梦)
du nom de sa ville natale, le plus connu étant « Le
Pavillon aux pivoines » (Mudanting
《牡丹亭》),
l’un des grands classiques de la littérature
chinoise et l’une des plus belles pièces du
répertoire kunqu. |
Edition numérique
Les cinq drames du Sud
《三刻五種傳奇》
(Bibliothèque numérique mondiale)
Ouvrage qui contient cinq chuanqi, présentés avec un
commentaire de synthèse, une table des matières et des
illustrations d’époque.
1/ L’histoire du lavage de la soie (Huansha ji
《浣纱记》),
de Liang Chenyu (梁辰魚,
1519-1593), inspiré de Printemps et automnes des familles Wu
et Yue (《吴越春秋》),
histoire non officielle de la dynastie des Han de l’Est
attribuée à Zhao Ye (赵晔).
2/ L’histoire du sceau doré (Jinyin ji《金印记》),
de Su Fuzhi (苏复之),
dramaturge du début de la dynastie des Ming, histoire inspirée à
la fois des Stratégies des Royaumes combattants (Zhanguoce《战国策》)
et des Mémoires historiques (《史记》)
de
Sima Qian.
3/ L’histoire du sac embaumé (Xiangnang ji
《香嚢记》),
de Shao Can (1465-1505)
4/ L’histoire du manteau brodé (Xiuru ji
《绣襦记》),
de Xue Jingun (薛进衮),
histoire inspirée du chuanqi des Tang La Vie de Liwa
(李娃传)
de Bai Xingjian (白行简),
frère cadet du poète Bai Juyi (白居易).
5/ Les pleurs du phénix (Ming feng ji
《鸣凤记》),
de l’historien et lettré Wang Shizhen (王世贞
1526-1590)
A télécharger :
https://www.wdl.org/fr/item/15122/
Bibliographie
Le théâtre chinois, de Roger Darrobers, PUF coll. Que sais-je
(n° 2980), 1995.
Chine, l’opéra classique : Promenade au Jardin des poiriers, de
Jacques Pimpaneau, Les Belles Lettres, 2014.
2.
Un chuanqi adapté
à l’opéra : « La Princesse Baihua », ou l’opéra comme soft
power.
|
|

