|
|
La littérature chinoise au
vingtième siècle
III bis. Haipai
/Jingpai ou le dualisme en littérature : Explications
par Brigitte Duzan, 23 juillet
2010
2. Le haipai
Le terme de haipai
est ainsi apparu dans l’histoire de la littérature chinoise
comme un label déprécié, une mentalité mercantile et vulgaire,
cultivant bassement les goûts les plus vils des nouvelles
classes de la société urbaine et de ses lecteurs. Mais ce n’est
pas seulement cela : le haipai recouvre aussi tout un pan
de littérature d’avant-garde, tant il est vrai que s’y côtoient
toujours le pire et le meilleur.
a)
L’ancien haipai
|
A l’origine,
cette littérature était le produit
d’une culture qui
était une culture de consommation avant la lettre et
avait pour centre l’actuelle rue de Fuzhou (福州路),
appelée au dix-neuvième siècle ‘Quatrième avenue’ (四马路)
(1). Au
début du vingtième siècle, la rue était célèbre pour ses
quelque cent cinquante ‘maisons de thé’ (茶肆)
qui étaient en fait des maisons de passe aux statuts
très hiérarchisés, identifiées par des bannières aux
couleurs racoleuses et aux noms évocateurs : c’était le
‘red district’ de |
|
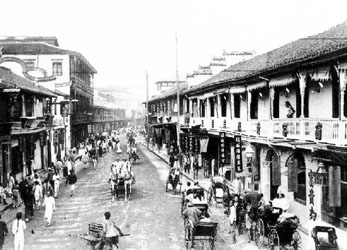
‘Quatrième avenue’
(四马路) |
Shanghai, descendant
direct des divertissements de la Chine ancienne tels qu’ils
apparaissent dans les romans Ming et Qing.
|
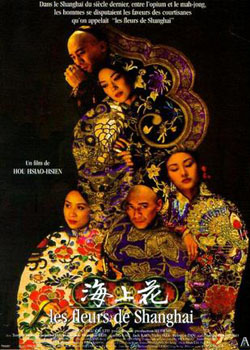
« Fleurs de Shanghai »
(《海上花》) |
|
Cette première
littérature haipai, née aux alentours des années
1880, reprenait le schéma classique des histoires de
« lettrés talentueux et belles dames » (才子佳人), en suivant les
intrigues des maisons de thé dont elle donnait
l’image
romantique de lieux privilégiés où pouvaient
librement se dérouler des histoires d’amour tout autant que des
discussions d’affaires. Tout cela était écrit et lu pour
se divertir et, bien sûr, de même qu’il y avait toute
une hiérarchie de maisons de thé et de courtisanes, il y
avait aussi, dans ces romans, une diversité qui
répondait au niveau de la clientèle et des maisons
qu’elle fréquentait.
C’est ce qu’on a appelé « romans de
courtisanes ».
Han Bangqing (韩邦庆
) , avec sa « Biographie des fleurs de Shanghai » (《海上花列传》)
en est le représentant emblématique, surtout depuis que
le roman, écrit en langue de wu, a été traduit en
mandarin par
|
Zhang Ailing (张爱玲)
puis adapté, en
1998, au cinéma par Hou Hsiao-hsien sous le titre « Fleurs de
Shanghai »
(《海上花》).
Mais il est une autre œuvre du
même genre qui a connu récemment
|
une
nouvelle notoriété,
c’est celui de Sun Yusheng (孙玉生), publié au tournant du siècle sous le nom de
Sun Jiazhen (孙家振) :
« Rêves de prospérité à Shanghai » (《海上繁华梦》).
C’est
Wang
Anyi
(王安忆)
qui lui a rendu un hommage indirect en reprenant le
titre pour l’un de ses romans, se plaçant ainsi
implicitement et dans la lignée du haipai et dans
la continuation de sa consœur, bien qu’elle s’en soit
toujours défendue.
Cette culture
du haipai de la fin des Qing était une survivance
de ce que les historiens chinois appellent la Chine
féodale. Après la Révolution de 1911 apparut un
littérature particulièrement orientée vers le public
populaire, des histoires d’amour le plus souvent
tragiques entre de pauvres lettrés et de jeunes beautés,
que la génération du 4 mai, ensuite, qualifia avec
mépris de « littérature canards mandarins et papillons »
(鸳鸯蝴蝶派)
pour son sentimentalisme simpliste. |
|
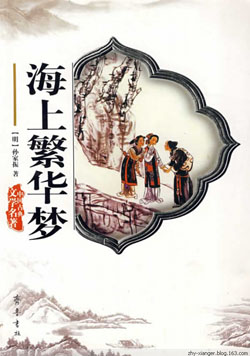
« Rêves de prospérité à
Shanghai »
(《海上繁华梦》) |
|
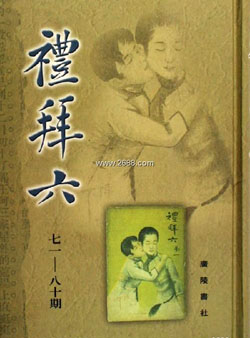
‘Samedi’
(《礼拜六》) |
|
Cette
littérature de pur divertissement (3), qui finit par
englober toutes sortes d’œuvres de second ordre, romans
policiers, aventures de chevaliers errants et,
inévitablement, romans à scandale, était publiée, dans
la grande tradition, sous forme de feuilletons, dans des
feuilles de chou aux noms aussi racoleurs que leur
contenu : ‘Samedi’
(《礼拜六》), créée en juin 1914, ou ‘Gaieté’ (《快活》),
créée en 1922. Mais l’avantage était que les auteurs
avaient ainsi des revenus stables qui leur permettaient
de vivre.
Certains de ces
auteurs sont restés dans les annales : Bao Tianxiao
(包天笑),
par exemple, dont le pseudonyme est déjà une profession
de foi (rire avec le ciel), et qui fut aussi traducteur
et éditeur ; ou Cheng Xiaoqing (程小青) qui, lui, adapta les
intrigues policières de Conan Doyle, en
|
créant en 1914 le personnage
de Huosang (霍桑)
qui est un
double de Sherlock Holmes, mais aussi un avatar du classique
juge Bao (包公).
|
Conan Doyle
avait été traduit en chinois dès la fin du 19ème
siècle, et c’est le très sérieux Liang Qichao (梁启超)
qui
avait été le premier à en publier des traductions en
Chine, au tournant du siècle (4)
.
Cheng Xiaoqing publia plus de soixante enquêtes de
Huosang (nouvelles et romans), mais écrivit aussi des
essais théoriques sur le roman policier, publiés en
trois volumes sous le titre « Techniques scientifiques
d’enquête » (《科学的侦探书》).
Les
aventures de Huosang seront publiées jusqu’au début des
années quarante dans divers journaux spécialisés dans le
genre policier, avant de retrouver une nouvelle vogue
actuellement, y compris aux Etats-Unis. |
|
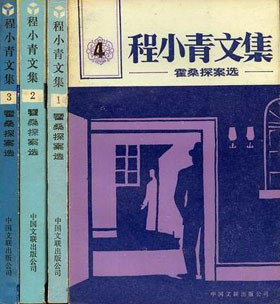
Cheng Xiaoqing
(程小青)
|
Il y eut bien, par
ailleurs, ce que l’on pourrait appeler une variante
« révolutionnaire » du genre des
« lettrés
talentueux et belles dames ». Elle fut initiée par
Yu Dafu (郁达夫),
chef de file de la société
|
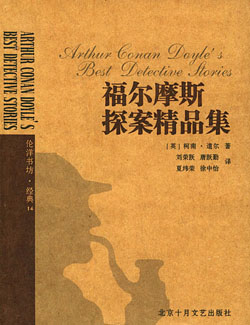
Conan Doyle en chinois |
|
Création,
avec sa nouvelle « Nuit d’ivresse printanière »
(《春风沉醉的晚上》,
publiée en 1923. Yu Dafu n’avait pas une grande estime
ni pour Shanghai ni pour la société shanghaienne, mais
sa nouvelle fit des émules. Elle reprenait le schéma
traditionnel en transformant le lettré talentueux en un
intellectuel miteux tentant péniblement de vendre
quelques poèmes pour survivre, et la belle dame en une
ouvrière travaillant dans une usine de cigarettes, les
deux communiant dans une affection fondée sur
l’entraide.
On est
cependant là en marge du haipai qui est, par sa
nature même, étranger à la littérature révolutionnaire
dont Shanghai devint le foyer à la fin des années vingt
par un alea de l’histoire. Cela n’a pas empêché
le haipai de prospérer, mais sous un jour
nouveau, sous l’effet des changements socio-économiques. |
b) Le
nouveau haipai des années trente
|
Les années
1920-30, à Shanghai, sont en effet la période où se
forme et se développe le cadre d’une culture de
consommation moderne : alors que le reste de la Chine
est aux mains des seigneurs de guerre, c’est l’époque où
Shanghai se bâtit un empire financier et commercial,
attirant les banques, les affairistes et les commerçants
du monde entier, les aventuriers aussi, devenant dans
l’imagerie populaire « le Paris de l’Orient ».
C’est l’époque
où l’architecture reflète les nouvelles classes
urbaines : commence à se construire le quartier
‘commercial et culturel’ de Nanjing lu (南京路)
avec ses quatre grands magasins, dont l’un des deux
précurseurs, établi dès 1918, Wing On, filiale d’une
compagnie de Hong Kong (永安),
est tout à fait caractéristique, avec hôtel, salon de
thé, toit-terrasse et salle de danse dans le même
bâtiment ; aux grands magasins se joignent de nouveaux
lieux de divertissement, comme le grand théâtre |
|

Nangjing Lu, années 1920 |
Da Guangming
(大光明),
œuvre de l’architecte Le Hudec aujourd’hui défigurée et
transformée en cinéma, ou le top du top, le dancing du Paramount
(百乐门)
avec son hall
d’entrée art déco et, déjà, l’air conditionné.
|

Le Da Guangming aujourd’hui, défiguré par
la fièvre immobilière |
|
C’est l‘époque
mythique où Du Yuesheng (杜月笙),
le chef de la Bande verte (青帮),
organise des réceptions dans les salons privés des
étages supérieurs du Paramount, tandis que se
développent non loin de là les studios qui tournent les
grands films de l’âge d’or du cinéma chinois qui, eux,
mettent en scène les laissés pour compte de cette
croissance effrénée et l’extrême misère que côtoie ce
luxe tapageur.
C’est
l’évolution de la sociologie urbaine et des modes de
consommation qui a entraîné cette frénésie
architecturale : toute cette architecture inspirée de
l’art déco français et du sytle jazzy américain,
panachée d’éléments décoratifs chinois, cela aussi,
c’est ce qu’on appelle le haipai. Et ce sont ces
mêmes facteurs qui, provoquant une évolution parallèle
du lectorat, ont entraîné une mutation, sinon une
rupture, dans la tradition littéraire du haipai :
elle s’est |
alors scindée en deux
courants, l’un cultivant les goûts les plus bas et les plus
superficiels, jusqu’à dégénérer parfois en une littérature
racoleuse de sexe et de violence, l’autre visant à satisfaire la
passion de la mode et de l’inédit des nouvelles classes
urbaines, pour tendre vers une littérature d’avant-garde.
|
C’est ce que
l’éminent spécialiste (pékinois) d’études comparatives
jingpai/haipai, le professeur Wu Fuhui, a appelé
« le haipai décadent » et « le haipai
montant » (2), l’un étant de facto supposé vulgaire, et
l’autre distingué. Gardons ces termes, ils ne
s’inventent pas. Entre les deux, cependant, il y a tout
un courant intermédiaire, ni racoleur ni élitiste, qui
rassemblait la majeure partie des écrivains.
1. Le
haipai « décadent »
Peu de ces
auteurs sont passés à la postérité, ne
serait-ce que
parce que nombre d’entre eux se contentaient d’écrire
dans l’anonymat pour magazines et tabloïds populaires
qui attiraient le lecteur par des |
|

Le Paramount
(百乐门) |
potins et bruits divers, y
compris sur la vie d’acteurs ou de personnages connus, par des
histoires drôles, rubriques de loisir et histoires d’amour,
voire érotiques, autant de journaux dirigés, effectivement, par
ce que Shen Congwen appelait des « dilettantes » (白相人).
|

Zhang Kebiao
(章克标) |
|
Ces romans
populaires ne s’élèvent guère, le plus souvent,
au-dessus du niveau de la presse du cœur, avec des
intrigues à faire pleurer Margot qui reprennent les
traditionnelles histoires « féodales » de jeunes gens
mariés contre leur volonté par leurs parents, mais qui,
maintenant, refusent de se soumettre, tout en étant, ce
faisant, plongés dans le désarroi, ou qui modernisent
des intrigues classiques en les inversant, comme
l’histoire de cette jeune femme confrontée à la colère
de ses amants qui se demande pourquoi ils ne veulent pas
la partager entre eux.
C’est le genre
d’histoires typiques qu’écrivait un auteur comme
Zhang Kebiao (章克标),
célébré lors de sa mort, à l’âge de cent huit ans, en
janvier 2007, comme le « dernier écrivain haipai
des années trente ». Il eut aussi une importante
activité journalistique et éditoriale. Il fut en
particulier en charge de la rubrique |
« libres discussions » (“自由谈”)
du magazine Shenbao (《申报》),
rubrique créée en 1911 qui servit au départ de porte parole aux
écrivains du mouvement des « canards mandarins et papillons ».
Il est célèbre
pour s’être bassement vengé de son échec auprès d’une jeune
femme qu’il courtisait en dévoilant dans un de ses romans sa
liaison avec Yu Dafu : il donna au personnage principal du roman
le nom à peine déguisé de son rival et en décrivit abondamment
les rêves érotiques.
|
Parmi ces
auteurs populaires, il en est un dont le nom est resté
comme l’emblème du pire de ce que l’on peut faire dans
le genre ; c’est un écrivain qui était au départ un
brillant élément de la société « Création » dont il
avait été
l’un des
co-fondateurs : Zhang Ziping (张资平).En 1926, il se tourna vers la littérature populaire, en publiant un
roman qui fut un incroyable succès de librairie :
《飞絮》
(fēixù :
chatons de saule virevoltants), et fut même ensuite
adapté au cinéma en 1933. Par la suite, il écrivit
régulièrement des histoires de ménages à trois,
teintées d’érotisme et rehaussées d’incestes et autres
perversions sexuelles, et en publia un certain nombre
lui-même, dans la maison d’édition qu’il avait
créée (appelée "乐群书店" :
au plaisir des masses) et qui incluait un mensuel du
même nom, ce qui lui permettait d’engranger directement
les |
|

Zhang Ziping
(张资平) |
bénéfices. Toutes choses qui firent dire à Lu
Xun que ses romans pouvaient se résumer à un triangle amoureux (张资平氏先前是三角恋爱小说作家)
et qu’il n’était
guère plus qu’un commerçant des lettres attiré par l’odeur de
l’argent.
Pendant la guerre de
résistance contre le Japon, il exécuta une autre volte-face : il
travailla avec le collaborateur Wang Jingwei, et publia un
journal pour l’association culturelle sino-japonaise. On ne peut
s’empêcher de penser que Lu Xun et Shen Congwen n’avaient
peut-être pas totalement tort en le considérant comme un
personnage sans beaucoup de scrupules. En tout cas, il
représente certainement le côté « voyou » du haipai
qu’ils déploraient tous deux.
C’est cet aspect du
haipai que visait le poème « Impression de Shanghai » (《上海印象》)
de Guo Moruo (郭沫若) où
il dépeignait une ville pleine de « cadavres ambulants et chairs
obscènes » (“游闲的尸,淫嚣的肉”).Mais
ce n’est pas le seul.
2. Le haipai
« montant »
|

Liu Na’ou
(刘呐鸥) |
|
A l’autre
extrême, il y eut un mouvement fugace mais brillant,
original et innovant, que l’on désigne du terme de « néo-sensationnisme »
(新感觉派),
terme importé du Japon par l’un de ses représentants les
plus éminents, Liu Na’ou
(刘呐鸥)Taiwanais de mère japonaise, il avait fait ses études au Japon avant de
venir à Shanghai en 1924 étudier le français à
l’université jésuite l’Aurore dont il suivit les cours
jusqu’en 1927, se liant là d’amitié avec d’autres
membres qui illustreront le mouvement, dont Shi Zhecun (施蛰存).
Il mourut
assassiné en 1939, à l’âge de trente neuf ans, mais
réussit en une carrière aussi courte à créer les bases
d’un genre qui lui-même dura peu, mais est
indissociablement lié au meilleur du haipai. Le
néo-sensationnisme a d’abord été associé à l’écrivain
japonais Yokomitsu Riichi ; il fonda en 1924, avec dix
|
autres écrivains, dont
Kawabata Yasunari, une revue dans laquelle il publia une
nouvelle intitulée « La
Tête aussi bien que le ventre » qui fait figure de naissance du
mouvement. Influencées par le symbolisme, ses œuvres sont alors
caractérisées par une mosaïque d'impressions et de
sensations qui évoquent l'insignifiance et la précarité de
l’existence humaine ; il innova ensuite en abordant le genre du
récit psychologique avec des phrases longues et une diversité de
voix intérieures.
|
C’est un
recueil de nouvelles japonaises traduites par Liu Na’ou
sous le titre « La culture de l’érotisme » (《色情文化》)
qui peut être considéré comme le précurseur du mouvement
à Shanghai. Il s’y élargit là sous l’influence du
modernisme européen sous toutes ses formes, non
seulement le symbolisme, mais aussi le surréalisme,
l’expressionnisme ou le cubisme, tous styles
particulièrement adaptés à la représentation des rythmes
de vie urbains, et en particulier ceux de la métropole
effervescente qu’était Shanghai. L’unique recueil de
Liu
Na’ou s’intitule « Panorama de la cité » (《都市风景线》):
c’est une cité
pleine de ‘modern girls’, qui se veulent affranchies
mais sont surtout très superficielles, et ressemblent
déjà comme des petites sœurs aux jeunes Shanghaiennes
d’aujourd’hui courant boutiques et nightclubs à la mode,
et affichant à tous vents leur liberté sexuelle. |
|
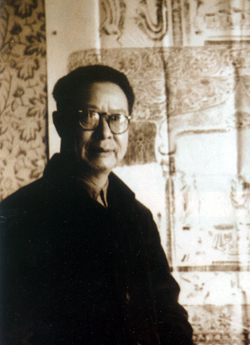
Shi Zhecun
(施蛰存) |
Shi Zhecun (施蛰存),
lui, s’est intéressé à la mentalité shanghaienne : pour peindre
les états d’âme de tous ces citadins récemment transplantés,
confrontés aux difficultés de l’existence urbaine nées de
l’isolement et du
déracinement, il utilise des éléments de psychologie freudienne
et les techniques du monologue intérieur propres au ‘courant de
conscience’ (意识流)
qui était en train de se développer dans la littérature
occidentale. Dans sa
revue ‘Xiandai’, sous-titrée ‘Les cosmopolitains’ (《现代》), éditée de 1932 à 1935,
il a résumé, dans un texte explicatif concernant les poèmes
qu’il y publiait (又关于本刊中的诗),
les principes de
base qui peuvent s’appliquer généralement à
son esthétique
littéraire :
“《现代》中的诗…
是现代人在现代生活中所感受到的现代的情绪用现代的词藻排列成的现代的诗形。……
les poèmes publiés dans « Xiandai » … sont une forme poétique moderne
utilisant un style moderne pour exprimer les sentiments modernes
ressentis par l’homme moderne dans la vie moderne. »
|

Mu Shiying
(穆时英) |
|
C’est cependant
dans les nouvelles de Mu Shiying (穆时英)
que ce néo-sensationnisme shanghaien atteint sans doute
son expression la plus élaborée. En 1930, Mu Shiying
avait envoyé une nouvelle intitulée « Notre monde » (《咱们的世界》)
au
magazine littéraire ‘Littérature et arts nouveaux’ (《新文艺》) qui fut édité de 1929 à
1930 par Shi Zhecun et Liu Na’ou. La nouvelle fit
sensation dans le groupe, et Mu Shiying devint le
protégé du premier tout en gardant des liens d’amitié
avec le second qui habitait la maison à côté de la
sienne. Il se lança alors dans des expérimentations
formelles, jusqu’en 1937 : pour échapper à la guerre, il
partit alors à Hong Kong ; quand il revint deux ans plus
tard, ce fut pour collaborer avec le gouvernement
pro-japonais de Nankin, sombrer dans une vie de dandy
nihiliste et finir assassiné, après son ami Liu Na’ou,
en juin |
1940. Lui aussi a donc
eu une courte carrière, mais prolifique.
Dans ses nouvelles, il
décrit la ville des grandes artères et des espaces publics,
partout où s’exhibe la vie et où elle se met en scène ; le
rythme syncopé des phrases, les répétitions, toutes sortes de
métaphores et allitérations traduisent le tourbillon dans lequel
sont prises les existences de chacun, sans pouvoir vraiment
contrôler ni le temps et ni les événement, comme dans « Le fox
trot de Shanghai » (《上海的狐步舞》).
C’est par ailleurs un univers citadin qui rejoint celui des
courtisanes du début du siècle, comme lui centré sur les lieux
de plaisir, mais un univers beaucoup plus crû d’où tout
romantisme a disparu : constellé d’éléments érotiques (souvent
sous forme de citations de chansons) et de descriptions
sexuelles comme autant de vignettes d’un collage cubiste.
En même temps, c’est
un style inspiré du cinéma, divertissement qui faisait
alors fureur à Shanghai et art dont tous ces auteurs étaient
passionnés. Liu Na’ou en fut même un théoricien, écrivant nombre
d’articles sur le
sujet dans les revues et suppléments spécialisés qui existaient
dans cette ville du cinéma qu’était Shanghai. Il a même traduit
le livre, publié à Berlin en 1932, du théoricien américain
d’origine allemande
Rudolf Arnheim : « Film as Kunst » (Du cinéma comme art :
《艺术电影论》) (5).
Il ne faisait
d’ailleurs en cela que s’inspirer du
néo-sensationnisme
japonais qui s’était doublé d’une expérimentation dans le
domaine cinématographique, sous l’égide du réalisateur Teinosuke
Kinugasa, auteur de deux films dans ce cadre : « Une page
folle » (《疯狂的一页》)
, film muet de
1926, et, deux ans plus tard, « Carrefour » (《十字路》)
où il dépeint l’effervescence factice du quartier de Yoshiwara,
célèbre quartier des plaisirs de Tokyo qui deviendra ensuite le
décor favori des films sur la prostitution féminine de
Mizoguchi (6) : c’est tout à fait l’univers de la littérature du
haipai, tout particulièrement dans sa version
néo-sensationniste. Mais, dans ce cas, c’est la littérature qui
avait inspiré le cinéma, à Shanghai c’est l’inverse.
Cependant, c’est
surtout le cinéma hollywoodien et ses stars qui fournissent à
tous ces auteurs, et à Mu Shiying en particulier, les modèles
des femmes modernes de leurs nouvelles. Ce qui est peut-être le
plus intéressant, c’est l’apport des techniques
cinématographiques à la structure narrative et au style, et,
dans ce domaine, les recherches de
Liu Na’ou ont été de
première importance. Son principal apport est sans doute la
théorie du « mouvement continuel des points de vue », chaque
mouvement de la caméra équivalant à un point de vue, ce qui se
traduit dans l’écriture romanesque par une rupture stylistique,
en s’attaquant au fondement de la narration réaliste
traditionnelle à la Balzac : la continuité. Il avait repris cela
entre autres de l’ouvrage d’Arnheim qui postule l’absence de
continuité spatio-temporelle au cinéma.
On retrouve cette
caractéristique dans les nouvelles néo-sensationnistes
où elle se traduit dans
l’émiettement de la
forme : émiettement de l’intrigue et émiettement du texte qui
finit par ressembler à un scénario, certaines nouvelles étant
ainsi découpées en séquences, la narration procédant par images
successives rendues dans un style elliptique, les meilleurs
exemples en étant les deux nouvelles de Mu Shiying : « Le
fox-trot de Shanghai » déjà cité et « Les cinq personnages dans
un night-club » (《夜总会里的五个人》)
(7).
Ce courant du haipai
était donc bien un mouvement moderniste différent de l’image
caricaturale du haipai véhiculée par ses pourfendeurs du
Nord, mais qui en reprend les grands thèmes et s’adresse
toujours à un public urbain et populaire.
c) La
continuité du haipai
Le haipai
littéraire s’est ainsi peu à peu formé autour de thèmes où sexe
et amour forment une base incontournable, mais qui prennent des
formes plus ou moins provocantes ou vulgaires selon les auteurs,
et la tranche du public à laquelle ils s’adressent. A partir des
années quarante, on retrouve constamment ce mélange d’auteurs
racoleurs et d’œuvres triviales, alternant avec des écrivains
novateurs dont l’œuvre constitue une page de l’histoire de la
littérature chinoise, avec au milieu toute une foule
d’écrivains, beaucoup féminins, qui restent secondaires mais
apportent leur contribution à
l’évolution du genre et
témoignent de l’évolution des mentalités.
Zhang Ailing
(张爱玲)
est celle qui a marqué le haipai à partir des années
quarante. Elle en a le mélange caractéristique de sinité et de
modernisme occidental qui concourt à la réussite de ses œuvres.
Vers la fin de sa vie, elle a elle-même rendu hommage à celui
qui en est considéré comme la figure tutélaire du haipai,
Han Bangqing, en traduisant en mandarin sa
« Biographie des fleurs
de Shanghai ». Ses premières œuvres furent d’ailleurs publiées
dans des revues du courant « canards mandarins et papillons ».
C’est
Wang Anyi
(王安忆),
aujourd’hui présidente de l’association des écrivains de
Shanghai, qui a ensuite, en quelque sorte, pris le relais : on a
dit qu’elle dépeignait dans ses romans et nouvelles des
personnages de Zhang Ailing qui seraient restés à Shanghai après
la Révolution culturelle. C’est un peu réducteur, mais, comme
tout propos réducteur, il a sa part de vérité symbolique.
Ces deux auteurs
méritent deux dossiers à part entière, à côté d’autres de la
nouvelle génération :
Cheng Naishan
(程乃珊),
Chen Danyan (陈丹燕)
et d’autres encore qu’il s’agira de découvrir au hasard des
rencontres.
Ces écrivains
représentent le courant « distingué »
du haipai, à côté de la persistance du courant
« décadent » représenté aujourd’hui par ces « romancières de
Shanghai » dont les seules qualités résident dans leurs
provocations, d’autant plus insolentes qu’elles sont écrites à
la première personne :
Mian Mian (棉棉)
et Weihui (周卫慧).
Comme aurait dit Shen Congwen, cela aussi, c’est ce qu’on
appelle le haipai …
Notes
(1) Il y
a d’ailleurs un livre
sur la rue dont le titre même rappelle cette origine :
《老上海四马路(老上海海派特色文化的一条街)》,
la Quatrième avenue, une rue du vieux Shanghai empreinte de
culture haipai.
Il a été
publié en 2001 et fait partie du nouvel engouement pour le
haipai, sur fond de nostalgie des années trente.
(2) Dans son chapitre
sur le sujet dans « « Pékin-Shanghai,
tradition et modernité dans la littérature chinoise des années
trente », p. 221 (voir bibliographie ci-dessous)
(3) Dont les tenants de la littérature du 4 mai n’ont pas manqué de
souligner qu’elle n’avait rien à voir avec la noble tradition du
dilettante éclairé qui pratiquait son art pour le plaisir (“游戏消闲”).
Et de souligner, lorsque sortit ‘Gaieté’, que ce monde de misère n’avait
rien de gai…
(4) D’après la
thèse d’Annabela Weisl : « Cheng Xiaoqing (1893-1976) and His
Detective Stories in Modern Shanghai»
(Grin Verlag, 2010)
(5) C’est son premier livre important, et celui où il jetait les
bases de sa psychologie de l’expérience visuelle. Ce qui est
assez étonnant, c’est que le livre fut publié juste avant
l’accession de Hitler au pouvoir, et, comme Arnheim était juif,
le livre fut retiré de la circulation. Il fallait avoir une
connaissance pointue du milieu cinématographique pour
s’intéresser à ce texte et le traduire.
(6) Pour la petite histoire, ce fut le premier film japonais à être
projeté en Occident, et, à Paris, ce fut au studio des
Ursulines.
(7) Voir l’analyse détaillée dans le dernier chapitre du livre
« Pékin-Shanghai » mentionné dans la bibliographie ci-dessous :
« Le
néo-sensationnisme et le cinéma », par Li Jin.
Bibliographie
sommaire
|
 |
« Shanghai : histoire, promenades, anthologie et dictionnaire »
sous la direction de Nicolas Idier (Robert Laffont,
collection Bouquins, 2010) – en particulier : « Les
écrivains chinois de Shanghai, d’hier à aujourd’hui »
par Isabelle Rabut (p. 497) et « Le haipai : style art
déco shanghaien » dans le chapitre « De la technologie
aux arts déco » par Nathalie Delande-Liu (p. 395). La
photo de couverture, à elle seule, est la plus belle
illustration de l’esprit du
haipai. |
|
 |
« Ecrire au
présent, débats littéraires franco-chinois » textes
réunis et présentés
par
Annie Curien (éditions MSH, 2004) – chapitre 2 : « Deux
courants de la littérature du haipai » par Chen
Sihe (p. 103-118). |
|
 |
« Pékin-Shanghai, tradition et modernité dans la littérature
chinoise des années trente », sous la direction
d’Isabelle Rabut et Angel Pino (éditions Bleu de Chine,
2000) |
|
 |
« Shanghai
modern: the flowering of a new urban culture in China,
1930-1945
»
par Leo Ou-fan Lee (Harvard University Press, 1999)
|
|
|

Shanghai (collection Bouquins) |
Traductions
|
 |
« Le
Fox-trot de Shanghai et autres nouvelles chinoises » traduites
par Isabelle Rabut et Angel Pino (Albin Michel 1996).
(Texte
chinois de la nouvelle du titre :
http://zhidao.baidu.com/question/132032360.html)
|
|
 |
Dans la
partie « Anthologie » du « Shanghai » de la collection Bouquins
cité ci-dessus : douze nouvelles publiées entre 1916 et 2006,
dont une histoire policière de Cheng Xiaoqing et les « Cinq
personnages dans un night club » de Mu Shiying.
|
|
|

