|
|
Yang Xianyi :
traducteur littéraire hors normes, fondateur de la collection
Panda
par Brigitte Duzan, 19 septembre
2010
|
Pendant les
dernières années de la vie de Mao Zedong, la littérature
avait pour mission quasi exclusive, même dans le domaine
de la fiction, de servir de porte parole à l’extrême
gauche qui dominait la vie politique. C’était
notoirement terne et ennuyeux, y compris les traductions
en langue anglaise qui paraissaient dans le mensuel
« Chinese Literature » (中国文学),
créé en 1951 pour faire connaître au monde la
littérature chinoise.
La collection Panda
Après la mort
de Mao, les rédacteurs de « Chinese literature »
entreprirent de dégager le travail de traduction de sa
gangue de bois tout en renouvelant et modernisant
l’éventail des œuvres traduites. Avec le développement
de la politique d’ouverture, naquit en 1981 la
collection Panda (熊猫丛书),
conçue en imitation de la collection britannique |
|
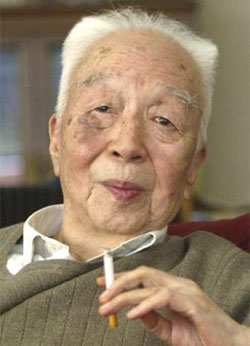
Yang Xianyi
(杨宪益)
en 2006 |
Penguin, y compris le
logo, un panda remplaçant le pingouin dans quasiment le même
médaillon ovale.
La collection a fait un
remarquable travail de défrichage et de vulgarisation. Les
grandes œuvres classiques, et les œuvres modernes considérées
comme les plus représentatives, en particulier de nombreux
recueils de nouvelles, ont ainsi été traduites en anglais et
publiées.
Les meilleures
traductions ont pendant longtemps été celles réalisées, en
collaboration avec son épouse, par un personnage hors du commun,
décédé il y a peu, en novembre 2009, à près de 95 ans : Yang
Xianyi (杨宪益).
Yang Xianyi
Enfance à Tianjin
|

Photo d'enfence |
|
Il est né à
Tianjin en janvier 1915, fils unique d’une famille
éminente de la ville. Son grand-père avait été
gouverneur provincial, et son père l’un des dirigeants
de la Banque de Chine à Tianjin. On dit qu’il avait
amassé une fortune en partie grâce aux affaires traitées
avec les seigneurs de guerre du Nord. Il mourut
cependant lorsque l’enfant n’avait encore que cinq ans,
le laissant aux soins de son épouse principale et de la
concubine qui lui avait donné le jour. Considérant les
deux femmes comme sa mère, l’enfant grandit choyé et
protégé, recevant une éducation traditionnelle de
tuteurs privés jusqu’à l’âge de douze ans.
Sa mère réussit
alors à convaincre l’épouse principale de lui permettre
d’aller à l’école. Comme une éducation cosmopolite était
alors à la mode dans les milieux huppés, c’est une école
de missionnaires qui fut choisie : le collège
|
anglo-chinois
de Tianjin. Par
patriotisme, le jeune Yang Xianyi refusa d’abord de prendre un
nom occidental, puis, comme son vieux professeur lui expliquait
qu’il devait le faire s’il voulait apprendre l’anglais, il
choisit le nom de Julien, en hommage à Julien l’Apostat,
l’empereur romain du quatrième siècle qui avait défendu, contre
le christianisme, un retour au paganisme et aux valeurs romaines
d’antan. Ce qui dénotait déjà, chez Yang Xianyi, outre une
certaine culture, un esprit original et attaché aux grandes
valeurs traditionnelles.
Il manifesta son
patriotisme à diverses reprises, en particulier lors de
l’invasion du Nord de la Chine par les Japonais, mais il était
surtout passionné de littérature ancienne, et c’est parce qu’il
ne trouvait pas de professeur de grec à Tianjin qu’il choisit de
partir continuer ses études en Angleterre.
Etudes et mariage
en Angleterre
|
Il partit en
1936 étudier au Merton College, à Oxford. Il y connut
Gladys Tayler, autre personnage hors du commun : née en
1919 à Pékin, où son père était missionnaire, elle était
revenue en 1926 en Angleterre poursuivre ses études, de
littérature chinoise. Ils étaient faits pour s’entendre.
Ils se fiancèrent.
Leur premier
travail en commun fut une traduction du célèbre poème de
Qu Yuan (屈原)
“Li
Sao” (《离骚》),
exprimant la douleur du poète exilé par le roi de Chu ;
Yang Xianyi, qui avait alors 24 ans, le traduisit en un long poème
épique dont le sinologue britannique David Hawkes dira
en riant qu’il avait autant de ressemblance avec
l’original qu’un œuf de Pâques avec une omelette. Mais
c’était un début.
Gladys Tayler
devint la première diplômée de littérature chinoise de
l’université d’Oxford. Une fois mariés, ils décidèrent
en 1940 de revenir en Chine, contre l’avis des parents
de Gladys, conscients des difficultés qui les
|
|
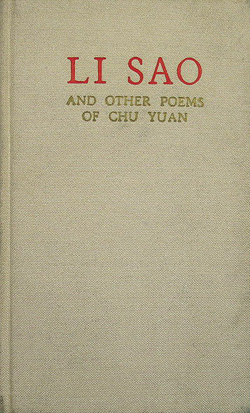
“Li Sao”
(《离骚》) |
attendaient dans une
Chine en guerre. Dans son autobiographie inachevée, Gladys Yang
a déclaré : « A l’encontre de bien des
amis étrangers, je ne suis pas allée en Chine pour la
révolution, ou par curiosité pour l’expérience de la vie en
Chine, mais par amour pour Yang Xianyi, pour les merveilleux
souvenirs que j’avais de mon enfance
à Pékin, et par admiration pour la culture chinoise. »
Retour en Chine
Ils arrivèrent en 1940
à Chongqing, alors capitale provisoire du gouvernement
nationaliste. La famille Yang était pratiquement ruinée, et Yang
Xianyi lui-même avait dilapidé son argent à Oxford en menant une
vie extravagante et dispendieuse. Il avait vendu ses livres pour
se renflouer un peu.
|

Les deux époux au moment de leur mariage
(Photo: Camden New Journal) |
|
Ils passèrent
les années de guerre à enseigner et à faire des
traductions, au début pour le gouvernement nationaliste,
mais ils furent bientôt attirés par la rhétorique
communiste ; finalement, lorsque les Nationalistes se
replièrent à Taiwan, ils proposèrent au couple de partir
sur un des vols affrétés par Tchang Kai-chek, mais ils
refusèrent. Ils descendirent le Yangzi jusqu’à Nankin,
sur une jonque en bois surchargée de réfugiés. Ils
perdirent tous leurs bagages lorsque coula la jonque qui
les transportait, mais ils arrivèrent sains et saufs,
avec leurs deux enfants. |
Au début, Yang Xianyi
fut honoré par le nouveau gouvernement chinois. En 1952, les
deux époux entrèrent aux Editions de la Presse étrangère, à
Pékin, chargés de la traduction en anglais des classiques
chinois. Ils traduisirent alors, outre, bien sûr, des œuvres de
propagande, « Le rêve dans le pavillon rouge » (《红楼梦》),
le roman de la dynastie des Qing paru en français sous le titre
« Chronique indiscrète des mandarins » (《儒林外史》)
et des œuvres de…
Lu Xun.
Mais le climat se
raidit peu à peu, fut de moins en moins favorable aux Chinois
qui avaient, comme lui, de nombreux contacts avec l’étranger, et
sa tendance à parler trop directement rendit Yang Xianyi
vulnérable aux attaques. Il se rendit compte que ses idées
n’étaient pas totalement conformes à la ligne officielle. Il
écrivit une série de livres sur les révoltes paysannes dans
l’histoire chinoise qui ne furent pas publiés, à l’exception de
celui sur la révolte des « Sourcils rouges » (1), car les
éditeurs trouvèrent que les paysans n’étaient pas décrits de
manière suffisamment héroïque, rapporte-t-il ironiquement dans
son autobiographie. Les deux époux continuaient cependant à
placer tous leurs espoirs dans le nouveau régime, même si
c’était avec quelques réserves.
A la fin des années
cinquante, Yang Xianyi était l’un des traducteurs littéraires
les plus éminents en Chine à cette époque, et l’un des plus
prolifiques. Travaillant, comme les autres, huit heures par jour
six jours sur sept, sans avoir un total contrôle sur le choix
des œuvres qu’il devait traduire, il utilisait ses loisirs à du
travail plus personnel : des articles sur la littérature
occidentale pour diverses revues, des traductions en chinois de
grands classiques occidentaux, voire, pour ses amis, des vers
satiriques dont il s’était fait une spécialité reconnue.
La Révolution
culturelle faillit être fatidique au couple.
Révolution
culturelle
Critiqué par ses
collègues, ostracisé, Yang Xianyi fit une dépression. Il
commença à entendre des voix, imaginant des ennemis cachés dans
l’appartement. Son épouse le voyait peu à peu sombrer dans la
folie. Ils furent finalement jetés en prison, mais pas au même
endroit, et ils restèrent ainsi séparés et sans nouvelles l’un
de l’autre pendant quatre ans. Dans son autobiographie, Yang
Xianyi a décrit a posteriori, avec son humour caractéristique,
des épisodes de sa vie en prison ; en réalité, ce fut une des
périodes les plus dures de son existence.
Qui plus est, leur fils
et leurs deux filles furent au même moment envoyés dans des
provinces éloignées travailler dans des fermes et des usines.
Leur fils en perdit la raison, ne guérit jamais, et se suicida
en 1979.
Et après
|
Après la mort
de Mao, les deux époux reprirent leur ancien mode de
vie, recevant beaucoup, leurs nombreux amis chinois et
étranger. Comme on leur régla les salaires impayés de
leurs années de prison, ils connurent une relative
aisance, s’achetèrent leur premier réfrigérateur et
aidèrent des amis, écrivains et artistes, qui avaient du
mal à écouler leurs œuvres dans un climat intellectuel
encore très statufié. Lorsque Yang Xianyi fut nommé
rédacteur en chef de la revue « Chinese Literature »,
qui avait été dirigée par Mao Dun jusqu’en 1966, il y
publia des traductions des |
|

Yang Xianyi et Gladys (photo Beijing
review) |
nouvelles et textes
représentatifs de la nouvelle littérature qui émergeait alors en
Chine. C’est en 1981 qu’il créa ensuite la collection Panda,
pour regrouper les traductions en anglais de textes classiques
contemporains dans une collection de poche de qualité, mais d’un
prix abordable, la revue « Chinese Literature » devenant
parallèlement trimestrielle.
Le couple recommença à
voyager à l’étranger, invité par des universités en Europe, au
Japon et en Inde. A nouveau plein d’espoir et optimiste quant à
l’avenir du pays, Yang Xianyi devint membre du Parti en 1985. Au
printemps 1989, cependant, il exprima publiquement son soutien
aux étudiants manifestant sur la place Tian’anmen, et fut
horrifié par le massacre du 4 juin qu’il dénonça dans des
entretiens téléphoniques avec des radios étrangères. Les deux
époux partirent se cacher quelques semaines, mais ne furent pas
inquiétés. Yang Xianyi voulut ensuite démissionner du Parti : on
lui répondit que c’était impossible, qu’il serait expulsé…
Après des années de
maladie, Gladys décéda en 1999. Yang Xianyi lui survécut dix
ans, tristement.
Une vie de
traductions
Ils ont toujours
travaillé ensemble : Yang Xianyi faisait une première ébauche,
que Gladys révisait ensuite, plusieurs fois, jusqu’à la version
finale.
Leur carrière débuta
réellement en 1943, lorsqu’ils furent invités à traduire des
classiques chinois à l’Institut national de compilation et
traduction, à Chongqing. Ils passèrent trois ans à traduire
l’œuvre monumentale de l’historien de la dynastie des Song Sima
Guang (司马光) :
le « Zishi Tongjian » ou « miroir général pour aider le
gouvernement » (《资治通鉴》),
ouvrage de référence de l’historiographie chinoise datant du
onzième siècle – 294 volumes, trois millions de caractères.
Ils perdirent le
manuscrit dans les turbulences de la guerre, mais cela détermina
ensuite leur parcours professionnel, qui commença en 1952
lorsqu’ils furent engagés par les Editions de la Presse
étrangère, à Pékin.
Les deux époux ont
réalisé la traduction des grands romans classiques chinois et
des œuvres notable de la période contemporaine, en particulier
un grand nombre de recueils de nouvelles. Outre leurs
traductions de textes chinois en anglais, ils traduisirent aussi
en chinois plusieurs grands classiques occidentaux comme
l’Odyssée d’Homère ou le Pygmalion de
George Bernard Shaw. Ils ont vraiment été un pont entre les deux
cultures à un moment crucial de l’histoire où la Chine s’ouvrait
au monde.
Le 17 septembre 2009,
deux mois avant sa mort, Yang Xiangyi fut couronné par
l’Association nationale des traducteurs chinois d’un prix venant
récompenser l’ensemble de son œuvre. Il était le second à
recevoir cette distinction, après l’indologiste Ji Xianlin
(季羡林).
|
Œuvres hors
traductions
Outre son
autobiographie, trois recueils d’écrits ‘au fil de la
plume’ et une nouvelle ‘de taille moyenne’ :
1947
《零墨新笺》
(随笔集)
(un peu
d’encre sur du papier neuf)
1950
《零墨续笺》
(随笔集)
(un peu d’encre sur quelques feuilles supplémentaires)
1957
《赤眉军》
(中篇小说)
« L’armée
des Sourcils rouges » (1)
1983
《译余偶拾》
(随笔集)
(bouts
de traductions ramassés au hasard)
Mars
2002 : « White Tiger », autobiographie (publiée en
chinois en février 2010 :
《杨宪益自传》)
|
|
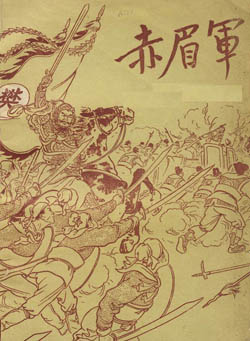
« L’armée des Sourcils
rouges »《赤眉军》 |
|
(Le titre
anglais est inspiré du rêve fait par sa mère avant sa
naissance « par lequel tout a commencé », dit-il : elle
avait rêvé qu’elle était assaillie par un tigre blanc ;
un devin y vit un signe à la fois auspicieux et néfaste,
l’enfant à naître n’aurait pas de frères et mettrait la
santé de son père en danger en naissant… mais il aurait
une carrière exceptionnelle après avoir connu bien des
malheurs)
Extraits :
www.amazon.com/White-Tiger-Autobiography-Yang-Xianyi/dp/9629960702#reader_9629960702
(dont une
galerie de photos dans la section « surprise me »)
(1) Mouvement
de révolte paysanne à la fin de la dynastie de Han
antérieurs (à partir de la fin de la première décennie
après Jésus-Christ), provoqué à la fois par les réformes
de l’usurpateur Wang Mang et par des inondations
dévastatrices du fleuve Jaune qui avaient entraîné
misère et famine dans la région du Shandong et du nord
du Jiangsu. |
|
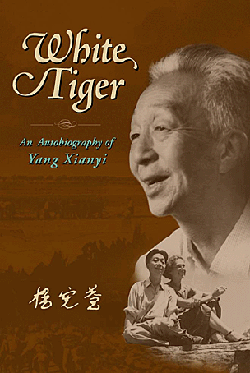 《杨宪益自传》
« White Tiger »
《杨宪益自传》
« White Tiger » |
|
|

