|
|
L’art perdu des
fours anciens :
la vie au village sur fond de Révolution culturelle, par Jia
Pingwa
par
Brigitte Duzan, 2 mars 2018, actualisé 1er octobre
2018
|
« L’art perdu des fours anciens » est la traduction
d’un roman de
Jia Pingwa (贾平凹)
paru aux éditions Littérature du peuple en 2012
:
une sorte de fable épique de quelque 670 000
caractères et plus de 600 pages dans son édition
originale, dont le titre chinois signifie Les
fours anciens (Gu
lu《古炉》)
– c’est en fait le nom d’un village perdu dans les
montagnes du Shaanxi dont le mode traditionnel de
subsistance était fondé sur ses anciens fours de
céramique.
Comme il est mentionné au dos de la page titre, la
traduction du roman a bénéficié d’une aide à la
traduction de l’éditeur chinois, Littérature du
peuple. Elle fait partie d’une offensive chinoise
visant à promouvoir les traductions de textes de Jia
Pingwa, peu traduits car réputés difficiles à
traduire, afin de le faire mieux connaître à
l’étranger.
La vie au village, au jour le jour
La survie d’abord |
|
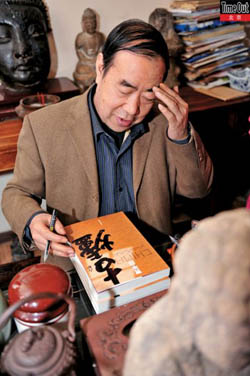
Jia Pingwa et son roman (photo
TimeOut) |
« L’art perdu des fours anciens » (《古炉》) aurait
pu être une énième histoire des désastres provoqués par la
Révolution culturelle, mais, sous la plume de Jia Pingwa, la
folie dévastatrice de la période va de pair avec les inondations
causées par les crues récurrentes de la rivière, les attaques
tout aussi récurrentes des hordes de loups qui rodent dans les
bois autour du village ou les épidémies venues de l’extérieur
que la médecine traditionnelle ne sait pas guérir. La Révolution
culturelle est un fléau de ce genre, apporté d’ailleurs,
extérieur au village, et incompréhensible de ce fait.
|

L’art perdu des fours anciens |
|
Ce n’est cependant pas le sujet principal ;
d’ailleurs, les trois cent cinquante premières pages
(sur les 1145 de la traduction) traitent de la vie
au village, vie immuable, comme vue au microscope ;
ce qui compte, c’est la répartition de l’aide
alimentaire venue du district qui va permettre aux
familles de survivre à l’hiver, ou l’application des
directives venues d’en haut, dont la construction de
terrasses cultivables selon le modèle de Dazhai…
bref, l’essentiel, c’est de trouver de quoi manger,
sur fond de traditions, de superstitions, et de
slogans. Et, dans ce contexte, les fours sont la
tradition la plus importante du village.
C’est par hasard que les villageois découvrent les
prémices de la Révolution culturelle, lorsque l’un
d’eux est envoyé au bourg sur le nouveau tracteur du
village, pour vendre des bols et des jarres de leur
production. Dans le bourg, c’est la pagaille, ils
peuvent à peine passer, les rues sont pleines de
jeunes qui défilent en brandissant des étendards
rouges et |
en criant des slogans. Et sur l’une des banderoles est
inscrit : « Vive la Grande Révolution culturelle. » Le mot
est lâché, mais la réalité mettra encore du temps à parvenir
jusqu’au village.
Et quand elle arrive, c’est par le biais de petits groupes
d’élèves qui débarquent à pied, comme des pèlerins, avec un
petit fanion rouge sur leur sac à dos. Commence alors une série
d’épisodes burlesques, les villageois devant « éliminer les
vieilleries », mais tournant au drame quand, emportés par le
désir frénétique de bien faire – et par les rivalités
personnelles, voire les inimitiés familiales – certains en
viennent à saccager les toits des plus belles maisons pour en
détruire les ornements sculptés.
Sur quoi ils passent à autre chose car il y a du travail à faire
dans les champs…
Comme le dit Wang Yiyan dans un essai biographique sur Jia
Pingwa et ses principaux romans
:
« Contrairement à d’autres romans dont l’histoire se situe
pendant la Révolution culturelle et qui traitent avant tout du
chaos et de la brutalité politiques caractéristiques de la
période, Gulu l’aborde comme toute autre période de
l’histoire chinoise, en mettant l’accent sur l’éternelle
priorité des paysans : les problèmes de la vie quotidienne. En
fait, le secrétaire du Parti communiste du village ne sait même
pas que des événements majeurs sont en cours, jusqu’à ce que des
jeunes Gardes rouges arrivent au village pour y semer le
désordre et recruter des membres. La routine de la vie au
village reste inchangée, avec les mêmes traditions ancestrales,
tandis que se déchaînent les vagues de tourmente politique. […]
La force de l’histoire réside dans la peinture des négociations
quotidiennes entre les exigences des autorités et celles de la
survie dans des conditions de pauvreté extrême. »
Des événements téléguidés de l’extérieur comme la Révolution
culturelle sont une catastrophe au niveau du village non tant
par les exactions commises, mais d’abord parce qu’ils ruinent la
paix fragile du village en faisant renaître les luttes entre
clans et en dressant les familles les unes contre les autres ;
finalement, en donnant la priorité aux luttes politiques, ils
provoquent la ruine de toute l’organisation économique du
village, et en premier lieu la fermeture des fours, avant
l’abandon des cultures. A la fin, toute l’énergie des villageois
passe dans la lutte – sanglante - contre le clan adverse, en de
multiples attaques et contre-attaques qui sont autant de gestes
de vengeance, ancrés, on le sent, dans une très vieille
histoire.
Traditions ancestrales et superstitions immémoriales
|
Cette histoire des modes de vie et mentalités
locales, c’est le sujet principal du roman. Chaque
page recèle une allusion à une croyance, un
développement sur une superstition, parce qu’elles
forment la trame même sur laquelle est bâtie une vie
soumise aux phénomènes naturels, inexpliqués mais
transcendés dans le rituel et le magique.
Premier phénomène naturel, d’abord, c’est le cycle
des saisons, d’où la construction du roman en six
parties comme autant de saisons, en commençant par
l’hiver et en s’achevant sur un bref printemps : la
vie finit toujours par renaître, même si c’est
d’abord pour panser les plaies de l’hiver.
Le roman dépeint des villageois dont les croyances
superstitieuses sont une marque de leur intégration
dans leur environnement naturel. Elles se traduisent
aussi bien dans des usages courants, comme
l’invocation de la divinité des fours, que dans des
pratiques de médecine traditionnelle, voire de
magie. |
|

Le roman Gulu (édition
chinoise,
Littérature du peuple 2012)
avec le mot China à côté du titre
chinois calligraphié par Jia Pingwa |
En même temps, ces croyances ancestrales sont complétées par
d’autres plus récentes, inculquées sous forme de slogans et mots
d’ordre, mais qui tiennent finalement du même esprit
irrationnel : la lutte des classes, et les mauvaises origines de
classe qui vous mettent au ban de la société, comme un décret du
ciel.
La Révolution culturelle au quotidien
C’est cette société dont Jia Pingwa nous dresse le tableau
minutieux, au ras du sol, au millimètre près, une société rurale
dont les caractéristiques essentielles sont la pauvreté et
l’ignorance, où la faim est tenace, la guerre entre les familles
toujours larvée, prête à s’enflammer au moindre soupçon de
faveur indûment obtenue, ou injustement refusée.
La Révolution culturelle vient embraser cet univers soumis aux
caprices de la nature et aux contraintes de la survie au
quotidien, en faisant passer la lutte politique au premier plan
et en ravivant les rivalités entre clans. Comme l’a dit un
critique du China Daily : « Le roman de Jia Pingwa vient remplir
un vide en littérature ; aucune œuvre, jusqu’ici, n’avait donné
une telle vision microscopique des destins de paysans ordinaires
pendant la Révolution culturelle. »
Cependant, Gulu n’est pas une histoire de la Révolution
culturelle au village, c’est une galerie de portraits de paysans
d’autant plus vrais qu’on les sent inspirés de personnages
réels, et finalement une exploration de la nature humaine qui
poursuit celle entreprise dans les romans précédents de Jia
Pingwa.
Exploration de la nature humaine
Une galerie de portraits
Gulu
est d’abord une
galerie de personnages hauts en couleur, plus vrais que nature,
et ce d’autant plus qu’ils sont calqués sur des personnes
réelles qui émergent du passé de l’auteur et de sa mémoire
.
Et ces personnages prennent vie dès leur surnom énoncé - on peut
d’ailleurs rendre hommage à l’art des traducteurs qui ont trouvé
des équivalents aussi percutants que les originaux
,
à commencer par le jeune héros de cette histoire : Pissechien ou
Gǒuniàotāi
(狗尿苔),
du nom d’un champignon qui pousse sur les ordures, nous est-il
expliqué. Un gamin de quatorze ans, l’âge qu’avait Jia Pingwa au
début de la Révolution culturelle, malin mais affligé d’une
"mauvaise origine de classe", tare rédhibitoire qui vaut celle
de ceux originaires d’ailleurs, les deux pouvant d’ailleurs se
conjuguer.
En fait, Pissechien a été porté tout petit jusqu’au village par
la rivière en crue, et a été recueilli par celle qui est devenue
sa grand-mère. Mais le mari de la vieille femme a jadis été
enrôlé par l’armée nationaliste avec laquelle il est parti à
Taiwan, jetant l’opprobre sur la famille, sa femme mais aussi
l’enfant adopté. Pissechien est traité comme un paria dans le
village, et c’est là un trait autobiographique, le père de Jia
Pingwa ayant été interdit d’enseignement et renvoyé en 1967 dans
sa localité d’origine, dans la campagne du Shaanxi, pour y
devenir paysan. Mais Pissechien est le seul, avec la grand-mère,
qui restera humain aux heures les plus noires de la
"Révolution", quand le village sera mis à feu et à sang par les
deux organisations "rebelles".
Jia Pingwa donne même à Pissechien le don de communiquer avec
les animaux et les plantes autour de lui. De même, sa grand-mère
– inspirée de la propre mère de l’auteur - est une spécialiste
des papiers découpés et les animaux qu’elle découpe ainsi ont
des pouvoirs quasi magiques. Elle sait tout des coutumes et
traditions locales, et on vient la chercher en particulier pour
les funérailles, mais elle connaît aussi des herbes médicinales
rares. Il y a là un petit côté "magico-réaliste", mais il est
plus réaliste que magique, parfaitement intégré dans le contexte
du reste de la narration, et des mentalités décrites.
Autour de ces deux personnages gravite une pléiade de villageois
et leurs épouses, dont quelques figures sortent du lot, comme le
secrétaire du Parti du village, le "lettré" chargé de
calligraphier les slogans sur les murs, ou encore un ancien
moine surnommé Shan Ren (善人)
– c’est-à-dire bon et charitable, traduit Cordial – un moine
dont on ne sait trop s’il était taoïste ou bouddhiste, mais qui
représente la sagesse populaire basée sur les cinq éléments ; et
puis, il y a le bon à rien du village, nommé Bacao (霸槽),
traduit Fier à Bras, un jeune frustré dont les parents sont
morts et qui vit seul dans une cabane, en ressemelant des
chaussures et réparant des bicyclettes. C’est par lui que le
malheur arrive, ce Fier à Bras, car c’est lui qui fonde au
village une première faction révolutionnaire "rebelle", le
Groupe des marteaux (榔头队),
tout-puissant jusqu’à ce que soit fondée une organisation
rivale, et que les deux groupes s’affrontent.
Rivalités ente clans
Jia Pingwa montre que, en fait, les deux groupes finissent par
se définir en termes de clan, leurs membres se rattachant à
l’une ou l’autre des deux grandes familles du village, les Zhu (“朱家族”)
et les Ye (“夜家族”).
C’est ainsi que la Révolution culturelle, a pour effet de
raviver d’anciennes rivalités, d’anciennes rancœurs, et ainsi de
déstabiliser la communauté, jusqu’à provoquer des affrontements
sanglants quand le Groupe des marteaux, ayant perdu l’avantage,
fera appel à une organisation du district pour venir les
soutenir.
Le roman décrit en minutieux détails la spirale de violence qui
est ainsi enclenchée sous prétexte de Révolution, et qui ne
s’achève que quand l’armée est dépêchée pour arrêter les
meneurs.
Politique contre survie
Ce que montre Jia Pingwa, c’est le progressif effondrement de
toute la structure socio-économique du village, au profit de la
lutte dite révolutionnaire. D’une part les fours sont arrêtés,
et les produits en réserves confisqués par Fier à Bras et ses
hommes, tandis que le temple de la divinité des fours est
réquisitionné. D’autre part, les structures du village ayant été
détruites, en particulier les équipes de production, le travail
des champs est désorganisé. Le village est livré au chaos et à
la destruction. Les villageois vivaient en économie de
subsistance, après la tourmente, ils sont plus pauvres que
jamais.
Le dénouement, cependant, est brutal. Il rappelle la fin des
rebelles du mont Liangshan, dans « Au bord de l’eau » (《水浒传》),
la Révolution culturelle à Gulu rappelant d’ailleurs par bien
des côtés celle décrite avec force détails et rebondissements
dans ce roman
.
Sortis de ce cauchemar, les survivants pansent leurs plaies,
mais, ce qui domine, c’est le sentiment d’un immense gâchis, il
ne reste aux villageois qu’à reconstruire et repartir de zéro,
mais rien de fondamental n’est changé au village. Les
mentalités, les modes de vie sont toujours les mêmes. On cherche
à oublier cet intermède barbare, comme un hiver interminable qui
s’est enfin achevé
.
La vie reprend son cycle immuable. Un bébé vient de naître.
Un sommet de l’art narratif de Jia Pingwa
L’art ancien des conteurs
Dans sa structure comme dans sa technique narrative, Gulu est à
rapprocher de l’art du conteur, dont dérivent la forme courte du
xiaoshuo, et le roman chinois classique que l’on peut
considérer comme une suite d’épisodes pouvant se dérouler en une
soirée de conteur
.
Le rapprochement avec le roman « Au bord de l’eau » prend là une
signification supplémentaire.
La technique narrative de Jia Pingwa dans ce roman est à
rapprocher de celle d’un cinéaste filmant un documentaire sur un
village en faisant de longs travellings, et s’arrêtant sur un
personnage, ou un fait saillant qui attire son attention.
Ce qui est particulièrement remarquable, c’est l’art consommé
avec lequel Jia Pingwa passe d’une ligne narrative à la
suivante, pratiquement sans transition, en suivant juste l’ordre
naturel des faits qu’il raconte, à travers le regard d’un
personnage, ou une intrusion, une rencontre soudaine faite en
chemin faisant dévier le parcours de ce personnage ou
l’attention des gens autour de lui.
Ainsi, par exemple, au chapitre 12
,
le village est secoué par une histoire inouïe de vol de clés,
quand soudain, le soir, la fille du secrétaire raconte que son
père est revenu du bourg en rapportant l’aide alimentaire ;
aussitôt toute l’attention des villageois passe des clés à la
question désormais fondamentale : celle de la répartition de
cette aide. Mais leur attention est à nouveau détournée par la
sortie soudaine de chez elle d’une villageoise soupçonnée du vol
des clés, et la narration fait un détour sur elle, avant de
revenir au vol des clés.
C’est cette technique narrative très subtile qui détermine la
progression du récit. Et c’est justement ce qui s’oppose à une
division en parties distinctes, même en saisons correspondant à
celles du récit : cela rompt la logique narrative même si le but
était d’aérer le texte et de faciliter la datation des faits
évoqués : du début de l’hiver 1965 au printemps 1967.
C’est pourtant bien fait pour la partie ‘Printemps’ : elle est
introduite entre les chapitres 16 et 17. A la fin du chapitre
16, à la recherche de Fier à Bras qui a disparu, Pissechien
constate que sa cabane est fermée, et qu’il n’y a personne à
l’intérieur. Au début du chapitre 17, avant de déclarer que
« Fier à Bras n’est toujours pas revenu » (霸槽没有回来),
l’auteur décrit la mousse couvrant le lion en pierre à l’entrée
du village : elle est en train de reverdir, c’est l’époque de la
Fête du Printemps. Mais c’est juste dit en passant. La
conversation entre Pissechien et son ami Niuling tourne toujours
autour de la disparition inexpliquée de Fier à Bras.
En revanche, la partie Eté, introduite entre les paragraphes 29
et 30, et l’Automne, entre les paragraphes 45 et 46, ne sont
amenées par aucune précision et paraissent arbitrairement
placées là : le paragraphe 29 se termine sur l’arrivée du Garde
rouge Huang Shengsheng au village, le paragraphe 30 reprend sans
transition sur le même personnage, dépeint tel un prophète
venant propager la bonne parole révolutionnaire, comme « une
étincelle dans la plaine ». De la même manière, le paragraphe 45
se termine sur la mise sous scellés du four par le Groupe aux
marteaux, et le paragraphe suivant débute par l’inventaire du
registre du four.
Les indications de saisons apportent une indication permettant
de situer le récit dans le cours de l’histoire telle qu’on la
connaît. Mais il n’y a pas de rupture. Le temps est fluide, son
passage imperceptible et le récit continu, les dates n’ont pas
de sens dans ce contexte ; elles n’ont de sens que pour le monde
extérieur. Les transitions entre chapitres, ou au sein d’un
chapitre, sont celles du conteur annonçant, à la fin d’une
soirée, la suite de son histoire la soirée suivante.
Un symbolisme subtil
A la demande de Jia Pingwa, l’éditeur chinois a ajouté sur la
couverture du roman le mot China en anglais et en
majuscules, à côté du titre chinois calligraphié de la main de
l’auteur, comme à son habitude. Jia Pingwa a expliqué : « Le
roman raconte l’histoire d’un village nommé Gu lu, Le
village du vieux four, mais je pensais en fait à la Chine. J’ai
aussi, et pour la même raison, appelé la montagne derrière le
village Zhongshan (中山),
la montagne centrale, comme on dit Zhongguo. »
Dans le récit, par ailleurs, les symboles ne sont pas rares. Le
plus terrible, sans doute, est celui que suggère cette maladie
qui se répand dans le village, apportée d’ailleurs, de la ville,
par des membres du groupe au marteau, et qui se révèle être la
gale : maladie très contagieuse, inconnue au village qui n’en
connaît donc pas d’antidote. C’est l’une des plus belles
trouvailles du roman.
Un regret….
Dans l’édition chinoise, le roman se termine par une postface (后记).
Il est dommage qu’on ne l’ait pas traduite. Jia Pingwa y
explique pourquoi il a écrit son roman et en donne quelques clés
de lecture. Il explique ainsi que les souvenirs de la Révolution
culturelle lui étaient revenus une fois passé le cap de la
cinquantaine :
« Un jour, j’ai rencontré l’un des anciens chefs de faction.
Il était seul, assis dans la cour de sa maison… Lorsque je suis
passé, il m’a appelé, par le sobriquet qu’on utilisait pour
m’appeler quand j’étais petit, et m’a dit : Eh, tu es de retour
? Cela fait longtemps ? Viens prendre un verre… Le soleil était
chaud, la cour déserte… A l’époque, des actes d’une violence
terrible avaient été perpétrés là, mais maintenant il n’en
restait rien. Il n’y avait ni taches de sang, ni corps en
décomposition, ni lambeaux d’affiches révolutionnaires, ni
bâtons, ni briques. Tout avait disparu sans laisser de trace. Le
passé s’était envolé comme une bourrasque de vent… »
Cette postface éclaire le récit, lui donne une ombre sur
laquelle il se détache comme en relief. C’est le conteur
terminant son histoire avant un dernier salut à son auditoire.
A lire en complément
- La critique de François Bougon dans Le Monde daté
22.12.2017 :
Clochemerle à l’heure
du Petit Livre rouge
http://www.lemonde.fr/livres/article/2017/12/21/clochemerle-a-l-heure-du-petit-livre-rouge_
5232668_3260.html
- L’article de Linda Lê : Le Livre du rire et de l’effroi
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2018/01/05/rire-effroi-pingwa/
- La fiche de lecture de la traductrice Nicky Harman, avec
extrait de traduction en anglais (chap. 14) :
http://www.ugly-stone.com/old-kiln-village/
- Les commentaires enthousiastes d’une lectrice du groupe de
lecture Voix au chapitre :
http://www.voixauchapitre.com/archives/2018/chine_jacqueline_pingwa.htm
On peut cependant se demander pourquoi certains noms
sont traduits et d’autres notés par leur seule
transcription en pinyin : le nom du camarade de
Pissechien, par exemple, est juste transcrit, Niuling,
il signifie clochette de bœuf (牛铃) ;
le surnom de l’amie de Fier à Bras, de même, est juste
transcrit Xingkai (杏开),
mais on aurait pu traduire Abricot…
Il
semble que n’ont été traduits que les surnoms qui ont
une signification dans le cadre de l’histoire, mais cela
induit un manque d’homogénéité dans la traduction,
surtout quand plusieurs prénoms sont cités, et que sont
mélangées traductions et transcriptions.
|
|

