|
|
A Cheng et la
trilogie des Rois
par Brigitte Duzan,
9 septembre 2019
Les trois nouvelles « moyennes »
qui constituent la trilogie dite « des Rois » sont les trois
premières œuvres publiées par
A Cheng (阿城) :
« Le Roi des échecs » (《棋王》)
en 1984, « Le Roi des arbres » (《树王》)
et « Le Roi des enfants » (《孩子王》)
en 1985.
|
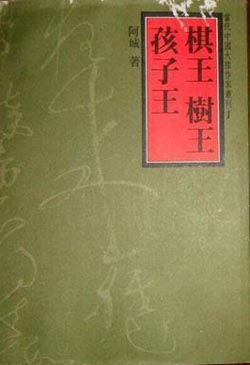
Les trois rois, édition 1996 |
|

Les trois rois, édition 2015 |
Ce sont trois chefs d’œuvre de la littérature post-maoïste : une
réhabilitation de la culture après la Révolution culturelle,
mais aussi de l’individu dans la société, longtemps écarté au
profit de la collectivité.
La préservation des valeurs est désormais le fait, non plus de
héros hors du commun, « positifs », mais d’hommes ordinaires
dont les exploits sont humains.
Avec ces trois récits, A Cheng renoue avec l’art du conteur dont
découle l’art romanesque en Chine. A la campagne, pendant la
Révolution culturelle, il avait exercé cet art auprès de ses
camarades jeunes instruits ; c’est l’écrivain et critique
Li Tuo
(李陀)
qui le persuada d’écrire ce qu’il leur racontait. Mais c’est
écrit avec un art consommé de la phrase courte, à mi-chemin
entre la langue classique, élégante et raffinée, et la langue
parlée, la langue populaire, vivante et colorée ; la fascination
exercée par la narration tient en grande partie à cette langue
naturelle qui a frappé les lecteurs et les critiques au sortir
de la période maoïste et de sa langue de bois statufiée.
Chacune des nouvelles a cependant un thème particulier, en lien
avec des éléments fondamentaux de la vie et de la culture qui
avaient été battus en brèche et oblitérés par l’idéologie
maoïste et ont été redécouverts à la fin des années 1970 ; ce
fut une véritable renaissance humaniste entraînant au milieu des
années 1980 un mouvement de recherche des racines auquel se
rattache la trilogie. Elle apparaît ainsi comme un triple retour
aux origines de la pensée et de la culture chinoise après
l’épisode maoïste.
-
Le roi des échecs
《棋王》
Retour à la pensée taoïste : la recherche du dao comme recherche
des racines
|
« Le roi
des échecs » est la première œuvre publiée
par A Cheng, écrite en trois jours, d’une seule
traite et pratiquement sans retouche, pendant la
chaleur suffocante du mois d’août de l’été 1983. Il
l’envoie à plusieurs revues littéraires, sans succès
.
Mais, quand la nouvelle paraît finalement, en
juillet 1984, dans la revue « Littérature de
Shanghai » (《上海文学》),
le succès est immédiat.
En décembre 1985, A Cheng est même invité à Hong
Kong, ce qui était un privilège rare à l’époque. Le
rédacteur en chef de la revue « Les années 90 » (《九十年代》)
organise une discussion avec lui, à laquelle
participent le réalisateur Tsui Hark, l’écrivaine
taïwanaise Shi Shuqing (施叔青),
sœur de
Li Ang (李昂),
qui vivait alors à Hong Kong depuis plusieurs
années, et encore le dramaturge Liu Chenghan (刘成汉)
qui écrira plus tard le scénario pour l’adaptation
du « Roi des Echecs » au cinéma. La trilogie des
Rois est d’ailleurs parue à Hong Kong (avec deux
autres nouvelles) avant d’être publiée en Chine
continentale. |
|
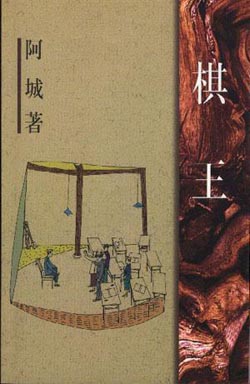
Le roi des échecs, édition 1999 |
Bien que n’étant pas lui-même passionné d’échecs, A Cheng dresse
un portrait formidable du « fou d’échecs » (棋呆子)
qu’est Wang Yisheng (王一生) :
un étudiant certes, mais pas ordinaire, qui s’est peu à peu
imposé comme un maître au sein de ses camarades et de leurs
proches, et qui a fini par n’avoir plus qu’« une vie » comme son
nom l’indique, une vie centrée sur les échecs et ne répondant
qu’à cette seule logique. Mais le jeu lui-même est dans la
nouvelle un condensé de plusieurs éléments métaphoriques. D’une
part, les pièces du jeu que possède Wang Yisheng sont l’œuvre
patiente de sa mère qui les a taillées dans des manches de
brosses à dents à un moment où ils vivaient dans une extrême
pauvreté et qui les lui a offertes en lui recommandant de ne pas
négliger ses études pour autant. C’est donc un témoignage
d’amour maternel sublimé.
Mais la passion du jeu prend chez Wang Yisheng une tournure
quasiment métaphysique : A Cheng en fait l’expression
intériorisée d’une pensée taoïste profonde, que Wang Yisheng
a découverte avec son premier manuel, un traité de taoïsme
précieusement conservé par un mendiant collecteur d’ordures
rencontré par hasard et qui, devenu son mentor, lui en a fait
cadeau. On est là dans la grande tradition taoïste, que l’on
retrouve aussi bien dans les romans de wuxia :
l’enseignement toujours un peu ésotérique préservé par des êtres
en marge de la société, et consigné dans des manuels tenant de
livres saints.
Quant à l’ami du fou d’échecs, le jeune instruit Ni Bin (倪斌),
il a le tempérament d’un noble rejeton d’une vieille famille :
il est prêt à se séparer d’un ancien jeu d’échecs datant des
Ming appartenant à sa famille pour que Wang Yisheng puisse
participer à la compétition régionale. Finalement, après avoir
refusé, Wang Yisheng accepte d’y participer, mais hors
compétition, pour l’amour du jeu, réaffirmant ainsi l’amour
profond pour la culture traditionnelle, à l’écart des
manifestations publiques et politiques. Il est dépeint, pendant
la compétition, comme un sage taoïste entrant en méditation et
faisant le vide dans son esprit. En même temps, sa déférence
envers le vieux maître d’échecs est celle du respect pour les
anciens, traditionnel dans la culture chinoise.
Tandis
que ses contemporains s’attachaient à décrire les désordres et
le chaos de la période écoulée, A Cheng, lui, s’attarde sur des
scènes paisibles, en harmonie avec la nature, où l’individu doit
savoir trouver un bonheur simple – bonheur lié à la pensée
taoïste qui est aussi sagesse profonde permettant de trouver la
concentration et la sérénité nécessaires pour gagner contre les
meilleurs joueurs d’échecs. Le jeu devient allégorie d’une
manière de vivre et de penser sa vie. Wang Yisheng est un double
d’A Cheng.
Et quand, à la fin du récit, le rideau tombe sur la
représentation, la compétition terminée, et que tous s’endorment
sur la scène, épuisés, la nouvelle s’achève sur l’image d’un
monde d’illusion, un monde peut-être rêvé comme dans la fable de
Zhuangzi.
Adaptation cinématographique :
Le
roi des échecs
《棋王》
de Teng Wenji (滕文骥),
1988.
Analyse comparée de la nouvelle et du film :
http://www.chinesemovies.com.fr/films_Teng_Wenji_Le_roi_des_echecs.htm
-
Le roi des arbres
《树王》
Retour à l’idéal d’une vie en harmonie avec la nature
« Le roi des arbres » est un souvenir nostalgique et douloureux
de l’expérience vécue par A Cheng au Yunnan pendant la
Révolution culturelle. C’est une critique voilée de la politique
de déboisement et défrichage sauvages menée par le Corps de
Production et Construction. Les jeunes instruits étaient
endoctrinés pour aller couper les arbres des forêts primitives
du Xishuangbanna pour planter des caoutchoutiers ; c’est ce que
A Cheng évoque en disant de manière allusive qu’il fallait
couper les arbres « inutiles » pour en planter des « utiles ».
Politique désastreuse, évidemment, et pour l’environnement et
pour la population et pour les jeunes, typique de la volonté de
dompter et maîtriser la nature caractéristique de l’idéologie
maoïste.
Le récit est conté par un jeune instruit qui fait office de
narrateur, à la première personne, face à un personnage
extraordinaire, d’une force peu commune, qui est comme l’âme de
la forêt et a jusqu’à l’aspect d’un vieil arbre : il est
surnommé Xiao Geda (肖疙瘩),
le Noueux a traduit Noêl Dutrait. C’est un ancien soldat, d’une
force phénoménale, qui a commandé un bataillon et mené des
actions héroïques mais n’a pas reçu les honneurs qui lui étaient
dus, pour une sordide histoire d’orange volée. A Cheng donne une
profondeur et une intensité à son personnage qui rendent le
dénouement final encore plus poignant.
Il fait apparaître le côté absurde de la politique d’abattage
des arbres par un dialogue entre le narrateur et Xiao Geda qui
ne comprend pas ce que les jeunes sont venus faire là : pour
couper les arbres ?
- Non, répond le
narrateur, nous somme venus pour nous rééduquer auprès des
paysans pauvres et moyens-pauvres, afin d’édifier et de protéger
la patrie et transformer sa situation d’arriération et de
pauvreté
(接受贫下中农再教育,建设祖国,保卫祖国,改变一穷二白)
- Alors pourquoi couper les arbres ? (demande Geda)
- Nous allons abattre les arbres inutiles et en replanter qui
soient utiles.
(把没用的树砍掉,种上有用的树)
|
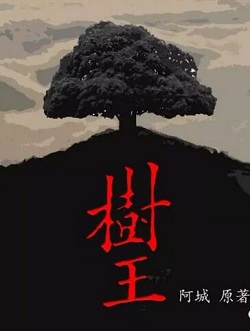
Le roi des arbres
Projet d’affiche pour l’adaptation
au cinéma (2018) |
|
Ils vont donc abattre les arbres et les brûler. Mais
ils vont commencer par l’arbre gigantesque qui
restait au sommet de la montagne et auquel personne
ne voulait toucher car il était « devenu un
esprit », raison supplémentaire pour l’abattre, afin
de lutter contre les superstitions. La mort de
l’arbre est une longue agonie qui ne prend fin
qu’avec l’aide de Xiao. Et l’on comprend alors qu’il
ne fait qu’un avec l’arbre, et que l’appellation de
Roi des arbres vaut autant pour lui que pour l’arbre
lui-même.
L’incendie
des arbres coupés nous donne ensuite une
fantasmagorique description de la forêt en feu dans
le dernier chapitre, description tellement vivante
qu’elle reflète certainement une expérience vécue,
traumatisante. D’ailleurs, elle répond aux souvenirs
semblables évoqués dans son autobiographie par Chen
Kaige, qui cite la description d’A Cheng
.
On mesure les désastres écologiques causés par une
politique |
volontariste de
développement à outrance qui s’est poursuivie pendant toute
la période maoïste.
Sous une autre forme, « Le roi des arbres » poursuit la
réflexion d’A Cheng commencée avec « Le roi des échecs » sur un
retour aux racines et aux fondements de la vie humaine, et
débouche sur l’aspiration à une vie paisible en harmonie avec la
nature.
Adaptation cinématographique :
L’appel des oiseaux 《鸟鸣嘤嘤》de
Tian Zhuangzhuang (田壮壮),
sortie prévue 2020
http://www.chinesemovies.com.fr/actualites_331.htm
- Le roi des enfants
《孩子王》
Retour à l’amour du livre et de l’écrit
|
A Cheng développe dans ce troisième récit l’un de
ses thèmes favoris : le culte du livre et de
l’écrit, qui remonte sans doute à son enfance, mais
prend toute sa profondeur dans un contexte où chaque
livre était devenu un trésor rare à préserver. C’est
en outre une critique de méthodes d’enseignement
fondées sur l’apprentissage par cœur de textes
destinés à renforcer l’emprise idéologique sur les
esprits bien plus qu’à les ouvrir et les éclairer.
Quand ils ont à rédiger des devoirs, les enfants
utilisent les mêmes clichés que ceux des textes
qu’on leur a donné à apprendre.
Le narrateur est ici un autre jeune instruit, envoyé
enseigner dans une école d’un village reculé où les
enfants n’ont même pas de manuel. Ils apprennent en
recopiant. Alors le nouvel arrivant balaie les
habitudes, enseigne à ses élèves les caractères de
base, leur apprend à |
|
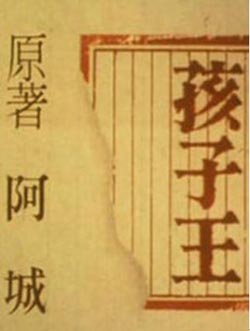
Le roi des enfants, édition numérique
2017 |
s’exprimer simplement et clairement. Il y a un enfant qui
sort du lot, dont le père ressemble beaucoup au Xiao du
récit précédent ; fort et solide comme lui, il forme comme
un lien entre les deux narrations en renforçant l’unité
narrative de l’ensemble
Mais le jeune instruit est renvoyé dans son unité de production
pour ne pas avoir suivi les textes imposés. En partant, il
laisse derrière lui … son dictionnaire, objet de culte dans ce
désert livresque, et érigé en symbole d’un enseignement vital et
d’une culture qui refuse de mourir. On pense bien sûr tout au
long de la nouvelle au fameux cri de
Lu Xun
(鲁迅)
lancé à la fin de sa
nouvelle « Le Journal d’un fou » (《狂人日记》) :
« Sauvez les enfants » (“救救孩子”) !
Mais il n’y a rien de mélodramatique chez A Cheng.
Il se dégage en fait de ces récits une certaine sérénité, même
dans « Le roi des arbres » qui traduit une expérience
personnelle douloureuse : les souffrances infligées par
l’histoire sont en toile de fond, les personnages s’efforcent de
préserver quelques moments de bonheur tout simple au milieu de
l’adversité, clé d’une existence harmonieuse et pacifiée qui est
celle du sage bouddhiste ou taoïste. Avec le recul, les drames
de l’histoire apparaissent comme quelques rides sur l’eau d’un
lac, qui n’entament que la surface, le temps que le vent se soit
calmé.
Adaptation cinématographique :
Le Roi des enfants 《孩子王》
de Chen Kaige (陈凯歌),
1987.
http://www.chinesemovies.com.fr/films_Chen_Kaige_Roi_des_enfants.htm
La période d’octobre à décembre 1983 est marquée par la
campagne contre la pollution spirituelle, mais elle
avait été précédée dès juin par une mise en garde de
Zhao Ziyang (赵紫阳),
en ouverture du 6ème congrès national du
peuple, contre les tendances trop libérales dans les
milieux académiques et artistiques. Cela peut expliquer
la frilosité des milieux de l’édition et de la presse.
|
|

