|
|
Brève histoire du
xiaoshuo et de ses diverses formes,
de la nouvelle au roman
par Brigitte Duzan, 25 avril 2015
Il n’y a pas au départ
de différence nette, en chinois, entre ce que l’on appelle en
Occident roman et nouvelle. Tout récit de fiction est désigné du
terme de xiaoshuo (小说) ; on distingue ensuite une forme courte, le duanpian xiaoshuo (短篇小说),
nouvelle en français ou short story en anglais, qui se distingue
de la forme longue ou changpian xiaoshuo (长篇小说),
qui correspond au roman ; mais avec une forme intermédiaire, qui
est un xiaoshuo de taille moyenne ou zhongpian
xiaoshuo (中篇小说)
et correspond à une longue nouvelle ou à un court roman.
Les trois formes ont
évolué en des genres bien distincts, qui répondent aujourd’hui à
des définitions bien précises en termes de nombre de
caractères et représentent des styles différents. Mais toute la
littérature de fiction chinoise a évolué à partir de la forme
courte du xiaoshuo, dont l’histoire recoupe et reflète
celle, politique et sociale, de la Chine dans son ensemble.
C’est cette histoire même qui donne une signification
particulière et une place à part à la nouvelle courte dans la
littérature chinoise.
I. Origines : des
anecdotes des Han aux chuanqi des Tang
Il faut d’abord définir
le xiaoshuo. 小
xiao
signifie ‘petit’ et
说
shuo
‘dire’, ‘parler’. Le terme a donc au départ une connotation
péjorative, qui remonte à ses origines.
Le texte le plus ancien
où apparaît ce terme de xiaoshuo est en effet un passage
du Zhuangzi (庄子),
écrit vers le 4ème siècle avant Jésus-Christ, où
l’auteur désigne par ce terme des propos futiles, sans
importance. Et s’ils étaient sans importance, et donc peu dignes
de considération, c’est parce qu’il s’agissait, pour la
plupart, de fabliaux ou de récits fantastiques qui n’étaient pas
fondés sur les Classiques, et ne correspondaient pas à une
vision ordonnée de l’univers telle que le voulait la tradition
établie par ces Classiques.
1.
Emergence
du xiaoshuo sous les Han
Or les Classiques
subirent une éclipse quand le Premier Empereur fit brûler les
livres, ce qui était une manière pour lui de contrôler le peuple
en détruisant les textes qui prônaient des politiques
diamétralement opposées à la sienne et n’étaient pas conformes à
l’ordre social qu’il voulait instaurer. Le xiaoshuo était
considéré comme facteur de désordre.
|
Cependant,
l’éclipse fut brève car les empereurs Han, ensuite, pour
bien se démarquer de leur prédécesseur, s’appuyèrent sur
le confucianisme et lancèrent des recherches pour
retrouver les anciens textes. Ils envoyèrent alors des
cohortes de petits fonctionnaires dans tout l’empire
avec pour mission de collecter ce qui avait été conservé
dans la mémoire populaire. Ainsi fut recueillie une
foule de récits, rapportés par ouï-dire, qui vinrent
alimenter un courant de xiaoshuo…
Cette démarche
est présentée dans l’histoire de la dynastie, le « Livre
des Han » (《汉书》),
comme |
|
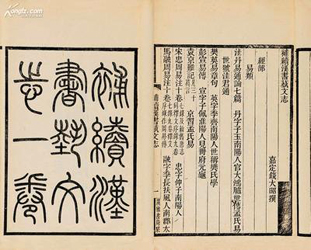
Livre des Han, traité de littérature |
remontant à une
pratique similaire des anciens souverains, plus ou moins
mythiques, qui représentent l’image idéalisée du souverain
chinois. C’était une manière de légitimer la dynastie.
Le Shijing ou
Livre des Odes (《诗经》),
le plus ancien recueil de poèmes chinois, qui remontent à la
période allant du 10ème au 7ème siècle
avant Jésus-Christ, serait en particulier, pour partie, le
résultat d’un tel travail de collecte dans la population ;
beaucoup de ces poèmes dépeignent d’ailleurs les durs labeurs
des paysans tandis que d’autres représentent des sortes de
chants populaires. Le livre des Han décrit précisément la
collecte des chants et récits populaires selon le modèle antique
:
« Les xiaoshuo
étaient des récits tirés des paroles des rues. Le Zuozhuan
rapporte les chants de porteurs de palanquins, le Livre des Odes
fut à l’écoute de l’humble peuple des campagnes… Au début du
printemps, retentissait la cloche à battant de bois utilisée
pour les proclamations, afin d’appeler à la quête des chants
populaires ; des rondes étaient organisées qui se tenaient à
l’écoute des balades et chansons afin de connaître les coutumes
du peuple. Elles étaient ensuite mises en ordre … tous les
ouï-dire furent ainsi soigneusement consignés. »
C’est dans les trente
années avant Jésus-Christ que les empereurs Han Chengdi (成帝)
et Aidi (哀帝)
organisèrent des collectes de cette manière, donnant un premier
fond de xiaoshuo. Cependant, dans la troisième partie du
Traité de littérature du Livre des Han, dix écoles (诸子)
sont citées, mais la dernière ne fut pas considérée digne
d’intérêt : c’est justement celle des xiaoshuo (小说家),
décrits comme « rumeurs des rues et ruelles » (街谈巷语)
et « histoires entendues en chemin » (道听途说),
collectées et diffusées par les petits fonctionnaires dont
c’était la charge, les baiguan (稗官).
C’est dans un appendice
au traité que l’on trouve une liste de quinze ouvrages relevant
de cette catégorie. Mais ce sont surtout des événements relevant
de l’histoire ancienne. Huan Tan (桓谭),
un philosophe et écrivain qui a vécu au tournant du millénaire,
à la période de transition entre Han de l’Ouest et de l’Est,
décrit les xiaoshuo comme présentant un intérêt dans la
mesure où peut leur être attribuée une utilité sociale :
« Les auteurs de xiaoshuo rassemblèrent des bribes éparses de
discours dont ils firent des paraboles, matière à de courts
livres pour gouverner les personnes et régler les organisations
sociales ; il y en eut ainsi qui furent dignes d’être considérés. »
Il restait à développer
de véritables récits de fiction.
2.
Développement sous les Six Dynasties et les Tang
Des contes et
anecdotes …
|
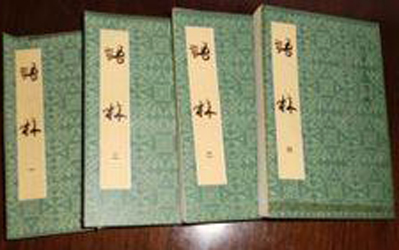
Yulin (Forêt des anecdotes) |
|
A partir du
troisième siècle, on voit apparaître des histoires de
fantômes, immortels et divinités diverses, d’abord sous
la dynastie des Wei (ou Cao Wei
曹魏,
220-265),
mais aussi des anecdotes pour divertir le lecteur, qui
se développent sous la dynastie des Jin (晋朝,
265-420), puis sous les dynasties du Nord et du Sud, aux cinquième et sixième
siècles – soit pendant toute la période dite des « Six
dynasties ».
|
Lu Xun cite le recueil
compilé, en dix volumes, par le lettré Pei Qi (裴启)
à l’ère Longhe des Jin (晋隆和,
soit 367) et
intitulé « Yulin » ou « Forêt d’anecdotes » (《语林》) ;
il était déjà perdu sous les Sui, mais il en existe des extraits
dans des ouvrages postérieurs. Ce sont souvent de véritables
petites anecdotes sans importance, telle celle-ci rapportée
dans le « Taiping Guangji » (《太平广记》) ou recueil de l’Ere de la grande paix, grande encyclopédie compilée
sous les Song du Nord :
娄护字君卿,历游五侯之门,每旦,五侯家各遗饷之,君卿口厌滋味,乃试合五侯所饷之鲭而食,甚美。世所谓“五侯鲭”,君卿所致。
Au terme d’un
voyage, Lou Hu, dont le prénom social était Junqing, était
arrivé à la Porte des cinq princes où, chaque jour, des gens de
la maisonnée des princes venaient lui apporter des plats à
déguster ; s’étant lassé de ces mets délicieux, il prépara un
ragoût avec la viande et le poisson qu’on lui avait portés, et
trouva le mélange délicieux. C’est ce qu’on appela « le ragoût
des cinq princes » et c’est Junqing qui en est l’inventeur.
|
D’un autre
recueil, compilé un siècle plus tard, il reste
aujourd’hui trente-huit chapitres : ce sont les
« Histoires du temps et nouvelles anecdotes » ou « Shishuo
Xinyu » (《世说新语》).
Certaines de ces histoires ressemblent à des fabliaux
moraux, tel celui-ci tiré du volume « Les conduites
vertueuses » :
阮光禄在剡,曾有好车,借者无不皆给。有人葬母,意欲借而不敢言。阮后闻之,叹曰,“吾有车而使人不敢借,何以车为?”遂焚之。(卷上《德行篇》) |
|
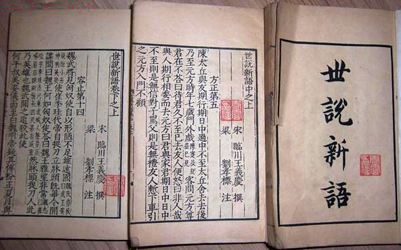
Shishuo xinyu (Histoires du temps
et nouvelles anecdotes) |
Ruan Guanglu avait
jadis à Yan un char superbe qu’il ne refusait jamais de prêter.
Or, un jour, devant enterrer sa mère, un homme songea à le lui
demander pour transporter le corps, mais n’osa pas. L’ayant
appris, Ruan déclara en soupirant : « Si j’ai un char et que
personne n’ose me l’emprunter, à quoi sert-il ? » Alors il le
brûla.
Mais il y a aussi dans
ce recueil des anecdotes sur la littérature qui sont savoureuses
aujourd’hui encore, telle celle-ci :
阮宣子有令闻,太尉王夷甫见而问曰,“老庄与圣教同异?”对曰,“将无同。”太尉善其言,辟之为掾,世谓“三语掾”。(卷上《文学篇》)
Ruan Xuanzi avait
une grande renommée ; un jour, alors qu’il l’avait rencontré, le
gouverneur militaire Wang Yifu lui demanda : « La pensée de
Laozi et de Zhuangzi est-elle comparable à l’enseignement du
grand Confucius ? » A quoi Ruan répondit en trois mots : « Jiang
wu tong » [ils vont de pair mais ne sont pas pareils]. Le
gouverneur apprécia ces paroles et prit Ruan comme assesseur. On
l’appela désormais « l’assesseur aux trois mots ».
Et il y en a également
dans le registre comique, telle celle-ci, du volume
« Comportements absurdes »
刘伶恒纵酒放达,或脱衣裸形在屋中。人见讥之。伶曰,“我以天地为栋宇,屋室为裈衣,诸君何为入我裈中?”(卷下《任诞篇》)
Liu Ling s’adonnait
sans retenue à son penchant pour la boisson, si bien qu’il lui
arrivait d’enlever ses vêtements et de se promener tout nu chez
lui. Le voyant ainsi, on se moqua de lui, mais Liu Ling
rétorqua : « J’ai le ciel et la terre pour demeure, et ma maison
pour pantalon. Alors, messieurs, que faites-vous dans mon
pantalon ? »
Il y a d’ailleurs des
recueils de plaisanteries et histoires comiques depuis les Han
postérieurs, à toutes les époques. Mais le Shishuo xinyu
a inspiré toute une littérature d’anecdotes et propos divers. La
mode, cependant, va ensuite passer des histoires fantasques aux
histoires fantastiques.
… aux histoires
fantastiques et chuanqi
Le Traité de
littérature du « Livre des Sui » (《隋书》),
commissionné par l’empereur Taizong
des Tang et achevé en 636, comportait une Série de contes
extraordinaires, en trois volumes, traitant d’êtres surnaturels
et de prodiges, qui sont aujourd’hui perdus, mais dont on trouve
des citations dans divers ouvrages. Cependant, ces histoires
n’avaient pas de véritables descriptions littéraires. Les
récits, brefs, étaient concentrés sur l’intrigue, conçue comme
une sorte de fait divers propre à susciter la curiosité.
C’est sous les Tang que
se développe le xiaoshuo comme récit de fiction,
c’est-à-dire une œuvre fondée sur l’imaginaire, et non plus sur
des anecdotes de la vie courante. C’est surtout à partir du 8ème
siècle, qu’émerge ce nouveau courant, c’est-à-dire sous les
règnes des empereurs Xuanzong (唐玄宗)
et Suzong (唐肃宗),
et ce parallèlement à l’essor de la poésie. On voit alors
apparaître tout un fond d’histoires et de contes fantastiques
qui deviennent un genre en soi, le chuanqi (传奇),
colportant des récits nourris des mythes et légendes et des
croyances et superstitions populaires.
Raisons du
développement des chuanqi sous les Tang
Il y a plusieurs
raisons, à la fois économiques et sociales, au développement de
ces récits populaires à cette époque.
D’abord, l’empire
unifié crée une formidable croissance économique qui entraîne
des bouleversements sociaux, et en particulier le développement
de la classe des marchands et de toute une nouvelle société
urbaine, avide de divertissements ; or ceux-ci sont en grande
partie fondés sur l’art des conteurs, qui sont alors la source
d’une littérature orale, fondement du xiaoshuo.
Par ailleurs, la
période Tang est aussi une époque de développement du
bouddhisme ; les prédicateurs utilisaient, pour attirer leur
auditoire, tout un corpus de récits simplifiant la pensée
bouddhique en récits colorés et faciles à comprendre ; les
foires des temples devinrent des lieux où se produisaient les
conteurs. Ces récits étaient des histoires tirées des Jâtaka,
les vies antérieures de Bouddha, ou de l’hagiographie
bouddhique. Ils étaient contés sous forme de chantefables,
mélanges de récits parlés et de parties chantées ou shuochang
(说唱).
Enfin, à l’autre bout
de l’échelle sociale, on trouve une raison liée aux examens
impériaux : les candidats avaient intérêt à se faire connaître
de personnages hauts placés et, pour ce faire, écrivaient des
poèmes ou de courts essais en prose qui leur étaient dédiés.
Mais des chuanqi ont aussi été écrits dans ce but : ils
circulaient sous forme de rouleaux contenant des illustrations
et des poèmes, créant un style hybride, entre classique et
populaire, qui était très prisé. Ils contribuent à
l’amélioration stylistique des contes et chuanqi.
Cette combinaison de
facteurs est spécifique des Tang, mais le premier facteur de
développement des xiaoshuo à l’époque, celui représenté
par la constitution d’un public spécifique grâce à l’essor
urbain entraîné par la croissance économique, est un facteur que
l’on retrouve à diverses périodes, et jusqu’à aujourd’hui.
Aux sources du
chuanqi : le Gujing Ji
|
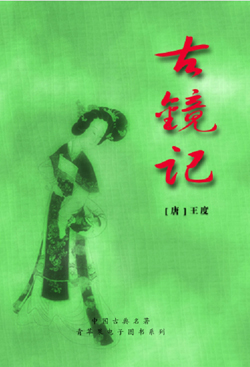
Mémoire sur un miroir ancien (édition
2012) |
|
A la période
charnière entre les Sui et les Tang paraît un « Mémoire
sur un miroir ancien » ou Gujing Ji (《古镜记》)
de Wang Du (王度)
qui fait figure de prototype du chuanqi. Il est
dans la lignée des récits merveilleux des Six Dynasties,
mais sans leur côté édifiant et avec une extension
géographique du domaine des esprits et démons, non plus
confinés dans de vagues contrées et montagnes
lointaines, mais désormais dans les villes, à proximité
des hommes. Le texte est complexe et l’œuvre d’un lettré
cultivé : mort en 625, Wang Du était historien et
annaliste ; il fut censeur, puis correcteur des archives
impériales.
Le Gujing Ji
est une série de douze récits liés entre eux par le
miroir du titre, qui mêlent habilement faits et fiction.
Il s’agit d’un miroir magique offert au narrateur, qui,
comme tout miroir de bronze dans la tradition taoïste,
permet de déceler les démons cachés sous une apparence
humaine et d’éloigner les esprits mauvais ; au cours
d’un voyage aux |
épisodes multiples, il
réalise divers prodiges pour protéger les protagonistes.
Ce miroir, cependant,
décrit avec précision, ne ressemble à aucun objet connu de
l’histoire de l’art chinoise, et celle des miroirs de bronze en
particulier : il mêle des éléments de diverses périodes et il
est bordé de caractères indéchiffrables. Il se présente, dès
l’abord, comme un miroir fantasmé, un « miroir de nulle part » ;
mais, procédant par allusion (yingshe
影射)
en jouant avec les symboles, cosmologiques, numériques et
autres, dans un contexte historique et taoïste, mais incorporant
des éléments bouddhistes et confucianistes, il finit par être
une métaphore, représentative d’une pensée et d’une culture.
A la fin de l’histoire,
il prédit la chute de l’empereur Yang et de la dynastie des Sui
(en 617). Le Gujing Ji peut donc se lire aussi comme une
allégorie politique.
Floraison du chuanqi
à partir du 8ème siècle
Le Gujing Ji a
été suivi, au début des Tang, de recueils d’histoires et
anecdotes, dont une « Histoire de Bu Jiangzong, le singe blanc »
(《补江总白猿传》),
dont l’auteur est inconnu, et qui raconte l’aventure survenue au
général Ouyang He (欧阳纥),
de la dynastie des Liang, au sixième siècle – le texte est
d’ailleurs conservé sous ce titre : sa femme ayant été enlevée
par un singe blanc, il la sauva, mais elle donna naissance à un
enfant ayant le faciès du singe. Lu Xun considère qu’il s’agit
d’un genre de texte écrit pour nuire à la réputation de
quelqu’un. Il utilise les ficelles des récits merveilleux des
Six Dynasties, mais il n’a pas l’intérêt du récit de Wang Du.
|
Dans un autre
style, le Youxianku ou « Voyage à la caverne
des immortelles » (《游仙窟》)
de Zhang Zhuo (张鷟)
– ou Zhang Wencheng (张文成)
- est un autre récit célèbre, datant de la jeunesse de
l’auteur, sous l’interrègne de Wu Zetian : le narrateur
raconte comment, au cours d’un voyage, il rencontra deux
jeunes filles avec lesquelles il passa une nuit à
festoyer, échanger des vers et autres menus plaisirs.
C’est écrit dans un style hybride, en usant de l’art du
parallélisme du pianwen (骈文),
avec force poèmes, mais sans dédaigner les expressions
« vulgaires » qui |
|
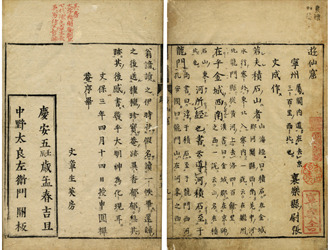
Le Youxianku, édition ancienne
conservée au Japon |
donnent de la
fraîcheur au texte. L’auteur fut très populaire en son temps,
mais aussi très critiqué.
C’est surtout à partir
des ères Kaiyuan (开元)
et Tianbao (天宝)
du règne de l’empereur Xuanzong (唐玄宗),
soit entre 713 et 756, qu’a lieu la véritable floraison des
chuanqi, le plus souvent de la plume de lettrés pétris de
culture classique et souvent historiens, occupant des fonctions
officielles.
|
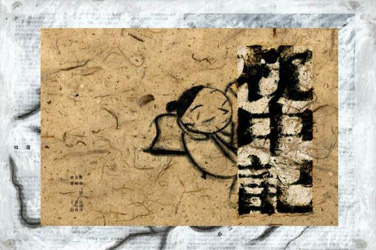
Illustration du Conte de l’oreiller |
|
Parmi ceux-ci,
par exemple, Shen Jiji (沈既济),
auteur des « Annales de l’ère Jianzhong » (《建中实录》),
était un historien réputé. Mais il est aussi l’auteur
d’un « Conte de l’oreiller » (《枕中记》),
qui figure dans le Taiping Guangji sous le titre
de « Lü Weng » (《吕翁》),
à titre d’exemple de xiaoshuo. Ce Lü Weng est un
taoïste qui, en route vers la ville de Handan (邯郸),
fait halte dans une auberge où il rencontre un jeune
voyageur, Lu Sheng, qui est profondément abattu. Lü
Weng lui offre un |
oreiller, et
l’autre, en rêve,
épouse la jeune fille de ses rêves, réussit les examens
impériaux, est nommé préfet de la capitale, mène une expédition
victorieuse contre les barbares, devient ministre et censeur
impérial, et finalement premier ministre. Cela attire les
jalousies ; calomnié, il est condamné au bannissement, mais
rappelé par l’empereur, et il finit ses jours au service de
l’Etat sans pouvoir se retirer pour mourir en paix.
Quand Lu Sheng se
réveille, il se rend compte qu’il a rêvé, mais la leçon est
prise ; il remercie le taoïste :
“夫宠辱之道,穷达之运,得丧之理,死生之情,尽知之矣:此先生所以窒吾欲也。
敢不受教!”
稽首再拜而去。
« Vous m’avez montré la voie des honneurs et celle de la honte,
le cycle de la fortune et de la misère, les lois du succès et du
malheur, les principes de vie et de mort ; j’ai bien compris,
monsieur : vous avez voulu mettre un frein à mes désirs. Comment
pourrais-je oublier cette leçon ?
Il se prosterna
avec déférence et s’en fut. »
Il s’agit d’une
histoire de rêve, inspirée d’une histoire des Six Dynasties :
« A la recherche des esprits » (《搜神记》)
de Gan Bao (干宝).
On retrouve d’ailleurs l’intention édifiante courante dans les
récits de cette période. Mais c’est un récit basé sur la longue
tradition du rêve héritée de Zhuangzi, qui en inspirera bien
d’autres, dont le célèbre « Conte de Handan » (《邯郸记》)
de Tang Xianzu (汤显祖)
sous la dynastie des Ming.
Mais, dès le neuvième
siècle, le « Conte du rêve de Qin » (《秦梦记》),
écrit à la première personne par Shen Yazhi (沈亚之),
est une autre variation sur le même thème, d’un auteur qui a
également écrit deux autres « Rêves étranges » (《异梦录》),
ainsi qu’une « Plainte de la rivière Xiang » (《湘中怨》),
chuanqi sur un autre thème, fantastique celui-là : celui
de la jeune fille rencontrée un jour, mais qui s’avère être du
gynécée d’un dragon, et doit donc repartir…
|
Le thème du
rêve, enfin, a inspiré un célèbre chuanqi à un
autre auteur de la même époque : Li Gongzuo (李公佐).
Parmi les quatre récits de lui qui nous sont parvenus,
« L’histoire du gouverneur de Nanke » (《南柯太守传》)
est le plus connu. C’est l’histoire d’un jeune homme que
l’on ramène ivre mort chez lui. La tête sur son
oreiller, il voit deux messagers apparaître et lui
présenter un ordre l’appelant à la cour. Il monte sur
leur char, qui s’engage dans une cavité creusée dans le
tronc d’un vieil acacia. Ils traversent des |
|

L’histoire du gouverneur de Nanke
(lianhuanhua) |
contrées sauvages et
parviennent à une grande ville dont les murailles portent
l’inscription : « Paisible royaume du Grand Acacia »
(“大槐安国”).
On retrouve ensuite le
thème de la « source aux fleurs de pêchers » de Tao Yuanming (陶淵明)
: le jeune homme épouse la fille du souverain, est fait
gouverneur de Nanke, et jouit de la plus haute considération.
Mais au bout de trente ans, il subit une défaite en allant
combattre un royaume ennemi. Il est destitué, la princesse
meurt, le souverain n’a plus confiance en lui et le bannit… sur
quoi le jeune homme se réveille. En examinant les racines de
l’acacia, il découvrira une colonie de fourmis présentant une
organisation semblable à celle du royaume vu en rêve.
Le récit estompe ainsi
la frontière entre réalité et illusion, ce qui lui donne plus de
profondeur que le récit du « Conte de l’oreiller ». Il sera lui
aussi adapté sous les Ming par Xiang Tianzu (汤显祖),
sous le titre « Le conte de Nanke » (《南柯记》).
|
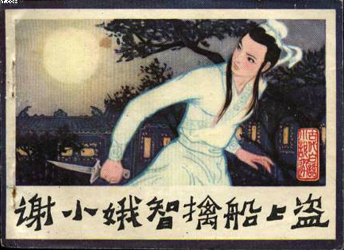
Xie Xiao’e |
|
Li Gongzuo a
laissé trois autres chuanqi dont l’un est une
histoire de vengeance exercée par une jeune fille dont
les parents ont été tués par des brigands : « L’histoire
de Xie Xiao’e » (《谢小娥传》)
comporte en outre une intrigue originale, l’identité des
assassins ayant été dévoilée à la jeune héroïne – en
rêve à nouveau – sous forme de rébus à déchiffrer.
L’histoire sera également reprise sous les Ming. Cette
histoire de vengeance n’est pas sans rappeler celle de
Nie Yinniang (聶隱娘)
par Pei Xing (裴铏),
mais sans développer le personnage de Xiao’e en
véritable nüxia. |
Liens avec la
poésie
A partir de la seconde
moitié du huitième siècle, le chuanqi se développe en
parallèle avec la poésie, dont c’est un âge d’or. Au début du
neuvième siècle, le grand poète Bai Juyi (白居易)
se lie d’amitié avec l’historiographe devenu en 805 grand maître
de cérémonie à Chang’an : Chen Hong (陈鸿).
|
Au début de
l’ère Yuanhe (元和),
celui-ci écrit une « Histoire du chant de l’éternel
regret » (《长恨歌传》)
qui raconte l’histoire, romantique et tragique à la
fois, de la concubine Yang Guifei (杨贵妃),
favorite de l’empereur Xuanzong, sacrifiée en raison de
l’incompétence et des erreurs de son cousin Yang
Guozhong. C’est cette « Histoire du chant de l’éternel
regret » qui inspira ensuite le célèbre poème de
|
|
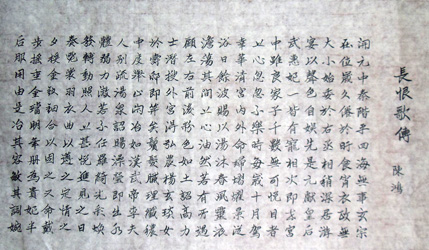
L’histoire du chant de l’éternel regret |
Bai Juyi « Le chant de
l’éternel regret » (《长恨歌》),
lui-même source d’inspiration d’un grand nombre d’opéras et de
films.
|
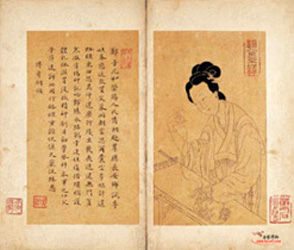
L’histoire de Li Wa |
|
Mais Bai Juyi
avait aussi un frère cadet vice-directeur de service
ministériel à la capitale et auteur de chuanqi :
Bai Xingjian (白行简).
Le Taiping Guanji contient l’un de ses récits, « L’histoire
de Li Wa » (《李娃传》),
qui raconte comment le fils d’une grande famille de
Chang’an devient esclave de sa passion pour la
courtisane Li Wa, et finit pleureur dans les cortèges
funèbres, puis mendiant ; Li Wa finira par le sauver et
il l’épousera après s’être réconcilié, grâce à elle,
avec son père. C’est l’un des chuanqi les plus
célèbres de la période, une histoire morale, mais
critique de l’institution du mariage traditionnel, qui a
inspiré maints opéras. |
Bai Xingjian a aussi
écrit un « Conte des trois rêves » (《三梦记》)
regroupant trois histoires qui élaborent des intrigues
impliquant chacune un rêve.
Un autre auteur de
chuanqi proche de Bai Juyi fut Yuan Zhen (元稹).
Poète lui-même, il composa dans sa jeunesse des odes avec Bai
Juyi. D’après sa biographie qui figure dans l’Histoire des Tang,
on parlait à l’époque des poètes Yuan et Bai, définissant un «
style de l’ère Yuanhe » (‘元和体’).
|
De ses contes,
il ne reste que « L’histoire de Yingying » (《莺莺传》),
mais elle est célèbre. Intitulée aussi « Rencontre avec
une immortelle » (《会真记》),
l’histoire raconte la rencontre d’un jeune lettré,
Zhang, avec la jeune Yingying et sa mère au monastère de
Pujiu où ils ont fait halte au cours d’un voyage. Zhang
tombe amoureux, les deux jeunes gens passent un mois
ensemble dans la ‘chambre de l’ouest’, puis Zhang
repart. Il échoue aux examens départementaux, se fixe
dans la capitale, tente de revoir Yingying, mais chacun
se marie de son côté. Ayant tenté de la revoir une
ultime fois, il n’obtient d’elle qu’un poème. |
|
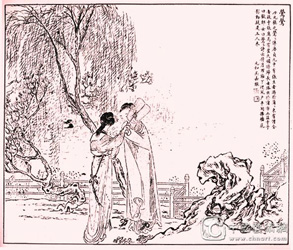
L’histoire de Yingying |
Le récit a donné lieu
à d’innombrables adaptations. Il a été d’abord développé en
« Ballade de la Chambre de l’Ouest » (《弦索西厢》)
par Dong Jieyuan (董解元)
sous les Jin, puis cette version a ensuite été adaptée en
opéras, et d’abord en opéra zaju par Wang Shifu (王实甫)
sous les Yuan, sous le titre « Conte de la Chambre de
l’Ouest » ou Xixiangji (《西厢记》).
Cette même histoire a
enfin été adaptée au cinéma : produit par Li Minwei (黎民伟)
et réalisé par Hou Yao (侯曜)
en 1927, le film nous est parvenu sous le titre français « La
Rose de Pushui » (《西厢记》).
Avec le chuanqi,
le xiaoshuo acquiert ainsi des lettres de noblesse. Tous
ces récits alimentent sous les Tang des recueils célèbres, comme
le « Recueil des mystères et prodiges » (《玄怪录》)
de Niu Sengru (牛僧孺).
Mais l’aspect extraordinaire ou fictionnel est souvent gommé,
comme chez Li Gongzuo. On assiste ainsi parfois à la fin à une
véritable déconstruction de l’étrange du récit qui ouvre la voie
à des récits beaucoup plus réalistes.
A la fin de la période
Tang, les xiaoshuo se sont développés selon trois axes
thématiques principaux, à partir des contes fantastiques de la
période des Six dynasties : histoires de fantômes et aventures
extraordinaires, histoires d’amour faisant à l’occasion
intervenir des événements ou des êtres étranges, et des
histoires de héros et héroïnes
précurseurs de la littérature de
wuxia.
Ce sont des récits écrits par
des lettrés, à des fins de divertissement.
Le développement du
xiaoshuo va se poursuivre sur ces bases sous les Song, sous
l’impulsion des facteurs propres à la période.
|
|

