|
|
A Cheng 阿城
Présentation 介绍
par Brigitte Duzan, 6 septembre 2009, actualisé 7 septembre 2019
|
A Cheng (ou Ah
Cheng selon les transcriptions) fait partie des grands
auteurs chinois nés avec la République populaire, ou peu
s’en faut en ce qui le concerne. Il est universellement
connu pour sa trilogie des « rois », et surtout pour la
première de ces trois nouvelles « Le roi des échecs » ;
elle marquait ses débuts en tant qu’écrivain, mais dès
sa publication, en 1984, elle bouleversa le monde des
lettres chinois.
Enfance
A Cheng est né
à Pékin, le 6 avril 1949. Dans son autobiographie qui
figure en avant-préface du « Roi des échecs », il
explique avec humour :
« Je
m’appelle Acheng, nom de famille Zhong. […] Né le jour
de la fête de Qingming, je suis arrivé comme par
étourderie au moment où les Chinois célébraient leurs
|
|
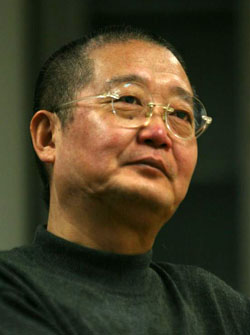
A Cheng (IC Photo) |
morts… Six mois plus
tard était fondée la République populaire de Chine.
Ainsi peut-on dire que j’appartiens à l’ancienne société…. »
Il a par ailleurs
commenté ainsi le prénom que lui ont choisi ses parents, et dont
il a fait son nom de plume (en deux caractères séparés) :
…父母在包围北平的共产党大军里,为我取名叫个“阿城”,虽说俗气,却有父母纪念毛泽东“农村包围城市”革命战略成功的意思在里面。
… mes parents ayant
fait partie de la grande armée communiste qui a encerclé
Beiping, ils ont choisi pour moi le prénom Acheng, prénom bien
ordinaire, mais qui traduit leur intention de commémorer la
réussite de la stratégie révolutionnaire de Mao Zedong qui
consistait à faire encercler les villes par la campagne…
(texte introductif du recueil《闲话闲说》)
Son père, Zhong
Dianfei (钟惦棐),
était un théoricien réputé du cinéma et sa mère travaillait aux
studios de Pékin. Son père était membre du Parti communiste,
mais souffrait de voir l’emprise croissante de la politique et
de la bureaucratie sur la création artistique, et
cinématographique tout particulièrement ; pendant la campagne
des « Cent fleurs », en 1957 (1), il écrivit un article
dénonçant cette ingérence : dénoncé comme « droitier », il fut
de ceux envoyés « à la campagne ».
Pour subvenir aux
besoins de la famille, la mère fut obligée de vendre les livres
de la bibliothèque familiale. A Cheng, chargé de les apporter
chez le marchand, se mit alors à les lire systématiquement avant
qu’ils ne disparaissent. A huit-dix ans, il lut ainsi, outre les
grands classiques chinois, les auteurs russes et français qui
formaient alors la base de la culture des lettrés chinois :
Tolstoï, Dostoïevski, Balzac, Hugo…
Le père fut réhabilité
en 1960 et fit alors entrer son fils au lycée « n° 4 » de la
capitale, celui des enfants des dirigeants du Parti : il s’y
trouva en même temps que Bei Dao et Chen Kaige (qui devait plus
tard réaliser un film adapté de la nouvelle « Le roi des
enfants »).
Eveil
d’une vocation
En 1966, au début de
la Révolution culturelle, ses parents sont envoyés à la
campagne, lui aussi : il a juste terminé ses études secondaires.
Il est un de ces « Jeunes instruits » (知青)
qui vont
y passer « guère plus de dix ans » comme il le dit lui-même dans
son autobiographie.
Il est d’abord envoyé
au Shanxi, où il découvre le dessin et la peinture, puis en
Mongolie intérieure, et enfin au Yunnan, dans la région de
Xishuangbanna,
où il passe beaucoup de temps à dessiner et fait la connaissance
du peintre Fan Zeng (范曾) qui devient son ami et mentor (2).
En même temps,
reprenant une très ancienne tradition chinoise qui a nourri la
littérature et l’opéra, A Cheng cultive un autre don : celui de
conteur. A leurs heures de loisirs, il raconte des histoires à
ses amis et aux paysans avec lesquels ils vivent, adaptant des
récits chinois ou étrangers. Tirant sur les souvenirs de ses
lectures, il leur raconte ainsi une « Anna Karénine » à sa
façon, découpée en épisodes qui s’étalent sur plusieurs mois.
Tous ces récits viendront par la suite alimenter ses écrits.
La
trilogie des « rois »
En 1979, A Cheng
revient à Pékin, grâce à son ami Fan Zeng qui le fait entrer
comme directeur artistique à la maison d’édition Shijie tushu
(世界图书出版公司) :
outre la rédaction, il s’occupe des maquettes et des
illustrations. Sa réputation se répand dans le monde
artistique ; il fréquente en particulier le groupe dit « des
étoiles » (星星
xīngxīng)
, groupe de peintres avant-gardiste et contestataires où il
rencontre l’écrivain et critique
Li Tuo (3) qui le persuade
d’écrire les histoires qu’il racontait pendant qu’il était
« jeune instruit » au Yunnan.
|
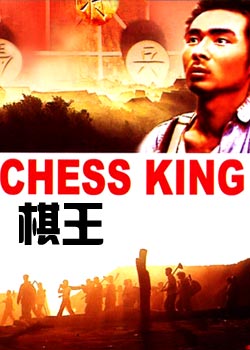
« Le roi des
échecs »《《棋王》》 |
|
A Cheng écrit ce premier
livre d’une traite, sous le coup de l’inspiration,
pratiquement sans retouche. C’est 《棋王》ou « Le roi des
échecs ». La nouvelle est publiée en juillet 1984, dans
la revue littéraire de Shanghai
《上海文学》:
le succès est immédiat et le livre secoue le monde
littéraire chinois, à un moment où les écrivains chinois
n’étaient guère sortis, à quelques exceptions près, du
« roman psychologique » doublé d’une réflexion sur la
société chinoise. Par ailleurs, alors que ses
contemporains s’attachaient à décrire les désordres et
le chaos de la période écoulée, A Cheng, lui, s’attarde
sur des scènes paisibles, en harmonie avec la nature, où
l’individu doit savoir trouver un bonheur simple. C’est
le début de ce qu’on a appelé le mouvement de
« recherche des racines », A Cheng en représentant, en
quelque sorte, le courant « du nord » et Han Shaogong
celui « du sud ». |
Fort de cette toute nouvelle
gloire, A Cheng démissionne de son poste pour se consacrer à
l’écriture de scénarios et à l’adaptation de films. Il collabore
d’abord avec le réalisateur (de la quatrième génération) Teng
Wenji (滕文骥)
qui travaille alors aux studios de Xi'an. Ils font deux films
ensemble, dont une adaptation de 《棋王》, mais sans grand succès. A
Cheng se tourne alors vers Xie Jin (谢晋), l’un des grands maîtres
de la quatrième génération des réalisateurs chinois, et adapte
pour lui le roman de Gu Hua 《芙蓉镇》(Fúróng
zhèn, ou « le
village des hibiscus »).
Le film sort en 1986 ; servi par
d’excellents acteurs, dont Jiang Wen, c’est un succès. Mais le
réalisateur s’est fâché à cette occasion avec A Cheng qui ne lui
avait remis qu’un scénario elliptique, sous le prétexte que rien
ne sert de rédiger de longues descriptions, car le réalisateur
fait de toutes façons ce qu’il a en tête. Le problème, c’est
qu’il était payé pour l’ensemble, non au caractère, il a donc
touché la totalité de son cachet, et Xie Jin a refait le
scénario… (4)
|
Mais ce n’est sans doute
pas son souci principal à ce moment-là (et à aucun
moment sans doute : l’écriture de scénario semble n’être
pour lui qu’une manière d’assurer ses fins de mois). En
cette année 1985, il écrit en effet les deux autres
volets de sa trilogie des « rois » : « Le roi des
arbres » (《树王》) et « Le roi des enfants » (《孩子王》). Ce
sont les chefs d’œuvre absolus de la littérature
post-maoïste. C’est une réhabilitation de la culture
après la Révolution culturelle, plus profonde qu’une
simple « recherche des racines » ; A Cheng y développe
l’un de ses thèmes favoris : le culte du livre et de
l’écrit, qui remonte sans doute à son enfance, mais
prend toute sa profondeur dans un contexte où chaque
livre était devenu un trésor rare à préserver.
Ces livres développent
surtout un autre thème majeur chez A Cheng : la
réhabilitation de l’individu dans la société, longtemps
méprisé au profit de la collectivité ; mais la
préservation des valeurs est désormais le fait, non plus
de |
|
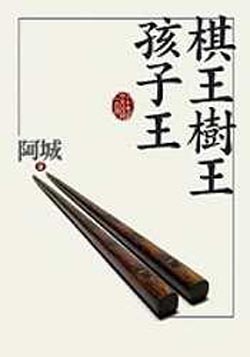
« Le roi des
arbres » (《树王》) et
« Le roi des enfants »
(《孩子王》) |
héros hors du commun, de héros
« positifs », mais de l’homme ordinaire, dont les exploits sont
humains : le roi des arbres défend un arbre (symbolique) jusqu’à
la mort, et le roi des enfants dépense toute son énergie à
éduquer les enfants du village ; lorsqu’il doit quitter son
poste, il est content de leur laisser au moins son dictionnaire…
Il se dégage de ces récits une grande sérénité : les souffrances
infligées par l’histoire sont en toile de fond, les personnages
s’efforcent de préserver quelques moments de bonheur tout simple
au milieu de l’adversité, clé d’une existence harmonieuse et
pacifiée qui est celle du sage bouddhiste ou taoïste.
D’ailleurs, A Cheng revendique
pour lui-même cet idéal de simplicité qui est celui du lettré
chinois de tous les temps :
« En 1979, je suis rentré à
Pékin où je me suis marié. J’ai trouvé un travail, j’ai eu un
enfant… Une telle expérience ne dépasse pas l’imagination d’un
Chinois moyen. J’ai vécu comme tout le monde, et je vis comme
tout le monde, à la seule différence près que j’écris. Pour
subvenir aux dépenses familiales, j’envoie les textes là où on
les imprime... Comme un menuisier qui part chaque jour au
travail, je suis un artisan. Je suis comme tout le monde, je
n’ai rien de différent. »
(avant-préface au « Roi des
Echecs
traduction Noël Dutrait)
Après la trilogie
|
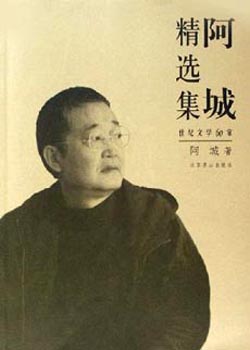
« Recueil » |
|
A Cheng écrit
cette même année une série de six courtes nouvelles qui
seront publiées dans un recueil avec « Le roi des
échecs », et sous le même titre :
《会餐》(huìcān,
un banquet),《树桩》(shùzhuāng,
la
souche) , 《周转》 (zhōuzhuǎn,
roulement de fonds),《卧铺》(wòpù,
la couchette),《傻子》(shǎzi,
l’idiot)
et
《迷路》(mílù,
perdre son chemin) (5).
En 1986, il
publie une série de textes très courts écrits pendant
les deux années qui précèdent, évoquant des paysages,
des personnages ou des situations spécifiques des
régions où il a vécu pendant ses années « à la
campagne », et regroupés sous le titre
《遍地风流》
(biàndì
fēngliú),
que Noël Dutrait traduit par ‘hommes remarquables de
tous horizons’ et que l’on pourrait aussi bien traduire
par ‘histoires de paysages’. Ce sont des textes
poétiques, qu’A Cheng a désavoués par la suite |
en les trouvant trop
peu naturels, mais qui
reprennent la grande tradition du
笔记小说
(bǐjì
xiǎoshuō) :
de brefs écrits qui peuvent être des essais ou de simples notes.
En 1987, A Cheng élit
domicile aux Etats-Unis, se partageant entre l’écriture de
scénarios (4) et celle de notes du genre
笔记
bǐjì,
devenu son genre de prédilection, qu’il publie dans diverses
revues. Il rentre en Chine à la fin des années 90, mais, depuis
1994, où ont été publiés, sous le titre《闲话闲说》(xiánhuà
xiánshuō),
des textes écrits entre 1987 et 1993 (6),
dans l’ensemble, ses publications se font rares. On ne peut
guère citer que les articles du genre
随笔
(essais informels,
écrits « au fil de la plume ») parus dans chacun des numéros de
la revue 《收获》(shōuhuò,
la
moisson) en 1997 et 1998, vingt-deux au total. En revanche, il
n’écrit plus de nouvelles. On dit qu’il avait initialement
l’intention d’écrire huit « rois » ; on espère toujours lire un
jour les cinq derniers…
Il a récemment donné
une interview au magazine ‘Oriental Outlook’ où perce une
certaine amertume : il définit l’écrivain comme un mendiant et
lui-même comme une personne sans identité ; c’est le meilleur
témoignage de l’humour glacial et du caractère acerbe et sans
concessions de sa vision actuelle des choses :
http://www.danwei.org/art/ah_cheng_on_making_a_living_as.php
Après 2005…
Au début des années
2000, A Cheng a été écrivain en résidence au Centre culturel du
département des médias de Taiwan, à Taipei. En 2004, il a écrit
le scénario du film « The Go Master » (《吴清源》)
de Tian Zhuangzhuang (田壮壮)
(4),
puis, en 2005, été membre du jury de la 62ème
Biennale de cinéma de Venise.
|
En 2006, il
commence à travailler avec le peintre Liu Xiaodong (刘小东),
comme responsable des images d’archives du projet
« Domino », et se partage dès lors entre ses activités
de scénariste et d’écrivain et son travail pour des
projets artistiques. En 2007, il écrit le script d’une
nouvelle version de l’opéra Turandot, mais il est aussi écrivain
en résidence à l’université Lingnan de Hong Kong. Puis,
en 2008, il est consultant en chef de la Compagnie des
Arts et représentations polyvalentes de |
|

Kungfu Poem |
Pékin pour leur pièce
dansée « Kungfu Poem ». Il
est aussi curateur du pavillon de la Chine à la Biennale
d’architecture de Venise.
En juillet 2012, A
Cheng a été consultant dans le cadre du projet Hotan de Liu
Xiaodong (《刘小东在和田》)
– un projet de deux mois dans le désert du Xinjiang, sous des
tentes ; l’un des curateurs était
Ou
Ning (欧宁)
qui en a profité pour rencontrer et interviewer des écrivains du
Xinjiang, ce qui fournira la base du numéro 12 de
Chutzpah/Tiannan « Xinjiang Time », sorti en décembre 2012
…
Les peintures
réalisées pour le projet Hotan :
http://hotan.artnow.com.cn/en/index.aspx?tid=4
Notes
(1) La collectivisation à marche
forcée instaurée en 1955 entraîne une crise agricole dès avril
1956 ; sous l’impulsion de Zhou Enlai, le programme est
suspendu. La récolte de l’été 1956 est désastreuse, la crise
agricole s’étend au secteur industriel et urbain en freinant les
capacités d’investissements. Cette crise entraîne à son tour une
libéralisation politique : il s’agit de restaurer la confiance
dans le Parti. Celui-ci tend la main aux intellectuels et aux
jeunes dont le mécontentement est le plus menaçant en lançant la
« Campagne des Cent Fleurs » (百花运动) (discours de Mao du 2 mai
1956). En échec sur la plan économique, Mao tente de reprendre
la main sur le plan politique. Le mouvement est renforcé en
février 1957 par le mouvement de « rectification » (discours sur
« La juste solution des contradictions au sein du peuple »).
C’est à ce moment-là que les Chinois sont invités à exprimer
leurs critiques des excès du régime. La contestation explose,
entraînant, en juin 1957, un mouvement de
répression « anti-droitiers » qui dure jusqu’en septembre et se
traduit par l’arrestation de centaines de milliers de cadres et
d’intellectuels qui sont « envoyés à la campagne » (下乡
xiàxiāng).
(2) A Cheng était effectivement
très doué en peinture, et, dans ce domaine, son style était
aussi critique que ses écrits. En 1976, par exemple, au moment
des manifestations marquant la disparition de Zhou Enlai, il a
réalisé un portrait de l’ancien premier ministre qui fut célèbre
à l’époque et fut ensuite publié dans le n° 3 de Jintian (le
journal fondé par
Bei Dao), en novembre 1978. On
y voit un Zhou Enlai au visage fatigué tranchant sur l’image
pimpante et souriante des photos officielles et des affiches de
propagande de l’époque.
(3) Né en 1939, auteur de
nouvelles, critique littéraire et de cinéma, auteur d’un essai
sur la modernisation du langage cinématographique qui influença
la cinquième génération de réalisateurs (ceux sortis en 1982 de
l’institut du cinéma de Pékin, la première génération après la
Révolution culturelle). Il faut aussi le mentor de
Yu
Hua et
Su Tong et édita plusieurs
volumes de nouvelles.
(4) Une autre controverse a
éclaté plus récemment, pour le film
de Tian
Zhuangzhuang (田壮壮)
« The Go Master » (《吴清源》Wu
Qingyuan),
sorti en 2006, dont A Cheng a écrit le scénario. Nombre de
critiques se sont demandés dans quelle mesure le réalisateur
l’avait vraiment suivi.
A Cheng a expliqué
à cette occasion que le réalisateur ne devait rien à son
scénariste, mais qu’il était responsable vis-à-vis de ses
producteurs…
A Cheng a écrit d’autres
scénarios pendant qu’il vivait aux Etats-Unis : celui de « Full
moon in New York » (《人在紐約》) de Stanley Kwan en 1990, et de
« Painted Skin » (《画皮之阴阳法王》) de King Hu (胡金铨) en 1993.
Surtout, c’est lui
qui est l’auteur du scénario du chef-d’œuvre de Tian
Zhuangzhuang réalisé en 2002 : le remake du grand classique de
Fei Mu « Printemps dans une petite ville » (《小城之春》).
(5) Ces nouvelles, sauf la
seconde, sont incluses dans le recueil paru aux éditions de
l’Aube sous le titre de la dernière (Perdre son chemin). Le
recueil inclut également quatre textes tirés de 《遍地风流》
sous le titre « Au fil du chemin ».
(6) Traduits en français sous le
titre « Le roman et la vie ».
En complément
On peut lire l’interview sur ses
années au Yunnan donnée à Berkeley, fin janvier 1987, alors
qu’il venait d’arriver aux Etats-Unis, dans l’anthologie
« Modern Chinese writers, self-portrayals » que l’on trouve en
ligne (en anglais), numérisée par google :
http://books.google.fr/books?id=CNAwX9FjrnUC&pg=PA106&lpg=PA106&dq=zhong+acheng&
source=bl&ots=px9mXCyzj8&sig=mNBVFDPSrRVoBgi7DhrVP5rZCmo&hl=fr&ei=O9KgSrqz
DOOMjAet5si-Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7#v=onepage&q=zhong%20acheng&f=false
Traductions en français :
Les principales œuvres d’A Cheng
ont été traduites en français par Noël Dutrait et publiées aux
éditions de l’Aube :
-
Perdre son chemin (1991 – 2001 pour
l’édition de poche)
-
Les trois rois (1994)
-
Le roman et la vie (1995)
-
Injures célestes (2004, parues sous
le titre de Chroniques en 1992)
Autre traduction :
-
Le vieux chanteur, nouvelle de
1984, trad. Noël Dutrait, dans l’anthologie La remontée
vers le jour,
Alinéa, 1988, pp. 177-185.
La plupart de ces courts textes, dans leur version originale en
chinois, sont regroupés dans le recueil paru en 2005 sous le
titre
《阿城,精选集》aux
éditions
北京燕山出版社.
A lire en complément :
La trilogie des Rois
« Le roi des échecs » : la nouvelle d’A
Cheng
et ses adaptations cinématographiques par
Teng Wenji et Tsui Hark
《炊烟》
«Fumée de cuisine»
阿城:《闲话闲说》中国世俗与中国小说 A Cheng :
Digressions sur les coutumes séculaires et la fiction en Chine
chapitre 27 La poésie Tang, la
musique et la vie quotidienne
chapitre 32 La
théorie des classes et l’expression wàngbā 忘八 / 王八
Club de lecture du
Centre culturel de Chine - Comptes rendus des séances 2019-2020
Séance 1 - octobre
2019 – A Cheng (阿城)
|
|

