|
|
A la découverte du
roman, histoire et défense du mythoréalisme par Yan Lianke
par Brigitte Duzan, 4
mai 2017, actualisé 25 février 2020
|
C’est en juillet 2011 que
Yan
Lianke (阎连科)
a publié « A la découverte du roman » (《发现小说》)
– long et subtil essai sur sa vision personnelle de la forme
romanesque et de son évolution dans la littérature mondiale. Il
faut rendre grâce aux éditions Philippe Picquier de l’avoir
publié, et à
Sylvie Gentil
de l’avoir traduit, car c’est une vision qui éclaire d’un jour
particulier l’œuvre de cet écrivain majeur des lettres chinoises
contemporaines : on suit ainsi mieux la pensée qui parcourt sa
création. En même temps, c’est une analyse approfondie de la
littérature contemporaine chinoise, appuyée sur des références à
un vaste corpus de textes de la littérature mondiale.
Il faut souligner aussi les subtilités de la traduction qui
s’ajoutent aux subtilités du texte lui-même et prennent une
connotation particulière maintenant que, soudain, nous a quittés
la traductrice. Elle a pris soin de traduire en même temps la
nouvelle ‘moyenne’ « Un chant céleste » (《耙耧天歌》)
que Yan Lianke cite dans son essai comme
|
|
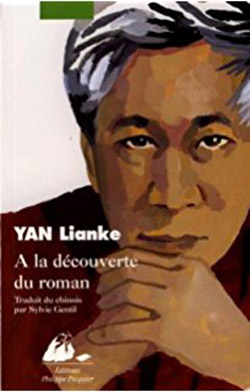
A la découverte du roman
|
étant la première apparition dans son œuvre de traces
mythoréalistes. Les deux textes sont à lire dans la continuité,
l’un venant en illustration de l’autre. Ils ont été réédités en
même temps en 2014.
|
A la découverte du roman
« A la découverte du roman » est en quelque sorte un plaidoyer
pro-domo : Yan Lianke nous explique comment il est arrivé au
mythoréalisme (神实主义)
pour créer des récits dont le style soit le mieux adapté à la
réalité concrète de la Chine actuelle, dans sa démesure, son lot
de folie et d’absurde au quotidien
.
Refus de conformité
Yan Lianke se livre pour ce faire à une analyse du réalisme en
littérature, en partant d’une déclaration qui est une citation
de la postface de la version originale de son roman
« Les
Quatre livres » (《四书》)
: « Je suis un fils indigne du réalisme » (我是现实主义的不孝之子),
« un traître à l’écriture »
(“写作的叛徒”).
C’est
un faux acte de contrition, qui assume au contraire la volonté
de ne pas rester aveuglément fidèle aux formes littéraires
usuelles, ce qu’il appelle la « littérature habituelle » (“习惯文学”).
1.
Les différentes formes de réalisme et leurs limites
Mais encore fallait-il bien savoir de quoi il se démarquait. Yan
Lianke commence donc, dans une première partie, par une
nomenclature des formes d’expression du réel dans le roman
mondial, en en distinguant quatre : le « réel fallacieux »
, image à la fois contrôlée et faussée d’une société elle-même
sous contrôle (社会控构真实) ;
le « réel mondain », image superficielle d’une société
appréhendée dans ses aspects extérieurs (世相经验真实)
; le « réel vital », qui donne une image de la vie telle
qu’elle est vécue, la vie comme expérience (生命经验真实) ;
et le « réel spirituel » qui est exploration des
profondeurs de l’âme (灵魂深度真实).
A
chacune de ces formes d’expression du réel correspond un
réalisme spécifique
,
illustré par des œuvres célèbres, de la littérature soviétique à
Balzac,
Shen Congwen (沈从文)
ou
Qian Zhongshu (钱钟书)
pour le réel mondain, Hugo, Stendhal, Tolstoï, Tourgueniev ou Lu
Xun (魯迅)
pour le réel vital, et enfin, pour le réalisme spirituel qui est
l’épitome de ce qui précède, Dostoïevski.
Toutes ces formes de réalisme ont leurs limitations, mais
surtout ce ne sont pas des catégories nettes et exclusives :
elles se recoupent et débordent les unes sur les autres. La
fiction romanesque est essentiellement question d’expression :
un art de la langue (“小说是语言的艺术”).
Pour mieux comprendre l’écriture romanesque, Yan Lianke étudie
donc, dans sa deuxième partie, les ressorts
narratifs, c’est-à-dire la narration sous l’angle causal : d’où
part la narration, de quelle cause (ou non-cause) initiale
procède-t-elle, et comment se déroule-t-elle ensuite ?
2.
Les schémas narratifs vus sous l’angle causal
Abordée sous cette angle, l’analyse est beaucoup plus claire.
Elle distingue quatre schémas narratifs basés sur cette notion
de causalité :
- la causalité zéro (章零因果),celle
de Kafka, de « La Métamorphose » et du « Château », c’est
l’absurde au quotidien ;
- la causalité absolue (全因果),
celle qui présuppose l’équivalence parfaite entre cause et effet
(s), et que l’on retrouve dans une grande partie des roman du 19ème
siècle ;
- la semi-causalité (半因果),
celle du fameux « magico-réalisme » sud-américain qui rompt avec
la rationalité de la causalité absolue, mais sans négliger
l’histoire et la réalité du peuple comme le fait la causalité
zéro ;
- et enfin, épitome des trois autres, la causalité interne
(内因果)
qui correspond à l’expression de la réalité spirituelle en se
plongeant dans les tréfonds de l’âme ; elle a donné le mouvement
du flux de conscience, et les chefs d’œuvre que sont « Mrs
Dalloway », « Ulysses » ou « La Recherche du temps perdu » ; il
est ici question de donner à voir le monde, pas seulement une
individualité.
|
|

Un chant céleste
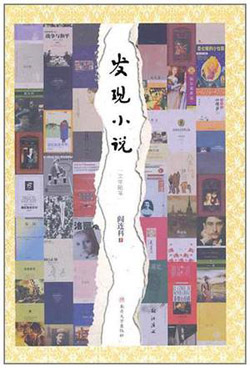
Edition de Nankai, 2011

Réédition Littérature du peuple, 2014
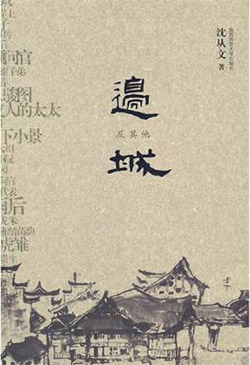
Shen Congwen, Biancheng《边城》
(réalisme mondain)
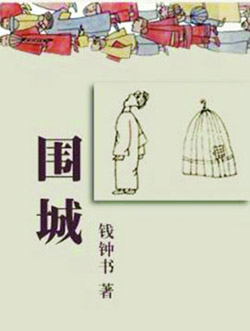
Qian Zhongshu, La forteresse assiégée
《围城》(réalisme mondain) |
|
Le mythoréalisme (神实主义)
se conçoit dans cette perspective, et dans ce prolongement, en
allant au-delà des causalités directes, et même des causalités
internes, celles de l’esprit dans son rapport avec l’autre, avec
le monde. C’est donc ce que Yan Lianke étudie dans sa troisième
partie.
3.
Le mythoréalisme
C’est un mouvement qui, selon lui, est en germe depuis très
longtemps dans la littérature chinoise et qu’il définit ainsi :
在创作中摒弃固有真实生活的表面逻辑关系,去探求一种“不存在”的真实,看不见的真实,被真实掩盖的真实。神实主义疏远于通行的现实主义。
Au cours du processus créatif, rejeter tout rapport logique
superficiel inhérent à la vie réelle pour rechercher une réalité
« qui n’existe pas », une réalité invisible occultée par la
réalité tangible. Le mythoréalisme s’est dégagé du réalisme
ordinaire.
Le mythoréalisme est en quête de réel interne, en faisant appel
à toutes les formes de l’imagination populaire, nées du réel,
mais transcendées en passant dans l’imaginaire collectif :
mythes et légendes, allégories, rêves et fantasmes. Le
mythoréalisme se définit ainsi dans une double dimension au-delà
du réel :
神实主义绝不排斥现实主义,但它努力创造现实和超越现实
主义。
Le mythoréalisme n’est pas rejet du réalisme, mais effort
opiniâtre de recréation et dépassement du réalisme.
Yan Lianke poursuit en développant son propos et en donnant des
exemples, dans la littérature contemporaine chinoise, d’œuvres
qui annoncent le mythoréalisme tout en restant dans le domaine
du réalisme, en commençant
|
|
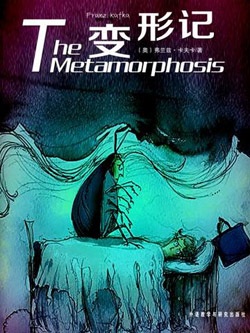
La Métamorphose 《变形记》(causalité zéro)
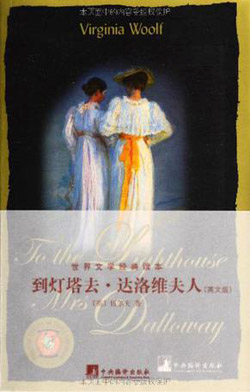
To the Lighthouse 《到灯塔去》/
Mrs. Dalloway《达洛维夫人》
(flux de conscience, causalité interne) |
par
« Brothers » (《兄弟》)
de
Yu Hua (余华)
et en poursuivant avec
Jia Pingwa (贾平娃)
et
Su Tong (苏童).
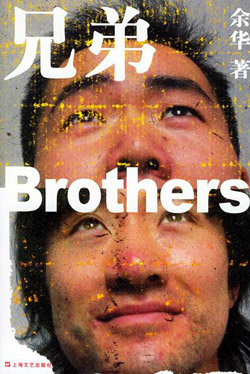
Brothers
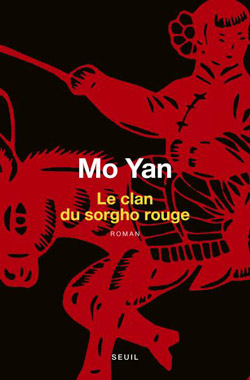
Mo Yan, le Clan du sorgho
(tr. Sylvie Gentil, Pascale Guinot) |
|
Cependant, il fait remonter la naissance du mythoréalisme aux
années 1980, ce qui est une autre manière d’aborder le
mouvement d’avant-garde de
ces années-là, les formes expérimentales de l’avant-garde étant
source d’inspiration « en ouvrant une lucarne sur le monde ».
Mais les deux auteurs que cite Yan Lianke comme point de départ
d’une écriture mythoréaliste encore vague sont peu connus : la
romancière
Shen Rong (谌容)
pour sa nouvelle « Dix ans de
moins » (《减去十岁》),
et Wu Ruozeng (吴若增)
pour « Le Fume-cigarette en émeraude » (《翡翠烟嘴》),
deux nouvelles des tout débuts de la décennie.
Même les nouvelles du courant de « recherche
des racines » (“寻根文学”)
comportent leur part de mythe et de merveilleux, dit encore Yan
Lianke, citant « PaPaPa » (《爸爸爸》)
de
Han Shaogong (韩少功),
« Merveilleux cimetières » (《美穴地》)
de
Jia Pingwa (贾平凹)
et bien d’autres. Cependant, dit-il enfin, c’est
Mo Yan (莫言)
avec
« Le Clan du
sorgho » (《红高粱》)
et ses œuvres suivantes qui a déclenché le mouvement : non point
mythoréalisme, mais dépassement du réalisme comme prélude au
mythoréalisme.
Ce qui donne une assise et une profondeur au mythoréalisme, ce
sont ses antécédents, sinon ses sources, dans une tradition
millénaire remontant à la Bible et aux épopées de l’Antiquité
gréco-latine, mais aussi, côté chinois, à une tradition
littéraire du fantastique ancrée dans l’imaginaire populaire, de
« La Pérégrination vers l’ouest » (《西游记》)
aux
« Chroniques
de l’étrange » (《聊斋志异》)
de Pu Songling (蒲松龄).
Mais même chez
Lu Xun on
trouve une écriture mythoréelle plongeant dans la tradition du
fantastique, dont la fameuse histoire de Mei Jianchi (眉间尺)
« Forger les épées » (《铸剑》)
des « Contes anciens à notre manière » (《故事新编》).
|
Cependant, termine Yan Lianke, la grande difficulté est de
rester dans la peinture du réel, sans tomber dans la légende,
l’absurde ou le surréalisme, c’est-à-dire des formes
antérieures, classiques, de dépassement du réel. Il semble
lui-même avoir encore évolué depuis l’écriture de cet essai,
puisque son roman paru en 2015,
« La mort du soleil » (《日熄》),
semble en revenir à une narration dérivant de la causalité zéro.
Surtout, il est difficile de parler de mouvement ou courant
littéraire pour une œuvre unique. Quoi qu’il en soit, il est
fascinant de voir un auteur soucieux d’assurer la pérennité de
son œuvre en inventant lui-même la théorie la mieux à même,
selon lui, de décrire au plus près ses propres intentions, choix
et critères de création.
Un chant céleste
|
Dans le cours de son essai, Yan Lianke cite l’une de ses
nouvelles comme point de départ de son écriture mythoréaliste.
Il s’agit d’une nouvelle zhongpian (pourtant publiée
comme roman par Philippe Picquier) dont la publication remonte à
1998 : « Le chant céleste des monts Balou » (《耙耧天歌》)
.
C’est une sorte de conte fantastique où une femme lutte pour
marier ses enfants tous atteints d’une maladie congénitale qui
les rend idiots. Son mari s’est jeté dans le fleuve pour fuir ce
destin funeste, mais son fantôme revient hanter sa femme dans
les moments difficiles, comme torturé par sa mauvaise
conscience. Pour guérir sa progéniture, un rebouteux finit par
lui indiquer une recette qui ressemble beaucoup à celle de la
nouvelle
« Le
remède » (《药》)
de
Lu Xun.
Une traduction remarquable
|
|

Le chant céleste des monts Balou,
réédition 2014 |
L’essai comme la nouvelle sont remarquablement traduits, dans un
style fluide et clair pour l’essai, poétique et prenant pour la
nouvelle.
L’essai a été particulièrement difficile à traduire car non
seulement il fallait inventer des termes correspondants à ceux
inventés par Yan Lianke, mais il fallait en outre trouver les
sources des innombrables œuvres citées. Et là, Sylvie Gentil a
poussé la conscience professionnelle jusqu’à chercher, et
trouver, dans tous les cas possibles, les références des
traductions déjà publiées en français. Sa traduction se lit donc
comme un superbe traité littéraire invitant à réfléchir sur la
littérature contemporaine chinoise, mais en outre comme une
source de références sur les traductions à lire pour compléter
la lecture de l’essai.
Seule ombre finale : il manque une table des matières*, et on
aurait aussi apprécié un glossaire final des titres et auteurs
cités. Mais cela pourra éventuellement être ajouté dans une
édition de poche ultérieure.
Ces deux titres resteront les dernières traductions de Sylvie
Gentil : elle est décédée un mois après leur publication.
Découvrir le roman
Un chant céleste
Editions Philippe Picquier, mars 2017.
*Table des matières
第一章 现实主义之真实境层
Chap. I : Les différentes strates du réel dans le
réalisme
(Les limites du réalisme)
1.
我是现实主义的不孝之子
1. Je suis un fils indigne du réalisme
2.
控构真实
2. Le réel, entreprise de falsification (Le réel fallacieux)
3.
世相真实
3. Le réel, reflet du monde (Le réel mondain)
4.
生命真实
4. Le réel, image de la vie (Le réel vital)
5.
灵魂深度真实
5. Le réel, expression des profondeurs de l’âme (Le réel profond
spirituel)
6.
真实相互
6. Interpénétration des réels (Interconnexion des réels)
7.
深层的现实主义道路可以走吗?
7. Jusqu’à quelle profondeur poursuivre le réalisme ?
(Quelle profondeur peut atteindre le
réalisme ?)
.
第二章 零因果
Chap. II : La causalité zéro
1.
格里高尔问题之一——作家在叙述中的权力与地位
1. Le problème de Gregor (I) – la place et le pouvoir de
l’auteur dans la narration
2.
格里高尔问题之二——故事双向的因果源
2. Le problème de Gregor (II) – le double niveau causal des
sources du récit
(la
bidirectionnalité causale en tant que source de l’histoire)
3.
格里高尔问题之三——零因果
3. Le problème de Gregor (III) – la causalité zéro
4.
零因果的黑洞意义
4. La causalité zéro en tant que trou noir
第三章 全因果
Chap. III : La causalité absolue
1.
全因果
1. Causalité absolue
2.
全因果局限
2. Limites de la causalité absolue
第四章 半因果
Chap. IV : La semi-causalité
1.
半因果
1. Semi-causalité
2.
半因果态度之一
2. Approche semi-causale (I) (L’attitude semi-causale)
3.
半因果态度之二
3. Approche semi-causale (II)
4.
半因果态度之三
4. Approche semi-causale (III)
5.
半因果胎议之一
5.
Aux sources de la semi-causalité (I)
6.
半因果胎议之二
6. Aux sources de la semi-causalité (II)
第五章 内因果
Chap. IV : La causalité interne
1.
外真实与内真实
1. Réel externe et réel interne
2.
内因果
2. Causalité interne
3.
内因果的可能性
3. Probabilité de la causalité interne
4.
内因果余话
4. Quelques mots supplémentaires sur la causalité interne
第六章 神实主义
Chap. IV : Le mythoréalisme
1.
神实主义的简单释说
1. Mythoréalisme : brève explication (Aperçu)
2.
神实主义的现实土壤与矛盾
2. Création mythoréaliste : terreau du réel et contradictions
3.
神实主义小说的当代创作
3. Roman mythoréaliste et création contemporaine
4.
神实主义之传统存在
4. Mythoréalisme et tradition
5.
神实主义在现代写作中的独特性
5. Singularité du mythoréalisme dans l’écriture moderne
6.
神实主义的规则和卜卦
6. Mythoréalisme : règles d’écriture et processus divinatoire
(Règles et augures)
Texte chinois :
http://lz.book.sohu.com/book-21973.html
Traduction en français
A la découverte du roman, trad. Sylvie Gentil, Philippe
Picquier, 2017, 208 p.
Mais il faut préciser dès l’abord qu’il ne s’agit pas
seulement de roman stricto sensu, mais aussi de
nouvelles. Eternel problème de la traduction de
xiaoshuo
小说
qui couvre en fait toute la fiction, des nouvelles
courtes au roman. Même s’ils sont en grande partie des
romans, les exemples donnés par Yan Lianke balaient
largement l’étendue du domaine, y compris en littérature
étrangère.
(1)社会控构真实——控构现实主义;
(2)世相经验真实——世相现实主义;
(3)生命经验真实——生命现实主义;
(4)灵魂深度真实——灵魂现实主义。
|
|

