|
« La Mort du
soleil » de Yan Lianke : une superbe allégorie de la Chine et du
monde
par
Brigitte Duzan, 24 février 2020, actualisé
23 juin 2021
|
En décembre 2015 est parue à Taiwan une première
édition d’un nouveau roman de
Yan Lianke (阎连科)
intitulé Rixi (《日熄》) :
littéralement « le soleil s’est éteint ». Le roman
nous arrive aujourd’hui dans une belle traduction en
français de Brigitte Guilbaud sous le titre « La
Mort du soleil », deux ans après une traduction en
anglais de Carlos Rojas, « The Day the Sun Died »
.
Entre-temps, en juillet 2016, le roman a remporté le
premier prix du prestigieux
« Prix du Rêve dans le
pavillon rouge » (“红楼梦奖”的首奖),
attribué tous les deux ans par l’Université baptiste
de Hong Kong ; c’est la deuxième fois que ce prix a
été décerné à un roman de Yan Lianke, après
« Les
Quatre livres » (《四书》)
en 2012. La publication de la traduction en anglais
avait suscité des éloges unanimes de la presse et
des critiques anglophones, la traduction en français
a le même effet. Et à juste titre : le roman est
l’un des plus réussis de Yan Lianke ! |
|
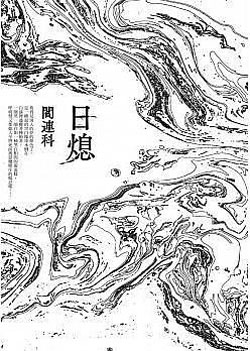
Rixi, 1ère édition, Taiwan,
décembre 2015 |
Une fois le livre refermé, cependant, on en est comme hanté, une
épidémie en appelant une autre, et l’actualité ne cessant de
nous y ramener.
Une histoire de somnambules…
|
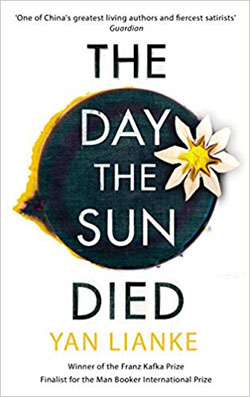
The Day the Sun Died (tr. Carlos
Rojas), 2018 |
|
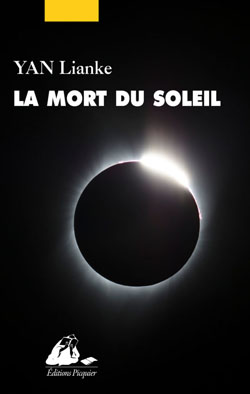
La Mort du soleil (tr. Brigitte
Guilbaud), 2020 |
Sur le thème du somnambulisme comme allégorie de la société
chinoise, le roman se rattache à ce que Yan Lianke a lui-même
qualifié de « mythoréalisme » (神实主义)
:
un genre auquel il est peu à peu arrivé
pour créer des récits dont le style soit adapté à la réalité
concrète de la Chine actuelle, dans sa démesure, son lot de
folie et d’absurde au quotidien. En ce sens, « La Mort du
soleil » parachève l’entreprise culminant jusqu’ici avec
« Les Chroniques de Zhalie » (《炸裂志》).
Mais Yan Lianke a franchi une étape supplémentaire en créant ce
que l’on va pouvoir appeler « hypnoréalisme ».
De la réalité à la fiction
L’histoire se passe dans un village à la saison des moissons,
par un mois d’août caniculaire : une nuit, le village semble
atteint d’une épidémie de somnambulisme. Les villageois
succombent les uns après les autres.
Yan Lianke a expliqué que l’idée lui est venue d’un souvenir
d’enfance
.
我少年时期生活在农村,就会经常遇到梦游的事情。每年夏天,特别热,大家收完麦子,都会睡在打麦场上,几乎每年都会有一两个人梦游,梦游的时候,一拍就拍醒了。在《年月日》小说里也写过一个老人在梦游,所以这不是一个偶然的创作,它到来得非常缓慢。试图摆脱历史,试图把握中国人精神上更内在的东西时,我想到了梦游。任何人想的东西,一生都在想的事情因为道德问题或者别的问题一生都不去做它,这些东西永远藏在我们内心,无法发现它,无法付诸去做它,但是在这个故事中,所有人每天想的,不能做的,在梦游状态中都可以去做了,实现了,于是美好的,丑恶的,善良的,最终都会在这个状态里实现。
Quand j’étais petit, dans mon village, j’ai souvent assisté à
des phénomènes de somnambulisme. L’été, quand il faisait très
chaud, une fois la moisson terminée, les villageois dormaient
parfois sur l’aire de battage, et il y en avait régulièrement
quelques-uns qui devenaient somnambules ; ils se réveillaient
quand on les tapait. Dans « Les jours, les mois, les années » (《年月日》),
l’un des récits est l’histoire d’un vieil homme somnambule. Ce
n’est donc pas une invention fortuite. Quand j’ai décidé de me
libérer de la narration historique, et que j’ai cherché quelque
chose pour remplacer l’Histoire qui règne en maître absolu sur
les esprits, en Chine, j’ai pensé au somnambulisme. Cette
soumission des esprits à l’Histoire est quelque chose de très
profond, d’insidieux, qui bride la créativité sous une forme ou
sous une autre, morale ou autre. En état de somnambulisme, les
gens sont libérés de leurs inhibitions. Et ils peuvent réaliser
tout ce qu’ils veulent, que ce soit bien ou pas.
Mais l’histoire est complexe car Yan Lianke a ajouté une seconde
ligne narrative, liée à l’obligation de crémation promulguée en
1985 mais difficilement appliquée avant le début des années 2000
en raison des résistances
;
cela lui permet de faire intervenir la conscience du personnage
du père, rongé par le remords d’avoir dénoncé dans sa jeunesse
des gens qui avaient enterré leurs parents morts au lieu de
procéder à leur crémation comme les y obligeait dorénavant la
loi.
这个小说中间,一个非常大的问题是写了一个人的忏悔,整个中国在20年前,实现土葬改火葬的时候,农村发生了无数的故事,比如一个人告密别人土葬,是可以奖励钱的。当特殊的天气到来,当人都在特殊的梦游状态醒不过来的时候,这一天太阳出不来的时候,是这个忏悔的人用他的生命创造了一个太阳,使人都醒过来进入一个正常的生活轨道,这是一个蛮奇特的故事。
Le grand problème, dans ma narration, a été de trouver comment
écrire le repentir individuel. Dans toute la Chine, il y a vingt
ans, quand on a remplacé l’enterrement par la crémation, il
s’est passé d’innombrables histoires ; ainsi, il est arrivé que
quelqu’un dénonce des gens qui avaient pratiqué un enterrement
car il recevait une récompense pour cela. Alors, par un temps
caniculaire, en état de somnambulisme profond et alors que le
soleil ne réapparaît pas, [j’ai imaginé] un tel personnage hanté
par le remords créant un soleil afin de pouvoir ensuite
s’éveiller à une vie normale, libérée du remords. C’est une
histoire terriblement bizarre.
A partir de cette double idée de départ, Yan Lianke a développé
une histoire hallucinante, qu’il a révisée une dizaine de fois
en supprimant ou ajoutant chaque fois des personnages et
narrations secondaires, avant d’arriver au texte final, publié
fin 2015.
Une histoire racontée par un enfant
Un jeune narrateur un peu simplet
Pour raconter cette histoire « terriblement bizarre » (蛮奇特),
il fallait un personnage hors du commun : ce sera un enfant se
disant lui-même un peu débile, mais sensible et doué d’un sens
aigu de l’observation. C’est le narrateur, Li Niannian (李念念),
14 ans, voisin par ailleurs d’un certain Yan Lianke, vieil
écrivain pathétique en panne d’inspiration auquel il prête sa
voix en lisant ses romans, qu’il mélange un peu et cite à
brûle-pourpoint.
Il est le fils de Li Tianbao (李天保),
ce personnage torturé par le remords d’avoir dénoncé des
familles ayant procédé à des enterrements, dénoncées au
directeur du crématorium qui se trouve être son beau-frère et
s’enrichit sur le dos des morts et de leurs familles.
Li Tianbao en profite aussi car il est le propriétaire de la
boutique d’articles funéraires du village (冥店) :
sa femme est spécialiste des fleurs en papier découpé et autres
décorations mortuaires. Mais, par ailleurs, il rachète à son
beau-frère les barils d’huile extraite des cadavres (quand on
fait cuire de la viande, elle exsude bien de la graisse,
explique Yan Lianke), et les emmagasine dans une grotte pour
empêcher qu’elle soit revendue pour être utilisée comme huile de
vidange, voire de cuisson…
Et puis brusquement, dans la canicule du mois d’août, en pleine
moisson, un soir à la tombée de la nuit, les gens commencent à
devenir somnambules. Le problème apparaît bientôt dans toute son
ampleur tragique : le somnambulisme, comme le rêve, libère les
villageois de toute inhibition ; ils se mettent à commettre les
actes les plus insensés qui étaient consignés au plus profond de
leur inconscient. Ils volent, ils tuent, s’imaginent rebelles
sous les Ming, les habitants des villages voisins viennent
tenter de profiter de la situation, c’est le chaos et les morts
se multiplient.
Tout le monde attend que le jour se lève et que le soleil
réapparaisse pour que l’ordre revienne avec lui. Mais, à l’aube,
il devient clair que le soleil ne reviendra pas : les bulletins
météo annoncent une dépression faisant planer un nuage sur toute
la région, et continuant à y faire régner l’obscurité.
Au milieu de ce chaos infernal qui rappelle les scènes de
combats entre villageois du roman
« Les
fours anciens » (《古炉》)
de
Jia Pingwa (贾平凹),
le roman s’achève sur une magnifique image finale. Mais elle ne
dissipe pas totalement l’impression angoissante laissée par la
lecture, car, si le village retrouve sa vie normale, c’est dans
l’oubli de ce qui s’est passé cette nuit-là, oubli qui permet de
vivre, mais laisse enfoui dans l’inconscient de chacun des
souvenirs qui peuvent à tout moment faire renaître les mêmes
désastres.
Une superbe construction
Comme très souvent chez Yan Lianke, la construction du roman est
très originale. Il est divisé en livres, et sous-divisé en
« veilles » ( gēng
更),
conformément à la division traditionnelle de la nuit, en Chine,
en périodes de deux heures, ce qui est logique puisque
l’histoire se déroule au cours d’une nuit, à partir de cinq
heures du soir, donc en gros, du crépuscule à l’aube. gēng
était le signal donné par le veilleur de nuit qui passait sonner
l’heure avec son gong. Le premier gēng (一更)
commençait au coucher du soleil, à 19 heures. C’est le premier
chapitre du roman, suivi du deuxième gēng (二更)
au Livre deux, qui commence à 21 heures, et du troisième gēng
(三更)
au Livre quatre qui commence à 23 heures, etc…
En outre, chaque veille, ou subdivision de veille, porte un
titre, comme les chapitres d’un roman classique. Mais les onze
livres ne sont pas divisés en veilles de manière rationnelle ;
le texte est parcouru comme par un souffle irrégulier et
incertain :
【卷一】一更:野鸟飞进人的脑裡了
Livre I.
1ère veille:
les oiseaux sauvages pénètrent la tête des hommes
【卷二】二更•上:鸟在那儿乱飞著
Livre II.
2ème veille (1) : les oiseaux volent partout
【卷三】二更•下:鸟在那儿筑窝了
Livre III.
2ème veille (2) : les oiseaux ont fait leur nid là
【卷四】三更:鸟在那儿生蛋了
Livre
IV.
3ème veille : les oiseaux ont pondu
【卷五】四更•上:鸟在那儿孵蛋了 Livre
V.
4ème veille (1): les oiseaux couvent
【卷六】四更•下:一窝鸟儿孵出来
Livre VI.
4ème veille (2) : toute une cuvée est éclose
【卷七】五更•上:大鸟小鸟乱飞著
Livre VII.
5ème veille (1) :
tous les oiseaux, petits et grands, s’envolent en désordre
【卷八】五更•下:有死的也有活著的
Livre VIII.
5ème veille (2) :
certains sont morts, d’autres sont vivants
【卷九】更后:鸟都死在夜的脑裡了
Livre IX.
Après la dernière veille :
les
oiseaux meurent tous au cœur de la nuit
【卷十】无更:还有一只鸟活著
Livre
X.
Plus de veille: il reste encore un oiseau vivant
【卷十一】升腾:最后一只飞走了
Livre XI.
Essor : le dernier oiseau s’est envolé
尾声:还说啥儿呢
Epilogue:
que dire encore…
Une allégorie hypnotique
La construction est complexe, mais celle des « Quatre livres »,
par exemple, l’était aussi. « La Mort du soleil », cependant, va
plus loin en termes d’imaginaire et de force créatrice que les
romans précédents : dans ce roman, Yan Lianke a créé un univers
fantasmagorique fondé sur la présupposition que tout reviendra à
la normale quand le soleil réapparaîtra, et caractérisé par le
fait que tout y est symbolique, à commencer par les personnages
et les lieux où l’histoire se déroule.
- L’histoire se passe dans le bourg de Gaotian (皋田)
dans les monts Funiu (伏牛山).
Il s’agit d’une chaîne de montagne qui va du sud du Shanxi à
l’ouest du Henan (en fait une extension à l’est des monts
Qinling (秦岭,)
au sud du fleuve Jaune, après la boucle de l’Ordos). Funiu (伏牛)
signifie « la vache cachée », cachée comme la mémoire
historique. Ici l’histoire est écrite pour être transmise, et le
fait qu’elle se passe au centre du berceau historique de la
Chine lui donne valeur de synecdoque.
- Tianbao (天保)
signifie « celui qui préserve le ciel », nom bien trouvé pour
quelqu’un qui ira jusqu’à sauver le soleil.
- Quant à Li Niannian (李念念), son prénom est une allusion
au texte bouddhiste dit « Sutra en 42 articles » (《四十二章经》) où
il est dit qu’il faut constamment psalmodier pour progresser
dans la voie du bien (niàn niàn wéi shàn“念念为善”).
D’après la tradition
chinoise, il s’agirait du premier texte bouddhiste parvenu en
Chine, en l’an 67, avec les deux premiers moines traducteurs.
Il s’agit de 42 textes courts présentés comme la parole de
Bouddha, commençant, de manière analogue aux Analectes de
Confucius, par : « Bouddha a dit… » (Fo
shuo
佛说).
Le style du roman, qui multiplie les sentences parallèles
et les répétitions, semble imiter ce mode de récitation
psalmodiée. Le texte est construit sur des séquences narratives
introduites ou conclues par des séries de trois phrases
quasiment identiques, répétant le même message à une nuance
près, avec effet d’accentuation, bien mis en relief dans le
texte original en présentant ces phrases comme des refrains.
Ainsi, dans le Livre I, Première veille, 2ème heure
(c’est-à-dire à 18 heures), quand tout le monde commence à être
atteint par le somnambulisme, la mère de Li Niannian s’endort en
préparant des fleurs de papier pour un client
:
我娘剪著剪著睡著了。
Tout
en coupant, ma mère s’était endormie.
她靠在牆上睡著了。
Elle s’était endormie appuyée contre le mur
做冥物她也累得睡著了。
Elle était tellement fatiguée de faire ces articles funéraires
qu’elle s’était endormie.
Une heure plus tard, le sommeil gagne tout le monde : le village
entier devient somnambule, le processus étant à nouveau marqué
par une série de trois phrases, deux sentences parallèles se
répondant et une sentence conclusive élargissant le propos :
家家戶戶夢遊了。
Les familles, une à une, devinrent somnambules.
萬萬千千夢遊了。
Des milliers et des milliers de gens devinrent somnambules.
天下世界全都夢遊了。
Le monde entier devint somnambule.
Le roman est aussi remarquable dans la forme que dans le fond :
Yan Lianke est l’un des rares auteurs chinois, aujourd’hui, qui
continue à expérimenter.
Le « rêve chinois » devenu cauchemar
Les somnambules, en chinois, sont des gens qui marchent en rêve
(mèngyóu zhě
梦游者).
Dès lors, le propos satirique de Yan Lianke apparaît
clairement : son histoire dessine le revers du « rêve chinois »
(中国梦),
le grand dessein proposé au peuple chinois par le président Xi
Jinping en mars 2013 – rêve de richesse et de puissance traduit
surtout en termes de stabilité sociale.
Tout cela éclate en l’espace d’une nuit dans l’histoire de Yan
Lianke. Les villageois atteints de somnambulisme errent comme
des ombres en quête de vengeance et rêvent de pillage ; ils en
reviennent même au rêve du royaume des Taiping (太平天国),
et jusqu’au soulèvement de Li Zicheng (李自成)
qui renversa la dynastie des Ming, créant une éphémère dynastie
Shun avant de mourir l’année suivante. Ils ressortent même les
lances à pompons rouges qui n’ont plus servi depuis la
Révolution culturelle. Le somnambulisme déchaîne une hystérie
collective du même genre, comme si c’était un phénomène
cyclique, avec effondrement des valeurs et de l’ordre moral.
Mais Yan Lianke va bien plus loin, en étendant sa vision à une
sorte de fin des temps causée par la mort du soleil (“日头死掉,时间死掉”).
L’obscurité sans fin condamnant au somnambulisme perpétuel
signifie l’impossibilité d’espérer dans la salvation de la fin
des temps. Il faudra une déflagration finale en forme de
rédemption personnelle pour sauver le monde en lui faisant
retrouver le soleil – solution christique à rebours du « rêve
chinois », et merveilleusement bien amenée par une construction
narrative parfaitement maîtrisée.
On est bien au-delà des œuvres avec lesquelles on peut établir
des correspondances ou des analogies, dont celles que mentionne
Carlos Rojas dans la préface de sa traduction : « Ulysses » de
James Joyce et la préface de
Lu Xun
(魯迅)
à son recueil de nouvelles
« L’appel
aux armes » (Nahan《呐喊》).
Le rapprochement avec le premier tient pour beaucoup à la
construction narrative : l’histoire se déroule en un seul jour
« très ordinaire » ; mais dans l’épisode II (Nestor), après une
longue discussion sur l’histoire de l’Irlande, Stephen Daedalus
déclare que « l’histoire est un cauchemar dont j’essaie de me
réveiller »
;
c’est bien ce que Yan Lianke illustre pour sa part.
Quant à
Lu Xun,
dans
la préface « L’appel aux armes »,
après avoir imaginé un groupe de gens
profondément endormis dans une maison de fer sans fenêtre,
menacés d’asphyxie, il se demandait s’il fallait les réveiller
sans être capable de les sauver du désespoir et de la mort.
Après quoi il se fixait pour mission de les réveiller. Yan
Lianke est de ceux qui lui ont emboité le pas.
Couchée dans un style qui frôle l’hallucinatoire par ses
répétitions, comme les litanies d’un prêtre célébrant une
cérémonie funèbre, son histoire ne peut laisser indifférent. La
lecture terminée, le roman ne cesse de dévoiler à la réflexion
de nouvelles couches de significations allégoriques, comme un
mille-feuilles qu’on aurait commencé à goûter en savourant
d’abord le sucre glacé qui le couvre.
Une allégorie du monde actuel
Allégorie de la Chine
On peut voir dans « La Mort du soleil » une triple allégorie de
la Chine.
1. « La Mort du soleil » est une image de la Chine en
profondeur : de l’inconscient collectif et de ses couches de
rancœurs accumulées au gré des calamités et des épreuves subies
depuis un siècle, sans exutoire possible. On a l’impression
d’une boîte de Pandore prête à exploser à tout moment, d’où les
efforts pour maintenir le couvercle bien fermé, sous prétexte de
stabilité sociale.
Là où Jia Pingwa – dans
« Les
fours anciens » -
décrivait la folie meurtrière de villageois exacerbée par les
rivalités de clans pendant la Révolution culturelle, Yan Lianke
nous livre une vision fantasmée, bien plus effrayante.
2. Cependant, la vision de la Chine, dans son roman, est
allégorique à un autre niveau. Bien sûr le somnambulisme dont il
est question vient de souvenirs d’enfance très réalistes, mais
ce village où le soleil est mort, où le ciel ne retrouve pas de
clarté à l’aube, où la terre reste plongée dans l’obscurité, ce
village-là rappelle les villes chinoises, Pékin en tête, voilées
dans un nuage de pollution qui offusque effectivement le soleil
dans la journée. Le communiqué météorologique à la radio, à la
fin du roman, annonçant que le soleil ne réapparaître pas dans
les jours à venir est d’une terrible réalité, même si elle est
satirique ; c’est au Livre X, plus de veille, six heures du
matin :
因地勢氣流和來至大西北地區的輕寒流所致,今天白天一整天,我市許多地區將處於無日無雨無風的長陰雲燥熱天氣。所謂長陰雲燥熱天氣,就是天空密布濃雲但又無雨可下無風可吹而形成長時間的燥熱陰暗,使得白天如同黃昏般。部分特殊山區,還將出現日蝕狀的晝暗現象,使得白天完全如同黑夜般。
En raison du terrain et des flux atmosphériques, ainsi que d’un
front froid venu du nord-ouest, plusieurs zones de notre ville
vont rester toute la journée et les jours qui viennent sous un
ciel couvert avec un temps très chaud, sans soleil, sans pluie
et sans vent. Ces conditions climatiques signifient qu’il y aura
sur la ville une épaisse couverture nuageuse, sans que l’on
puisse espérer ni pluie ni vent pour la dissiper, avec pour
conséquence une chaleur intense et des nuages tels qu’il fera
aussi sombre à midi que si c’était la tombée de la nuit.
Certains endroits pourraient même être plongés dans une
obscurité semblable à une éclipse solaire, comme si c’était la
nuit en plein jour.
3. Dans l’épilogue, intitulé « Que dire d’autre ? » (还说啥儿呢),
mais dans le sens de « Plus rien à dire », Yan Lianke offre une
autre allégorie satirique, de la propagande officielle cette
fois, en relatant les efforts des autorités locales pour
minimiser la portée du phénomène de somnambulisme et surtout les
désordres et les centaines de morts causés en l’espace de la
nuit. Dès le lendemain, la radio, la télévision et les journaux
s’empressent de diffuser des communiqués du même ordre :
d’abord, comme il a fait très chaud, qu’il fallait moissonner
très vite, et qu’un phénomène climatique a entraîné une
« obscurité saisonnière », des villageois ont été atteints de
somnambulisme tandis que d’autres tentaient de les réveiller
dans un esprit louable de maintien de l’ordre…
但在召南縣皋田鎮一帶,卻也出現了許多有關夢遊的大面積死人和發生社會混亂的不實之謠傳。為了制止謠言的散播,創造良好穩定的社會秩序,政府已派出大量的國家機關幹部和公安人員去進行調查和制止,並幫助人民群眾,盡快恢復生產和良好的社會生活秩序。
Cependant, dans le bourg de Gaotian du district de Zhaonan, on a
fait courir de fausses rumeurs faisant état de nombreux morts et
de graves désordres entraînés par ce phénomène de somnambulisme.
Pour mettre fin à de telles rumeurs et promouvoir la stabilité
sociale, le gouvernement a envoyé un grand nombre de cadres et
de responsables de la sécurité publique pour mener une enquête
et aider les masses à retrouver très vite un ordre social
propice aux activités productives.
Pas une larme ne fut versée. Trois mois plus tard, les morts
avaient été enterrés – plus question de crémation car le
crématorium avait été détruit – le soleil était revenu, et le
village avait retrouvé son calme, le monde entier était très
calme, comme si rien n’était arrivé. Et là, ce ne sont pas trois
phrases mais quatre qui se répètent pour souligner ce calme. Ce
silence, aussi, car il n’y a rien à dire :
事情就這樣。
C’est ainsi que sont les choses.
世界就這樣。
C’est ainsi qu’est le monde.
Allégorie du monde
Effectivement, on retrouve bien des traits du monde actuel dans
« La Mort du soleil », et sans parler de l’épidémie à laquelle
fait immédiatement penser cette « crise de somnambulisme comme
une épidémie » (梦游症如瘟疫)
– ce coronavirus que l’on aura sans doute oublié, lui aussi,
dans quelque temps, avec les morts qu’il aura causées.
Ce somnambulisme, cependant, nous le connaissons nous aussi, il
s’illustre régulièrement dans l’actualité, et récemment, par
exemple, dans le phénomène des Gilets jaunes, qui ressemblent à
s’y méprendre à ces somnambules de Yan Lianke se rêvant revenus
au temps des Ming pour refaire la rébellion de Li Zicheng. Mais
on pourrait aussi penser à la Grande Grève de cet hiver
2019-2020, autre rébellion de somnambules qui nous ont rendus
tels, nous aussi, pendant plus d’un mois, le temps que revienne
le soleil.
Ce qui frappe, enfin, c’est la superbe allégorie incarnée par
Xiao Juanzi
(小娟子),
la petite orpheline du crématorium, sans doute le personnage le
plus attachant de tout le roman, bien que secondaire, ou plutôt
le seul qui le soit vraiment, outre le jeune narrateur, car
c’est le seul qui apporte un souffle de poésie et de grâce dans
un monde plongé dans l’obscurité - Xiao Juanzi, chargée du
nettoyage du crématorium, qui se charge de le faire fleurir,
comme elle se chargera de faire refleurir le village dévasté.
On ne peut s’empêcher de voir se profiler derrière cette enfant
l’image de l’égérie improbable du mouvement écologiste, la jeune
Greta Thunberg dont la mère, contant récemment l’enfance
difficile de sa fille autiste au journal britannique The
Guardian, déclarait : « Elle était peu à peu en train de sombrer
dans une sorte d’obscurité. »
C’est sur Xiao Juanzi que s’achève « La Mort du soleil », dont
on se dit qu’il pourrait faire une superbe adaptation au cinéma.
Mais aussi dans « Mes réalités, mes ismes » (《我的现实,我的主义》),
publié en Chine, aux éditions Littérature du peuple, en
2011.
Selon le Livre des Han postérieurs, en
64 l’empereur Mingdi des Han (汉明帝)
vit en rêve un être auréolé de lumière lui apparaître,
venant de l’ouest. Un ministre ayant avancé qu’il
s’agissait d'un dieu nommé Buddha, l’empereur aurait
envoyé vers l’Inde à la recherche de son effigie une
délégation de dix-huit personnes menées par trois
moines. Il semble qu’ils se soient arrêtés en
Afghanistan chez les Yuezhi (月氏),
d’où ils revinrent en 67 en compagnie de deux
traducteurs en apportant des effigies du Bouddha et le Sūtra
en quarante-deux articles.
|

