|
|
Rencontre avec la traductrice Emmanuelle Péchenart :
portrait
d’un pèlerin des lettres chinoises
par Brigitte Duzan, 7
octobre 2011
|
Emmanuelle
Péchenart. On voit son nom sur les livres les plus
divers traduits du chinois publiés ces derniers temps.
Des livres qui ont un point commun essentiel : ils sont
d’une très belle écriture, exigeants, difficiles à
traduire, et sont tous, chacun à sa manière, des œuvres
marquantes de la littérature contemporaine de langue
chinoise.
Au cours des
quatre derniers mois, on a ainsi vu paraître, traduits
(ou co-traduits) par elle, un roman majeur des lettres
taiwanaises contemporaines, en juin, un livre de poésie,
en juillet, et, en septembre, le dernier roman de
Bi Feiyu,
qu’elle accompagnait mardi 4 octobre lors de son
passage à la librairie le Phénix
pour le présenter.
Ce sont
évidemment les calendriers propres des éditeurs qui
expliquent cet emballement des publications. Il n’en
|
|

Emmanuelle
Péchenart |
reflète
pas moins le travail d’une traductrice qui ne se contente pas de
traduire tranquillement devant son ordinateur, son chat sur les
genoux, des textes qu’on lui a proposés, mais prend aussi de
temps en temps son bâton de pèlerin pour aller dénicher
l’éditeur idoine, capable de se passionner avec elle pour un
auteur découvert au hasard de ses lectures.
Parcours du pélerin
Tout a commencé au lycée Racine, au début des années 1970.
C’était en effet, à l’époque, le seul lycée parisien à offrir
des cours de chinois, dans le cadre de cursus bilingues et
trilingues. Ce n’étaient guère que deux heures par semaine, mais
suffisantes pour une bonne initiation, et surtout pour éveiller
l’intérêt et donner l’envie d’en apprendre plus. C’est ce qui
s’est passé.
LanguesO’, Fudan
Emmanuelle Péchenart est entrée en 1974 aux LanguesO’, comme on
disait alors. C’était encore l’époque héroïque. Le département
Chine avait de grand maîtres pour enseignants, François Cheng,
Jacques Pimpaneau, et alia ; c’était une pépinière dont on
retrouve aujourd’hui nombre de spécimens arrivés à maturité, en
particulier dans le domaine de la traduction.
L’étape suivante fut un stage de deux mois en Chine, pendant
l’été 1979. Le pays commençait juste à s’entrouvrir après la
mort de Mao ; les conditions de vie étaient encore très zen,
mais c’était un monde fascinant. Emmanuelle fit une demande de
bourse qui lui permit de partir deux ans, de l’automne 1980
jusqu’à la fin de l’été 1982. Elle partit avec sa camarade (et
future traductrice elle aussi)
Sylvie
Gentil, mais, pendant que celle-ci allait étudier à
Pékin, Emmanuelle se retrouva à l’université Fudan (复旦大学),
à Shanghai.
Institut d’art
dramatique de Pékin
| |

Institut central d’art dramatique |
|
Elle y resta un an. Période austère, seule dans une ville qui
avait beaucoup souffert sous Mao, et continuait une cure forcée
d’austérité. Au bout d’un an, elle partit à Pékin, à l’Institut
central d’art dramatique (中央戏剧学院), créé par Mao dès avril 1950, bastion du théâtre expérimental, mais
aussi pépinière de réalisateurs et d’acteurs de cinéma, dont
Jiang Wen (姜文),
qui y était
entré, justement, l’année précédente, en 1980.
En
outre, un bâtiment spécial était en construction pour les
étudiants étrangers, mais il n’était pas terminé. En fait,
dit-elle, cela n’a pas tellement changé, on a juste ajouté des
lampions rouges à l’entrée… Elle était donc mêlée étroitement à
la vie de l’établissement, se formant à la poésie et au théâtre
classiques et surtout à l’opéra. Son meilleur souvenir est un
festival d’opéra kunqu sur une scène à l’ancienne à
Suzhou dont elle a conservé des enregistrements pris sur le vif.
|
Si elle n’a pas
connu Jiang Wen, en revanche, elle a fait là la
connaissance de
Zhang Xinxin (张辛欣),
entrée elle aussi en 1980, pour étudier la mise en
scène. Elle allait cependant surtout devenir l’une des
figures marquantes du renouveau du roman chinois dans
les années 1980 ; en 1981, elle publia à Shanghai, dans
la revue Shouhuo (收获),
une nouvelle qui fit sensation, traduite plus tard par
Emmanuelle sous le titre « Sur
la même ligne d'horizon » (《在同一地平线上》).
Mais, pour
Emmanuelle, l’heure en était encore aux études. Elle
choisit pour sujet de maîtrise la pièce « La maison de
thé » (《茶馆》), grand classique post-49 de
Lao She (老舍)
dont elle fit aussi une nouvelle traduction.
Intermède
En 1982, de
retour à Paris, les études littéraires ne
|
|
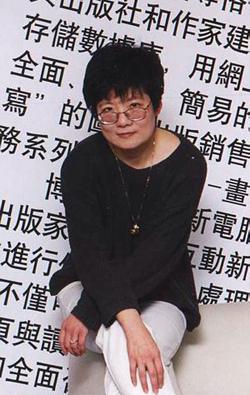
Zhang Xinxin |
nourrissant pas tellement son homme, elle entra à l’Institut
français d’architecture, où elle
participa à des études sur
l’architecture et la ville en Chine avec Pierre Clément qui
dirigeait le département d'architecture comparée, et aussi plus
tard avec Françoise Ged, spécialiste de Shanghai et qui dirige
aujourd'hui l’Observatoire de la Chine contemporaine à la Cité
de l’architecture et du patrimoine.
Elle travailla sur Suzhou, publiant en 1985 un livre sur la
ville avec Pierre Clément (1), puis fut envoyée en mission à
Shanghai, en 1987, où elle entendit parler de…
Zhang Ailing (张爱玲).
Les études sur l’architecture asiatique durent cesser peu après,
faute de crédits, mais elle avait gagné dans l’histoire un sujet
d’étude autrement passionnant pour une jeune future traductrice.
De
retour en France, elle trouva à la bibliothèque de Jussieu les
œuvres de Zhang Ailing qui avaient été publiées dans les années
1950 à Hong Kong. Elle reprit ses études.
Doctorat
|

Viviane Alleton |
|
Elle
s’inscrivit pour préparer un DEA à l’EHESS (école des
Hautes Etudes en Sciences sociales) pour lequel elle fit
une étude comparée des traductions existantes du premier
chapitre de
« La véritables histoire d’AQ » (《阿Q正传》)
de
Lu Xun (魯迅).
Elle
continua par un doctorat sous la direction de Viviane
Alleton. Cette fois-ci, elle choisit
Zhang Ailing
pour sujet de thèse, et plus exactement ce qui reste
sans doute son plus grand chef d’œuvre, le plus
caustique et le plus personnel : « La Cangue d’or » (《金锁记》).Son
projet était d’en analyser le texte sous divers aspects
très précis (temps, descriptions, dialogues, etc…)
Sur ces
entrefaites, cependant, son mari fut envoyé pour deux
ans en mission en Centrafrique, et elle se retrouva à
Bangui, dans un environnement peu favorable à l’étude de
|
textes chinois. C’est là qu’elle apprit le décès de Zhang
Ailing, en septembre 1995, dans des circonstances dont le
caractère tragique lui apparut légèrement irréel ; elle se
sentait vraiment déconnectée.
Elle soutint finalement sa thèse en 2002, grâce au soutien de
Viviane Alleton qui ne la laissa pas abandonner. Mais elle avait
déjà commencé sa carrière de traductrice.
Traductrice de Zhang
Ailing et Zhang Xinxin, mais tant d’autres aussi
Emmanuelle Péchenart est surtout connue comme traductrice et
spécialiste de
Zhang Ailing (张爱玲)
et de
Zhang Xinxin (张辛欣) qu’elle a contribué
à faire connaître en France,
mais ce n’est pourtant qu’une toute petite partie émergée de
l’iceberg.
Zhang Ailing et Zhang
Xinxin
Elle a d’abord
connu Zhang Xinxin dont elle a traduit deux nouvelles publiées
chez Actes Sud – « Sur la même ligne d'horizon » (《在同一地平线上》), en
1987, et « Le courrier des bandits » (《封/片/连》),
co-traduit avec
Robin Setton, en 1989 – puis a participé à la traduction,
dirigée par Bernadette Rouis, de la série de textes de cet
auteur publiés en 1992 sous le titre « L’homme de Pékin »
(《北京人》).
Elle a aussi traduit et publié les textes fondamentaux de Zhang
Ailing, d’abord chez Bleu de Chine, puis à l’Aube et chez Robert
Laffont.
|
Aujourd’hui, elle a encore des traductions non publiées de ces
auteurs : un roman autobiographique de la première, des
nouvelles et des essais de la seconde. Elles ne semblent
cependant plus avoir la faveur des éditeurs. Mais Emmanuelle a
d’autres cordes à son arc : elle est constamment à la recherche
de nouveaux auteurs, de nouveaux textes, et s’en fait ensuite le
passeur et l’ardent défenseur.
On
ne peut pas tout citer, mais il faut dire un mot des deux
derniers livres qu’elle a traduits, ceux sortis juste avant
celui de Bi Feiyu : un roman taiwanais, « Les Survivants »
(《余生》)
de Wuhe (舞鹤),
et un recueil de poésie, « L’année des fleurs de sophora » de
Meng Ming (孟明).
Wuhe
Elle a traduit
« Les Survivants » (《余生》)
avec la traductrice d’origine taiwanaise Esther
Lin-Rosolato qui en
|
|
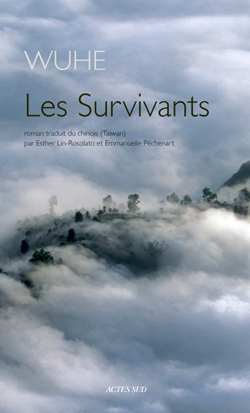
Les survivants |
avait entendu parler à Taiwan. Le roman a été publié en
juin dernier, dans la collection Lettres taiwanaises
d’Actes Sud dirigée par
Isabelle Rabut, Angel
Pino et Chan Hing-ho (2).
C’est un roman
d’une écriture très originale, d’un auteur dont on
parlait beaucoup à Taiwan, et dont on parle encore plus
maintenant que vient de sortir un film, « Seediq Bale »
(《赛德克·巴莱》),
qui a été présenté à la biennale de Venise le 1er
septembre dernier et reprend le même sujet (3), un
sujet dans l’air du temps mais peu connu jusqu’ici, concernant
le sort réservé aux aborigènes qui peuplaient l’île avant
l’arrivée des Chinois.
|

Meng Ming lors d’une lecture de ses
poèmes dans la cour de Cheyne, le 20 août 2011 |
|
Si le film est
une grosse production, et essentiellement démonstratif,
le roman, lui, est réflexif, offrant une longue
méditation en forme de monologue ininterrompu
sur ces événements. C’est un livre écrit au
rythme de la pensée,
ponctuée de temps à autre de rares points qui permettent à
l’auteur de reprendre son souffle. Le flot continu de la
réflexion se déroule ainsi sous nos yeux, un geste, un bruit, le
passage d’une ombre devant la fenêtre en déviant le cours, comme
dans la vie.
C’est un livre dans lequel on entre peu à peu, comme dans un
univers dans lequel il faut faire sa place avant de s’y sentir à
l’aise pour pouvoir accéder à la pensée qui s’y déroule. On
apprend à respirer avec chaque point, en symbiose avec l’auteur.
C’est du grand art, exigeant et très difficile à traduire, il y
a fallu un tandem hors pair,
beaucoup de temps, et la révision
minutieuse
|
d’Isabelle Rabut.
Le résultat est à la hauteur de l’original.
Meng Ming
Meng Ming est
un autre cas d’auteur difficile à traduire, cette fois
parce qu’il s’agit de poésie contemporaine et que la
poésie est la chose la plus ardue à traduire : parce
qu’il faut en rendre le rythme, la musique, qui n’est
pas seulement celle de la langue, mais celle de la
pensée du poète.
|
Cette fois,
Emmanuelle était seule devant le texte, mais en dialogue
avec l’auteur, poète chinois en exil en France depuis
1989. Elle a
le sentiment d’être restée fidèle au texte, au sens
comme à la forme,
comme une sorte de double du poète, de l’autre
côté du miroir de la langue.
C’est d’ailleurs pour elle une exigence
fondamentale pour toute traduction : restituer à chaque
texte son côté poétique entendu en ce sens, une fusion
étroite de la forme et de la signification. Ce qui
implique aussi un choix
|
|

Ma Desheng |
exigeant des textes eux-mêmes.
Et maintenant ?
Maintenant,
Emmanuelle Péchenart rêve d’autres textes à découvrir et
faire découvrir, rêve aussi de placer ceux de
ses auteurs
favoris qu’elle a traduits et sont restés tristement sur
une étagère.
Pour l’heure, ce
qu’elle attend avec impatience, c’est le long poème qu’est en
train d’écrire son ami
Ma Desheng (马德升) et qu’il lui a annoncé
pour bientôt… bientôt…
Notes
(1) Suzhou, forme et tissu urbains, d’Emmanuelle Péchenart et
Pierre Clément (architecte), Institut
français d'architecture, 1985.
(2) Il s’agit en fait d’une «
collection itinérante », les traductions étant publiées chez
plusieurs éditeurs, Christian Bourgois, Bleu de Chine et You
Feng outre Actes Sud.
(3) Sur le film, le livre et son auteur, voir :
www.chinesemovies.com.fr/films_Wei_Tesheng_Seediq_Bale.htm
Principales
traductions :
*Ecrivains de Chine
continentale :
De
Bi Feiyu (毕飞宇) :
-
Les aveugles, Philippe Picquier, septembre 2011
De
Wang Gang (王刚)
:
-
English (《英格力士》),
traduit avec
Pascale Wei-Guinot, Philippe Picquier, février 2008
De
Zhang Xinxin (张辛欣) :
- L'homme de Pékin, traduit,
sous la direction de Bernadette Rouis, avec une série de traducteurs dont
les noms apparaissent à la fin de chaque texte, Actes Sud 1992
- Le courrier des bandits, traduit avec Robin Setton, Actes Sud
1989
- Sur la même ligne d'horizon , Actes Sud 1987
De
Zhang Ailing/Eileen Chang (张爱玲) :
-
Lust.Caution/Amour, luxure et trahison (quatre nouvelles), R.
Laffont janvier 2008, repris en 10/18 oct. 2009
-
Un amour dévastateur, L’Aube, janvier 2005
-
Rose rouge, Rose blanche, dessins de Françoise Ged, Bleu de
Chine, 2001
-
La cangue d’or, Bleu de Chine, 1999
*Ecrivains taiwanais :
De
Wuhe (舞鹤) :
-
Les survivants , traduit avec Esther Lin-Rosolato, Actes Sud,
coll. Lettres taiwanaises, juin 2011
De
la romancière
Ping Lu (平路)
:
-
Le dernier amour de Sun Yat-Sen, Mercure de France, mai 2008
De
Huang Chunming (黃春明)
:
-
Le gong, traduit avec Anne Wu, Actes Sud, coll. Lettres
taiwanaises, novembre 2001
*Poètes :
De
Meng Ming (孟明)
:
-
L’année des fleurs de sophora, édition bilingue, Cheyne, coll.
D’une voix l’autre, juillet 2011
Extrait de la préface :
http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-107074-l-annee-des-fleurs-de-sophora.htm
De
Ma Desheng (马德升) :
-
Rêves blancs, âmes noires, édition bilingue, L’Aube, novembre
2003
-
24 heures avant la rencontre avec le dieu de la mort, Actes Sud,
1992
|
|

