|
|
Lao She
老舍
1899-1966
Présentation
par Brigitte Duzan, 17 mai 2010,
actualisé 21 janvier 2025
|
Lao She (老舍),
de son vrai nom Shu Qingchun (舒庆春),
est né à Pékin en 1899 dans une famille d’origine
mandchoue, appartenant à la ‘bannière rouge’ (正紅旗
zhènghóngqí),
l’une des huit ‘bannières’ (滿州八旗)
créées
par Nurhachi, au
début du 17ème siècle,
pour
structurer la société Jürchen selon un système militaire
à même de transcender les frontières de clans.
Cette origine
mandchoue eut de telles conséquences sur la formation de
sa personnalité et, partant, de son œuvre, qu’on ne peut
vraiment les comprendre sans en saisir les implications
profondes.
1899-1918 : Mandchou dans un
monde qui cesse de l’être
|
|

Lao She
(老舍) |
Lao She est né
un an après la dernière tentative de réforme du système
impérial : la réforme dite « des Cent Jours » (百日维新)
(1)
initiée par le théoricien réformateur Kang Youwei (康有为),
avec le soutien de l’empereur Guangxu, mais écrasée en
septembre 1898. L’empereur fut
écarté du trône ; six des principaux réformateurs furent
exécutés.
|
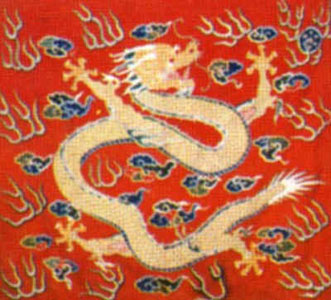
bannière rouge
(正紅旗
zhènghóngqí) |
|
Les partisans
du modernisme furent désormais convaincus que le système
impérial ne pouvait être sauvé. Les idées de réforme se
transformèrent alors en idéal révolutionnaire sur fond
de haine des Mandchous au pouvoir,
avivée par la
répression des soulèvements qui se multiplièrent. Celui de
Wuchang (武昌起义),
le 10 octobre 1911, fut le prélude à la révolution dite Xinhai (辛亥革命)
qui mit fin à l’Empire.
De manière
significative, elle avait pour objectif de mettre fin à un
régime qui avait mis les Han au ban de la société. Au terme
|
d’une véritable chasse
à l’homme, quelque vingt à trente mille Mandchous furent tués
en une semaine. Dans la capitale, les
membres survivants des bannières se préparaient à la revanche ;
Yuan Shikai sut éviter une autre tuerie.
Lao She avait douze
ans ; il survécut, sa mère aussi, mais il n’oublia ni ne
pardonna jamais. Son existence en fut bouleversée : la famille
n’était déjà pas riche car son père, un soldat de la garde
impériale, était mort en 1901 au cours d’une bataille de rue,
lors de l’entrée des troupes étrangères dans la capitale après
la rébellion des Boxers. Ils tuèrent le chien avant de mettre la
maison à sac. Lao She dira plus tard qu’il n’avait jamais
entendu sa mère, dans son enfance, lui conter des histoires
d’ogres et de monstres ; les « diables étrangers » dont elle
parlait étaient bien plus effrayants car ils étaient réels, et
avaient affecté toute la famille.
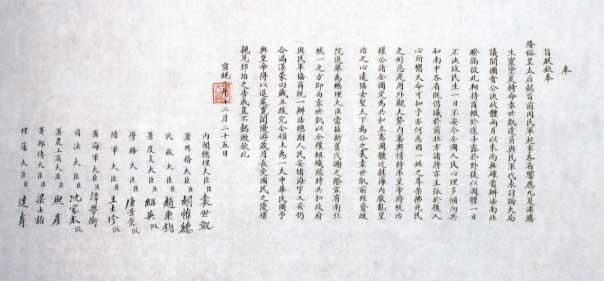
Abdication de l’empereur Puyi, 12 février 1912
Il fut élevé par sa
mère, au prix de grands sacrifices. Les conditions matérielles
étaient difficiles, mais, bien pire, ils étaient victimes de
l’ostracisme et de l’arrogance des Han redevenus maîtres du
pays. Cette situation de paria a profondément marqué Lao She :
il eut peu d’amis pendant ses études, et, par la suite,
considéra toujours avec méfiance et réticence toute implication
dans un mouvement de nature politique.
1918-1924 : Enseignant par nécessité
A l’issue de l’école
primaire, il aurait dû apprendre un métier, les parents et amis
étaient prêts à aider sa mère dans ce but ; il aurait ainsi pu
contribuer à alléger les soucis maternels :
« 当我在小学毕了业的时候,亲友一致的愿意我去学手艺,好帮助母亲。我晓得我应当去找饭吃,以减轻母亲的勤劳困苦。 »
(2)
Mais Lao She voulait
continuer ses études : il passa en secret l’examen d’entrée à
l’école normale de Pékin où il serait nourri, logé, habillé et
où les livres lui seraient fournis. Mais il fallait quand même
verser dix yuans de droits d’entrée. C’était une somme énorme
pour eux, et sa mère travailla deux semaines d’arrache pied pour les
gagner.
En 1918, à sa sortie de
l’école, il fut nommé inspecteur au Bureau de l’Education et
chargé d’une
mission d’inspection dans les
provinces du Jiangsu et du Zhejiang, après quoi il fut promu,
l’année suivante, contrôleur des affaires éducatives de la
Section Nord. Mais il était jeune, et renâclait à dépendre de
supérieurs corrompus pour son avancement. Il démissionna en 1921
pour devenir
secrétaire d’une école privée, à Pékin ; en plus du
travail de secrétariat, il donnait deux heures de cours de
chinois par jour, et il gagnait le tiers du salaire de son
précédent poste. C’était assez dur étant donné qu’il avait sa
mère à sa charge : cet hiver-là, il vendit son manteau de
fourrure pour lui acheter des vêtements chauds.
Il n’avait pas
participé au mouvement du 4 mai 1919 (3) : pour lui, il
s’agissait de luttes entre factions Han, lui, Mandchou, n’y
avait pas sa place. Par la suite, il écrivit nombre de nouvelles
dépeignant des étudiants superficiellement occidentalisés,
provoquant grèves et manifestations de manière irresponsable, et
finalement manquant de caractère et de compréhension véritable
des grands problèmes que le pays avait à affronter.
|
Cependant, il a
déclaré avoir été énormément influencé par les idées
novatrices nées à
l’époque :
« [Le mouvement du 4 mai] m’a insufflé un esprit nouveau
et m’a offert un nouveau langage littéraire. Je lui suis
reconnaissant de m’avoir permis de devenir un
écrivain. » En attendant, il était enseignant, et
n’avait guère de temps pour autre chose.
Pourtant, il
commence alors |
|

collège Nankai
(南开中学) |
à écrire, et
publie en mai 1921 un
premier très court
récit, en baihua, mais un baihua encore
expérimental ; en même temps, c’est une mini-nouvelle reflétant
les idées de l’époque en faveur de l’émancipation des femmes et
comportant une recherche formelle :
« L’échec
d’une femme » (《她的失败》).
A l’automne 1922, il
obtint un poste de professeur de chinois à Tianjin, au collège
Nankai (南开中学).
Il
écrivit là sa première véritable nouvelle,
« La petite cloche » (《小铃儿》),
qui parut dans le journal du collège, mais il a dit par la suite
qu’elle n’avait aucune valeur, que c’était juste pour remplir
quelques colonnes…
Au
bout de six mois, il revint à Pékin. Il semble avoir été
déprimé, à cette époque, et se serait alors converti au
christianisme, pour la lueur d’espoir qu’il offrait. C’est du
moins ce que l’on peut déduire par analogie avec l’un des
personnages de son premier roman, « La philosophie de Lao
Zhang » (《老张的哲学》) : « Il était foncièrement honnête et candide, mais avait connu des jours accablants si bien qu’il avait perdu de sa
confiance en lui-même ; il n’avait plus aucune foi dans la
société, c’est pour cela que la religion l’avait attiré. »
Devenu membre d’une
association chrétienne, Lao She commença à apprendre l’anglais.
Il obtint alors un poste d’enseignant de chinois dans ce qui
n’était encore que l’école des Etudes orientales, à
l’université de
Londres. L’enseignement était plus que jamais sa planche de
salut autant que son gagne-pain.
1924-1929 : Séjour en Angleterre et premiers romans
|
Il part pour Londres en 1924, à un moment où les
sociétés littéraires s’étaient multipliées, publiant une
centaine de journaux diffusant idées et traductions. Il
trouve à Londres une atmosphère plus calme, plus
policée, et une littérature nouvelle pour lui ; il
découvre Dickens qui influence les romans qu’il écrit
alors, et qui sont parmi ses œuvres les plus
populaires en Chine, constamment rééditées depuis 1949 :
« La philosophie de Lao Zhang » (《老张的哲学》),
« Zhao Ziyue » (《赵子曰》)
et « les deux Ma » (《二马》).
Si le premier roman est écrit à moitié en langue
classique à moitié en chinois ‘vernaculaire’ baihua,
la part de baihua augmente d’œuvre en œuvre.
On peut les considérer, du point de vue formel tout au
moins, comme des œuvres encore expérimentales.
1. « La philosophie de Lao Zhang »
est directement
inspiré de la lecture de « The Pickwick
Papers » et « Nicholas Nickleby » (4), respectivement
premier et troisième romans |
|
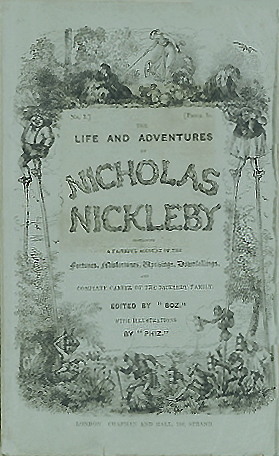
« Nicholas Nickleby » |
de Dickens :
le premier fut rédigé sous forme
de chapitres plus ou moins bien reliés entre eux, de façon à
être publié sous forme de feuilleton ; par ailleurs, les
personnages sont dépeints de façon humoristique, donnant au
livre un ton de satire sociale pleine d’humour ; ces
caractéristiques, qui contribuèrent à l’immense succès de
l’œuvre, furent ensuite reprises dans « Nicholas Nickleby », qui
relate les aventures d’un jeune garçon qui doit subvenir aux
besoins de sa mère et de sa sœur après la mort de son père,
situation très « chinoise » s’il en est, mais également dépeinte
sur un ton humoristique.
|
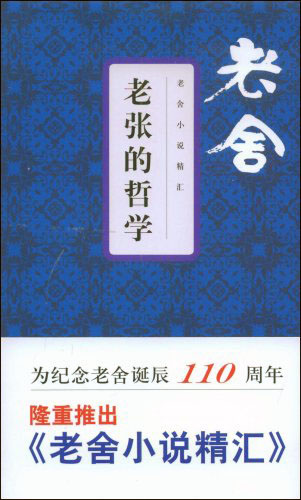
«La
philosophie de Lao Zhang»
《老张的哲学》 |
|
Lao She a
repris le même ton et la même structure : trente neuf
chapitres comme autant de tableaux. Quant au ton,
détaché et ironique, s’il est dû en partie à l’influence
de Dickens, c’est aussi une marque de la distanciation
de Lao She, sa situation d’outsider jetant un regard
satirique sur son pays. Il n’est en Angleterre que
depuis quelques mois quand il écrit
« La philosophie de Lao Zhang », mais il y apprécie l’ordre, les valeurs
morales et la conscience sociale qui lui paraissent
faire d’autant plus défaut chez lui.
Lao Zhang (老张)
est un maître d’école et boutiquier avare et sans
scrupule dont la « philosophie » de l’existence est
trinitaire en tout sauf pour l’argent (“钱本位而三位一体”):
il a même transformé l’invitation rituelle « je vous
invite à déjeuner » (“请吃饭”)
en « je vous invite à prendre le thé » (“请吃茶”).
Préoccupé également par son statut social et pensant
qu’une concubine l’améliorerait, il jette son dévolu sur
la sœur d’un de ses élèves, tentant de la prendre
comme
concubine en |
échange de
l’annulation d’une dette. Celle-ci,
cependant, est amoureuse d’un autre élève ; Lao She développe
alors une histoire d’amours contrariées très classique, où les
femmes, bien sûr, finissent victimes. Mais là n’est pas l’important : ce
canevas sentimental n’est que le prétexte à une satire d’un
humour dévastateur qui s’attaque à tous les
travers de la société chinoise : les conditions d’éducation,
l’hypocrisie sociale et la sujétion des femmes, la corruption
des gouvernements locaux et de la police, le manque
d’indépendance de la presse, l’inefficience de la loi.
Comme beaucoup de ses
contemporains, Lao She était indigné et affligé par l’échec des
nouvelles institutions nées avec la République, comme si la
modernisation du pays était impossible vu le poids de
l’éthique confucéenne
et de la bureaucratie ; mais les valeurs traditionnelles ne
pouvaient inspirer les jeunes : la tentative d’assassinat de Lao
Zhang par son ancien élève, vers la fin du roman, est le
symptôme et le symbole des frustrations de toute une génération.
|
2. L’histoire
de « Zhao Ziyue », le roman suivant, se passe
également à Pékin, dans les années 1920, c’est-à-dire
aux lendemains du mouvement du 4 mai. Si, dans le roman
précédent, les étudiants sont présentés comme des
victimes, ils sont dépeints ici comme des êtres
velléitaires, dont la mentalité nationaliste exacerbée
et occidentalisée est condamnée comme superficielle.
Zhao Ziyue (赵子曰)
est le leader d’un groupe d’étudiants révolutionnaires
dont la principale activité est d’organiser des grèves
et de débiter des slogans. Divisés en d’innombrables
groupuscules, ils sont incapables de s’unir, sauf -
propension universelle - pour ne pas passer les examens,
et leur principal souci, in fine, est d’obtenir un bon
poste une fois diplômés. La passion révolutionnaire une
fois retombée, ne reste qu’un songe creux.
3. Commencé en
1928 et terminé l’année suivante, juste avant de quitter
Londres, |
|

« Zhao Ziyue »
《赵子曰》 |
« Les deux Ma » (《二马》),
traduit en français « Messieurs Ma père et fils »,
décrit le mépris, sur fond de racisme, auxquels sont confrontés
les Chinois en Angleterre, comme si la situation décrite dans
les romans précédents ne pouvait faire d’eux, partout, que des
citoyens de second ordre.
Le vieux Ma se rend à
Londres avec son fils parce que son frère lui a légué un magasin
d’antiquités, mais, dès leur arrivée, ils sont confrontés aux
préjugés tenaces qui les font apparaître, aux yeux des Anglais,
comme des fumeurs d’opium, trafiquants d’armes et assassins
violeurs de femmes, comme tous leurs congénères. C’est grâce à
un missionnaire qu’ils trouvent finalement à se loger, et
réussissent à se faire accepter. Mais, en dépit de l’humour qui
nous vaut quelques scènes très drôles, le ton est amer :
l’incompréhension est
totale, même pour les missionnaires, les Chinois ne sont que des
âmes à sauver de l’enfer qui les guette
(5).
Transition :
Singapour
C’est donc,
semble-t-il, un Lao She sans illusion qui, en juin 1929, son
contrat achevé, reprend le chemin de la mère patrie, mais par le
chemin des écoliers. Il passe d’abord par Paris où il reste
trois mois, mais sans réussir à trouver un travail. Il repart
donc, cette fois pour Singapour, poussé par son admiration pour
Joseph Conrad.
Toutefois, là où Conrad
n’avait vu qu’un enfer pour l’homme blanc, Lao She veut montrer
que l’archipel a connu un développement économique dû pour
l’essentiel… aux Chinois. Mais il lui faut enseigner pour
survivre, il n’a donc pas le temps de voyager à loisir pour
rassembler les éléments de nature à étayer sa thèse.
Au lieu de cela, après
avoir remisé un roman d’amour à moitié terminé qu’il avait
commencé à griffonner sur le bateau, il se met à écrire un roman
dont le personnage principal est un enfant, d’origine chinoise
vivant à Singapour : « L’anniversaire de Xiao Po » (《小坡的生日》).
Xiao Po est un enfant adorable, pas encore assez grand pour
avoir des préjugés, qui voit le monde comme une immense famille,
pleine de chaleur et de tendresse, ce qui lui pose des problèmes
pour arriver à y intégrer l’ennemi japonais ; il trouve quand
même une raison pour ne pas les aimer, les Japonais : la forme
de leurs îles…
Le livre reflète
l’amour de Lao She pour les enfants : « Ce genre de livre me
fait sentir jeune et heureux, a-t-il dit ; j’aime les enfants,
il sont la lumière, une nouvelle page de l’histoire… l’espoir
est là. » Cela ne suffit pas pour en faire un bon roman, ce sont
juste quelques pages écrites le temps d’une escale, avec
suffisamment de bons sentiments pour que ce ne soit pas de la
bonne littérature. Le livre n’est pas terminé lorsque Lao She
reprend le bateau, au début de 1930, il l’achève à Shanghai et
repart pour ce qui est alors Peiping.
1930-1937 : Retour en Chine et tâtonnements à Jinan
En Angleterre, Lao She
était devenu nationaliste, mais le pays qu’il retrouve est, à
ses yeux, pire que celui qu’il avait quitté (6). Il est
maintenant polarisé en deux clans ennemis qui se livrent une
lutte à mort, et la confrontation entraîne à son tour la
polarisation du monde littéraire ; le 2 mars 1930 est
|

Ce qui reste de Cheeloo University à
Jinan |
|
créée à
Shanghai, sous l’égide de Lu Xun, la « Ligue chinoise
des écrivains de gauche » (中国左翼作家联盟)
à laquelle adhèrent bientôt quelque trois cents
écrivains. Lu Xun déclare : « C’est la politique qui est
la priorité, et l’art doit s’adapter en fonction
d’elle. »
Dans ce climat,
il n’y a pas place pour un penseur ou un écrivain
libéral. Pourtant, fidèle à sa ligne |
de conduite,
Lao She évite les polémiques, et ne prend pas parti.
Outsider résolu, il part au Shandong, enseigner à l’université
Qilu (齐鲁大学),
à Jinan (济南)
(7).
Jinan, en 1930,
portait encore les stigmates de « l’incident » qui porte son nom
(済南事件),
encore appelé « le massacre du 3 mai (五三惨案)
car, à cette
date, en 1928,
l’armée japonaise, alliée aux
|
seigneurs de
guerre du Nord, se heurta dans la ville aux unités de
l’Expédition
du Nord lancée contre ces derniers par le Guomindang.
Lao She se rend compte que les combats, qui continuèrent
pendant plusieurs jours, sont encore présents dans les
esprits ; il décide donc d’en faire la toile de fond
d’un roman intitulé « Daming Hu », ou ‘le lac de
la grande clarté’ (《大明湖》),
du nom d’un lac célèbre, au nord de Jinan, et l’envoie
une fois terminé à Shanghai, au Xiaoshuo Yuebao (小说月报)
qui
avait jusqu’ici
|
|

le lac de la grande
clarté 《大明湖》 |
publié tous ses romans,
sous forme de feuilleton ; or,
justement, le journal n’avait pas encore terminé la publication
de « L’anniversaire de Xiao Po » ; « Daming Hu » est donc mis en
attente.
Or, sur ces
entrefaites, le 8 janvier 1932, les Japonais bombardent
Shanghai ; le bâtiment du Xiaoshuo Yuebao est touché et
incendié, les presses sont détruites, et le manuscrit de Lao She
disparaît dans les flammes. Il en tirera plus tard une nouvelle,
intitulée « Croissant de lune » (《月牙儿》),
qui fait partie de ses nouvelles dénonçant les injustices
sociales, et en particulier celles que doivent subir les
femmes : c’est l’histoire des souffrances d’une jeune fille qui,
comme sa mère, est poussée à se prostituer par la pauvreté et
qui, en dépit de ses efforts pour s’en sortir, finit en prison.
|
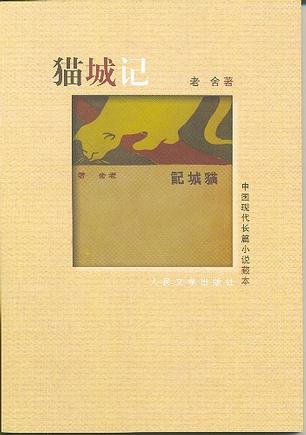
« La cité des chats »
《猫城记》 |
|
En 1932,
cependant, c’est un autre roman qui
l’occupe : « La
cité des chats » (《猫城记》),
satire où affleure le désespoir autant que
l’indignation
devant la situation désespérée où se trouve la Chine et
les lâchetés et compromissions politiques qui
l’empêchent d’y faire face. Le livre commence comme un
roman de science fiction : il décrit les aventures d’un
astronaute chinois dont
l’avion
s’échoue en arrivant sur Mars et se retrouve devant une
société bizarre d’hommes-chats qui ont tous les défauts
de la société chinoise, soigneusement passés en revue.
C’est
d’ailleurs cet
étalage de maux exhaustif qui constitue la principale
faiblesse du livre, sans parler des longues discussions
politiques : la narration en est affaiblie. Le livre
reste une curiosité.
Ce roman
constitue cependant une transition dans l’œuvre
de Lao She : à partir de là, il va |
se
concentrer sur
l’étude des caractères et le développement de
thèmes originaux dans ses histoires. En même temps, il va
privilégier la forme courte au roman, forme qu’il
considère plus aboutie et plus pure stylistiquement (voir la
note sur les nouvelles ci-dessous).
En attendant, dans la
chaleur suffocante de l’été 1933 à Jinan, regrettant la
fraîcheur londonienne, il écrit encore un roman, très vite, en
soixante dix jours ; il y pensait depuis longtemps, il faut
croire que le sujet était mûr : c’est « Le divorce » (《离婚》),
pour lequel il renoue avec le style humoristique de ses débuts,
et avec Peiping.
Le personnage
principal, Lao Li (老李),
est un jeune fonctionnaire du Bureau des Finances du
gouvernement local ; né au tournant du vingtième siècle, c’est
un jeune lettré partagé entre l’ancien et le moderne, qui mène
une vie tristement introvertie ; c’est aussi un jeune homme
frais émoulu de la campagne où il a laissé sa femme et ses
enfants. Cependant, son ami Zhang (张大哥)
le persuade de les faire venir à la capitale avec lui. Ce Zhang
est tout l’opposé de Lao Li : gai, sociable, il sert
d’entremetteur pour
arranger des mariages ; sa théorie est qu’il n’y aurait pas la
chienlit communiste si les gens étaient heureux chez eux avec
leur épouse :
假如人人有个满意的妻子,世界上决不会闹“共产”。张大哥深信此理。
Evidemment, les choses
ne sont pas si simples : la femme de Lao Li est une paysanne
inculte qui a eu les pieds bandés et qu’il tente honteusement de
cacher à ses collègues de bureau. La vie de Lao Li devient un
enfer. Pris entre sa haine du bureau et celle de sa famille, et
ne pouvant échapper ni à l’un ni à l’autre, il est comme pris
entre deux murs. Après bien des aventures malheureuses, il
finira par retourner vivre au village, mais sa femme aura
beaucoup appris, pendant son séjour à la ville, et aura en
particulier été gagnée par les idées de libération de la femme….
|
« Le divorce »
est une œuvre d’un humour contrôlé où l’accent est mis
avant tout sur la psychologie des personnages,
préfigurant les grandes œuvres qui ont fait la renommée
de Lao She, dont « Le pousse pousse ». En 1936,
il est enfin à même de renoncer à ses émoluments de
professeur : il démissionne pour se consacrer
totalement à l’écriture, et
c’est alors qu’il écrit cette nouvelle, intitulée en
chinois ‘Xiangzi le chameau’ (《骆驼祥子》)
qui est
l’une de ses œuvres les plus connues et les plus
populaires, mais qui reprend les ingrédients du roman
précédent, en les intégrant dans une histoire beaucoup
plus dramatique, celle d’une inéluctable descente aux
enfers : le personnage principal est un jeune tireur de
pousse qui économise pour pouvoir acheter son propre
pousse, mais qui, régulièrement détroussé et |
|
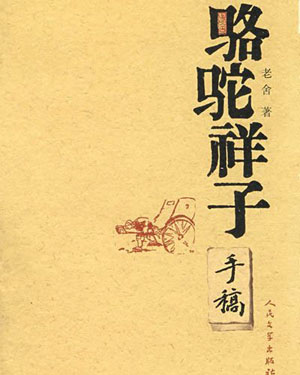
‘Xiangzi le chameau’
《骆驼祥子》 |
victime des pires
injustices, finit par
perdre son optimisme et ses
valeurs morales dans un monde pourri.
Le pessimisme de Lao
She semble ici sans issue, reflet d’un pays à la dérive qui va
bientôt se retrouver en guerre et envahi.
1937-1945 : Années de guerre et littérature militante
Début juillet 1937
éclate la seconde guerre sino-japonaise, ou, comme disent les
Chinois, la guerre de Résistance (抗战
).
Pékin et Tianjin tombent en l’espace d’un mois, Nankin en
décembre, le gouvernement nationaliste se replie à Wuhan qui
fait office de capitale pendant un an, jusqu’en décembre 1938 ;
à cette date, la capitale est transférée à Chongqing, jusqu’à la
fin de la guerre, en 1945.
Lao She suit le
mouvement, comme beaucoup de ses confrères. De nombreux
écrivains de gauche, en particulier, refluent à Wuhan après la
chute de Shanghai en novembre 1937, et y fondent, le 27 mars
1938, la ‘Fédération nationale anti-japonaise des Ecrivains et
Artistes de toute la Chine’ (中华全国文艺界抗敌协会),
qui se substitue, en quelque sorte, à la Ligue des écrivains de
gauche, dissoute en 1936.
La fédération est dotée
d’un comité exécutif impressionnant de quarante cinq membres,
dont Guo Moruo (郭沫若),
Mao Dun (茅盾),
Ba Jin (巴金),
Yu Dafu (郁达夫)
et autres célébrités. Lao She est l’un des rares écrivains
célèbres, parmi ceux repliés à Wuhan, qui n’ait jamais eu aucune
affiliation politique, ni côté communiste ni côté nationaliste.
C’est pour cette raison même qu’il est alors choisi comme
président.
Il devient aussi
éditeur du journal que publie la fédération, « Littérature et
arts de la résistance » (《抗战文艺》),
le seul magazine littéraire qui paraîtra pendant toute la
guerre, de mai 1938 jusqu’en juin 1946, et exercera donc une
influence déterminante sur le monde littéraire et artistique. En
outre, la fédération fait de la propagande pour l’effort de
guerre par le biais d’une dizaine de troupes de théâtre,
originellement créées à Shanghai en août 1937, et envoyées dans
les zones encore contrôlées par les Chinois avec pour mot
d’ordre : « diffuser la littérature dans les villages, diffuser
la littérature dans
l’armée »
(“文章下乡,文章入伍”).
Lao She participe à ces activités de propagande
anti-japonaise en
écrivant pièces de théâtre, poèmes et essais. Mais, des quatre
pièces de théâtre écrites durant ces années de guerre, aucune ne
survécut au conflit qui les avait fait naître.
Transition :
1946-1949 aux Etats-Unis
En 1946, Lao She est
invité, avec le dramaturge Cao Yu (曹禺)
(8)
à donner une série de
conférences aux Etats-Unis ; mais, à la fin de l’année, Cao Yu
revient seul en Chine.
|

« Quatre générations sous
un même toit »
《四世同堂》 |
|
Juste avant de
partir, Lao She avait commencé ce qui deviendra son
œuvre la plus ambitieuse, roman de la guerre et de la
résistance chinoise : « Quatre générations
sous un même toit » (《四世同堂》),
véritable roman-fleuve
d’une centaine
de chapitres regroupés initialement en trois
tomes (« Effroi »《惶惑》,
« Subsistance »
《偷生》,
et « Famine »《饥荒》).
C’est un foisonnement de descriptions et de digressions,
à l’exact opposé
de la concision et de l’humour du « Pousse-pousse », qui
rejoint l’art romanesque chinois traditionnel. Il nous
dépeint un monde clos, replié sur sa ruelle, dont la
situation se détériore peu à peu au fur et à mesure que
se prolongent les combats.
Mais c’est
aussi un roman d’amour, l’amour de Lao She pour sa ville
natale : c’est un exercice de mémoire, un hommage à la
capitale avant la fondation de la République. Comme le
dit si |
bien Le Clézio dans
son introduction à la traduction parue initialement
dans le Mercure de France, « alors que la Chine de Mao est en
train de naître, « Quatre générations sous un même toit » est un
extraordinaire inventaire de la vie à Pékin… les goûts, les
odeurs, les couleurs de la rue avec ses rituels quotidiens, ses
musiques, ses espoirs, ses illusions… Et puis, ces instants
merveilleux, à la fin de l’été, quand le ciel est d’un bleu pur
au-dessus de la ville… »
C’est cela qui émeut et
retient dans ce livre, plus que l’évocation de l’horreur de la
guerre et de la résistance héroïque à l’envahisseur. C’est cette
vie de Pékin qui va tellement manquer maintenant que
disparaissent peu à peu les hutongs qui l’abritaient,
cette vie, comme l’a dit Lao She, « où l’on pouvait très
facilement, et par habitude, passer son temps à le gaspiller. »
1949-1966 : Ecrivain officiel, victime de la Révolution culturelle
C’est à l’invitation
personnelle de Zhou Enlai que Lao She revient en Chine après la
fondation de la République populaire, en décembre 1949. Membre
du comité éducatif et culturel du gouvernement, député au
Congrès national populaire, il est un personnage influent dans
le domaine des arts et des lettres, défendant le système
anti-impérialiste et luttant contre l’injustice sociale, celle
qu’il a fustigée toute sa vie dans son œuvre, lui qui se sentait
si proche des petites gens « premières victimes des massacres,
des pillages et des viols ».
Il continue à écrire,
de nombreuses pièces de théâtre pour ‘éduquer le peuple’, dont
on ne peut guère retenir que la « Maison de thé » (《茶馆》),
mais aussi romans et nouvelles, dont les dernières,
autobiographiques et moins connues, que sont « Histoire de ma
vie » (《我这一辈子》)
et « Sous la bannière rouge » (《正红旗下》),
cette dernière écrite en 1961-62, restée inachevée, et publiée
seulement en 1979.
Et puis, survient la
Révolution culturelle. Dès le début, il en est inquiet, et
exprime son angoisse à un couple d’amis étrangers venus lui
rendre visite à Pékin :
« Je peux comprendre
que Mao Zedong cherche à détruire le vieux monde bourgeois, mais
je ne peux écrire sur ce combat parce que je ne suis pas
marxiste, et que je ne peux penser et sentir comme un étudiant
de Pékin en 1966... Nous autres, les vieux, nous n'avons pas à
demander pardon pour ce que nous sommes. Nous pouvons seulement
expliquer pourquoi nous sommes ainsi et encourager les jeunes à
trouver leur voie vers le futur… » (9)
Quelques semaines plus
tard, accusé d’être traître et réactionnaire ("反派"),
l’écrivain était
arrêté, interrogé, paradé dans la rue et battu en public par des
Gardes rouges. Humilié et renvoyé chez lui, il trouva sa maison
pillée et saccagée, ses livres et documents, en particulier,
jetés à terre. Trois jours plus tard, le 24 août, sa famille fut
informée que l’on avait trouvé son corps dans un lac de la
capitale, le lac Taiping (太平湖),
et que la police
avait conclu au suicide (10).
Il fut réhabilité en
1978.
Note complémentaire
Pourquoi Lao She n’a pas eu
le prix Nobel
Selon des informations émanant de
son fils, maintenant apparemment confirmées, en 1968, Lao She
aurait été le candidat privilégié pour le Prix Nobel de
Littérature : c’est lui qui aurait eu le plus de votes sur les
cinq candidats en lice lors du vote de présélection.
C’était trente ans après que le
prix avait été décerné à Pearl Buck qui connaissait bien Lao
She. L’écrivain chinois était l’une des deux personnalités du
monde littéraire chinois qui avaient été invitées aux Etats-Unis
vingt ans auparavant dans le cadre d’un échange culturel (voir
ci-dessus). C’est ainsi que Pearl Buck et son mari l’éditeur
Richard Walsh se lièrent d’amitié avec lui et Pearl Buck
l’introduisit auprès de l’agent littéraire David Lloyd. Mais Lao
She était rentré en Chine.
Pour tenter de localiser
l’écrivain dont personne n’avait de nouvelles, les autorités
suédoises écrivirent au gouvernement chinois, mais sans obtenir
de réponse : le pays était plongé en plein chaos en raison de la
Révolution culturelle. De toute façon, Lao She était mort depuis
deux ans, et le prix ne peut être décerné qu’à un auteur vivant.
Finalement, comme le comité Nobel
avait l’intention, cette année-là, de décerner le prix à un
auteur asiatique, c’est le Japonais Kawabata Yasunari qui le
remporta, devenant ainsi le premier écrivain né en Asie de l’est
à en être le lauréat. Il était alors pratiquement inconnu en
Occident, et il avait été préféré à des personnalités
prestigieuses comme Graham Greene, Norman Mailer, André Malraux,
Alberto Moravia, Samuel Beckett ou encore Eugene Ionesco.
Notes
(1)
维新wéixīn
signifiant
‘modernisation’ ; la réforme est aussi désignée par le terme
戊戌变法wùxū
biànfǎ, ou
réforme de l’ère wuxu.
(2) « Ma mère » (《我的母亲》),
article paru en
janvier 1943 dans le Shishi Xinbao ou ‘Nouveau journal de
l’actualité’ (時事新报)
édité à Shanghai ; il fait partie des textes traduits dans le
recueil « Ecrits de la maison des rats »,
éditions Philippe Picquier, mai 2010.
(3) Voir « Repères
historiques, II »
(4) Comme il l’a lui-même expliqué dans un texte écrit en 1935,
« Comment j’ai écrit "La philosophie de Lao Zhang" » (《我怎样写〈老张的哲学〉》) :
http://wenku.baidu.com/view/a7154bd97f1922791688e80a.html
(5) Sur Lao She à Londres, voir l’ouvrage :
« Lao She in London », par Anne Witchard, Hong Kong University
Press, août 2012, 188 p.
http://www.hkupress.org/Common/Reader/Products/ShowProduct.jsp?Pid=1&Version=0&Cid=16&Charset=iso-8859-1&page=-1&key=9789888139606
Signalons par ailleurs la publicationen 2013 chez Penguin China,
dans la série Modern Classics, des traductions en anglais des
deux ouvrages écrits par Lao She à Londres : « Cat Country » en
septembre et « Mr Ma and Son » en août.
(6) Voir « Repères
historiques, III »
(7) Ou ‘Cheeloo university’, fondée, au tout début du vingtième
siècle, par des missionnaires presbytériens et anglicans.
C’était une université d’obédience protestante, qui fut dissoute
en 1952. On retrouve donc là un nouveau témoignage des liens de
Lao She avec le christianisme.
(8) Promoteur du
« théâtre parlé » (话剧)
sur le modèle occidental.
(9) Cité par Le Clézio
dans sa préface à « Quatre générations sous un même toit », p.
24.
(10) Voir la pièce de
Liu Xinwu (刘心武)
« La mort de Lao
She » (《老舍之死》)
qui est en fait un scénario d’opéra. Traduit par Françoise Naour
et publié chez Bleu de Chine.
Principales œuvres
de Lao She en chinois :
http://www.hxqw.com/wxxsgl/zgwxmz/200605/3239.html
Principales
traductions en français :
« L’enfant du Nouvel
An », Gallimard 1986, Folio, mai 2003. Traduction Paul Bady et
Li Tche-houa
《离婚》« La Cage
entrebâillée », Gallimard 1986, Folio 2002. Traduction Paul Bady
et Li Tche-houa
« Gens de Pékin »,
Folio Gallimard, 1993 – recueil de nouvelles, dont « Histoire de
ma vie », préface Paul Bady. Traduit du chinois par
Paul Bady, Li Tche-houa, François Moreux, Alain Peyraube et
Martine Vallette-Hémery.
《我这一辈子》« Histoire
de ma vie », Folio Gallimard, janvier 2002.
《四世同堂》 « Quatre
générations sous un même toit »,
en trois tomes :
Quatre générations
sous un même toit. I,
trad. Jing-Yi-Xiao, préf. J.M.G. Le Clézio, Mercure de France,
1996, coll. « Folio », 1998.
Quatre générations
sous un même toit. II. Survivre à tout prix,
trad.
Chantal Chen-Andro,
Mercure de France, 1998, « Folio », 2000.
Quatre générations
sous un même toit. III. La famine, trad.
Chantal Chen-Andro, post. Paul Bady, Mercure de France, 2000, coll. « Folio », 2001.
《猫城记》
« La cité des
chats », Presses pocket, 1997
《小坡的生日》« L'Anniversaire
de Xiaopo », éditions You Feng, 1999. Traduction Claude Payen.
《骆驼祥子》 « Le
pousse-pousse »
, Picquier poche, 1998. Traduction François Cheng et Anne Cheng.
《鼓书艺人》 « Les
Tambours », Philippe Picquier, 2001. Traduit de l'anglais par
Claude Payen. (1)
《二马》 « Messieurs
Ma, père et fils », Picquier poche, 2003. Traduction Claude
Payen, préface Paul Bady.
《不说谎的人》« L'homme
qui ne mentait jamais »,
Picquier poche, janvier 2006. Traduction Claude Payen.
《老张的哲学》« La
philosophie de Lao Zhang », Philippe Picquier, 2009. Traduction
Claude Payen
(1) le livre est
traduit de l’anglais car la première traduction a été réalisée
en 1949, alors que Lao She était encore aux Etats-Unis, et c’est
le texte le plus proche de l’original que nous possédions : le
texte original a en effet disparu, et le texte chinois dont nous
disposons a été traduit en 1980 sur la base de cette première
traduction anglaise.
* Note sur les nouvelles :
Lao She a rédigé au début de 1944 un texte intitulé « comment
j’ai écrit mes nouvelles » dans lequel il classe celles-ci en
fonction de l’importance qu’il leur accorde, et surtout,
explique leur rapport au roman.
Il élimine ses premières nouvelles, comme ne présentant pas
grand intérêt : elles sont fondées sur des faits réels et cela
ne suffit pas pour faire une bonne histoire, dit-il. Celles du
deuxième groupe sont déjà mieux car elles sont basées sur des
histoires qu’on lui a racontées, c’est-à-dire sur le bouche à
oreille, il y a donc déjà là du matériau fabulé. Mais ce sont
celles du troisième groupe qui sont les meilleures : « Croissant
de lune » (《月牙儿》),
« Vieille tragédie ancienne pour temps modernes »
(《新时代的旧悲剧》),
« L’épée meurtrière » (《断魂枪》), « La lumière du soleil »
(《阳光》),
etc… En effet, dans ces dernières nouvelles, les faits sont
totalement imaginaires, et l’histoire est très souvent
construite sur la base d’une idée abstraite (comme dans « Li le
noir et Li le blanc » (《黑白李》)
ou « Buffle de fer et Canard malade » (《铁牛和病鸭》)qui
dépeignent des personnages représentant des caractères ou des
défauts opposés).
En dehors du fait que
les nouvelles étaient plus faciles à publier que des romans
entiers pendant la période de la guerre, il explique qu’il a
d’abord écrit des romans parce que les lecteurs sont plus
indulgents à leur égard et que le monde en général est prêt à
accepter des romans imparfaits, ce qui
n’est pas le cas pour
la nouvelle courte. Le roman lui a donc servi d’exercice
préparatoire, en quelque sorte.
La nouvelle demande
beaucoup plus d’habileté et de technique. En outre, chacune des
intrigues secondaires d’un roman pouvant servir de base à une
nouvelle, on sélectionne forcément les passages les plus
intéressants, ou les plus réussis. « Il vaut mieux croquer un
morceau d’une pêche de l’immortalité plutôt
que de manger tout un panier d’abricots pourris », dit-il en
paraphrasant un dicton.
C’est ce qui s’est
passé pour « Croissant de lune »
(《月牙儿》), qui n’était au départ qu’un épisode du roman « Daming Hu »
(《大明湖》),
disparu dans le bombardement de Shanghai, ou « L’épée
meurtrière » (《断魂枪》) qui
devait être au départ un roman de wuxia …
Ceci dit, ajoute-t-il,
cela demande une certaine abnégation, car un roman de quelque
100 000 caractères se vendra dans les 300 à 500 dollars, tandis
que qu’on ne pourra même pas en tirer
20 d’une nouvelle de 5 000
caractères. C’est d’ailleurs, dit-il avec son humour habituel,
la raison
pour laquelle je ne m’en suis pas toujours tenu aux
exigences artistiques les plus pures : se sacrifier
pour l’art
est une noble cause, mais on ne peut pas demander à l’écrivain
de montrer l’exemple en mourant de faim.
À lire en complément :
Le
compte rendu de la séance du 15 janvier 2025 du Club de
lecture de littérature chinoise (CLLC) qui était consacrée aux
nouvelles de Lao She.
Principales adaptations au cinéma et à la télévision :
|
1992 Divorce《离婚》de
la réalisatrice
Wang Haowei (王好为)
2016
Mr No Problem (《不成问题的问题》),
écrit et réalisé par
Mei Feng (梅峰),
avec
Fan Wei (范伟)
dans le rôle principal.
2024 « Successor » (《抓娃娃》),
de Yan
Fei et Peng Damo (闫非、彭大魔)
, inspiré de la nouvelle « Le Nouvel Émile » (《新爱弥儿》).
Télévision :
《四世同堂》« Quatre générations sous un même toit » : Feuilleton en
28 épisodes, diffusé sur CCTV du 16 août au 9 septembre
1985.
|
|
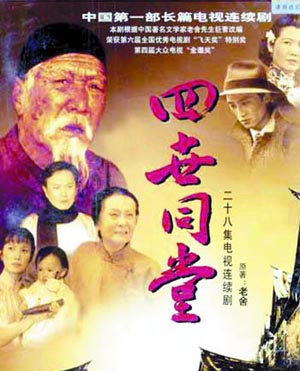
《四世同堂》
« Quatre générations sous
un même toit » |
A lire en complément :
Son article :
« Qu’est-ce que l’humour ? » 《什么是幽默》
Le dernier jour de Lao She (page 1)
Le dernier jour de Lao She (page 2)
(article paru dans Le Monde daté jeudi 28 juillet 2016,
troisième volet de la série « Il était une fois la Révolution
culturelle »)
La mini-nouvelle :
« Acheter un billet de loterie »《买彩票》
La mini-nouvelle :
« L’échec
d’une femme »《她的失败》
Actualités :
Les derniers chapitres de « Quatre
générations sous un même toit » retrouvés… en anglais
« Ecrits de la maison des rats » :
quelques pages douces-amères pour mieux connaître Lao She
|
|

