|
|
« La véritable histoire
d’AQ »
(《阿Q正传》) :
la nouvelle de Lu Xun (鲁迅)
et le film de Cen Fan (岑范)
par Brigitte Duzan, 9 février 2011
A l’occasion de la
programmation du film de Cen Fan (岑范) « La
véritable histoire d’AQ » (《阿Q正传》)
dans le
cadre du
cycle « Littérature et cinéma »
de l’Institut Confucius de l’université Paris Diderot, et alors
que la nouvelle éponyme de
Lu Xun
(鲁迅)
vient, en
septembre dernier, d’être
supprimée des
manuels scolaires en Chine, il est intéressant
de se replonger dans cette nouvelle et de voir comment elle a
été adaptée par Cen Fan pour en faire un film qui, en 1982, fit
sensation au festival de Cannes.
I. La nouvelle de Lu
Xun
|
« La véritable histoire d’AQ » (《阿Q正传》) fut d’abord publiée dans la presse sous forme de feuilleton entre le 4
décembre 1921 et le 12 février 1922, puis, en 1923 dans
le recueil « L’appel aux armes »
(《呐喊》)
dont Sebastian Veg vient de nous livrer une
nouvelle traduction (1). C’est la plus longue des
quatorze nouvelles du recueil (neuf chapitres, dont
l’introduction), et l’une des plus célèbres.
Le récit
L’histoire se
passe au moment de la révolution de 1911, ou révolution
xinhai (辛亥革命),
dans une petite ville du nom de Weizhuang (未庄)
(2). AQ est un paysan sans éducation et sans occupation
fixe, qui vit une existence précaire, hébergé dans le
temple du dieu de la ville.
Dans le premier
chapitre, Lu Xun explique ironiquement
|
|

L’appel aux armes 《呐喊》 |
qu’il voulait écrire cette
histoire depuis des années, mais ne savait pas comment
l’intituler ni comment appeler son personnage : or, comme l’a
dit Confucius, il est important de donner des termes corrects à
chaque chose. Or, non seulement AQ ne semblait pas avoir de nom
de famille, mais son prénom,
阿Quei, posait
même un problème d’écriture : le premier caractère est un
diminutif courant, mais quel caractère utiliser pour Quei (3) ?
Faute de savoir, Lu Xun décide de n’utiliser que la première
lettre, d’où AQ (阿Q) : un personnage ainsi défini dès le départ par un parfait anonymat,
et qui plus est un individu sans attaches familiales, donc
forcément problématique.
|
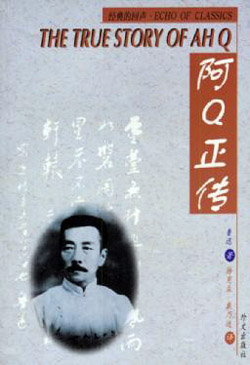
« La véritable histoire d’AQ »
(《阿Q正传》)
|
|
Cet AQ est un
trublion méprisé de tous et traité de tous les noms (万八蛋
wànbā
dàn
espèce de crétin..), capable au besoin de se traiter
lui-même d’insecte pour se sortir d’une mauvaise passe (我是虫豸
chóngzhì),
mais qui cherche noise à tout le monde à tout bout de
champ, et se fait rosser en conséquence. Il a une
manière bien à lui de transformer chacune de ses
corrections, chacun de ses échecs, en victoire
éclatante, au moins dans sa tête, comme quand il se
gifle pour s’être fait voler son argent : comme c’est
lui qui administre la gifle, il se considère comme le
vainqueur. Les chapitres 2 et 3 sont le récit de ses
« victoires ». AQ vit ainsi dans un monde totalement
illusoire.
Un jour,
cependant, il fait des avances à la servante de la
famille du riche propriétaire local, la famille Zhao (赵家).
Or c’est une chaste veuve. Il s’ensuit une crise pour
laquelle il |
se fait à nouveau
rosser et qu’il doit compenser en courbettes et en
argent. C’est le début de sa ruine. Tout le monde se détourne de
lui, il ne trouve plus ni emploi ni crédit : affamé, il en est
réduit à voler quelques navets dans le jardin du monastère. Pris
sur le fait, il décide de partir tenter sa chance à la ville.
Il en revient plusieurs
mois plus tard transformé et, de toute évidence, enrichi. Il
raconte aux villageois médusés qu’il a vu des révolutionnaires
se faire tuer. Le mot de révolution va désormais hanter le
village. Lui-même se fait ‘révolutionnaire’, les Zhao aussi.
Mais, un soir d’ivresse, il avoue avoir volé les marchandises
qu’il revend, source de sa fortune soudaine. Du coup, il tombe à
nouveau dans l’estime des villageois et, lorsque des pillards
mettent à sac la résidence des Zhao, toujours au nom de la
‘révolution’, il sert de bouc émissaire idéal.
Il est arrêté, et finit
exécuté, sans avoir réalisé pratiquement jusqu’au bout la
gravité de sa situation, pathétique dans son application à
dessiner un rond parfait en guise de signature pour avaliser le
papier qui l’envoie à la mort, ou dans son désir de trouver un
chant approprié pour distraire la foule massée pour le voir
exécuté.
La satire
La satire est double et
d’une ironie cinglante.
|
D’abord, AQ est
emblématique du peuple chinois et de sa mentalité :
prompt à s’attaquer au plus faible, comme la petite
nonne qu’il harcèle en provoquant l’hilarité générale,
mais veule devant les plus forts et les riches dont il
accepte les coups sans broncher. Lu Xun fait de ce trait
de caractère l’une des raisons de l’oppression prolongée
dont le peuple chinois a souffert, et la cause
principale de son retard, l’autre étant la croyance
imperturbable en sa supériorité naturelle sur le reste
du monde, traditionnellement qualifiés de barbares. Leur
mentalité de groupe, mentalité grégaire qui les pousse à
rire du malheur du plus faible, et à se montrer
parfaitement apathiques face à la tyrannie du plus fort,
est un autre trait entraînant la perpétuation des
injustices sociales.
L’autre objet
de la satire est la révolution de 1911, dont les
conséquences à terme avaient été une déception pour Lu
Xun. Dans la nouvelle, la ‘révolution’ est un mot vide
de sens, que tout le monde utilise à ses fins propres,
les uns pour se donner de l’importance, les autres pour
piller, les |
|
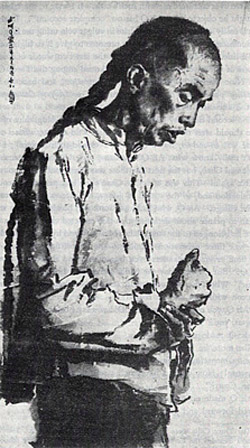
Illustration de la nouvelle |
puissants pour ne pas
perdre leur autorité. Finalement, tout le monde se retrouve
« révolutionnaire ».
La critique est sombre
et amère, et c’est peut-être son caractère très négatif quant
aux retombées de toute révolution qui a valu à cette nouvelle
d’être retirée des manuels scolaires récemment : le constat et
le message de Lu Xun étaient que les masses paysannes avaient
des mentalités tellement retardées qu’un simple changement de
gouvernement ne pouvait rien changer. Comme il le dit dans la
préface de « L’appel aux armes »
(《呐喊》自序),
ce qu’il fallait au peuple, c’était une « médecine de l’âme » :
…我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺…
…la
tâche la plus importante était de changer les esprits, et il
m’apparut alors que, pour ce faire, il fallait en priorité
développer l’art et la littérature …
Mais, dans
« La véritable histoire d’AQ », il n’y a que constat critique,
pas même une allusion à une possible rédemption. AQ meurt sous
la risée de la foule qui lui réclame une chanson…
Aujourd’hui encore, l’expression « mentalité à la AQ » ou
« esprit AQ » (阿Q精神
A Q
jīngshén)
est utilisée pour désigner ironiquement l’attitude de quelqu’un
qui vit dans l’illusion d’une fausse supériorité sur les autres,
ou se berce de prétextes pour ne pas affronter la réalité,
attitude narcissiste qui transforme chaque échec en « victoire
spirituelle ».
Lire :
- le texte chinois :
www.xys.org/xys/classics/Lu-Xun/Nahan/aq.txt
avec notes explicatives :
www.my285.com/xdwx/luxun/nahan/08.htm
- la traduction en anglais :
In “Selected
stories of Lu Hsun” , traduit par Yang Hsien-yi et Gladys Yang,
Foreign Languages Press, Beijing 1960, 1972
www.coldbacon.com/writing/luxun-calltoarms.html#AhQ
II. Le film de Cen Fan
|
Le film
« La véritable histoire d’AQ » (《阿Q正传》)
date de
1982 : c’est un film de la maturité de Cen Fan (岑范)
qui y
déploie en particulier tout son art de la direction
d’acteurs (4).
En outre, le scénario est de Chen Baichen (陈白尘) :
né en 1908, écrivain reconnu après la publication d’une
première nouvelle au début des années 1920 et devenu un
dramaturge réputé dans les années 1930 et 1940 ; pendant
la guerre de Résistance contre le Japon, en particulier,
il a écrit une série de pièces qui sont surtout des
satires politiques et dont on retrouve le ton dans son
adaptation de la nouvelle de Lu Xun.
Une
adaptation fidèle à la nouvelle
Cen Fan suit
fidèlement la nouvelle en commençant par
l’introduction : la séquence introductive montre un Lu
Xun |
|

Cen Fan
(岑范) |
plus vrai que nature
réfléchissant sur la conception de sa nouvelle et le nom de son
personnage, la
|

Chen Baichen
(陈白尘) |
|
teneur de ses
pensées, reprenant le texte de la nouvelle, étant donnée
par une voix off. Le procédé est repris ensuite à
diverses reprises dans le film, lui donnant profondeur
et qualité littéraire.
Le film est
construit en séquences distinctes qui suivent
linéairement les péripéties du récit de Lu Xun, et sont
souvent liées par de courtes séquences de transition
montrant AQ en train de dormir, soit récupérant après
une raclée, soit rêvant : elles tendent à accentuer
l’impression d’apathie et de retrait face à la réalité
qui est le fond de son caractère.
Le ton général
et le jeu des acteurs sont naturels, avec une tendance à
la théâtralité accentuée par les gros plans sur les
visages, et en particulier celui d’AQ, dans les
situations les plus dramatiques. Mais le film est
entrecoupé de |
séquences oniriques ou
vaudevillesques qui rappellent
l’opéra, dont Cen Fan était un spécialiste. Cela donne en
particulier deux séquences très réussies :
|
-
celle du rêve d’AQ, se voyant en révolutionnaire
prenant sa revanche sur les Zhao et tous ceux
qui
l’oppriment, séquence conçue comme un
pastiche
d’opéra auquel il ne manque que la musique ;
-
ou la scène de l’arrestation d’AQ par une milice campée
ironiquement comme une
troupe d’opérette : la révolution ne fait pas sérieux,
et l’on pourrait presque comprendre AQ de croire
jusqu’au bout qu’il va « rentrer chez lui » (回家
comme
lui dit un co-détenu en montrant le ciel, mais il ne
voit pas l’allusion). |
|
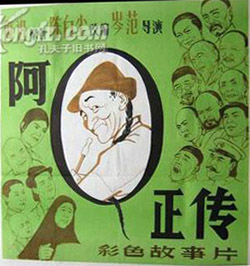
Affiche du film |
|
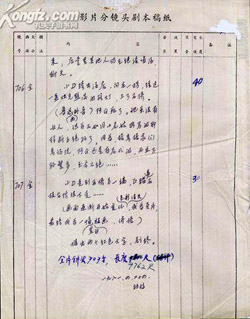
Scénario du film |
|
La seule ombre
au tableau est l’inclusion de scènes de femmes qui
n’existent pas dans la nouvelle : dans celle-ci, en
particulier, les déboires de la femme de Zhao, affligée
par la décision de son mari de prendre une concubine,
est seulement contée laconiquement par la servante à AQ.
Dans le film, le scénariste a rajouté une scène de
pleurs qui pourrait se concevoir dans un contexte
d’opéra populaire, mais qui, par son jeu très appuyé,
tire le film vers le feuilleton télévisé.
Heureusement,
le jeu des acteurs est par ailleurs remarquable, surtout
celui qui interprète AQ.
|
Un film porté par le
jeu de l’acteur principal
|
Le film ne
devait pas être, à l’origine, tourné par Cen Fan, mais
par un autre réalisateur très célèbre, Huang Zuolin (黄佐临),
qui avait prévu de tourner avec
l’acteur
vedette du moment, Zhao Dan (赵丹)
(5), celui-ci devant d’ailleurs interpréter les deux
rôles de Lu Xun et
d’AQ. Mais
Zhao Dan mourut brutalement, d’un cancer du pancréas, le
10 octobre 1980. Huang Zuolin renonça à tourner le film,
qui fut alors repris, avec le scénario, par Cen Fan : le
film ne pouvait être
sabordé, il était
prévu |
|
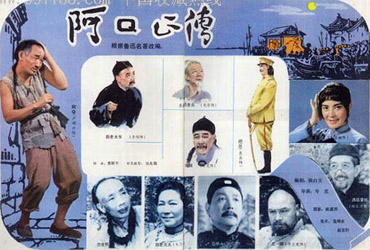
Les personnages du film |
qu’il sorte pour le centième anniversaire de la naissance
de Lu Xun.
|
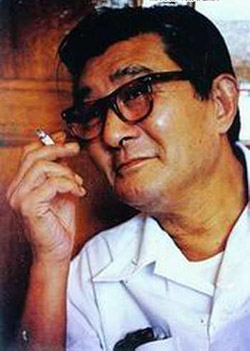
Zhao Dan
(赵丹) |
|
L’acteur que
Cen Fan choisit alors, Yan Shunkai (严顺开),
était inconnu ; mais ce n’était pas plus mal pour
interpréter un personnage sans identité bien définie,
sans même de nom. Yan Shunkai se coula parfaitement dans
le rôle. Il était né en 1937 ; en 1981, sur le tournage
du film, il avait donc 44 ans, ce qui était beaucoup
mieux pour interpréter AQ que Zhao Dan qui en aurait eu
66. Il était sorti de
l’Académie
d’art dramatique de Pékin en 1963, mais n’avait jamais
tourné de film. Il fut en fait découvert et formé par
Cen Fan, comme l’acteur le dira lui-même, en lui rendant
un hommage posthume : 他是我的伯乐
c’est
lui qui m’a découvert (伯乐bólè
désignant le maquignon qui voit les qualités d’un cheval
au premier regard).
Si le film fut
primé à divers festivals, ce furent surtout des prix
venant récompenser l’acteur : entre autres
prix du |
|
meilleur acteur au festival international du film de comédie
de Vevey, en août 1982, et prix du jury au festival international du
film de Figueroa (Portugal), en septembre 1983.
Mais la
consécration vint surtout au festival de Cannes, en mai
1982, où
« La véritable histoire d’AQ » fut le premier film de
Chine continentale à figurer en compétition
internationale. Cen Fan et Yan Shunkai y firent
sensation, comme le montre cette interview réalisée
alors et conservée dans les archives de l’INA : |
|

Yan Shunkai en AQ |
www.ina.fr/art-et-culture/cinema/video/I00013631/cen-fan-le-realisateur-et-yan-shunkai-l-acteur-a-propos-du-cinema-chinois.fr.html
|
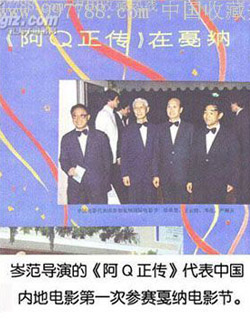
Le film au festival de Cannes
dans la presse chinoise |
|
L’image de Yan
Shunkai est indissociable de celle d’AQ.
Quant au
message du film, au-delà de l’hommage rendu à un grand
écrivain pour le centième anniversaire de sa naissance,
on peut se demander s’il était le même, dans
l’esprit de Cen
Fan en 1982, que celui, désabusé et amer, de Lu Xun en
1923. …
|
Notes
(1) A l’encontre de
l’habitude établie, il traduit d’ailleurs le titre du recueil
par « Cris », et non par
« L’appel aux armes », et celui de la nouvelle par « L’édifiante
histoire d’AQ ».
(2)
未庄
Wèizhuāng :
c’est littéralement le « non village », comme AQ est une non
entité.
(3) En pinyin, on
écrirait aujourd’hui Guī.
(4) Voir sa
présentation :
http://cinemachinois.blogs.allocine.fr/cinemachinois-295979-cen_fan_et__la_veritable_histoire_daq_.htm
(5) C’est son rôle
dans le grand classique « L’ange de la rue » (《马路天使》)
aux côtés de la
légendaire Zhou Xuan (周璇
) qui l’avait rendu célèbre, en 1937 ; il continua à tourner
dans les années 1950-60, mais fut persécuté pendant la
Révolution culturelle et emprisonné pendant cinq ans.
|
|

