|
|
Janvier 2011 :
deuxièmes rencontres littéraires franco-chinoises à Pékin
par Brigitte Duzan, 30 janvier 2011
|
Pendant deux
jours, les 21 et 22 janvier, huit personnalités du monde
littéraire français, dont quatre écrivains (1), sont
venues à Pékin rencontrer douze de leurs homologues
chinois (2) : écrivains, éditeurs, traducteurs et
spécialistes ont ainsi pu débattre des problèmes
auxquels doit faire face la littérature aujourd’hui,
dans un pays comme dans l’autre, en
tentant de les aborder avec un « regard nouveau », thème
général des débats (“中国—法国新眼光”).
Ces deuxièmes
rencontres littéraires franco-chinoises (第二届中法文学论坛)
ont eu lieu dans un endroit emblématique : le musée
national de la Littérature chinoise moderne (中国现代文学馆).
Ouvertes au public, et faisant suite à celles qui
s’étaient déroulées
à Paris
en novembre 2009,
elles étaient placées, côté chinois, sous l’égide
de la présidente de l’Association nationale des
écrivains chinois,
Tie Ning (铁凝),
et côté français, sous celle du conseiller culturel de
l’Ambassade de France, Anthony Chaumuzeau. |
|
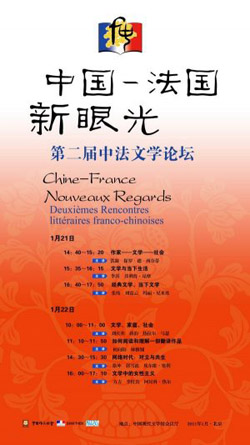 |
|

Le musée de la littérature chinoise
moderne |
|
Dans son
allocution introductive (3), la présidente Tie Ning a
comparé la littérature à des fleurs : comme il y a, pour
les fleurs, ceux qui les plantent et ceux qui les
vendent à la criée au marché, en essayant d’en tirer le
plus d’argent
possible, il y a en littérature, a-t-elle dit, des
écrivains qui sèment et d’autres qui se contentent
d’écrire vite pour une vente rapide. Les uns n’aiment
pas les fleurs, les autres se moquent de la littérature,
et le problème est qu’ils risquent de faire fuir les
lecteurs. Il faut donc cultiver l’amour des
belles lettres, et ces
rencontres |
étaient une façon de le cultiver et de l’approfondir
en commun, étant donné que des problèmes similaires se posent
dans les deux pays.
|
Les questions
abordées ont concerné la place de la lecture, de la
littérature et de
l’écrivain dans
le monde moderne, le rôle de la poésie dans ce monde,
et, comme il y a deux ans déjà, la place, ambivalente,
du numérique dans celui de la littérature et de
l’édition. Un autre sujet à
l’ordre du jour
était celui de la traduction et des problèmes
|
|

Les participants, français et chinois |
de compréhension qu’elle
comporte, présenté et animé par deux spécialistes de la
question : Liu Yan (刘焰),
traductrice, entre autres, d’un recueil de nouvelles de Tie Ning
paru aux éditions Bleu de Chine, et
Sylvie Gentil, qui a reçu le
prix de traduction Amédée Pichot en novembre 2010 pour sa
traduction de « Bons baisers de Lénine » de
Yan Lianke.
|

Tie Ning avec Annick Geille à sa droite,
He Xiangyang (à gauche sur la photo) et Fang Fang (à
droite) |
|
C’est peut-être
le rôle du féminisme dans
l’avant-garde
littéraire et l’émergence de nouveaux talents qui a
suscité les interventions les plus personnelles et
vivantes. La première intervenante sur ce sujet était
Annick Geille, ancienne amie et biographe de Françoise
Sagan à laquelle elle a consacré plus de trois cents
pages de souvenirs et réflexions : « Un amour de
Sagan ». Elle a souligné l’importance de Sagan à son
époque : par sa vie autant que par ses écrits, elle a
donné l’exemple d’une femme insoumise qui a contribué à
élargir |
le champ de la liberté individuelle, pour les
femmes, mais pas seulement. Annick Geille a également rappelé
qu’il n’y a pas de différence de sexe en littérature, il y a
simplement de bons écrivains, et des mauvais.
Ce qu’on pourrait
appeler le « modèle Sagan » s’est révélé être toujours
d’actualité lorsqu’on a entendu
Fang
Fang se demander quelle devait être l’attitude de la
femme écrivain : soumission ou révolte. En Chine, a-t-elle dit,
malgré une « libération » en trois étapes, la femme n’a toujours
pas gagné une totale autonomie, et cela reste un des sujets de
réflexion les plus profonds. Et, comme toujours, cela traduit un
problème social bien plus général que la littérature est le
mieux à même d’appréhender.
*
Comme il y a deux ans, ces rencontres sont pour nous l’occasion
de présenter des auteurs chinois pour la plupart peu connus en
France :
Fang Fang (方方),
Liu Qingbang (刘庆邦),
Zhang Wei (张炜)
et Li Er (李洱).
Nous terminerons par un dossier sur
Bi Feiyu (毕飞宇).
Notes
(1) Ces écrivains
étaient Marie Nimier, Annick Geille, Gérard Macé et Philippe
Nemo ; étaient également présents côté français, outre les
traductrices Liu Yan et
Sylvie Gentil, Hervé Serry, chargé de
recherche au CNRS, spécialiste de la sociologie de la production
culturelle, et Geneviève Imbot-Bichet, aujourd’hui directrice de
collection chez Gallimard.
(2) Outre
Jiang Yun (蒋韵),
Liu Zhenyun (刘震云)
et Xu
Kun (徐坤),
qui étaient déjà aux rencontres de Paris en 2009, participaient
à ces rencontres les écrivains
Fang Fang (方方),
Bi Feiyu (毕飞宇),
Liu Qingbang (刘庆邦),
Zhang Wei (张炜),
Li Er (李洱)
et Guo Xuebo (郭雪波),
le critique littéraire Li Jingze (李敬泽),
le directeur adjoint du musée de la Littérature contemporaine et
de l’Association de recherches pour le roman de Chine Wu Yiqin (吴义勤),
ainsi que deux chercheurs : He Xiangyang (何向阳),
directrice adjointe du Département de recherches en création
littéraire de l’Association des Écrivains de Chine, membre du
Comité de critique théorique de Chine et directeur adjoint de
l’Association de recherche pour le roman de Chine et Ji Hongzhen
(季红真),
professeur à l’Institut de la Culture et de la Littérature
chinoise de l’École normale supérieure de Shenyang après avoir
été pendant vingt ans membre du département de recherche en
création littéraire de l’Association des écrivains de Chine.
(3) Intitulée « Les fleurs aussi se vendent à la criée » (“花盆也喧嚣”)
|
|

