|
|
Liu Qingbang 刘庆邦
Présentation 介绍
par Brigitte Duzan, 6 février 2011, actualisé 18
décembre 2015
|

Si Liu Qingbang (刘庆邦) |
|
Si Liu Qingbang
(刘庆邦)
est
connu en Chine, il l’est moins chez nous. Jusqu’à
maintenant, une seule de ses nouvelles a été traduite en
français : il s’agit d’une nouvelle ‘de taille moyenne’
(中篇小说)
dont le titre chinois《神木》Shénmù a été traduit par
« Le puits ».
Or, cette
nouvelle a été adaptée au cinéma, et le film a eu un
succès tel que, comme souvent, il a fait connaître la
nouvelle et incité à la lire. Il s’agit de « Blind
Shaft » (《盲井》), de Li
Yang (李杨),
Ours d’argent au festival international du film de
Berlin en février 2003, et Lotus d’or au festival du
cinéma asiatique de Deauville au printemps de la même
année.
C’est dans la
foulée de ces récompenses que la nouvelle a été traduite
en français, avec un titre et une couverture se |
|
référant
directement au film (1), mais le nom de l’auteur reste
quand même confidentiel. Il est pourtant un écrivain
réputé en Chine, comme l’a montré, entre autres, sa
présence dans le groupe des écrivains chinois qui ont
participé récemment aux
deuxièmes rencontres littéraires franco-chinoises
à Pékin, un écrivain original à plusieurs égards qui
mérite d’être apprécié à sa juste valeur.
Des
champs à la mine et de la mine au journalisme
Liu Qingbang
est né en décembre 1951 au sud-est du Henan, dans la
bourgade de Shenqiu (河南沈丘),
district de Zhoukou (周口市).
Il a terminé ses études secondaires, au lycée n° 4 de
Shenqiu, en 1967, mais n’a pu poursuivre des études
universitaires : il est devenu paysan, puis mineur, à
dix neuf ans.
Il est alors
entré au service de l’information du Bureau des Mines,
où il fut remarqué pour la qualité de son écriture : il
|
|
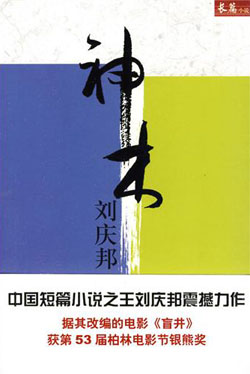
《神木》 |
fut donc muté à la
rédaction du « Journal des mines de charbon de Chine » (《中国煤炭报》),
comme
journaliste, puis rédacteur en charge des suppléments. C’est
dans ce cadre qu’il a commencé à écrire, en 1972.
|
Il a travaillé
au journal pendant près de vingt ans, avant de devenir,
en 2001, écrivain professionnel et membre de
l’Association
des écrivains de Pékin, dont il est aujourd’hui le
vice-président.
S’il est
célèbre, c’est surtout pour ses nouvelles sur le monde
de la mine, mais il serait dommage de le réduire à cette
image convenue. Lui-même s’en défend.
Chantre
de la campagne et de la mine
Etre mineur
pendant neuf ans est forcément une expérience qui
marque ; dans le cas de Liu Qingbang, elle a ensuite
été complétée par un travail de journalisme d’une
vingtaine d’années sur le
terrain, qui l’a fait voyager dans tout le pays au gré
des reportages. Il connaît toutes les mines de Chine,
sauf celle du Tibet. La mine est devenue son univers
intime,que ses nouvelles nous
font découvrir et pénétrer de
l’intérieur. |
|

Shenqiu : la mosquée
(槐店清真寺) |
La mine : condensé
de la société chinoise et de son histoire
La mine est un monde à
part, avec ses normes, ses codes, et ses signes distinctifs. Les
mineurs ont souvent de légères blessures au visage, explique Liu
Qingbang, blessures qui sont aussitôt, comme le reste du visage,
maculées de poussière de charbon ; il en reste des taches bleues
sur la peau, caractéristiques :
“只要看到这种煤斑,你就知道那一定是煤矿来的弟兄。”
« Il
me suffit de voir ces taches de charbon, je sais aussitôt que
j’ai affaire à un frère de la mine. »
|

« Journal des mines de
charbon de Chine » (《中国煤炭报》) |
|
C’est un
univers où l’on vit sous la menace constante de la mort,
une tension de chaque instant contre laquelle on ne peut
lutter que par l’humour, et l’alcool. C’est un univers
masculin, qui rêve de femmes, et en peuple les galeries
et tunnels des mines : les poteaux de soutènement sont
les « filles de fer » (“铁姑娘”)
et les
souris, blanchies par une vie dans le noir, les « filles
aux cheveux blancs » (“白毛女”)
(2).
C’est un
univers de tragédies répétées, que Liu Qingbang connaît
bien pour avoir réalisé enquêtes et reportages sur le
sujet pendant des années, dans le cadre de son travail
de journaliste. Mais, quand le drame est trop poignant,
la situation trop désespérée pour que l’on puisse même
songer à documenter l’actualité et écrire un article,
cette actualité devient alors sujet de nouvelles.
Il se souvient,
par exemple, d’un accident dans une mine |
du Jiangsu, juste avant
la Fête du Printemps 2000. Elle avait été inondée par une fuite
d’eau, et des mineurs y étaient restés emprisonnés. Il avait
neigé toute la journée. Malgré tout, comme toujours dans ces
circonstances, des parents et des proches attendaient, en
espérant, dans le froid. Parmi eux, un vieil homme qui attendait
des nouvelles de son petit-fils : son visage trahissait sa
frayeur, mais il n’osait pas pleurer de peur que cela leur porte
malheur…
Dans de telles
circonstances, dit Liu Qingbang :
“..
作为记者你不用问任何问题,你只能用心体察,用心体会。”
… il est inutile à
un journaliste de poser des questions, on ne peut que comprendre
et percevoir du fond du cœur.
Et écrire ensuite une
nouvelle à partir de ces histoires, pour s’en libérer autant que
pour témoigner…
Au fil du temps s’est
ainsi constitué tout un réseau narratif constituant une image
d’une réalité sociale plus vaste, qui reflète celle de la Chine
entière ; dans la post-face de l’un de ses derniers romans,
« Charbon rouge » (《红煤》),
il a ainsi écrit :
“煤矿的现实就是中国的现实。”
« La
réalité des mines de charbon est la réalité de la Chine »
|
Cet ouvrage,
publié en janvier 2006, est, pour une fois, une longue
histoire : un roman de 34 chapitres racontant la vie
d’un paysan,
Song Changyu (宋长玉),
prêt à tout pour se sortir de la misère. S’étant fait
embaucher dans une mine, il en courtise la fille du
propriétaire, qui le renvoie ; il part alors dans un
village proche où il finit par épouser la fille du
maître
d’école qui est
aussi le chef du village. Petit à petit, il arrive à
acquérir une mine et à faire fortune. Mais un accident
le contraint à la fuite pour éviter les problèmes, et il
se retrouve dans une situation pire qu’au début.
Ce n’est pas
une fable morale, simplement le reflet de la réalité
chinoise d’aujourd’hui. Cette histoire aurait aussi bien
pu se passer dans n’importe quelle entreprise. En fait,
|
|
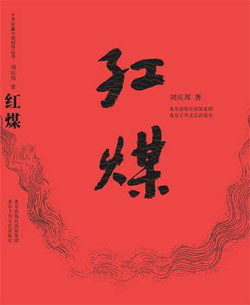
« Charbon rouge »
(《红煤》) |
cela pourrait
aussi être l’histoire d’un de ces paysans, un de ces mingong, allant
tenter sa chance en ville : beaucoup partent, bien peu,
finalement, réussissent.
“不光理解宋长玉,还理解类似的、千千万万从农村奋斗到城里的人。”
« Je n’ai pas seulement voulu expliquer l’histoire de Song Changyu,
mais de tous les cas semblables, des centaines et des milliers
de paysans qui luttent pour s’affranchir de la campagne et aller
en ville. »
Tout cela constitue
l’histoire de la Chine des deux ou trois dernières décennies.
Celle des mineurs est donc bien emblématique en ce sens. Elle
l’est d’autant plus que les mineurs sont des paysans, et qu’il
n’y a pas de rupture entre le monde de la mine et le monde
paysan.
|
D’ailleurs,
contrairement à l’image que l’on a de lui, la moitié des
nouvelles de Liu Qingbang ont pour sujet la campagne.
La
campagne et la mine : une même culture
Quand on lui
demande pourquoi il s’intéresse tant à la mine, Liu
Qingbang répond que c’est le point de rencontre de la
ville et de la campagne :
“矿工多数来自农村,他们脱下农装换上工装,就成了矿工,收入比农民高,但代价也更高,他们的文化背景和性格特征都还是农民类型的。”
« la grande majorité des mineurs viennent de la campagne, ils
quittent leurs vêtements de paysans pour revêtir ceux
des mineurs, et deviennent ainsi mineurs ; s’ils gagnent
plus d’argent, le coût est aussi bien plus élevé ; mais
leur arrière plan culturel et leur caractère propre
restent de nature paysanne. » |
|
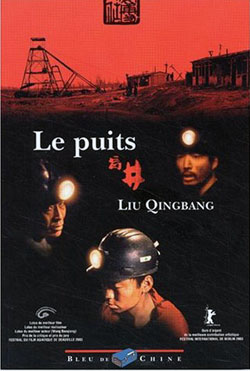
« Le puits » (《神木》) |
Ce sont peut-être ses
meilleures nouvelles qui reflètent son expérience et ses
souvenirs de ce monde
d’avant la mine qui fut
le sien. Il dit lui-même que la nouvelle qu’il préfère n’est pas
celle qui l’a rendu célèbre, celle qu’on a traduite en français
par « Le puits » (《神木》),
mais une autre, intitulée
«
Ensemble à vents » (《响器》) :
ce terme désigne
en fait les ensembles qui jouent à la
|
campagne pour les
mariages, les enterrements et autres festivités
villageoises, et qui incluent aussi des instruments à
vent appelés suona (唢呐).
L’histoire est
celle d’une jeune fille qui, au cours d’un enterrement,
entend par hasard le son d’un suona et, fascinée,
veut apprendre à en jouer. Mais, a-t-il dit, une
histoire est comme un arbre, on est impressionné par le
feuillage au point d’en oublier les branches. En fait,
il faut voir dans la nouvelle un message personnel, un
symbole du désir d’expression artistique à l’état latent
en chacun d’entre nous :
“我的观点是,每个人都是一个响器,都渴望发出自己最‘惊心动魄’的声音,而我的作品就是我的响器。”
« Mon point de vue est le suivant : chaque homme est un instrument de
musique qui désire rendre le son le plus touchant, le
plus émouvant, et moi, ce sont mes nouvelles qui jouent
ce rôle. » |
|
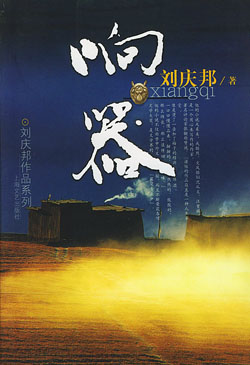
« Ensemble à vents »
(《响器》) |
Si les nouvelles sur la
mine peuvent être considérées comme traitant de la lutte de
l’homme contre la nature (“人与自然的抗争”),
en revanche celle traitant de la vie à la campagne vont plutôt dans le
sens de la recherche d’une harmonie entre l’homme et la nature
(“人与自然的和谐”).
Une harmonie
qu’il apprécie lui-même chaque fois qu’il revient chez lui, au
village.
Ce qu’il désire le
plus, c’est émouvoir, et non tellement frapper par le réalisme
parfois cru de ses nouvelles sur la mine. Il considère qu’une
nouvelle réussie doit laisser le lecteur l’esprit absent, les
idées en suspens ; contrairement à ceux qui considèrent qu’il
faut « saisir » le lecteur, il pense plutôt qu’il faut le
laisser à ses pensées, pour qu’il lui reste ensuite comme un
arrière-goût, une effluve discrète qui persiste longtemps après
la fin de la lecture.
“作品都是表达作家脆弱的感情,真正好的作品,它应该是柔软的。”
« Les écrits d’un écrivain expriment ses
sentiments fragiles, et une nouvelle vraiment bonne doit être
tout en douceur. »
“人光看重血不看重眼泪是不对的,血你随便用刀子捅哪儿都可以流出来,但眼泪你不到悲伤的时候就是流不出来。”
« Accorder plus d’attention au sang qu’aux larmes n’est pas correct ;
le sang, on peut le faire couler à volonté avec une lame, alors
que les larmes, il faut une grande affliction pour les faire
couler. »
|
C’est bien de
témoigner pour les quelque six mille mineurs qui meurent
chaque année dans des accidents, il en assume la
responsabilité. Mais la littérature va pour lui au-delà
de l’utile ; la
littérature doit apporter sa part de poésie, de beauté.
C’est la direction qu’il privilégie maintenant, avec
pour thème principal ses souvenirs des années 60 et 70.
Le roi de
la nouvelle : pour la littérature et contre le marché
En même temps,
il a évolué vers la forme longue du roman, parce qu’il
est plus apprécié du public, et des éditeurs, mais aussi
parce qu’il a maintenant plus de temps. Parmi ceux-ci,
« Poésie lointaine » (《远方诗意》)
ou « Les chants de la plaine » (《平原上的歌谣》)
correspondent à ses sujets de prédilection. Le premier,
publié en octobre 2002, est une sorte de conte
d’initiation,
|
|
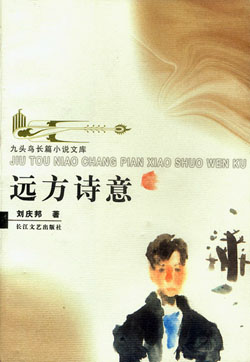
« Poésie lointaine »
(《远方诗意》) |
une quête identitaire du village à la ville, et de la
ville au village, le second, publié plus récemment, en novembre
2009, un récit particulièrement poignant : il relate son
expérience de la grande famine des « trois années terribles »
(1959-62).
|
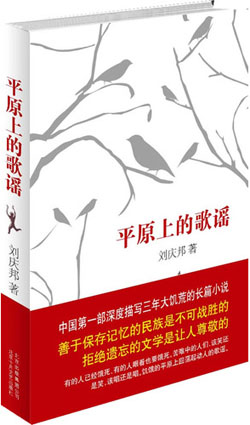
« Les chants de la
plaine »
(《平原上的歌谣》) |
|
Cependant, il
continue à écrire surtout des nouvelles courtes, qui
correspondent mieux à ses exigences de forme, tout
autant que de fond. Dans l’histoire littéraire récente
de la Chine, il se place dans la lignée de
Shen Congwen
(沈从文)
et
Wang Zengqi
(汪曾祺).
Il dit ne laisser au hasard ni une phrase, ni un
caractère, ni un élément de ponctuation, le choix des
sujets restant le plus difficile.
Pourtant il
écrit énormément : tous les jours, sans discontinuer,
dès cinq heures du matin, quatorze ou quinze nouvelles
par an, ce qui reste modeste par rapport à Chekhov,
dit-il.
On l’a ainsi
surnommé « le roi de la nouvelle chinoise
»
(中国的短篇小说之王).
Il reconnaît que ce n’est pas très rémunérateur, il vaut
mieux écrire des récits plus longs, mieux à même d’être
adaptés en feuilletons télévisés. Mais ce n’est pas ce
qu’il recherche : sa prédilection pour la nouvelle est
aussi une sorte de rébellion contre le marché.
|
Notes
(1) Le puits,
traduction Marianne Lepolard, Bleu de Chine, octobre 2003.
(2) Référence à une
histoire légendaire adaptée en de multiples films et opéras.
A lire en complément :
La
nouvelle :
«
Ensemble
à vents » (《响器》)
Analyse comparée :
« Le puits » (《神木》)
et « Blind Shaft » (《盲井》)
La nouvelle de Liu Qingbang et le film de Li Yang
Actualités :
Un recueil de trois nouvelles de
Liu Qingbang paru chez Gallimard
Dans la série Read Paper Republic, la
traduction par Lee Yew Leong de la nouvelle initialement publiée
dans Chutzpah/Tiannan 《天南》, n° 6 (février 2012), « The
Revolutions » (革命) :
The One who Picks Flowers 《挑花儿的》
https://paper-republic.org/pubs/read/the-one-who-picks-flowers-1/
|
|

