|
|
Yu Dafu 郁达夫
1896-1945
Présentation
par Brigitte Duzan, 9 août 2010
|
Disciple de Guo
Moruo, puis ami de Lu Xun, Yu Dafu a participé à tous
les combats de l’avant-garde littéraire des années 1920
qui ont contribué à l’émergence et au développement de
la nouvelle littérature chinoise. Dès ses premières
nouvelles, qui ont fait scandale par leurs thèmes et la
liberté de leur ton, il a défini un style totalement
nouveau en se faisant le fer de lance d’une écriture
autobiographique qu’il avait rapportée avec lui du
Japon.
I. Une
carrière brillante, interrompue par la guerre
1. Premières années : 1896-1912
Yu Dafu (郁达夫)
est né en 1896 dans une famille
d’intellectuels de Fuyang (浙江富阳),
petite ville au bord de la rivière Fuchun (富春),
dans la banlieue sud-ouest de Hangzhou, dans la province
du Zhejiang.
Son père et son |
|
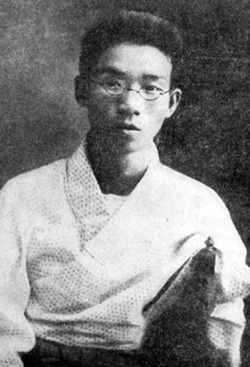
Yu Dafu jeune
(郁达夫) |
grand-père étaient médecins, mais son père mourut quand il avait
trois ans, comme beaucoup d’autres à
l’époque,
Lu Xun
par exemple, ce qui réduisit la famille à la pauvreté. Lui aussi
se souviendra avoir eu faim dans son enfance, et il est possible
que cela ait affecté sa santé. Pourtant sa mère réussit à faire
poursuivre des études à ses trois fils, aidée par
des bourses du
gouvernement.

Fuyang 浙江富阳
En 1903, à l’âge de
sept ans, Yu Dafu entre, à Fuyang même, dans une école privée
traditionnelle (私塾
sīshú),
puis, en 1905, dans l’école primaire (publique) de Fuchun (富春高等小学堂),
une école progressiste fondée cette année-là en insufflant à une
école antérieure (春江书院)
les principes modernes d’enseignement prônés dans les milieux
réformistes de l’époque, ouverts sur l’Occident.
Devenue aujourd’hui ‘l’école
primaire expérimentale de Fuyang’ (富阳市实验小学),
elle continue à donner à l’enseignement valeur civilisatrice et
se targue d’avoir contribué à l’épanouissement intellectuel du
jeune Yu Dafu. Il y écrit ses premiers poèmes
|

La stèle à l’entrée de l’école
expérimentale de Fuyang |
|
En 1910, il
quitte le cocon familial pour aller étudier au collège
de Hangzhou (杭州府中学堂)
où il a pour camarade de classe le (futur) poète Xu
Zhimo (徐志摩),
rejeton
d’une riche famille de banquiers qui suivit à peu près
le même cursus que Yu Dafu, d’une éducation
traditionnelle à l’ouverture sur l’étranger, un parcours
assez typique pour les intellectuels de
l’époque. A
quinze ans, cependant, Yu Dafu
s’intéresse à
la poésie classique chinoise, et écrit quelques poèmes
qui sont publiés dans divers journaux. |
Il est pourtant marqué
par l’atmosphère de l’époque, ces années de réformes avortées et
de révolution en marche, tant politique que littéraire (1). Ses
œuvres favorites comprennent alors aussi des œuvres
d’un caractère
nationaliste tout à fait dans l’air du temps : par exemple la
poésie narrative d’un auteur du dix-septième siècle, Wu Weiye ou
Meicun (吴伟业/梅村),
qui appartenait lui aussi à une période de transition
historique, dans son cas dynastique puisqu’il vécut la chute des
Ming et quitta son Jiangnan natal pour aller à Pékin se mettre
au service de la nouvelle dynastie des Qing ; son œuvre est
empreinte de tristesse à l’évocation de l’irresponsabilité des
derniers empereurs Ming, ce qui devait certainement susciter une
certaine empathie chez le jeune Dafu.
De manière tout aussi
typique, entré en 1912 à l’université de Hangzhou, il en est
expulsé quelques mois plus tard pour avoir participé à une
manifestation estudiantine, à la suite de l’éviction de Sun
Yatsen par Yuan Shikai.
2. Dix ans au Japon, études universitaires et premières créations :
1913-1922
|
L’atmosphère en
Chine n’était pas favorable aux trublions. En septembre
1913, son frère aîné, Yu
Mantuo (郁曼陀),
ayant réussi à décrocher une bourse pour aller faire des études de droit
au Japon, Yu Dafu lui emboîte le pas. Le Japon était la
destination des intellectuels chinois frustrés dans
leurs aspirations libérales qui y trouvèrent un
environnement propice à toutes les innovations. Après
quelques mois d’acclimatation, linguistique en
particulier, Yu Dafu entre en
juillet 1914 en année préparatoire à
l’université impériale de Tokyo. Un an plus tard, en
septembre 1915, il part à l’université de Nagoya étudier
la médecine, et revient en 1919 à Tokyo, où il est admis
à
l’université impériale en section économie politique.
C’est pour Yu Dafu une période de bouillonnement
créatif. Outre le japonais, il apprend l’anglais et
l’allemand et se |
|

Yu Dafu en 1919 |
familiarise avec la littérature étrangère, pour la plupart dans
des traductions en japonais qui fait alors office de lien
obligé, sinon totalement transparent, entre la Chine et
l’Occident. Mais c’est surtout sous
l’influence de la littérature japonaise qu’il écrit alors ses
premières nouvelles.
Il y a par
ailleurs à Tokyo la fleur de l’intelligentsia chinoise, qui
constitue une communauté spirituelle avide de novation ; Yu Dafu
se retrouve avec
Guo Moruo (郭沫若),
Zhang Ziping (张资平),
Cheng Fangwu (成仿吾),
Zheng Boqi (郑伯奇)
et le (futur) dramaturge Tian Han (田汉),
autant d’amis avec lesquels il passe des soirées à courir les
estaminets de Tokyo, à boire, à réciter des poèmes et à
|
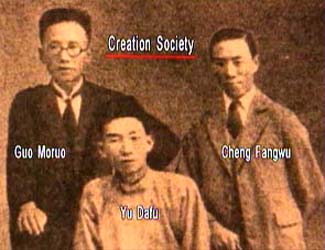
Société Création, trois des membres
fondateurs |
|
discuter, et
avec lesquels il va se lancer dans une entreprise qui va
marquer la littérature des années 1920, mais aussi, bien
au-delà, l’histoire culturelle de la Chine moderne. Il
est difficile
d’imaginer que
c’est le même personnage qui, pendant les vacances de
l’été 1920, se soumet au rituel d’un mariage arrangé par
sa mère lors
d’une brève
visite à Fuyang.
En juin 1921,
Yu Dafu s’associe avec Guo Moruo et Cheng Fangwu pour
fonder la société " Création" (创造社),
qui reçoit pour mission de promouvoir une nouvelle
littérature. Celle-ci, |
déclinée en autant de
styles que d’auteurs participant au mouvement, se caractérise
cependant au départ par quelques traits essentiels qui rompent
avec la tradition : une importance déterminante accordée à la
voix de l’individu, opposé au collectif, sur un modèle inspiré
de Nietzsche, mais aussi influencé par le romantisme, le
symbolisme et l’expressionnisme.
|
Un mois plus
tard, Yu Dafu publie son premier recueil de nouvelles :
ce sont trois récits, précédés d’une préface, « Noyade »
(《沉沦》),
« Départ au sud » (《南迁》)
et « Une mort gris argenté » (《银灰色的死》),
la première faisant aussitôt figure, à plusieurs égards,
de texte fondateur et, comme telle, autant louée que
décriée (2).
C’est le début
de sa carrière littéraire.
3. Retour en Chine : 1922-1938
En mars 1922,
il revient en Chine après avoir terminé ses études à
l’université. Il continue à Shanghai la carrière
littéraire débutée à Tokyo.
Les années
‘Création’ : 1922-1927
Il devient
éditeur de la revue trimestrielle éditée par la
|
|

« Noyade »
(《沉沦》) |
société "Création” (《创造季刊》)
dont le premier numéro sort en mai, et est aussitôt critiqué par
les membres de l’"association de recherche littéraire" (文学研究会),
créée elle aussi en 1921, mais pour défendre le réalisme en
littérature. C’est en juillet qu’il publie, dans la revue
"Création”, justement, l’une de ses plus célèbres nouvelles : « Enivrantes nuits de printemps » (《春风沉醉的晚上》).
En 1923, après quelques mois d’enseignement de l’anglais
dans l’Anhui, il quitte Shanghai pour Pékin où il est nommé
professeur de statistiques à l’université Beida, tout en
continuant son travail pour ‘Création’. C’est alors qu’il se lie
d’amitié avec
Lu Xun.
En 1925, il est nommé à l’université de Wuchang. Il devient
en même temps éditeur de la revue littéraire bi-mensuelle ‘Hongshui’
ou " Le déluge " (《洪水》),
tout en prenant ses distances de "Création".
En 1926, il va
enseigner à l’université Sun Yatsen de Canton
(广州中山大学文学院),
qui est alors un repaire de révolutionnaires où sont allés
enseigner de nombreux membres de la société "Création", dont Guo
Moruo, après l’interdiction des journaux du groupe ; il est
bientôt rejoint par
Lu Xun.
Il publie alors deux essais théoriques importants, l’un sur le
roman (《小说论》,
l’autre sur le théâtre (《戏剧论》).
Rupture
avec ‘Création’ et engagement politique : 1927-1933
|

Yu Dafu et Wang Yingxia |
|
En 1927, peu
satisfait de l’atmosphère qui règne à Canton, il préfère
retourner à Shanghai. En janvier,
il rencontre Wang Yingxia (王映霞)
avec laquelle il se fiance en juin, et se marie au début
de l’année suivante.
Cependant, pour avoir critiqué le Guomingdang avec
lesquels Guo Moruo et Cheng Fangwu étaient liés, il se
fâche avec eux et rompt avec la société "Création" en
août 1927. Il se rapproche alors de
Lu Xun, et de sa
société ‘Yusi’, soit ‘fils de discours’, ou
‘bouts de conversation’ (《语丝》),
qui avait |
été créée à Pékin trois ans
auparavant ; Yu Dafu collabore au journal du même nom,
spécialisé dans
|
l’essai court,
qui correspond à
ses idées esthétiques : avec pour collaborateur de
grands noms comme le frère de Lu Xun, Zhou Zuoren (周作人) ou Lin Yutang (林语堂),
le journal avait développé un style très particulier, ce
qu’on a appelé « le genre Yusi » ( “语丝文体”).
Lorsque Lu Xun
vient se réfugier à Shanghai, et qu’il devient éditeur
du mensuel ‘Benliu’ ou ‘Torrent’ (《奔流》),
Yu Dafu y collabore aussi. Puis, après l’interdiction de
‘Benliu’, toujours à l’instigation de Lu Xun, il
devient éditeur en chef du mensuel “Littérature et
culture du peuple”
(《大众文艺》),
lancé le
20 septembre 1928 par la maison d’édition shanghaienne ‘Xiandai’
(ou Moderne)
(现代出版社),
pour
participer au débat d’idées sur la popularisation de la
culture et de la littérature, et sur la modernisation du
théâtre. Après la fondation de la ‘Ligue des écrivains
de gauche’ (中国左翼作家联盟),
en mars 1930, le mensuel en devient un organe de
diffusion, ce qui lui vaut d’être interdit par le
Guomingdang dès le mois de juillet suivant. |
|
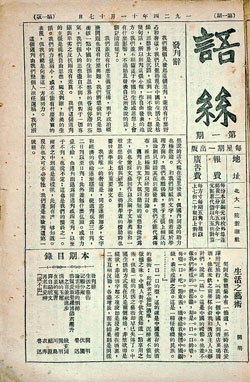
‘Yusi’ 《语丝》 |
En 1930, Yu Dafu écrit
« Fleurs d’osmanthe tardives » (《迟桂花》),
publiée en 1932 en même temps qu’un quasi roman, « C’est une
faible femme » (《她是一个弱女子》),
réédité en 1933 sous le titre « Pardonnez-lui » (《饶了她》).
C’est une œuvre de maturité venant clore un cycle créatif
intense de huit années qui aura vu la parution de ses plus
belles œuvres, essais et nouvelles. Suit une autre période de
huit années, où, après un bref retour au classicisme, ses écrits
sont essentiellement politiques.
Retraite à
Hangzhou : 1933-1938
|
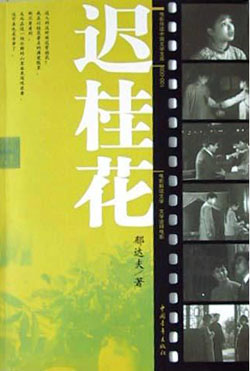
« Fleurs d’osmanthe
tardives »
(《迟桂花》) |
|
En 1933,
Yu Dafu se
retire de la Ligue, arguant qu’ « un auteur
petit-bourgeois ne peut écrire de la littérature
prolétarienne »,
et va s’installer à Hangzhou où il revient vers la
poésie classique et aborde un genre tout
nouveau chez lui : les notes de voyage (山水游记),
écrites également dans un style traditionnel. En même
temps, il participe aux activités de l’assemblée
provinciale du Zhejiang. Il fait aussi partie, aux côtés
de Lu Xun et de nombreux autres intellectuels, des
membres fondateurs de la Ligue chinoise des droits de
l’Homme, créée cette
année-là sous l’égide de Song
Qingling (宋庆龄),
seconde épouse de Sun Yatsen.
Puis, en 1936,
à l’invitation du président de l’assemblée provinciale
du Fujian, alors aux mains d’un "seigneur de la guerre",
il y travaille pendant deux mois, et devient éditeur du
journal ‘le citoyen du Fujian’ (《福建民报》).
La même année, il devient également éditeur de
l’hebdomadaire de |
Lin Yutang ‘les
Analectes’ (《论语》),
journal satirique fondé en 1932 avec pour but de parler de tout
sauf de politique.
Cependant, l’engagement
politique de Yu Dafu croît au fur et à mesure que s’intensifie
la guerre contre le Japon. En 1938, il part à Wuhan, base
arrière de la résistance à l’envahisseur, où il entre dans les
services de propagande et devient directeur de l’association
littéraire et artistique de résistance à
l’ennemi. Sa création
purement littéraire est désormais tarie.
4. Exil à Singapour, puis Sumatra : 1938-1945
|
A la fin de
1938, il fuit à Singapour avec sa femme et son fils.
Jusqu’en
1942, il
travaille là comme directeur littéraire du quotidien
‘Sin Chew Daily’ (《星洲日报》).
Pendant ces trois années, il publie quelque quatre
cents articles sur des sujets d’actualité qui seront
publiés en 1978 à Taiwan en deux ouvrages : ‘Les essais
au fil de la plume de Yu Dafu dans les mers du
sud » (《郁达夫南洋随笔》)
et « Les écrits de résistance de Yu Dafu » (《郁达夫抗战文录》).
Il y avait dans
l’île toute une communauté chinoise que vient alors
grossir un flot de réfugiés de Chine continentale, dont
de nombreux artistes, nourrissant un courant de
littérature chinoise
anti-japonaise, appelée « littérature de résistance » (抗战文学),
dont Yu Dafu devient une figure de proue. Dans un
éditorial du
‘Sin Chew
Daily’, il décrit ce qui est désormais sa seule raison
d’écrire : |
|
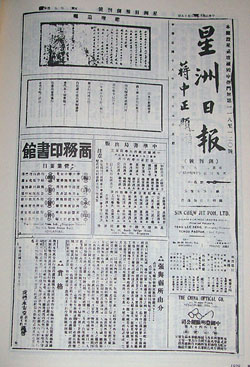
Journal
de Singapour 《星洲日報》
(calligraphie de Chang Kai-chek) |
« Cela fait
deux ans et six mois que la lutte pour défendre la mère patrie a
commencé. Nous avons atteint le stade où il nous faut mobiliser
toutes nos forces pour assurer la victoire finale. Il nous faut
développer nos capacités à nous battre aussi sur le front
littéraire… Il nous faut attaquer les défaitistes et les
collaborateurs… Il ne doit y avoir aucune division entre les
hommes politiques, les militaires et les intellectuels. Il nous
faut désormais garder cet impératif en mémoire lorsque nous
écrivons. »
En 1940, il divorce : des journaux ont publié des lettres
révélant que Wang Yingxia avait une liaison. Plus important,
cette même année, il participe à la création de la « South Sea
Society » de Singapour (新加坡南洋学会)qui,
bien sûr, édite aussitôt un journal intitulé tout simplement
« Journal of the South Sea Society » (《南洋学报》),
nouvel organe de diffusion des écrits « de résistance ».
En 1942, lorsque les
Japonais envahissent Singapour, il fuit à Sumatra. Sous une
identité d’emprunt, il
s’installe à Sumatra
Ouest, dans la communauté chinoise d’outre-mer, en montant une
fabrique de vin avec l’aide d’un ami chinois. Il est bientôt
connu comme le patron Zhao Lian (赵廉),
un petit type avec une moustache parlant indonésien qui se marie
en septembre 1943 avec une jeune Chinoise de Sumatra,
He Liyou (何丽有).
|
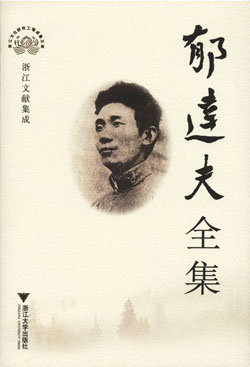
Edition des oeuvres en douze volumes |
|
Mais la police
militaire japonaise apprend qu’il est une des rares personnes, à
Sumatra, à parler japonais, et l’enrôle comme interprète et
traducteur à
Bukit
Tinggi, quartier
général de la 25ème Armée japonaise qui occupe alors
l’île. Cela lui sera fatal.
Il disparaît un soir de
1945 pour ne plus jamais reparaître. Il est vraisemblable qu’il
fut arrêté par la
Kempeitai, la police
militaire japonaise, lorsque celle-ci finit par découvrir sa
véritable identité. Il aurait été exécuté peu de temps après la
capitulation japonaise. Mais le mystère demeure
et a
alimenté une source ininterrompue d’écrits. L’autre thèse est
qu’il a
été assassiné par des résistants de Singapour qui le prirent
pour un traître et un collaborateur en raison de ses activités
de traducteur au service de l’armée japonaise.
En 1952, le
gouvernement chinois l’a élevé au rang de « martyr de la
révolution » (革命烈士).
Son œuvre a
|
récemment fait l’objet
d’une édition complète en douze volumes.
II. Une écriture
novatrice
|
Dès son premier
recueil de nouvelles, en 1921, Yu Dafu fait sensation.
Ce sont : « Noyade » (《沉沦》),
« Départ au sud » (《南迁》)
et « Une mort gris argenté » (《银灰色的死》).
Elles sont porteuses de thèmes et écrites dans un style
qui en font des œuvres sans précédent dans la
littérature de fiction chinoise, et qui, en tant que
telles, ouvrent une voie totalement inédite.
Thèmes
récurrents
Ce sont des
nouvelles qui dépeignent la vie de jeunes Chinois au
Japon. « Départ au sud » évoque les relations sexuelles
entre un étudiant et une jeune fille japonaise dans un
environnement rural idyllique, la religion faisant ici
contrepoids à la sexualité. Dans « Une mort gris argenté
», le personnage principal apprend que son épouse vient
de mourir en Chine ; déprimé, il offre son
anneau en gage |
|

« Noyade »
(《沉沦》) |
pour avoir de l’argent pour
pouvoir aller boire ; il a fait la connaissance de la fille du
propriétaire d’un bar à vin où il se rend : mais, apprenant
qu’elle vient de se marier, il meurt dans la rue, seul.
On a là quelques uns
des thèmes qui vont se retrouver dans les nouvelles suivantes :
la solitude de jeunes étudiants, leur pauvreté et leur isolement
dans un pays étranger, leurs frustrations sexuelles et le
sentiment de culpabilité qui leur est lié, tout ceci étant en
grande partie autobiographique, ce qui ne pouvait qu’ajouter au
scandale de peintures de sentiments que les Chinois n’étaient
pas habitués à voir étalés aussi crûment.
La nouvelle qui fit le
plus scandale fut « Noyade », et ce d’abord parce que le jeune
protagoniste de
l’histoire ressemble à
l’auteur en tous points, y compris son lieu de naissance.
Etudiant chinois au Japon, il vit dans une auberge et, victime
du racisme ambiant, n’a pas d’amis proches. Sa solitude est
soulignée dans la scène initiale où Yu Dafu lui fait lire un
poème de Wordsworth. Mais sa vie, en réalité, est loin de
connaître la paisible tranquillité que reflète le poème. Il est
en proie à des frustrations sexuelles si fortes qu’il se
masturbe toutes les nuits, et en ressent une terrible
culpabilité. Il finit par aller vivre dans une cabane isolée
hors de la ville, mais, un jour, il surprend un couple en train
de faire l’amour, sur quoi il revient à la ville, et se rend
dans un lupanar. Torturé par le remords, il part se noyer, sans
que l’on sache s’il va vraiment le faire ou non.
Ses dernières paroles,
cependant, sont pour apostropher la Chine, lui reprochant d’être
responsable de sa mort, et de tant d’autres. C’est la première
fois dans la littérature chinoise que les frustrations sexuelles
adolescentes sont directement liées aux humiliations subies par
la Chine et à sa faiblesse.
Controverses
|

Yu Dafu (à d.) avec Guo Moruo (au milieu)
a priori en 1928,
date de l’arrivée à Shanghai d’Edgar Snow
(à g.) |
|
Dès sa
publication, la nouvelle suscita des controverses
houleuses. Le frère de Lu Xun, Zhou Zuoren, fut son plus
ardent défenseur, avançant deux arguments clés pour
répondre aux principales critiques : d’une part,
l’érotisme du roman répondait à un but artistique, qui
était de lutter contre la morale conventionnelle, et
d’autre part, les théories de Freud faisaient de la
sexualité un important élément créatif. Quant à
Guo Moruo, il dira que Yu Dafu voulait dénoncer les
hypocrisies de la |
société chinoise, la
répression sexuelle allant de pair chez
lui avec la répression sociale et économique. Yu Dafu lui-même
dira : " Pour me débarrasser de l'hypocrisie criminelle, il faut
me mettre à nu. "
Le débat fut ainsi
lancé sur ce terrain ambigu.
On dit du style de
cette nouvelle qu’il était « décadent » (颓废tuífèi),
parce que Yu Dafu y faisait une description complaisante d’une
situation pathologique qu’il ne condamnait pas,
et
cela
devint
par là même une forme artistique revendiquée
comme esthétisme
non-conformiste, lié à l’époque et à la décadence nationale. Les
descriptions de frustration sexuelle seraient ainsi à
interpréter comme des protestations contre les codes moraux
répressifs, frustration venant renforcer l’aliénation des
couches défavorisées de la population et en particulier de la
jeunesse.
Dans un article
remarquable (3), Sebastian Veg a montré qu’il s’agit là
en fait d’un faux scandale, et que tous les thèmes
traités le sont avec ambiguïté, y compris la sexualité
qui n’est jamais abordée de manière franche et directe,
la frustration sexuelle comme une métaphore de l’impuissance
politique étant par ailleurs également insatisfaisante.
En fait, il a été maintes fois souligné que la nouvelle
comporte une dimension pathologique, le personnage
principal souffrant d’une paranoïa qui le pousse à
éviter de plus en plus tout contact humain, son
sentiment de culpabilité étant le reflet de sa quête de
pureté.
Surtout, les
jeunes héros de Yu Dafu recherchent la liberté sexuelle,
mais restent prisonniers d’un schéma dualiste qui est
celui de la Chine ancienne, schéma dans lequel l’amour
se rattache à la quête
d’un être idéal, les désirs
charnels
étant assouvis avec
des prostituées. Il faut donc relativiser les aspects scandaleux
de ce texte.
Ecriture
autobiographique
Ce qui semble plus
intéressant, c’est qu’il ouvrait la porte d’une écriture
subjective à la première personne, une écriture autobiographique
en rupture totale avec le style romanesque qui avait cours
jusque là. Yu Dafu était un romantique, un admirateur des
« Rêveries d’un promeneur solitaire » de
Jean-Jacques Rousseau
qu’il avait traduites. Un romantisme non sans ambiguïté lui
aussi, mais qui vaut pour la complaisance dans l’épanchement des
sentiments les plus personnels, composante importante de
l’émancipation individuelle revendiquée dans la mouvance du 4
mai.
Pour cette écriture
novatrice à la première personne, on a souligné maintes fois que
Yu Dafu s’est inspiré du « roman du moi » qui était alors en
vogue au Japon, ce shishôsetsu
que tous les écrivains japonais
de l’époque se sont appropriés. Il l’a adapté en un style
personnel, la première personne intervenant dans les monologues
intérieurs de ses personnages, leurs journaux ou poèmes.
Si
l’on considère qu’une bonne partie de la littérature de fiction
moderne, en Chine, est une revendication de l’écriture
subjective à la première personne, on peut dire qu’elle a
commencé avec ces premières nouvelles de Yu Dafu.
*
On a là une écriture
dont les thèmes ne changeront guère. Même « C’est une faible
femme » (《她是一个弱女子》),
l’une de ses dernières nouvelles publiées, en 1932, reprend des
thèmes analogues
d’amours inabouties et
de sexualité frustrée, simplement c’est ici le fait de trois
femmes. Quant à la dernière, « Fleurs d’osmanthe tardives »,
elle semblait annoncer une écriture plus bucolique, plus
apaisée, mais ce fut un chant du cygne.
Il est une nouvelle,
cependant, qui représente une tendance légèrement différente,
bien que publiée seulement deux ans plus tard que les trois
premières, une nouvelle où la sexualité est contrôlée, que Yu
Dafu a appelée « nouvelle à couleur socialisante » : « Enivrantes
nuits de printemps »
(《春风沉醉的晚上》) ;
c’est elle qui a
inspiré le film de Lou Ye présenté au festival de Cannes
en 2009 qui en reprend le même titre, bien que traduit
différemment : « Nuits d’ivresse printanière ». Il est
intéressant de la lire et de l’analyser, et de voir pourquoi Lou
Ye l’a choisie comme référence.
Notes
(1) Voir
Repères historiques, 1900-1917
(2) Voir analyse dans
la deuxième partie.
(3) « Sexualité,
transgression et politique dans les premières nouvelles de Yu
Dafu » de Sebastian Veg (Communication lors du colloque
« Traduire l’amour, la passion et le sexe dans les littératures
d’Asie », université de Provence, Aix en Provence, 15-16
décembre 2006). On peut lire l’article en ligne :
http://publications.univ-provence.fr/lct2006/index158.html
On peut lire également
un article intéressant d’un lacanien : « La
transposition du corps libidinal et
l’émergence de la sexualité
dans la littérature chinoise moderne,
entre aliénation pathologique et idéologique » par Victor
Vuilleumier (Texte présenté lors du colloque « Traduire
l'amour, la passion, le sexe, dans les littératures d'Asie »,
université de Provence, Aix en Provence, 15-16 décembre 2006) :
http://www.lacanchine.com/ChEncore_Sex-Litt.html
En complément :
A lire et écouter :
« L’automne dans l’ancienne capitale »
(《故都的秋》)
Traductions en français :
Editions Philippe Picquier
- « Rivière d’automne » : trois
nouvelles, traduction Stéphane Lévêque, septembre 2002
(réédition en poche, mars 2005). Présentation de l’éditeur :
Publié en 1932, « Une femme
sans importance » (autre traduction de « C’est une faible
femme ») prend place dans le contexte historique des seigneurs
de la guerre : une jeune femme insipide et vénale, découvre les
plaisirs saphiques dans les bras d’une bisexuelle dominatrice et
perverse. Econduite par son amante, elle se tourne alors vers un
homme sans relief qu’elle finit par épouser avant de s’en aller,
de liaison en liaison, jusqu’à son destin tragique. Dans « Le
Passé », écrit en 1927, un homme se souvient de la relation
masochiste qu’il a entretenue avec une femme. « Rivière
d’automne » met en scène des amours croisées au sein d’une
famille.
- in « Treize récits chinois,
1918-1949 », traduction Martine
Vallette-Hémery, 1991 (réédité en poche en mars 2000) :
« Le moine Calebasse » (1932)
Pour fuir
l’agitation politique de la ville, l’homme est parti dans le sud
où il veut écrire une carte impériale des Song du sud. Lorsque
des paysans lui parlent du moine Calebasse, il décide de le
rencontrer mais ce moine n’est autre qu’un de ses anciens amis
avec qui il était à l’étranger et qui s’était fiancé avec la
femme qu’il aimait !
Editions Bleu de Chine
- in « Shanghai 1920-1940, douze
récits », juillet 2000, deux nouvelles de Yu Dafu.
« Du sang et des larmes »
et « Un soir de griserie » qui n’est autre que…
« Enivrantes nuits de printemps »
A lire en complément :
《春风沉醉的晚上》
« Enivrantes nuits de printemps »
|
|

