|
|
Mao Dun 茅盾
1896-1981
Présentation
par Brigitte Duzan, 29 novembre 2011
|
Mao Dun est né
en 1896 dans le bourg de Wuzhen, dans la ville-district
de Tongxiang (桐乡县乌镇),
à l’extrême nord du Zhejiang. Son vrai nom était Shen
Dehong (沈德鸿),
mais son nom « de courtoisie » (字)
étant Yanbing (雁冰)
(1),
c’est celui sous lequel il fut généralement connu
jusqu’à ce qu’il prenne le nom de plume de Mao Dun (茅盾).
Il a vécu une
vie mouvementée, partagée entre l’écriture engagée et
l’activisme politique aux côtés des communistes, et ce
dès la première heure, nourrissant ses romans et
nouvelles de ses expériences vécues sur le terrain, ce
qui lui a valu le surnom de « Malraux de Mao ».
Ses œuvres sont
écrites dans un style réaliste qui puise ses techniques
aux sources du même naturalisme que celui prôné par
Zola. C’est un remarquable analyste de la société de la
Chine de son temps. |
|

Mao Dun, quand il était encore Shen
Yanbing |
Premier éveil :
enseignement classique
|
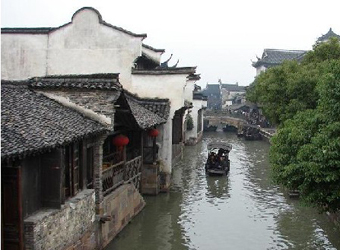
La maison natale de Mao Dun à Wuzhen |
|
Il reçut son
premier enseignement de son père, Shen Yongxi (沉永锡),
mais celui-ci tomba malade quand il n’avait encore que
huit ans ; il entra alors dans la petite école (乌镇立志小学)
à côté de leur maison. Quand son père mourut, ensuite,
c’est sa mère, Chen Aizhu (陈爱珠),
qui prit la relève et
lui donna le goût des classiques. Il lui rend
hommage dans ses mémoires : « C’est ma mère qui fut mon
premier maître, la source de mon premier éveil. » (“我的第一个启蒙老师是我母亲”).
|
|
A treize ans,
cependant, son enfance est terminée, on peut dire qu’il
avait lu tous les livres, les classiques s’entend. Il
entre alors, non loin de Wuzhen, au collège de Huzhou (湖州), et deux ans plus tard, à
l’automne 1911, au lycée à Jiaxing
(嘉兴), la ville-préfecture dont
dépend Tongxiang. Peu de temps plus tard éclate la
révolution dite Xinhai (辛亥革命)
qui met
fin à l’empire. Celui qui n’est pas encore Mao Dun se
sent déjà la fibre révolutionnaire : avec quelques un de
ses congénères, il attaque un surveillant qu’ils
trouvaient peu conforme à l’esprit nouveau, et se
retrouve exclu de
l’école. Il devra aller à Hangzhou
terminer le lycée.
Il a décrit par
la suite l’enseignement obsolète qui était alors
dispensé dans les établissements scolaires chinois :
“书不读秦汉以下,骈文是文章之正宗,
诗要学建安七子;……气度要清华疏旷” |
|

La petite école de son enfance |
« En histoire, on n’allait pas plus loin que les dynasties Qin et Han,
en composition, la prose parallèle était le style orthodoxe,
en poésie on devait étudier les Sept Maîtres de Jian’an (2) ; … …
on devait adopter une pose à la fois raffinée et distanciée. »
(《我的中学时代及其后》)
(mes années de collège et après)
|
De la
description qu’il fait de ses études se dégage une
impression d’ennui, d’étouffement ; il passait les temps
morts à lire des romans, romans classiques, bien
entendu, qui laisseront quelques marques sur son
inspiration et son style.
En 1913, il va
à Pékin, dans une école préparatoire à l’université où
il étudie la littérature, |
|

Les Sept Maîtres de Jian’an |
chinoise et étrangère.
Malheureusement, les finances familiales ne lui permettent pas
de continuer ; l’été 1916, il est obligé d’arrêter ses études et
de chercher du travail.
Premier travail :
troublion de l’édition
|

La Commercial Press (logo) |
|
En août 1916,
il est engagé dans le département de traduction de la
principale maison d’édition de Shanghai, la Commercial
Press (上海商务印书馆).
Il commence par réviser un
manuel de
cours d’anglais par |
correspondance, puis
fait des traductions en équipe avec d’autres traducteurs.
En même temps, il
travaille comme rédacteur à la Revue des étudiants (《学生杂志》)
éditée par la Commercial Press, et écrit un livre de fables
bientôt publié par le département de littérature chinoise de la
maison : « Fables chinoises » (《中国寓言》).
Par ailleurs, il
participe à la création puis à la rédaction de la revue ‘Contes’
(《童话》), et c’est là qu’il publie
ses premiers textes, dès 1918 : des contes comme « La chanson de
l’âne » (《驴大哥》), « La tortue d’or » (《金龟》), « Le jardin merveilleux » (《怪花园》),
ou encore « Les
chaussures volantes » (《飞行鞋》).
Après le
4 mai 1919, il participe
au mouvement de révolution littéraire qui se dessine, en
particulier autour de
Lu Xun
(鲁迅).
Il est promu au département de littérature chinoise de la
Commercial Press, et, au début de 1920, est chargé d’une
nouvelle rubrique dans la revue littéraire que la maison édite
depuis 1910, le ‘Mensuel de la fiction’ (《小说月报》) :
la rubrique s’appelle
« La nouvelle vague du
roman » (“小说新潮栏”).
Il y publie d’abord un manifeste (《小说新潮宣言》), puis une série d’articles où il développe ses idées sur la littérature
moderne et les responsabilités qu’il considère être celles de
l’écrivain (《现在文学家的责任是什么?》).
Il entreprend de
rénover la revue en appliquant ces idées.
Fin
décembre 1920, avec ses amis Ye Shengtao (叶圣陶)
et Zheng Zhenduo (郑振铎),
le jeune frère de Lu Xun, Zhou Zuoren (周作人), et bien d’autres, il
participe à la création de la Société de recherche littéraire (文学研究会),
formellement lancée le 1er
janvier 1921
dans le but de promouvoir des formes littéraires
nouvelles. Il continue en même temps ses activités de recherche,
de critique et de traduction de textes de la littérature
étrangère.
Le Mensuel réformé se
révèle être un succès : il se vend à des milliers d’exemplaires.
Il diffuse les idées du mouvement de la Nouvelle Culture, et
surtout se fait le porte-parole d’une toute nouvelle forme de
réalisme dans la littérature chinoise : la ‘littérature pour la
vie’ (文学为人生),
et donc contre ‘l’art pour l’art’, dont Ye Shengtao est alors,
avec Shen Yanbing, l’un des plus ardents avocats au sein de la Société de
recherche littéraire.
Le futur Mao Dun est
devenu une figure
majeure de la
littérature au sud du Yangzi. C’est alors que son activisme sur
le front littéraire va rejoindre son engagement politique.
Premier compagnon
de route du Parti communiste
Au début de l’année
1921, à Shanghai, il participe à un groupe de travail communiste
et, lorsque le Parti est fondé, en juillet, il en l’un des
premiers membres. Ensuite, à partir de 1922, il effectue un
travail de liaison pour le Parti. Il enseigne également dans
l’école pour femmes pauvres que celui-ci a créée
ainsi qu’à l’université de Shanghai. Il est désormais de tous les combats,
on suit avec lui l’histoire en marche.
|
En 1923,
mécontente de la tournure que prennent les choses, la
direction conservatrice de la Commercial Press retire à
Shen Yanbing la responsabilité du journal et le renvoie
au département de littérature de la maison.
Le 10 mai 1925,
il fait paraître dans un autre journal, l’Hebdomadaire
littéraire
(《文学周报》), un long article intitulé « Sur l’art du prolétariat » (《论无产阶级艺术》),
suivi de
trois autres, les 17 et 31 mai, puis le 24 octobre ; il
y fait le point |
|
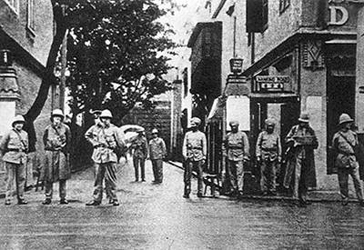
Policiers britanniques et sikhs dans la
concession
internationale, Shanghai 1925 |
sur une controverse
qui s’est développée dans les rangs du Parti en 1924,
parallèlement
à un mouvement d’art prolétarien parti d’Union soviétique, qui
confiait à la littérature un rôle actif dans le processus
socio-historique.
|

Manifestations à Canton en soutien aux
grévistes de Shanghai
(mouvement du 30 mai 1925) |
|
Après la
conférence plénière de Xishan (西山会议)
du 23 novembre 1925, qui s’est soldée par la victoire
des forces anti-communistes (et anti-Comintern) au sein
du Guomingdang (3), il organise à Shanghai une branche
de l’aile gauche du parti. Fin 1925, en tant que
représentant de cette aile gauche du |
Guomingdang à
Shanghai, il participe à une réunion plénière du parti à Canton,
à l’issue de laquelle il est choisi comme secrétaire de la
section de propagande, dirigée par nul autre que… Mao Zedong.
Mais, après
l’incident du Zhongshan (中山舰事件)
(5), le 20 mars 1926, il rentre à Shanghai.
Quand, le 30 mai 1926,
éclate là le mouvement dit du 30 mai (五卅运动,
où
卅
sà
signifie trente) (4),
Shen Yanbing y prend une part active. En juin, avec Zheng
Zhenduo (郑振铎) et quelques autres, il
tente de fonder un journal où pouvoir exprimer leurs vues : le
Quotidien de la vérité universelle (《公理日报》), qui est aussitôt
interdit. En août, il est élu représentant ouvrier et participe
à un mouvement de grève à la Commercial Press.
En novembre 1926, Wang
Jingwei (汪精卫),
représentant l’extrême gauche du Guomingdang, décide de
transférer le siège de son gouvernement Hankou, et de fusionner
les trois villes contiguës de Wuchang, Hankou et Hanyang (武昌、汉口、汉阳)
pour en faire le « district capitale » de Wuhan ; le transfert
est effectif le 1er janvier 1927, Shen Yanbing y arrive au
printemps.
Il s’installe à Hankou
et y fonde un nouveau journal, le ‘Quotidien de la République’ (《民国日报》)
dont il devient rédacteur en chef. D’avril à juillet il y publie
une trentaine d’articles. Mais, le 12 avril, Chiang Kai-chek se
retourne contre les communistes, c’est le « massacre de
Shanghai » (四一二慘案) ;
il achève ensuite la purge des communistes des rangs du
Guomingdang et installe son propre gouvernement à Nankin.
Shen Yanbing quitte
Wuhan sans avoir pu participer au soulèvement de Nanchang (南昌起义
Nánchāng Qǐyì),
le 1er août, (6) parce que toutes les voies d’accès
sont bloquées. Il rentre à Shanghai dans un climat très
dangereux pour lui.
1927 : tournant
décisif vers l’écriture romanesque
Il
se retire dans une allée isolée, avec pour seule consolation
d’avoir près de lui ses amis Lu Xun et Ye Shengtao. Mais il n’a
pas de travail, et aucun journal n’accepte ses articles. C’est
dans ces circonstances difficiles qu’il décide d’écrire des
nouvelles. Mais c’est une situation pleine de contradictions,
qui lui inspire le nom de plume dont il va désormais signer ses
écrits : Mao Dun (矛盾),
signifiant
contradiction. Quand il le soumet à Ye Shengtao avec sa première
nouvelle, cependant,
celui-ci lui conseille de modifier
légèrement le premier caractère pour éviter de trop attirer
l’attention, en lui donnant le sens de chaume et non plus de
lance tout en gardant la même prononciation :
茅盾.
C’est alors que
commence pour l’écrivain la période la plus féconde,
littérairement parlant, de son existence : grosso modo douze
ans, de 1927 à 1939. Il va transcrire dans son œuvre sa
profonde compréhension des bouleversements historiques auxquels
il a participé : on ne peut vraiment la comprendre que quand on
garde en mémoire son parcours jusque là.
Eclipse
|
Le premier
texte signé Mao Dun est une nouvelle, « Désillusion »
(《幻灭》huànmiè),
publiée en 1927 dans le ‘Mensuel de la fiction’,
aussitôt suivie de deux autres, publiées en 1927 et
1928 : « Vacillation » (《动摇》dòngyáo)
et « Poursuite » (《追求
zhuīqiú》),
les trois formant une trilogie intitulée « Eclipse »
(《蚀》shí). Mao Dun y décrit un
groupe de jeunes intellectuels pris dans la tourmente
révolutionnaire de 1927-1928, portés par l’enthousiasme
mais sans réelle compréhension de la profondeur des
changements auxquels ils participent.
L’œuvre traduit
bien l’amertume de l’auteur et sa propre désillusion.
Cette
désillusion, il la traduit dans la première nouvelle par
celle d’une étudiante déçue par ses camarades et amis ;
cherchant un nouvel espoir, elle se retrouve à Wuhan
avec le nouveau gouvernement, pour être à nouveau déçue.
|
|
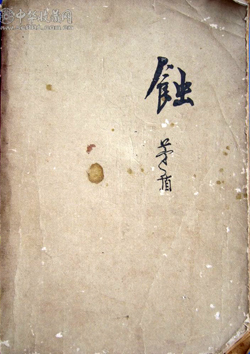
Eclipse (édition 1954) |
« Vacillation »
continue dans une petite ville du Hubei où le personnage
principal, fonctionnaire dans
l’aile gauche du
Guomingdang, échoue à mobiliser les gens ; le parti est
incapable de prendre des mesures décisives, et il doit s’enfuir.
« Poursuite » se passe en 1928 à Shanghai et parachève le
tableau de jeunes désorientés qui ont perdu jusqu’à l’espoir de
bâtir une société meilleure ; l’un se suicide, un autre devient
alcoolique, tous se replient dans un individualisme timoré.
Arc-en-ciel
|

Mao Dun et Qin Dejun au moment
de leur séparation, en 1930 |
|
En 1928,
menacé, il part au Japon sous un nom d’emprunt. Sur le
bateau qui l’y emmène, il fait la connaissance d’une
étudiante,
Qin Dejun (秦德君) ;
il a 32 ans, elle en a 22 , et déjà cinq dans le Parti ;
ils vont se retrouver à Tokyo, partager les mêmes
passions, et finalement la même chambre. Ce ne serait qu’un détail
intime sans trop d’importance si la jeune femme n’avait
eu une influence sur ce qu’il écrit
pendant les deux années de leur séjour commun. Mao Dun a
trouvé un endroit bucolique, dans le banlieue de la
capitale, qu’il a décrit en termes poétiques dans ses
|
mémoires : une petite
maison au bord d’un étang d’où l’on pouvait voir au loin les
contreforts d’une chaîne de collines sur lesquelles, la nuit,
brillaient quelques lumières révélant la trace d’habitations.
“…
想到这,便觉得我的新居确实是富有诗意,对写作十分有利。”
… en y
songeant, je me dis que ma nouvelle demeure était pleine de
poésie,
tout à fait propice à l’écriture…
Et de fait, ces deux
années au Japon vont être prolifiques, et
Qin Dejun apporte une
contribution critique non négligeable. D’abord, c’est elle qui
suggère à Mao Dun de lier les trois nouvelles déjà publiées en
une trilogie, et de l’appeler « Eclipse », avec une symbolique
de phénomène transitoire tout autant qu’inévitable, ainsi qu’une
connotation réaliste. L’œuvre sera publiée sous ce titre en
1930.
Mao Dun, cependant,
était en panne d’inspiration. C’est en parlant avec Qin Dejun,
en écoutant le récit de ses expériences vécues, qu’il conçut le
projet de ce qui allait devenir sa première œuvre majeure
: « Arc-en-ciel »
(《虹》).
Dans ses mémoires encore, il rend hommage à l’inspiration que
lui a fournie la jeune femme
:
“这都是些极好的小说材料!你呀,好比手里捧着一大把铜钱,只要用一根线穿起来,就是很好的文学作品。”
« Tout cela [ce
qu’elle lui racontait de sa vie] était un excellent
matériau pour un roman ! On aurait dit que tu tenais dans les
mains une poignée de pièces de cuivre, il suffisait juste de
leur passer un fil au milieu et de les relier pour obtenir une
superbe œuvre littéraire. »
C’est elle encore qui
lui suggère le titre, l’arc-en-ciel, phénomène à la fois
passager et illusoire, empreint d’un charme magique et augurant
la fin de l’orage. Effectivement, le roman reflète le bonheur
tranquille qui était celui de l’écrivain, son éloignement du
cœur des conflits politiques en Chine : il est beaucoup plus
optimiste qu’« Eclipse », c’est même le seul de ses romans qui
se termine de façon positive. Après un mariage décevant et un
divorce, la jeune femme qui est au centre du récit retrouve
l’espoir en rencontrant un jeune cadre communiste qui lui donne
le sens d’une mission à accomplir : le roman s’achève alors
qu’elle s’apprête à participer aux manifestations du 30 mai…
D’avril à août 1929,
Mao Dun envoie les passages rédigés au ‘Mensuel de la fiction’
qui les publie en épisodes séparés. Qin Dejun étant alors
obligée de rentrer à Shanghai pour se faire avorter, il en
arrête la rédaction, jusqu’à ce qu’elle revienne. Il écrit des
nouvelles et des essais en l’attendant.
Son passé le rattrape
cependant. En effet, il avait été marié en 1918 par sa mère à
une jeune femme quasi illettrée, fille d’un petit commerçant,
Kong Dezhi (孔德沚).
La nouvelle de la liaison de son mari finit par lui revenir aux
oreilles, elle alla en larmes se plaindre à sa belle-mère.
Lorsque, au début
d’avril 1930, Mao Dun revint à Shanghai avec Qin Dejun, il
continua à vivre un temps avec elle, et l’introduisit à son
cercle d’amis. Mais il dut bientôt se rendre aux pressions de sa
mère, et rompre avec elle pour revenir vivre avec Kong Dezhi.
Qin Dejun avala une boîte de somnifères mais survécut, et revint
se soigner dans son Sichuan natal. Autant Mao Dun est disert
dans ses mémoires sur les circonstances de la rédaction d’«
Arc-en-ciel », autant il est muet sur la rupture avec Qin Dejun
est ses conséquences (7).
Trilogie
rurale et Boutique de la famille Lin
Dès son retour à
Shanghai, Mao Dun entre à la Ligue des écrivains de gauche (中国左翼作家联盟) dont il devient le secrétaire exécutif l’année suivante ; il
travaille en étroite
collaboration avec
Lu Xun
à promouvoir un mouvement révolutionnaire en littérature. Ses
romans et nouvelles de 1932-33 sont le reflet de cet engagement,
mais offrent une image extrêmement subtile de sa vision de
l’évolution sociale en Chine au début du siècle, une vision
historique qu’il veut réaliste de la métamorphose en cours de la
société tant rurale qu’urbaine.
Ces œuvres présentent
des panoramas détaillés d’une Chine parvenue au croisement
d’axes de valeurs contradictoires - modèle agraire contre modèle
industriel, capitalisme contre communisme, déclin contre
révolution, passé contre futur - termes binaires qu’il évalue en
termes de dialectique marxiste, en tant qu’interactions et non
simples oppositions.
Ce qu’il montre dans
les œuvres les plus significatives de cette période, c’est que
tant la société rurale que la société urbaine est en voie
d’effondrement en Chine, mais qu’il s’agit d’un processus
historique inévitable et nécessaire pour accéder à une société
communiste. Ce ne sont pas des œuvres qui dénoncent, mais qui
dépeignent un mécanisme en marche.
|
Il traite la
société rurale dans sa « Trilogie rurale » (“农村三部曲”) :
« Les vers à soie du
printemps » (《春蚕》),
« La moisson d’automne » (《秋收》)
et « Les ruines de
l’hiver »
(《残冬》).
Dans la
première nouvelle, il décrit la ferveur avec laquelle
une famille paysanne élève ses vers à soie comme une
sorte de rituel, pour se retrouver face à la ruine quand
ils ne peuvent écouler leur production, les usines ayant
fermé leurs portes à cause de la guerre. La même
conséquence désastreuse se reproduit dans la seconde
partie de la trilogie : le malheureux paysan ayant
décidé de se reconvertir dans la culture du riz se
retrouve dans la même situation de surproduction.
Dans une construction mélodramatique, Mao Dun multiplie les désastres
qui pleuvent sur ses |
|
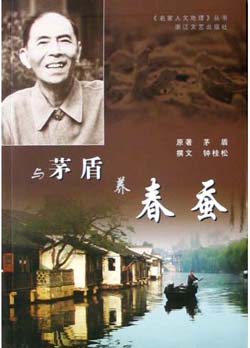
Les vers à soie du printemps |
personnages, qu’il
décrit empêtrés dans leurs traditions ; mais il le fait avec
émotion, on ne sent aucune critique de leurs superstitions, de
leur conservatisme, simplement il faut qu’il en soit ainsi, que
la vieille société meure pour que puisse naître la nouvelle.
|

La boutique de la famille Lin |
|
A la fin de la
trilogie, le fils rebelle finit par se révolter contre
les autorités locales avec ses camarades, au milieu de
rumeurs annonçant l’apparition d’un Prince céleste. Ce
n’est en fait qu’un malheureux innocent, qui est arrêté
par la police et sauvé par hasard quand les rebelles
attaquent la prison. Ce sont bien eux, finalement, qui
représentent
l’espoir ultime de renouveau. La trilogie
semble donc bien dépeindre la progression de la
paysannerie vers la révolution, mais de manière
ambiguë : la lutte semble être aussi bien contre les
forces de la Nature, comme peuvent le laisser entendre
les titres appelant à replacer cette lutte dans le cadre
du rythme des saisons.
Dans l’autre
nouvelle importante de cette année 1932,
« La
boutique de la famille Lin » (《林家铺子》),
Mao Dun montre la famille d’un petit boutiquier conduite
à la ruine par une suite impitoyable d’événements hors
de leur |
contrôle : la guerre, la crise
économique, la concurrence, mais aussi la corruption des
autorités locales. Là encore, le vieux monsieur Lin n’est pas
particulièrement mauvais bien qu’il contribue à ruiner les
pauvres hères qui lui ont confié leurs économies, simplement la
marche de l’histoire est inexorable, et il n’en est qu’un
rouage.
Minuit
|
En 1933, « Minuit »
(《子夜》)
apporte
le troisième volet de l’analyse entreprise par Mao Dun
de la décomposition de la société chinoise de l’époque :
il concerne l’industrie métropolitaine, et en
l’occurrence un industriel de Shanghai. Comme les
paysans et leurs cocons, comme monsieur Lin dans sa
boutique, il se bat en vain contre le mécanisme de
l’histoire, et plus il tente de lutter, plus il
s’enfonce dans les dettes.
Il rachète des
petites entreprises en faillite, mais se retrouve en
déficit parce qu’elles ne sont pas rentables. Pour
tenter de se renflouer, il essaie de spéculer en bourse,
ce qui ne fait qu’affaiblir encore sa base industrielle.
Sur quoi il essaie de renouer avec les bénéfices en
diminuant ses coûts, c’est-à-dire en |
|

Minuit (édition originale) |
diminuant les
salaires, ce qui déclenche une grève qu’il n’arrive à contrôler
qu’en appelant la police. Il finit vaincu par les machinations
de son principal rival, soutenu par des fonds étrangers.
|
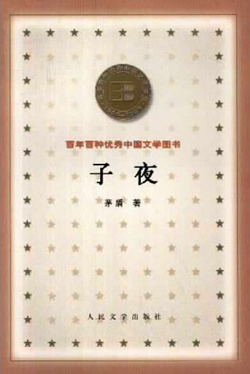
Minuit (édition moderne) |
|
« Minuit » est
le sommet de l’œuvre de Mao Dun. D’une extrême
complexité dans la description des mécanismes
économiques et boursiers, tout autant que par la
richesse des interactions humaines qui y sont
représentées, le roman a été salué par le grand
théoricien marxiste Qu Qiubai (瞿秋白)
comme « le premier roman réaliste réussi de la
littérature chinoise ». Mao Dun a expliqué qu’il avait
composé son roman selon les méthodes réalistes du
naturalisme à la Zola : patient travail de
documentation, liste de personnages fixée dès le départ
pour représenter les diverses strates de la société
shanghaïenne. « Minuit » est fascinant par la minutie du
détail autant que par la maîtrise de la ligne narrative.
Le reste des
œuvres de la période, y compris les essais, reprennent
des thèmes analogues sur l’histoire et l’évolution
contemporaine de la Chine. Mais Mao Dun poursuit aussi
son travail de recherche littéraire, et |
travaille en
particulier avec
Lu Xun
pour diffuser des traductions de grandes œuvres de la
littérature étrangère, dans la revue que
Lu Xun
a créée dans ce but et qui s’appelle, justement, « Littérature
en traduction » (《译文》).
Fin 1937, la chute de
Shanghai marque la fin d’une phase importante dans la vie de Mao
Dun comme dans son œuvre. Comme les intellectuels de Shanghai
autour de lui, il prend la route de l’intérieur et va mener une
vie errante pendant toute la guerre, mais en continuant à écrire
de manière tout aussi prolifique.
1938-1948 :
errance et écriture
|
En mars 1938,
il est à Wuhan, deux mois plus tard à Canton, puis à
Hong Kong. A la fin de l’année, il part au Xinjiang, où
l’appelle un ancien industriel de Mandchourie reconverti
dans le journalisme de guerre,
Du Zhongyuan (杜重远),
qui
l’appelle pour venir enseigner à l’université de Dihua (迪化),
aujourd’hui Urumqi, dont on lui a confié la charge.
Mao Dun y
arrive en mars 1939, prend la tête de
l’association
culturelle du Xinjiang qui vient d’être créée, donne des
cours, mais l’atmosphère est pesante, il repart en avril
1940, passe par Yan’an en chemin pour Chongqing où il
arrive en octobre. Il retrouve là Guo Moruo (郭沫若) et se pose le temps
d’écrire ses essais sans doute les plus célèbres : « Du
paysage » (《风景谈》) et surtout « Eloge du
peuplier blanc » (《白杨礼赞》), plus qu’un |
|
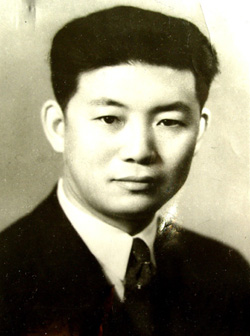
Du Zhongyuan |
essai, un poème en prose, devenu un classique que l’on apprend à
l’école en Chine.
Exemple (texte à écouter)
|
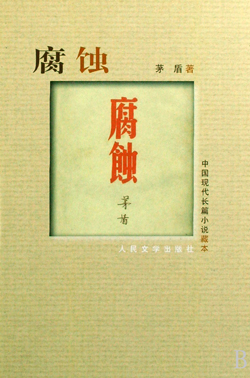
Putréfaction |
|
Début janvier 1941,
dans le sud de l’Anhui, a lieu l’incident dit de la Nouvelle
4ème Armée (新四軍事件) :
échauffourée entre troupes communistes et armée nationaliste qui
marque la fin de la coopération entre les deux armées. Mao Dun
quitte Chongqing et gagne Hong Kong. Il tire de
l’événement
matière à un roman : « Putréfaction » (《腐蚀》).
L’histoire se passe à
Chongqing entre septembre 1940 et février 1941 ; elle est écrite
sous la forme d’un journal que l’auteur prétend dans
l’introduction avoir trouvé dans un abri anti-aérien et qui est
censé être celui d’une femme qui travaillait pour le
gouvernement nationaliste ; elle y décrit comment elle a changé
après avoir provoqué la mort d’un jeune garçon qu’elle avait
aimé plus jeune et qu’elle était chargée d’espionner. L’histoire
aurait pu donner un roman policier, Mao Dun l’a traitée le plan
psychologique, et en a fait un pamphlet anti-nationaliste.
|
|
A la fin de l’année, il
est à nouveau rattrapé par la guerre : Hong Kong est occupée par
les Japonais, il fuit à Guilin où il écrit un roman sur la chute
de la ville : « Objets perdus ramassés après le désastre »
(《劫后拾遗》). Fin 1942, il revient à
Chongqing, et écrit une pièce de théâtre qu’il vaut mieux
oublier.
En mars 1946, la guerre
contre le Japon est terminée, il quitte Chongqing pour revenir à
Shanghai, par Hong Kong. Il arrive à Shanghai en mai, mais, si
les Japonais sont partis, le Guomingdang est toujours là. Il
repart à Hong Kong et y écrit encore une nouvelle, « Discipline »
(《锻炼》),
sur la guerre. Plus que jamais, la valeur de ses écrits tient à
leur réalisme, à leur qualité de documents sur l’époque : il
capture en toute hâte l’essence des événements qui sont encore
frais dans les mémoires avant qu’ils ne s’effacent.
Mais, à la fin de
l’année, à l’appel du Parti, il part rejoindre
|
|
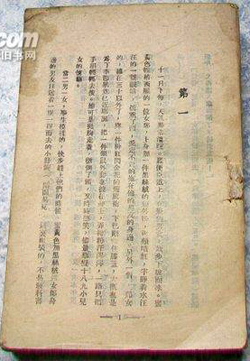
Objets ramassés après le désastre,
édition originale de 1942 |
les troupes
communistes dans le nord. Le 2 février 1949, il entre dans ce
qui est encore Beiping.
Après 1949 :
personnage officiel
|

Le président Mao avec Zhou Yang, Mao Dun
et Guo Moruo
毛泽东主席与周扬、茅盾、郭沫若 |
|
A partir de la
fondation de la République populaire, il est un personnage
officiel. Il devient rédacteur en chef de la revue ‘la
littérature du peuple’ (《人民文学》) puis est nommé ministre
de la culture en octobre 1949 et le restera jusqu’à la fin de
1964.
Après la Révolution
culturelle, en 1970, il devient rédacteur en chef d’un magazine
pour enfants. Malade, il passe ensuite ses dernières années à
rédiger ses mémoires, « Le chemin que j’ai parcouru » (《我走过的路》),
qui ont d’abord été publiées par
épisodes dans la publication officielle
|
du Parti « Documents
historiques sur la nouvelle littérature » (新文学史料).
|

Mao Dun officiel |
|
Il est mort le 27 mars
1981 avant de les avoir terminées, mais en laissant des œuvres
complètes qui font quarante volumes.
Il continue à exercer
une influence importante sur le monde littéraire, en dépit des
controverses (8), par le biais du Prix Mao Dun (茅盾文学奖)
qu’il a créé de ses propres deniers.
|
Notes
|
(1) Les zi (字)
étaient fondés
sur des jeux de caractères :
鸿
hóng
et
雁
yàn
désignent
tous deux une oie sauvage.
(2) Les Sept Maîtres de
Jian’an (建安七子) sont un groupe de sept
poètes/penseurs de la période des Han de l’Est, Jian’an (建安)
étant plus précisément le nom du règne de l’empereur Xian (獻帝),
196-220, date qui marque la fin de la dynastie des Han et le
début de celle dite ‘des Trois Royaumes’. C’est une période de
déclin dynastique, mais d’essor artistique, en particulier de la
poésie.
(3) La conférence
plénière de Xishan fut convoquée par le Guomingdang le 23
novembre 1925, au monastère Biyun des collines de l’Ouest, ou
Xishan (西山碧云寺),
dans la banlieue de Pékin. Marquant le triomphe des forces
anti-communistes
|
|
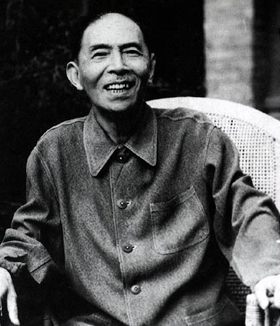
Mao Dun âgé |
(et anti-Comintern) dans le
Parti (ensuite appelées groupe de Xishan 西山派),
elle
prononça l’illégalité du Parti communiste (中国共产党“非法”).
Elle annonçait la rupture prochaine du premier front uni. Mais,
à la veille de l’Expédition du Nord, le Guomingdang réprima
encore la tendance Xishan pour ne pas s’aliéner Moscou.
(4) Dans le contexte
d’un désordre intérieur croissant après le mort de Sun Yat-sen,
en mars 1924, le mécontentement social s’amplifie à Shanghai
dans les premiers mois de 1925. Troubles et grèves se
multiplient dans une usine japonaise ; un gardien japonais tire
sur un ouvrier et le tue, provoquant de violentes manifestations
contre les capitalistes étrangers, et en particulier japonais.
Le 30 mai, la police arrête quinze étudiants qui menaient une
protestation dans la concession étrangère ; une foule s’amasse
devant le poste de police où ils sont détenus, en demandant leur
libération ; un cordon de police est établi pour les empêcher
d’entrer, mais la manifestation devient violente ; un policier
britannique tire sur la foule, suivi de la police sikh et
chinoise, faisant quatre morts et de nombreux blessés dont cinq
mourront ensuite de leurs blessures à l’hôpital. Les grèves et
manifestations s’étendent alors à tout le pays.
|
(5)
“中山舰事件”
Zhōngshān Jiàn Shìjiàn :
l’incident du navire Zhongshan,
prétendu complot par le capitaine du navire, et les communistes
derrière lui, pour enlever Chiang Kai-chek. Il a pour résultat
la rupture entre le Guomingdang et le Parti communiste. Zhou
Enlai rentre à Shanghai.
(6) Premier engagement
des communistes contre les forces nationalistes, le 1er
août 1927, pour réagir contre les purges
anti-communistes par le
Guomingdang. C’est la raison pour laquelle le 1er
août est
|
|

Ancienne résidence à Pékin |
considéré
comme le jour de
fondation de l’Armée rouge et célébré comme tel.
(7) Qin Dejun aura par
la suite une action non négligeable dans la lutte
révolutionnaire. En mai 1949, elle fut arrêtée par la police du
Guomingdang, jugée et condamnée à mort. Elle fut miraculeusement
sauvée par la libération de Shanghai. A près de 80 ans, en avril
1985, soit quatre ans après le décès de Mao Dun, elle livra à la
postérité son histoire malheureuse avec le grand écrivain dans
un livre de mémoires publié à Hong Kong : « Mao Dun et moi, un
épisode amoureux» (《我与茅盾的一段情》).
(8) Les critiques se
sont déchaînées lors de la remise du dernier et
8ème Prix décerné en
août 2011 : les œuvres récompensées ne semblent pas être
particulièrement choisies pour leurs qualités novatrices.
Traductions en
français
- Les vers à soie du
printemps et autres nouvelles, éditions en langues étrangères,
Pékin 1958
- Les vers à soie du
printemps, éditions Acropole, 1980
- L’arc-en-ciel,
traduction du chinois de Bernadette
Rouis et Jacques Tardif, revue et corrigée par Michelle Loi,
éditions Acropole, 1981
- L’éclipse (la
trilogie), Blandin Noël/Sillage, 1992
- Minuit, Laffont, 1972
- Minuit, traduction du
chinois de Jacques Meunier et Michelle Loi, éditions You Feng,
mars 2011
Edition bilingue
-
The Shop of the Lin Family & Spring Silkworms, translated
by Sydney Shapiro, introduction by David Der-wei Wang,
Chinese-English bilingual edition, Chinese University Press,
Hong Kong 2004.
Trois nouvelles dans deux
recueils :
« Shanghai 1920-1940 », nouvelles de huit écrivains traduits par
Victor Surio, Emanuelle Péchenart et Anne Wu, Bleu de Chine,
juillet 1998. Deux nouvelles de Mao Dun :
- « Un déménagement d’opérette » : en attendant son mari encore
au travail, seule à la maison, une femme s'ennuie et s'inquiète
: entendre le voisin jouer de l'harmonium à côté la rassure,
cela signifie qu’il est encore là, que les gens n'ont pas encore
déménagé pour fuir les combats dont parlent les rumeurs, en
ville.
- « Shanghai » : Une description acerbe et désopilante du
parcours du combattant à mener pour s'installer à Shanghai.
« Treize récits chinois 1918-1949 », traduits par Martine
Vallette-Hémery, Philippe Picquier, 1991
- « L’histoire de Grand-Nez » (《大鼻子的故事》) : une des rares
nouvelles de Mao Dun à la fois pleine d’humour et avec une fin
optimiste, mais sans abandonner le message anti-japonais.
Janvier 1932, les Japonais ont bombardé Shanghai ; un enfant
d’une huitaine d’années ayant perdu sa maison et ses parents
erre en cherchant à manger, en chapardant au besoin. Quatre ans
plus tard, il croise une manifestation d'étudiants qui crient «
Vive la lutte pour la libération ! » et autres slogans ; il ne
comprend pas, mais décide de les suivre.
Texte chinois :
http://www.my285.com/xdmj/maodun/04.htm
Adaptations
cinématographiques
|
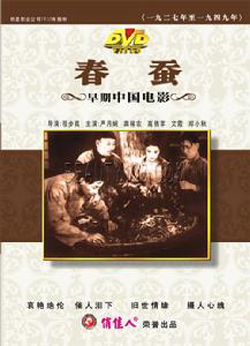
Les vers à soie du printemps, le film |
|
La nouvelle « Les
vers à soie du printemps » (《春蚕》)
a été adaptée par Cai Chusheng (蔡叔声)
et mise en scène par Cheng Bugao (程步高)
dès 1933. C’est dire l’importance de la nouvelle à l’époque,
autant que les liens très étroits qui existaient entre les
cercles littéraires et cinématographiques de gauche. Le film est
considéré comme l’un des grands classiques du cinéma de gauche
des années 1930 en Chine.
« La boutique de la
famille Lin » (《林家铺子》)
a été
adaptée par Xia Yan (夏衍)
et mise en scène par Shui Hua (水华)
en 1959.
Voir
l’analyse comparée de la nouvelle et du
film.
|
|
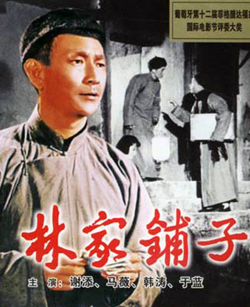
La boutique de la famille Lin, le film |
|
« Minuit » (《子夜》)
a été adapté au
cinéma et réalisé par Sang Hu (桑弧)
en 1981. Il avait prévu de le faire dès 1960, mais le projet
prit du retard et il ne put voir le jour plus tôt en raison de
la Révolution culturelle.
|
Lire en complément :
« La
boutique de la famille Lin »
《林家铺子》 :
la nouvelle de Mao Dun (茅盾)
et le film de Shui Hua (水华)
《雾》 (茅盾) « Brouillard » (Mao Dun)
« Les
vers à soie du printemps » (《春蚕》)
(à
venir)
|
|

