|
|
« Ecrits de la maison
des rats » : quelques pages douces-amères pour mieux connaître
Lao She
par Brigitte Duzan, 21 mai 2010
|
« Ecrits de la
maison des rats » est le deuxième livre de la collection
des éditions Philippe Picquier lancée en avril dernier
avec
« Songeant à mon père »
de Yan Lianke :
intitulée « Ecrits dans la paume de la main », cette
nouvelle collection s’intéresse aux textes brefs,
réflexions sur le vif ou souvenirs d’enfance, « miettes
modestes volées à la mémoire ».
Les textes de
Lao She qu’elle nous offre aujourd’hui sont
effectivement des petits joyaux de cet ordre.
« Ecrits de la maison des rats »
Les écrits en
question sont de courts articles, publiés dans divers
journaux et revues entre 1934 et 1959, où
Lao She donne
le meilleur de son humour doux-amer, nous laissant
souvent entre sourire et |
|
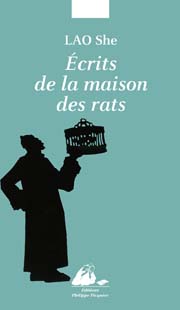
« Ecrits de la maison des
rats » |
larmes, comme il le
voulait (1).
Le livre commence fort
à propos par un texte très drôle qui donne tout de suite le ton
de ce qui suit ; intitulé « Dur, dur d’écrire son
autobiographie »,
Lao She y décrit les diverses étapes que se
doit de suivre une biographie chinoise et les raisons pour
lesquelles il lui est impossible de se plier à ces règles, ce
qui exclut l’autobiographie, et laisse donc le champ ouvert à
des écrits au gré du vent et de la plume, des souvenirs intimes
et des réflexions sur le moment qui passe.
Les textes sont
présentés dans un ordre thématique, présentant d’abord des
souvenirs d’enfance, et en particulier un émouvant hommage à sa
mère, à un oncle haut en couleur qui lui a permis de continuer
ses études, et, bien sûr, à sa chère ville de Pékin, une ville
« calme dans le mouvement », dont il nous transmet la nostalgie,
nostalgie de ces « espaces libres de construction où l’on peut
respirer librement ».
Le reste est un choix
de réflexions sur la vie, la vie de tous les jours, la vie telle
qu’elle est et telle
qu’elle pourrait être,
celle qui, déjà, fait partir du passé et revient vous hanter,
des choses infimes, quelquefois, qui font de certaines pages de
subtils petits poèmes en prose.
Un témoignage sur la vie et la pensée de Lao She
Si l’on se livre
cependant à un petit exercice de remise en ordre chronologique
des textes, apparaît dès lors un autre aspect de leur contenu,
lié au contexte de l’époque où ils ont été écrits.
De 1934 à 1936,
c’est-à-dire avant le début de la guerre dite ‘de résistance’
contre le Japon,
Lao She est alors professeur à Tianjin ; il
évoque d’abord des souvenirs de l’été, des impressions
épidermiques, et puis il passe à des réflexions sur la lecture,
les examens, son travail : il dit que le pire, c’est d’être
contraint de faire un travail que l’on n’aime pas, parce qu’il
faut bien remplir son bol de riz. On croit sentir que ces
textes, justement, sont écrits dans ce but.
Ce qui est tout aussi
intéressant, ce sont les journaux dans lesquels ils sont
publiés, et qui donnent un aperçu fugace de l’environnement dans
lequel évoluait
Lao She. On l’a dit résolument apolitique, non
affilié à quelque mouvement que ce soit. Pas tout à fait.
|
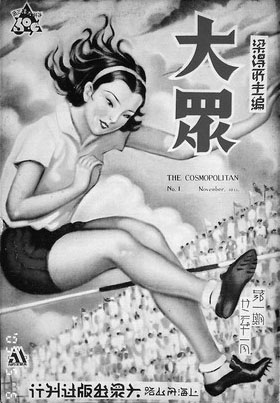
《大众画报》« Cosmopolitan » |
|
En effet, il
publie à l’époque principalement dans quatre journaux :
le bimensuel Lunyu
《论语半月刊》,
le magazine illustré
《大众画报》(qui
s’était donné le titre international « Cosmopolitan »),
le « monde des hommes »《人间世》et « le vent
cosmique »《宇宙风》. Ces titres ont un point commun : ils font partie de ce qu’on appelle
« le groupe Lunyu », autour de Lin Yutang (林语堂),
l’un des écrivains et penseurs chinois les plus
influents à l’époque (2).
Le bimensuel
Lunyu fut créé par Lin Yutang en 1932, et le succès que
connut le titre entraîna la création des autres. Le
propos de ces publications n’était pas révolutionnaire,
et se démarquait de la tendance gauchiste des écrivains
autour de
Lu Xun ; la
ligne éditoriale était plutôt la critique sociale, voire
le commentaire sur la myriade de petits faits de la vie
quotidienne, dans le contexte des contradictions nées de
la modernisation. Bon nombre des auteurs qui
|
gravitaient dans cette
orbite étaient des chercheurs en sciences sociales, formés en
Occident, plutôt que des wenren. Mais
Lao She fut l’un de
ceux que ces publications contribuèrent à faire connaître.
C’est dans le « vent
cosmique »《宇宙风》, par exemple, que fut
publié « Le pousse pousse », sous forme de feuilleton, en 1936.
A partir de 1940,
et pendant toute la guerre,
Lao She se tourne vers les journaux
créés ou réfugiés à
l’ouest, comme
le « Quotidien de l’ouest chinois » (《华西日报》);
en même temps, ses thèmes se font plus nostalgiques : il se
souvient avec émotion de l’oncle qui l’a sauvé de
l’apprentissage (1940), de sa mère (1943), les poules (1942)
étant une autre manière d’évoquer l’amour et l’héroïsme
maternels.
Autant de textes qui
nous transportent dans l’univers intime d’un auteur dont l’œuvre
gagne ainsi en profondeur : il faut saluer ici la justesse des
choix opérés par le directeur de la collection.
Un mot sur le traducteur, Claude Payen
Il y a des traducteurs
compulsifs comme il y a des lecteurs compulsifs : Claude Payen
en est un (4), et, qui plus est, méticuleux, toujours à la
recherche du mot juste, on se demande où il trouve le temps de
traduire autant, et aussi bien, car, en lisant ces «écrits de la
maison des rats », on en finirait presque par oublier qu’il
s’agit quand même de littérature chinoise.
|
Il a commencé
sa carrière de traducteur en traduisant de l’anglais un
livre qui est maintenant un ouvrage de collection,
préfacé par Lucien Blanco et publié en deux volumes en
1969 par l’Imprimerie nationale : « La Longue Marche :
mémoires du maréchal Zhu De » d’Agnès Smedley, cette
journaliste américaine qui fut, entre autres choses,
correspondant de guerre en Chine dans les années 1930,
et qui, de 1938 à 1940, visita les zones contrôlées par
les forces communistes et celles du Guomingdang.
Il a ensuite
traduit, du chinois cette fois, pour les éditions
Youfeng, un roman basé sur un fait divers authentique :
« Rouge… sang » de deux auteurs dont le nom importe peu.
Le plus intéressant dans l’histoire est que le
responsable de la collection l’a mis sur la piste de
Lao
She, en lui suggérant d’abord de traduire
« L’anniversaire de Xiao Po » ;
mais cette traduction
fut publiée chez
Philippe Picquier |
|
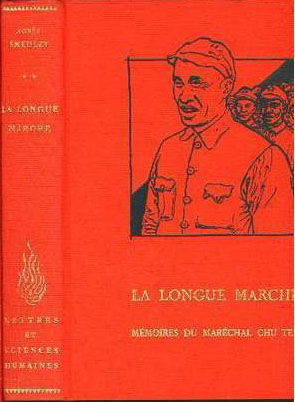
« La Longue Marche :
mémoires du maréchal Zhu De » d’Agnès Smedley |
qui est resté ensuite l’éditeur attitré de
Claude Payen, avec une brève infidélité pour passer aux éditions
de
l’Olivier le temps d’une traduction : celle du roman de
Murong Xuecun intitulé « Oublier Chengdu ».
Rien de plus différent,
a priori, tant du point de vue de la langue que des histoires
elles-mêmes et du contexte dans lequel elles s’inscrivent, que
tous ces livres dont on a presque l’impression que les
traductions se chevauchent et se bousculent. En fait, ce qui le
gêne le plus, dit-il, ce sont les libertés avec la réalité que
se permettent parfois les auteurs, sans faire exprès, pris par
l’urgence de la plume, et qui ne gênent en rien le public
chinois : des incongruités sur la durée d’une grossesse, ou des
descriptions invraisemblables d’attitudes ou de situations, qui
demandent beaucoup de doigté et
d’expérience pour
rétablir un sens qui tienne la route.
Il dit que, tous les
soirs, il lit du français pour peaufiner son style, car c’est
cela le plus difficile, finalement : non point la compréhension
du texte original, mais le maniement de sa propre langue afin de
la rendre suffisamment souple et élégante pour que l’on oublie
le traducteur, mais sans perdre en précision.
Il se veut transparent,
Claude Payen, mais de temps en temps il faut bien satisfaire un
peu la curiosité des lecteurs ...
Notes
(1) Voir son article « Qu’est-ce
que l’humour ».
(2) Né en 1895, après
des études à Shanghai, Lin Yutang a étudié aux Etats-Unis (à
Harvard), et, après un séjour en France, a préparé un doctorat
en Allemagne (à l’université de Leipzig). C’est un des grands
intellectuels chinois qui ont contribué à faire connaître et
populariser la littérature et la pensée chinoises à l’étranger.
(3) Outre cinq livres
de Lao She, il en a traduit trois de Bi Feiyu, deux de
Yan Lianke (et non des
moindres : « Le rêve du village des Ding » et « Servir le
peuple »), les « Ripoux » de
Zhang
Yu, et j’en passe… et tout cela dans les dix
dernières années : libéré de l’enseignement, il a pu consacrer
tout son temps à la traduction, comme
Lao She, en son temps, à
l’écriture.
|
|

