|
|
« S’ouvrent les
portes de la ville » : souvenirs de Pékin, par le poète Bei Dao
par
Brigitte Duzan, 25 juillet 2020
Les portes de Pékin, la ville de son enfance, s’étaient
refermées sur
Bei
Dao (北岛)
en 1989. Lors des événements de la place Tian’anmen, il se
trouvait à un colloque littéraire à Berlin. Il avait affiché une
position de plus en plus critique à l’égard du gouvernement
chinois, jusqu’à ce que, en 1986, son recueil de poèmes « Rêve
en plein jour » (Bairi meng
《白日梦》)
soit interdit : c’était un cauchemar éveillé.
|
En 1989, il signe avec une trentaine d’autres
intellectuels une lettre ouverte au gouvernement
demandant la libération des prisonniers politiques,
dont le combattant de la démocratie Wei Jingsheng (魏京生)
arrêté en mars 1979 et condamné à quinze ans de
prison
.
Bei Dao n’est pas place Tian’anmen, mais ses poèmes
circulent parmi les étudiants. Il n’en fallait pas
plus pour qu’il soit prié de rester où il était : il
est condamné à l’exil ; sa femme, l’artiste peintre
Shao Fei (邵飞)
et sa petite fille Tian Tian (田田)
ne sont pas autorisées à le rejoindre. Il verra sa
fille à plusieurs reprises, au Danemark et en
France, au début des années 1990 ; quant à Shao Fei,
il la retrouvera en 1995 aux Etats-Unis.
Il lui faudra attendre bien plus longtemps pour
revoir Pékin : ce n’est qu’en 2001 qu’il est
autorisé à y retourner, pour rendre visite à son
père malade. Quand il débarque, c’est le choc : la
ville est méconnaissable. Il entreprend alors
d’écrire un livre de souvenirs, pour rebâtir « son »
|
|
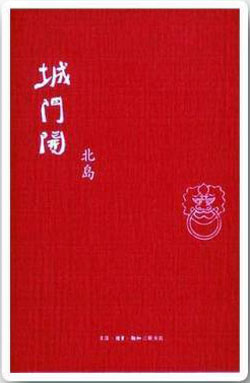
Chengmen kai, réédition 2015
à Hong Kong |
Pékin en inversant le cours du temps et nier par
là-même
cette ville étrangère qui a perdu le charme qu’elle
avait autrefois. Ce qu’il ouvre, ce sont les portes
labyrinthiques
de la mémoire et elles sont quelque peu rouillées. Il lui
faudra près de dix ans pour venir à bout de son entreprise :
le livre, Chengmen kai (《城门开》),
est achevé en 2010, comme en fait foi la préface ; il est
alors publié à Hong Kong
et réédité en juillet 2015.
|
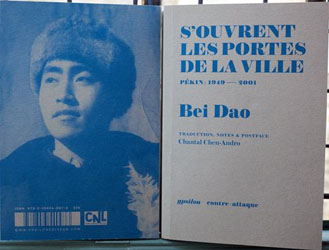
S’ouvrent les portes de la ville,
2020 |
|
Ces souvenirs nous arrivent aujourd’hui traduits en
français par
Chantal Chen-Andro,
aux éditions Ypsilon,
avec des photos inédites, tout un appareil de notes,
une annexe et une postface de la traductrice. C’est
un régal.
Le livre est en 18 chapitres, correspondant à une
thématique en deux temps : neuf chapitres sur les
souvenirs du quotidien, dans les années 1950-1960
essentiellement, et neuf chapitres plus précisément
sur la ville, lieux et habitants, dont l‘histoire de
la famille, s’achevant sur un portrait du père,
comme un hommage post mortem. |
Les souvenirs ne sont pas rédigés de manière chronologique mais
thématique, comme si un mot suscitait soudain un déclic de la
mémoire, et que les images arrivaient à flot. Mais elles se
recoupent, se croisent, certaines répétées en prennent plus
d’importance, plus de signification que d’autres. On perçoit le
travail de mémoire, de reconstitution du passé, avec une
précision telle dans les images que le récit prend vie dans
l’imagination au fur et à mesure de la lecture.
1.
Pékin années 1950-1960 : atmosphère
Les souvenirs s’égrènent au fil des différents thèmes de la vie
quotidienne, en commençant par trois chapitres nés de souvenirs
visuels, auditifs et olfactifs :
Lumières et ombres
光与影
– Odeurs
味儿
– Bruits
声音
Lumières
d’abord : ce sont celles qui accueillent le voyageur de retour
dans sa ville natale, en l’éblouissant – les lumières de la
ville, entrant par les hublots de l’avion, font ressembler Pékin
« à un immense stade illuminé ». Alors aussitôt affluent les
images d’ombres de la ville de son enfance : une ville sombre,
peu éclairée, une lampe dans la pièce d’habitation principale,
pas de réverbères dans la plupart des rues… Mais aussitôt surgit
le côté poétique : l’ombre était propice aux jeux de cache-cache
et à l’imagination, propice aussi aux histoires de fantômes qui
nécessitent l’obscurité pour être bien contées. Dans les années
1970, l’arrivée de la lumière crue des néons bouleversa tout
cela, mais les coupures de courant permirent, en devant allumer
des bougies, de retrouver l’ambiance du passé.
|
Odeurs
ensuite, liées à des saveurs aussi (le mot wei’er
味儿
désignant les deux) : odeur de choux en novembre,
des fumées de charbon des cuisines, de la poussière
obligeant à porter un masque ; odeur « de menthe »
de la neige au goût sucré, la neige rappelant
aussitôt les parties de patinage sur le lac Houhai (后海)
et la glace conservée dans la glacière au nord du
pont Li Guang (李广桥),
du nom d’un eunuque de la dynastie des Ming, comme
l’a bien noté la traductrice. Plus loin, il évoque
son arrivée pendant l’hiver 1957 dans le hutong de
Sanbulao où la famille vient d’emménager : l’endroit
|
|

Le pont Li Guang |
est lié pour lui à l’odeur de l’épaisse fumée des patates
douces en train de griller. Quant aux étés, ils étaient
parfumés par les fleurs de sophora…
Bruits
enfin : on en a des collections entières dans la littérature
chinoise ; Bei Dao cite le recueil des « Bruits de la ville
collectés pour le plaisir » (《市声拾趣》)
de
Zhang Henshui (张恨水),
ceux des années 1920-1930, mais il nous ajoute les siens, du
début des années 1960, quand Pékin était un grand village où
l’on était réveillé par le chant du coq du voisin, en
l’occurrence celui de la famille du rez-de-chaussée qui élevait
des poules dans son jardin privé, et même une dinde qui
glougloutait « comme un vieillard asthmatique ». Et puis il y a
les bruits de la rue, le maître d’école qui passe en faisant
crisser ses chaussures, les cris du facteur et des marchands
ambulants, mais aussi les bestioles de l’été, moustiques,
grillons et cigales, ces derniers étant bien sûr prétexte à
développement.
2.
Souvenirs de la vie quotidienne
Bei Dao nous raconte ensuite la vie d’un enfant à Pékin à
l’époque, avec ses jeux et les mille choses de la vie de tous
les jours :
Jouets et jeux
玩具与游戏
– Meubles
家具
– Disques
唱片
– Pêche
钓鱼
– Nage
游泳
– et enfin : Elevage des lapins
养兔子
Quelques pans de vie
1/ C’est plein de vie et d’humour, et d’expressions prises sur
le vif. Ainsi, les balsamines (凤仙花),
ou impatiens, ces « fleurs d’immortels phénix », avaient
des pétales dont les petites filles se badigeonnaient les
ongles : c’étaient donc des « fleurs à ongles » (指甲花)
.
Parfois, c’est un pan de vie qui renaît sous nos yeux, souligné
par une référence qui plonge le récit dans la tradition
ancienne. Ainsi les grillons, chez Bei Dao, prennent-ils une vie
particulière. Les jours de foire au temple de la Sauvegarde
nationale (护国寺),
nous dit-il, outre les différents bateleurs et conteurs, il y
avait un marché aux grillons dans la rue derrière le temple : la
rue dite des « Cent fleurs bien cachées » (“百花深处”) ;
les grillons les plus redoutables, à la tête triangulaire,
étaient appelés « couvercles de cercueil » (“棺材板”).
Pour les enfants les plus hardis, il s’agissait d’aller essayer
d’en attraper au pied des remparts, au milieu des tombes, dans
un endroit désert. Mais il était difficile de les localiser car
la campagne entière était pleine de leurs stridulations ; les
enfants effrayés se sentaient encerclés,
« de tous côtés montaient
les chants de Chu » (四面楚歌),
dit Bei Dao en citant avec humour une expression tirée des
« Mémoires
historiques » de Sima Qian.
2/ Les différents chapitres sont prétextes à récits
humoristiques qui nous font percevoir l’atmosphère de l’époque,
entre grandeur passée, pauvreté et débrouillardise ; celui sur
les meubles, par exemple : la vente de vieux ressorts de matelas
Simmons usagés est un morceau de bravoure, mais aussi la
séquence du nettoyage des portes en verre du vieux buffet de
cuisine : malgré tous les efforts de l’enfant qui les frottait
et les briquait, elles restaient tout aussi obscures et opaques
–elles étaient en fait en verre teinté…
Bei Dao a des expressions qui font mouche pour synthétiser la
période. Ainsi, il explique que ses parents ont acheté le
premier poste de télévision de leur immeuble et que la
télévision leur a changé la vie, non tant pour ce qu’ils y
voyaient, mais pour la posture qu’elle entraîna : il fallait
désormais être assis sur un canapé. Ils en ont même acheté deux,
avec le poste trônant au milieu. C’étaient cependant des meubles de
fortune fabriqués par un artisan du quartier, confortables, mais
surtout bon marché. Car « c’était l’époque où la population
entière calculait par soustraction ; quand on est passé à
l’addition, père et moi en avons eu le tournis » (那是全国人民共用减法的年代,一改成加法,竟让我和父亲都有点儿晕眩。).
Des années plus tard, ils devaient passer à la multiplication….
autres temps.
Débuts d’écrivain en musique
|

Le poste de radio-gramophone marque
Pivoine |
|
Au passage, il évoque ses débuts en écriture,
au début des années 1970, et ces premiers écrits,
dit-il, furent certainement influencés par la
musique qu’ils se passaient et repassaient alors sur
le vieux poste de radio de la marque Pivoine qui
faisait aussi office de gramophone (牡丹牌电唱机),
objet de luxe que son père avait acheté au début des
années 1960 avec quelques disques, achat dont Bei
Dao souligne le caractère « romantique » en un temps
où tout le monde cherchait d’abord à se mettre
quelque chose sous la dent.
La musique, c’était « Le beau Danube bleu », le
« Capriccio italiano » de Tchaïkovski et le 4e
concerto pour violon de Paganini, mélodies
délicieusement décadentes, incongrues dans le
contexte,
|
écoutées
rideaux fermés au creux de la nuit. Comme dans les films de
Wong Kar-wai, la musique est là pour donner à imaginer le
contexte : désir d’évasion nourri par la musique et traduit
dans l’écriture.
Bei Dao explique que le 33 tours Deutsche Grammophon du 4e
concerto avait été rapporté d’une tournée à l’étranger par un
oncle flûtiste, membre de l’Orchestre philharmonique national.
Il note cependant pour conclure ce chapitre sur la musique qu’il
est quand même inimaginable que ces disques aient pu entrer,
d’une manière ou une autre, dans la Chine hermétique de l’époque
et enflammer les esprits de jeunes fréquentant des « salons »
littéraires tout ce qu’il y a de plus clandestins. On touche là
un trait spécifique de l’époque dont on parle peu.
Elevage de lapins au temps de la famine
L’histoire de l’élevage des lapins est prétexte à développement
sur la famine du début des années 1960 ; on sait la
catastrophe que ce fut
,
mais c’est toujours un sujet tabou en Chine : elle est encore
attribuée à des calamités naturelles et pieusement évoquée dans
les documents officiels sous le terme fallacieux de « trois
années de difficultés » ou « trois années difficiles » (三年困难).
Bei Dao, lui, parle crûment de « grande famine » (大饥荒)
avant de se ranger à la nomenclature officielle. Dans le
chapitre sur le hutong de Sanbulao, un peu plus loin, il en
parle plus longuement, en rapportant des propos de sa mère,
disant avoir été inquiète pour ses enfants, et avoir eu
tellement faim que par moments ses mains en tremblaient et
qu’elle en avait des sueurs froides.
On est loin cependant des tableaux cauchemardesques de campagnes
littéralement jonchées de cadavres que l’on peut lire par
ailleurs dans tant de pages d’écrivains chinois
.
Il semblerait, à lire Bei Dao, que la situation à Pékin était
bien moins dramatique : il se rappelle avoir eu faim, se
souvient des consignes données aux enfants pour économiser leurs
forces, des emplois du temps scolaires allégés, et même des
consignes données par Mao. Mais on ne mourait pas à Pékin comme
à la campagne, de toute évidence : sa mère dit même avoir eu
tellement faim, un jour, qu’elle est allée prendre un bol de
soupe dans un restaurant sichuanais. Quant à son père, au pire
de la famine, en 1960-1961, il travaillait à l’Institut du
socialisme (社会主义学院)
et, dit-il dans les notes citées par son fils, il faisait venir
là ses trois enfants, « parce qu’ils pouvaient y manger un peu
mieux » (多少可以吃得好些).
Ceci semble aussi confirmer que les informations sur la
situation dans le pays ne remontaient pas jusqu’aux instances
centrales du Parti, car les dirigeants locaux jonglaient avec
les chiffres et camouflaient la réalité pour sauver leur peau.
La rumeur qui courait était que la responsabilité de la famine
incombait au grand frère soviétique qui obligeait la Chine à
rembourser ses dettes contractées lors de la guerre de Corée.
Evidemment les lapins passèrent à la casserole, mais on est
étonné que les enfants aient trouvé de quoi les nourrir, y
compris des graminées sauvages comestibles : à la campagne, les
paysans avaient mangé jusqu’à l’écorce des arbres. On touche là
une question cruciale : celle de l’inégalité extrême entre
campagne et villes. Il faut rappeler que les campagnes chinoises
ont été pressurées au maximum pour financer la
pseudo-industrialisation du Grand Bond en avant.
Bei Dao, par ailleurs, témoigne dans un chapitre ultérieur
de son étonnement quand il a découvert l’inégalité qui frappait
ses confrères étudiants de la campagne face aux examens : en
raison des quotas d’admission dans les grandes écoles et
universités, ils devaient obtenir des résultats bien supérieurs
aux étudiants urbains pour accéder à l’université en ville, gage
pour eux d’une vie dégagée des travaux des champs. Si la
situation a quelque peu évolué, l’inégalité n’a pas disparu.
3.
Pékin : hommes et lieux
|
Les huit chapitres suivants sont en quelque sorte,
dans l’ordre chronologique, le cadre de vie de Bei
Dao et les événements marquants dont il a gardé le
souvenir, de l’emménagement de la famille dans
l’immeuble alors tout neuf du hutong Sanbulao
(三不老胡同)
pendant l’hiver 1957, alors qu’il avait huit ans,
jusqu’au « grand échange » (大串联),
lors de ses 17 ans, en septembre 1966.
C’est l’histoire brute vue par les yeux de l’enfant
et de l’adolescent qu’il |
|

Hutong Sanbuliao, l’ancienne demeure
réputée avoir été celle de Zheng He,
au n°6 |
était, avec sa dose d’incompréhension, de distance,
d’émotion personnelle, parfois, mais très peu.
Ruelle Sanbulao, n° 1
三不老胡同1号
/ Tante Qian
钱阿姨
/ Lire
读书
/ Voyage à Shanghai
去上海
/ L’école primaire
小学
/ Le lycée n° 13 de Pékin
北京十三中
/ Le lycée n° 4 de Pékin
北京四中
/ Le Grand Echange
大串联
La vie à Sanbulao
Le hutong de Sanbulao, dans le district de Xicheng, est devenu
légendaire pour avoir été le lieu de résidence de nombreux
intellectuels après la « Libération », dont Bei Dao, mais son
histoire commence avec le célèbre amiral des Ming Zheng He (郑和)
sensé avoir résidé au n° 6.
L’immeuble de briques rouges était celui de la compagnie
d’assurance pour laquelle travaillait le père de Bei Dao. Juste
construit, il se trouvait au niveau de l’emplacement actuel du
deuxième périphérique, mais les fenêtres de l’appartement, au
troisième étage, donnaient alors sur la campagne ! C’était la
première fois, surtout, que la famille n’avait pas à partager la
cuisine et les wc.
|

Campagne d’extermination des
moineaux, « que tout le monde s’y mette », dit
l’affiche |
|
En revanche, Grand Bond en avant oblige, en 1958, la
cour eut droit à une cantine collective, et à un
petit haut fourneau, installé devant l’un des
escaliers, dont les premiers morceaux de ferraille
furent salués par gongs et tambours. Souvenir bien
plus mémorable cette année-là : la campagne
d’extermination des moineaux (打麻雀运动)
,
vaste entreprise de folie collective pendant trois
jours et trois nuits, qui se solda par la
liquidation de quelque 400 000 moineaux dans la
seule région de Pékin.
Puis ce furent les trois années difficiles.
La faim, omniprésente, lancinante, est le souvenir
dominant. Mais, liés à la faim, d’autres souvenirs
émergent, de menus plaisirs que s’octroyait la
famille, comme par compensation, dit-il : ils
allaient pratiquement tous les dimanches au cinéma,
« comme des fidèles allant à l’église » (像信徒去教堂一样).
Et où allaient-ils au cinéma ? Au temple de la
Sauvegarde nationale (护国寺电影院),
dont on a vu qu’il était le lieu de foires et de
divertissements proche de chez eux. |
|
Nous avons des détails précieux sur le cinéma, dont
les séances étaient annoncées dans le quotidien du
soir, le Beijing wanbao (《北京晚报》),
qui n’avait alors que quatre pages
.
Mais son pète était un passionné de cinéma et était
aussi abonné à diverses revues spécialisées. Il
privilégiait les films étrangers, donc, à l’époque,
surtout des films soviétiques doublés au studio de
Changchun, avec, petit détail croustillant, l’accent
local du Dongbei, si bien que Bei Dao croyait que
c’était du russe ! Evidemment, la bande cassait
parfois, et dans le silence qui s’instaurait, ils
entendaient les cris des grillons. En revanche on
n’a pas de précisions sur les films qu’ils voyaient
.
La vie à Sanbulao, c’étaient aussi les voisins, aux
différentes portes et différents paliers, qui nous
sont décrits avec juste les détails nécessaires pour
les faire revivre et leur donner chair. Ce sont
autant de portraits qui sont comme des amorces de
|
|
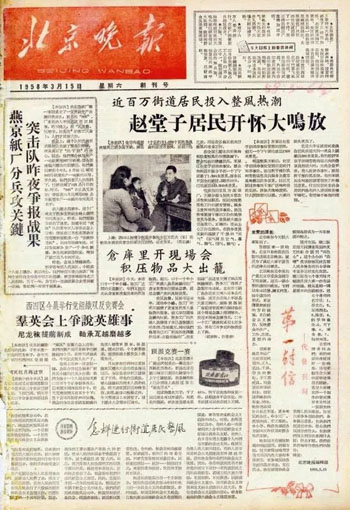
Le Beijing wanbao, numéro du
15 mars 1958 |
nouvelles. Mais la description de Sanbulao est aussi
l’occasion pour Bei Dao d’un développement sur le paysage
social local, et la distinction entre deux cultures
politiques : celle de la cour et celle de la ruelle
(“大院”与“胡同”) -
la cour étant habitée par des gens extérieurs, occupant de
hautes fonctions, avec des hiérarchies très nettes, et
la ruelle, le hutong, étant dévolue au petit peuple
des natifs du lieu. Le n° 1 émergeait du dédale du hutong
comme « le symbole du pouvoir paternel et de l’ordre
établi » aux yeux de l’adolescent un rien rebelle.
La Révolution culturelle se déclenche là d’abord comme « un
carnaval » (狂欢节),
mais se transforme très vite en tragédie sanglante. Le n° 1 de
Sanbulao devient la cible privilégiée des perquisitions à Pékin,
tous les habitants étant considérés comme des
contre-révolutionnaires, selon un avis affiché à la porte de
chaque escalier. Ce fut un « été de boucherie » (littéralement
« une pluie de sang dans une bourrasque nauséabonde »
血雨腥风的夏天) ;
l’été passa, mais la vie en fut bouleversée. Commencèrent les
grandes migrations, en même temps que l’on commença à creuser
des abris antiaériens… Bientôt les escaliers du n°1 furent
vides, comme Pékin : les gens étaient partis.
Cette Révolution culturelle débutée dans l’enthousiasme, une
fois le « grand échange » passé, laissa vite « le sentiment
d’avoir été trahis ». Et 1969 fut l’année-charnière qui marqua
un tournant dans la perception des événements, en scellant la
dispersion de la famille.
Famille dispersée
Bei Dao n’insiste sur aucun détail tragique ; quand il évoque le
suicide d’un voisin, par défenestration, il le mentionne en une
phrase, comme au détour de la pensée. Les atrocités de la
Révolution culturelle sont évacuées en quelques pages, comme une
tempête qui dévaste tout puis s’éloigne. L’annonce de la chute
de la Bande des quatre (octobre 1976) apparaît presque comme un
dénouement de comédie, avec une de ces formules typiques de Bei
Dao qui frappent et restent en mémoire : il était allé apporter
la bonne nouvelle à un ami de son père, qui était dans sa
cuisine en train de se sécher le dos avec une serviette, alors
« il fit volte-face en même temps que l’Histoire » (于是他和历史一起转身。).
Le meilleur de Bei Dao est là, comme des bribes de poésie.
L’histoire sinistre de cette période de son enfance et
adolescence est ainsi passée comme la pluie sur les plumes d’un
canard. Mais il reste des souvenirs très lourds, dont celui de
la dispersion de la famille, sur laquelle il revient plusieurs
fois, la dernière en en décrivant précisément les étapes dans le
chapitre final consacré à son père : au printemps 1969, il est
affecté comme ouvrier à une entreprise de construction à Pékin
qui travaille à la construction d’une centrale électrique dans
le Hebei, puis son frère cadet est envoyé dans une unité de
l’armée à la frontière de la Mongolie intérieure ; sa mère part
à l’automne dans une Ecole de cadres dans le Henan,
où la rejoint sa fille ; quant au
père, il part à la fin de l’année dans une Ecole des cadres du
Hubei…
Surtout, comme bien d’autres, l’histoire familiale recèle son
drame : le 27 juillet 1976, toujours dans le Hubei, Shanshan, la
petite sœur se noie en tentant de sauver quelqu’un de la
noyade. Le lendemain matin, c’était le tremblement de terre de
Tangshan
,
qui annonçait déjà la mort de Mao et la fin de la Révolution
culturelle. Ce drame a marqué les esprits au fer rouge et s’est
résolu dans le silence. Bei Dao n’en dit pas plus, seulement que
sa mère en fit une dépression nerveuse suivie d’une longue
maladie mentale.
Chantal Chen-Andro,
bien plus tard, rendit visite à la famille à Pékin en leur
apportant un bouquet de fleurs : il passa directement à la
poubelle. Depuis la mort de Shanshan, lui confia Bei Dao, les
fleurs étaient interdites chez eux…
4.
Entreprise cathartique
Sur toutes ces pages plane l’ombre du père, auquel est consacré
le dernier chapitre, après ceux sur les différentes écoles et
collèges, comme une montée en grade. Autant la mère, dont on
apprend au hasard d’une digression qu’elle était médecin, est
évanescente dans ces souvenirs , autant le père est omniprésent.
Le livre est dédié à ses deux enfants, un peu comme
Bi
Feiyu (毕飞宇)
écrivant ses souvenirs des années 1970 pour son fils.
Mais il apparaît comme une longue remontée du souvenir où le
père fait figure de Commandeur, donnant presque l’impression
d’une sorte d’exorcisation des fantômes du passé.
Quant à son œuvre à lui, Bei Dao, il n’en parle presque
pas, comme si ce qui importait, c’était justement, à travers la
quête de l’enfance et de l’adolescence passées, d’en tracer le
cadre, les conditions préalables et les premiers balbutiements :
les premiers poèmes au début des années 1970, le lancement de la
revue Jintian (今天)
en 1978… et la rébellion contre le père comme figure d’autorité
annonçant la révolte du poète contre l’ordre établi.
Note sur la traduction et l’édition
|
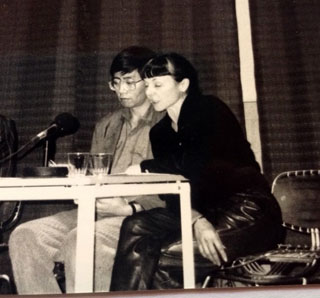
Bei Dao et Chantal Chen-Andro
à la BnF au début des années 1990. |
|
Il faut saluer la traduction qui rend remarquablement justice au
texte de Bei Dao.
Chantal Chen-Andro le
connaissant bien, on sent une connivence avec lui
et on est sûr
qu’il ne peut y avoir d’erreurs d’interprétation. Elle a en
outre ajouté un appareil de notes, une annexe née de ses
recherches sur l’histoire des portes de Pékin qui éclaire le
texte, et enfin une postface où elle l’on trouve ce que Bei Dao
tait sur la naissance de son œuvre, et où elle glisse une
traduction du fameux poème Huida (《回答》)
devenu un véritable manifeste de la jeunesse en rébellion, même
s’il s’en défend.
Il faut saluer aussi l’éditrice, Isabella
Checcaglini, à la
tête de la maison d’édition
|
Ypsilon qu’elle a créée en 2007. Les mémoires de Bei Dao, elle
les a découvertes en traduction anglaise, alors que Chantal en
avait commencé la traduction en français, à la demande de Bei
Dao lui-même, dès la publication du livre à Hong Kong, en 2010,
sans qu’aucun éditeur français ne s’y soit intéressé jusque-là.
Les problèmes dus au
confinement en ont encore retardé la sortie, mais le livre a
fini par venir à bout des ultimes péripéties en juin 2020. Les
photos pour la plupart inédites n'en sont pas le moindre atout.
S’ouvrent les portes de la ville, Pékin 1949-2001,
Traduction du chinois, notes et postface de Chantal Chen-Andro,
Ypsilon éditeur, coll. Contre-attaque,
juin 2020, 380 pages.
Littéralement le « lac de derrière », le plus grand et
le plus au nord des trois lacs du centre de Pékin, qui
forment ensemble les shichahai (什刹海)
dont il est question à plusieurs reprises par la suite :
lieu de loisirs privilégié pour les enfants à un moment
où il n’y avait peu de piscines à Pékin – au chapitre
« Nage » Bei Dao cite celle du Pavillon des loisirs ou
Taoranting ( 陶然亭),
grande piscine au sud-ouest de Pékin construite en 1956.
Quelques films sont cités. L’un vient en illustration de vient en
illustration de la propension à la violence des
garçons : « Le lanceur de couteaux volants » (《飞刀华》).
Il s’agit d’un film de 1963 en noir et blanc réalisé aux
studios de Shanghai par Xu Suling (徐苏灵),
avec des acteurs très célèbres, qui raconte l’histoire
d’un jeune orphelin adopté par le chef d’une troupe de
jongleurs et bateleurs, pendant la guerre. Le film, se
rappelle Bei Dao, faisait rêver les enfants et les
incitait à s’entraîner avec des couteaux rouillés sur
les couvercles en bois des poubelles comme cibles de
fortune.
Le film :
https://www.youtube.com/watch?v=mHqxBOH0yMo
Les autres sont cités indirectement à travers les
lianhuanhua qui en
ont été adaptés : « Le destin du tambour » « La petite
fleur écarlate », etc. Pour la plupart des films de la
première moitié des années 1960, avant la Révolution
culturelle.
« Un
jeune Don Quichotte du nord du Jiangsu » (《苏北少年“堂吉诃德”》).
Ils sont nés le même jour (compte tenu du
décalage horaire, précise Chantal) à trois ans
d’intervalle et ils ont souvent fêté leur anniversaire
ensemble depuis qu’ils se sont connus, au début des
années 1990, quand Chantal a commencé à traduire ses
poèmes.
|
|

