|
|
Bei Dao 北岛
Présentation
par Brigitte Duzan, 5 septembre 2009, actualisé
24 avril 2022
|
Bei Dao est né
en 1949. Son père était administrateur de société, sa
mère médecin. Il s’appelait en fait Zhao Zhenkai (赵振开),
sa famille était originaire du Zhejiang, mais il est né
et a été élevé à Pékin. Bei Dao, ‘l’île du nord’, est un
nom de plume, suggéré par un ami, qui suggère une
atmosphère de solitude et de désolation que l’on
retrouve dans sa poésie, et ses écrits en général. Il en
avait un autre, dans le même style, mais moins connu :
Pierre silencieuse (Shímò « 石默 »)
.
Le rebelle
Au début de la
Révolution culturelle, en 1966, il s’enrôle avec
enthousiasme dans les Gardes rouges, comme beaucoup
d’autres. En 1969, ses désillusions envers la révolution
et le régime lui valent une période de « rééducation » :
il va travailler pendant onze ans |
|

Bei Dao en 2015 (photo
ifeng) |
comme ouvrier dans le bâtiment, jusqu’en 1980 ! Il participe
brièvement à la rédaction du magazine Xin guancha《新观察》
(que l’on pourrait traduire par « Le nouvel observateur »). Il
commence alors à écrire des poèmes, en 1970.
a) Premiers poèmes
En avril 1976, il est
alors électricien sur un chantier en dehors de Pékin lorsque
surviennent les manifestations de la place Tian’anmen, ce qu’on
appelle en chinois « l’incident du 5 avril » (四五事件
sìwǔ
shìjiàn) :
des manifestations en hommage à Zhou Enlai, mort le 8 janvier
précédent, pour la fête de Qingming (la fête des
morts), doublées d’une protestation déguisée contre le régime,
et en particulier la Bande des Quatre.
Lors de ces
manifestations pacifiques, des milliers de citoyens ordinaires
vinrent déposer des gerbes de fleurs et des poèmes autour de la
stèle du grand homme disparu. Le plus célèbre de ceux qui nous
restent est celui de Bei Dao : « Réponse » (Huídá《回答》),
une lamentation sur l’état de la Chine et un cri de révolte, qui
marque les débuts d’un courant de poésie que l’on a appelé
« poésie obscure » (Ménglóng shī "朦胧诗").
Immédiatement après la
mort de Mao, en septembre de la même année, son successeur
désigné, Hua Guofeng, fait arrêter son épouse et ses acolytes,
la Bande des Quatre. Un climat de libéralisation souffle sur le
pays, les révisionnistes, droitistes et autres ‘criminels’
internés en camps de travail sont réhabilités et libérés, les
Chinois sont incités à s’exprimer, s’élève alors à Pékin le
« mur de la démocratie », près d’un arrêt de bus à Xidan.
|
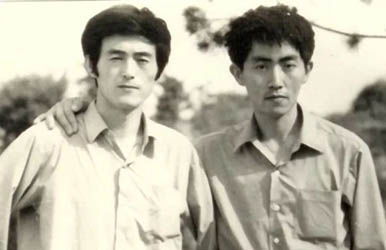
Bei Dao et Mang Ke à la fin des
années 1970 |
|
En 1978, il semblait
que la Chine allait entrer d’elle-même dans une ère de grands
changements politiques, il y avait dans l’air une atmosphère
d’interrègne. C’est alors que Bei Dao, avec son ami le poète
Mangke (芒克) fonde
le magazine Jintian《今天》),
qui va devenir le porte-parole des « poètes obscurs » jusqu’à ce
qu’il soit interdit par le gouvernement deux ans plus tard. Le
premier numéro contenait entre autres le poème Huídá《回答》,
avec les caractères 北岛
manuscrits à côté du titre.
|
Ce
premier numéro portait en outre en exergue un éditorial
éloquent : « L’histoire nous a enfin donné l’occasion de pouvoir
exprimer, sans encourir pour autant de terribles châtiments, les
chants que nous avons tenus cachés dans nos cœurs au cours des
dix dernières années, … Notre génération va devoir établir la
signification de chaque existence individuelle, et approfondir
la compréhension que nous avons de la notion de liberté. … »
b)
Premières nouvelles
|
En
même temps, il écrit une première œuvre de fiction commencée dès
1974,
terminée en 1979 et publiée en 1981 : « Vagues » (bōdòng 《波动》),
récit qui relate les destins croisés et tragiques de quelques
représentants de la « génération perdue » de la Révolution
culturelle.
C’est une œuvre que
l’on peut qualifier de révolutionnaire, dans le fond comme dans
la forme, et qui fait instantanément de Bei Dao la figure de
proue du renouveau de la création littéraire en Chine, marqué
par un certain désespoir frisant le nihilisme devant l’absurdité
de l’existence, ou du moins celle de ces jeunes auteurs. Ce
courant littéraire a été souvent appelé « la littérature des
ruines » (fèixū
wénxué 《废墟文学》).
On a comparé l’émergence de ce mouvement, après la Révolution
culturelle, à celle de l’existentialisme en Europe, et en France
en particulier, après la seconde guerre mondiale.
Parmi les autres
nouvelles de ces années 1980, on trouve
|
|
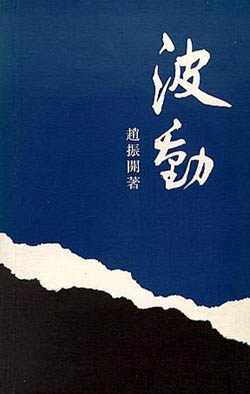
Vagues, éd. originale |
celles qui seront
publiées dans le recueil qui porte le titre de sa première nouvelle,
« Vagues » (《波动》),
dont, symboliquement, celle intitulée « Dans les ruines » (zài
fèixū
shàng 《在废墟上》)
et celle dont le texte est présenté sur ce site : « Un inconnu
est de retour » (guīláide mòshēngrén《归来的陌生人》).
c) 1989
Au début des années
1980, Bei Dao travaille à la Presse des Langues étrangères, et
fait des traductions pour vivre. Les années 1978-80 sont une
période de relative accalmie dans les relations entre le pouvoir
et les artistes. Il y a une communauté d’intérêts temporaire
entre les divers acteurs du monde littéraire et artistique, et
la faction du pouvoir autour de Deng Xiaoping, fondée sur la
conviction que le futur de la Chine dépendait de l’élimination
des pratiques restrictives dans toutes les sphères de
production, y compris intellectuelle. Cette atmosphère propice
entraîne une vague de publications dans le domaine littéraire.
|

Bei Dao à Chengdu pendant l’hiver
1986
(2ème à partir de la g.) [photo sina]
avec de g. à dr. Shu Ting 舒婷, Xie Ye
谢烨,
Gu Cheng 顾城, Li Gang 李钢 et Fu Tianlin
傅天琳 |
|
Mais le climat se
détériore peu à peu, pour aboutir à la campagne contre la
« pollution spirituelle » qui commence à l’automne 1983 et
s’achève sur un semi-échec à l’été 1984.
Bei Dao est l’une des premières cibles : ses poèmes, qui
paraissaient dans diverses revues littéraires depuis
l’interdiction de Jintian, sont sur liste noire pendant toute la
période.
Vers le milieu de la
décennie, il commence à voyager, mais l’atmosphère s’alourdit ;
il écrit : j’observe les pommes pourrir… Et, en 1986, il livre
une collection de poèmes dont l’un, très
|
long, s’intitule « Rêve en
plein jour » (báirì mèng 《白日梦》) :
c’est plutôt un cauchemar éveillé. Il participe aux mouvements
en faveur de la démocratie, soutient Wei Jinsheng (l’auteur du
pamphlet appelant à réaliser « la cinquième modernisation »,
c’est-à-dire la démocratie), fait circuler des tracts en faveur
de sa libération.
Quand la période
d’effervescence intellectuelle des années 1980 se termine
brutalement avec l’écrasement sanglant des manifestations de la
place Tian’anmen, le 4 juin 1989, Bei Dao n’est pas en Chine ;
il a été invité en Allemagne et donne des conférences à Berlin,
mais des extraits de ses poèmes sont récités avec ferveur par
les étudiants et leur servent de slogans pro-démocratiques, les
vers de Huida《回答》bien
sûr, mais aussi ceux d’un poème postérieur, « Proclamation » (xuāngào《宣告》),
qui sonnent comme une provocation :
决不跪在地上
Je refuse de
m’agenouiller par terre
以显出刽子手们的高大
cela ferait
paraître les bourreaux bien plus grands
好阻挡自由的风
et freinerait
le vent de la liberté
|
Le résultat ne se fait
pas attendre : Bei Dao est accusé d’avoir encouragé la révolte
estudiantine en propageant des idées malsaines ; il sait qu’il
sera arrêté s’il tente de revenir en Chine, il reste à
l’étranger. Sa femme, Shao
Fei (邵飞),
et sa petite fille, Tiantian (田田),
ne sont pas autorisées à le rejoindre. Elles n’obtiendront
l’autorisation qu’en 1995. Bei Dao, quant à lui, ne pourra
rentrer définitivement en Chine qu’en 2006. Il commence ainsi
une vie d’exilé, coupé de ses proches et de ses amis.
L’exilé
|
|
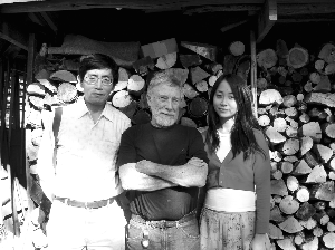
Bei Dao en 2007 avec sa fille Tian
Tian et le poète américain Gary Snyder pour le
lancement de
son recueil d’essais 《青灯》(photo
肖全/sina) |
Dans un article intitulé « Le
journal de mes déménagements », il a écrit qu’il avait déménagé
quinze fois et changé sept fois de pays entre 1989 et 1995. Le 4
juin 1989, donc, il était à Berlin, à Berlin-Ouest plus
précisément, c’était avant la chute du mur qui ne tomba que
lorsqu’il fut parti, pour Oslo, où il se retrouva avec son ami
Duo Duo. Puis, au Nouvel An 1990, il part pour Stockholm où il
reste jusqu’à l’été et relance le magazine Jintian, qui devient
un forum pour les écrivains chinois exilés. A l’automne, il part
pour deux ans pour Arrhus, la deuxième ville suédoise, où il
reçoit la visite de ses parents et de sa fille. En octobre
1992, il déménage à Leiden, aux Pays-Bas, au bout de quoi il
obtient enfin un visa américain et part aux Etats-Unis après un
séjour de trois mois en France, trois mois d’été heureux : il a
sa fille avec lui, il l’emmène jouer dans les squares ; il a
dit : c’était comme la course qui précède un saut en longueur.
Le 25 août 1993, il débarque en Amérique où sa femme et sa fille
le rejoignent à l’automne 1995, et ils s’installent alors en
Californie.
C’est une vie d’exilé, mais aussi
de nomade : quand on n’est pas chez soi, tous les endroits se
valent, les Etats-Unis faisant quand même figure de havre
suprême. Il se nomme lui-même, ironiquement, le hérisson en exil
(táowáng de
cìwèi 逃亡的刺猬).
Mais il commence à prendre une vue plus calme, plus distanciée
des choses, et ce qui semble le préoccuper le plus, pendant
toutes ces années, c’est son rapport à sa langue maternelle. Il
avait commencé par se faire le chantre d’un nouveau langage,
très proche en cela de Paul Celan avec lequel il se trouvait
lui-même beaucoup d’affinités, Celan qui avait œuvré à
« nettoyer » la langue allemande après les horreurs de la
seconde guerre mondiale, tout comme Bei Dao avait contribué à
dégager le chinois du carcan dogmatique du maoïsme, Celan dont
|
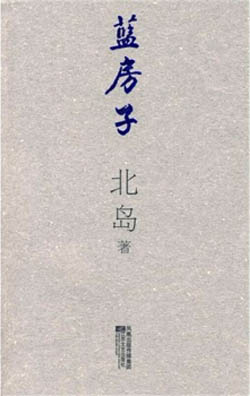
La maison bleue, déc.1998 |
|
Bei Dao a dit qu’il avait transformé son
expérience des camps en « langage de douleur », comme lui. Bei
Dao continuait désormais son travail sur la langue, au-delà du
politique, pour lui restaurer une valeur individuelle et
humaine.
Finalement, ce qu’on retiendra
peut-être en tout premier lieu, de ces années d’exil, ce sont
les essais regroupés dans plusieurs recueils, et en particulier
« La maison bleue » (lánfángzi 《蓝房子》).
La langue se fait ici claire et proche, aussi limpide que sa
poésie est hermétique. La politique n’y est qu’un écho
lointain ; après une introduction sur les grandes figures
littéraires qu’il admire, l’auteur s’y penche sur son passé, ses
souvenirs de son pays, et de là sur son sentiment de profonde
solitude. L’exil est aussi pour lui l’expérience du vide, une
expérience que tout le monde doit faire un jour, dit-il. La
« maison bleue » du titre, c’est celle de son ami, le poète
suédois Tomas Tranströmer : une maison chaude, accueillante,
mais qui ne n’était pas chez lui et ne le serait jamais.
|
|
Il aura peut-être fallu la dure
expérience de l’exil pour lui faire trouver l’humanisme qu’il
cherchait en fait jeune pour remplacer les décombres qui
restaient du marxisme. L’écriture, finalement, lui fournit un
lien avec les hommes ; comme il le dit à la fin de « la maison
bleue » : comment les anciens récitaient-ils la poésie ? en
levant une coupe dans le vent, en exprimant leurs joies ou leurs
peines à l’occasion d’une naissance, du départ d’un ami, de la
visite d’un autre, d’un décès…
Bei Dao vit aujourd’hui à Hong
Kong, où
|
|

Bei Dao avec la poétesse Lan Lan 蓝蓝
et le poète Yang Junlei 杨君磊
(aux Nuits internationales de la
poésie,
à Hong Kong en novembre 2013) |
il enseigne au Centre d’études
sur l’Asie de l’Est de l’université chinoise.
2018 : Exposition à Paris :
Moment
|
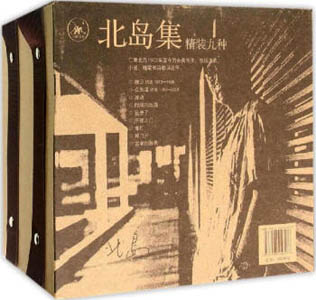
Anthologie de ses principales œuvres
en 9 volumes, avril 2016 |
|
Le 8 avril 2012, Bai Dao a été
victime d’un accident vasculaire cérébral, à Hong Kong. Il a été
hospitalisé et s’en est sorti relativement bien, mais avec de
graves problèmes de langage. Il a suivi une rééducation et a
fait de rapides progrès d’élocution, mais le verdict d’un
spécialiste a été formel : il ne récupérerait jamais que 30 % de
ses capacités de communication par la langue.
C’est alors que, sa famille lui
ayant apporté pinceau, encre et papier, il a commencé à
griffonner, puis, de retour chez lui, à peindre. Au début il a
dessiné des lignes, puis il a expérimenté avec des points
d’encre. Au total, de 2013 à 2017, il a réalisé une série de
peinture pointillistes rejoignant la peinture de shanshui
traditionnelle.
|
En 2016, il avait tellement bien récupéré ses
capacités linguistiques qu’il a recommencé à écrire de la
poésie, en réalisant que les éléments de ses poèmes étaient très
proches des points d’encre.
|
Pour cette exposition, la galerie
a publié un ouvrage qui comporte non seulement des reproductions
en double page des tableaux exposés, mais en outre deux textes
très intéressants :
- l’un de Xu Bing (徐冰),
artiste contemporain et cinéaste expérimental :
« Les "Points" de Bei Dao » (《北岛的"点"》) ;
- l’autre de
Li Tuo (李陀),
écrivain, critique littéraire, critique d’art et théoricien du
cinéma : « Faire que le "point" trouve vie sur le papier –
Impressions devant la peinture de
|
|
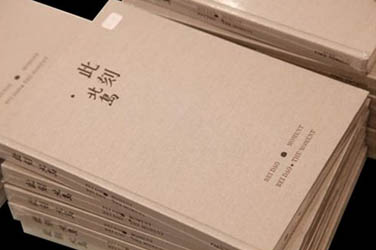
Livre-catalogue de l’exposition
Moment,
galerie Paris Horizon 2018 |
Bei Dao »
(《让点在纸面获得生命-看北岛绘画有感》).
Les deux textes ont
été traduits en français par
Chantal Chen-Andro et en
anglais par Lucas Klein.
2020 :
traduction de ses mémoires
|
En juin
2020 paraît aux éditions Ypsilon la traduction en
français, par Chantal Chen-Andro, des mémoires
d’enfance et d’adolescence du poète :
« S’ouvrent
les portes de la ville » (《城门开》).
Le
texte original est paru à Hong Kong en 2010
et réédité en juillet 2015.
C’est un
texte né du choc que fut son retour à Pékin en 2001,
pour la première fois depuis 1989. Il a eu
l’autorisation de revenir dans la capitale pour
rendre visite à son père malade. La ville lui a
paru, brillamment illuminée, sans
|
|
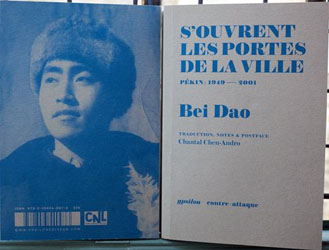
S’ouvrent les portes de la ville,
2020 |
plus guère
de rapports avec celle qu’il
avait quittée douze années plus tôt. D’où son désir de la
faire revivre telle qu’il en gardait le souvenir, en en rouvrant
les portes.
Traductions en
français
par
Chantal Chen-Andro
- Vagues, Philippe
Picquier, 1994
- 13 rue du Bonheur,
recueil de six nouvelles, Circé, 1999
- S’ouvrent les portes
de la ville (《城门开》),
traduction, notes et postface de
Chantal Chen-Andro, avec 26
photos originales, Ypsilon éditeur, 2020.
Poésie
- Au bord du ciel,
Circé, 1998
- Paysage au-dessus de
zéro, Circé, 2004
A lire en complément
La nouvelle
« Un inconnu de retour » 《归来的陌生人》
Bibliographie complémentaire
Compte rendu de Françoise Naour
sur « Vagues » (Études chinoises, vol. 1-2, printemps-automne
1996, pp. 230-232) :
https://www.persee.fr/doc/etchi_0755-5857_1996_num_15_1_1247_t1_0230_0000_3
Françoise Naour souligne
l’utilisation originale des monologues intérieurs alternés, mais
aussi de longs dialogues, de descriptions « naturalistes » et de
flashbacks récurrents, le tout couché avec une grande retenue
même dans la peinture des situations les plus violentes. Elle
voit dans le titre une double métaphore : celle des vagues du
temps et des vagues des sentiments.
|
|

