|
|
La littérature chinoise au
vingtième siècle
III bis. Haipai
/Jingpai ou le dualisme en littérature : Explications
par Brigitte Duzan, 21 juillet
2010
Le haipai (海派),
ou style/école
de Shanghai, et le jingpai (京派),
ou style/école
de Pékin, sont deux notions appariées comme le yin et le yang ;
nées à la fin de la dynastie des Qing, elles furent l’objet,
dans les années 1930, d’une controverse houleuse dans le monde
littéraire chinois, sur fond de rivalités personnelles teintées
de provincialisme, autant politiques que littéraires.
Cette polémique a
contribué à ancrer dans l’histoire deux concepts qui n’avaient
au départ qu’une signification dépréciative, surtout le premier.
Ils seraient cependant restés simples témoins d’une époque s’ils
n’avaient ensuite été repris, sans qu’ils aient pour autant
acquis une définition précise, pour qualifier l’œuvre
d’écrivains contemporains, comme
Zhang Ailing (张爱玲)
ou Wang Anyi (王安忆). C’est pour cette raison qu’il importe de savoir ce qu’ils recouvrent.
1. Haipai /Jingpai :
origines et controverse
|
Origines
C’est vers la
fin de la dynastie des Qing que l’opposition entre
esprit pékinois et esprit shanghaien se traduit par
l’émergence de ces deux notions opposées, en littérature
comme auparavant au théâtre et en peinture, le
modernisme souvent jugé outrancier du second entraînant
en retour sa dénonciation par le premier (1).
Ce dualisme est
une caractéristique immémoriale de la culture chinoise
dans son ensemble, qui se décline en de nombreuses
variantes ayant pour origine le clivage entre ce qui est
considéré comme le berceau de la civilisation chinoise,
le bassin du fleuve Jaune, culture du Nord, rationaliste
et confucéenne, et le versant méridional de cette
civilisation, centré sur la culture de Chu, culture
irrédentiste, magique et taoïste. |
|

Pékin dans les années 1930 : ville encore
en phase avec le monde rural |
Ce dualisme Nord-Sud se
double d’un autre, entre la côte et
l’intérieur,
qui tend déjà à devenir une fracture au début du vingtième
siècle et qui a pris une telle importance aujourd’hui qu’on
aurait tendance à oublier le premier ; celui-ci renaît cependant
avec l’intérêt croissant accordé aux cultures régionales.
|

Shanghai, ville commerçante : le Bund en
1891 |
|
Au début du
vingtième siècle, ce double dualisme sous-tend
l’opposition emblématique des deux métropoles de Pékin
et de Shanghai, qui deviennent les symboles de deux
modes antagonistes de vie et de pensée : la vieille
capitale du Nord, ancrée dans la tradition et perpétuant
l’idéal de vie de la Chine ancienne, essentiellement
rurale ; et la flambante métropole commerciale du Sud,
parangon de la modernité sous toutes ses formes, y
compris les plus vulgaires, presque par définition, la
vulgarité, en Chine,
étant |
traditionnellement, dans la culture confucéenne, le propre du
commerçant, ravalé aux strates inférieures de la société.
Pékin est alors une
ville en phase avec un monde rural qui se retrouve jusque dans
ses murs, dans ses hutongs et ses cours carrées, un lieu de
stabilité, un monde de permanence. Shanghai, en revanche, est
une ville de rupture, avec le passé tout autant qu’avec la
nature
environnante, un lieu en perpétuel mouvement, un monde
cosmopolite avide de nouveautés.
Ce sont surtout les
flux migratoires, entraînant l’émergence de nouvelles classes
sociales, donc d’un public urbain nouveau, qui font de Shanghai,
en ce début de siècle comme aujourd’hui, un centre de modernisme
et d’innovation, dans tous les domaines artistiques, et en
littérature en particulier. En même temps, ce public est surtout
à l’affût de détente et de spectaculaire, tandis que les
artistes sont étroitement dépendants, pour leur survie comme
pour leur création, de marchands enrichis qui gèrent les salles
de spectacle et financent la presse : il était facile pour leurs
critiques du Nord de les taxer de mercantilisme et de voir dans
le haipai une culture de pacotille encline à tous les
excès et toutes les provocations.
Politisation et
trivialisation
|

Quatre membres de la société Création
(创造社) en
1926 (de g à d) :
Wang Duqing 王独清,
Guo Moruo 郭沫若,
Yu Dafu 郁达夫 et
Cheng Fangwu 成仿吾 |
|
Cependant, le
monde littéraire des années 1920 apporte une autre
dimension, politique, à cet antagonisme primaire,
quasiment viscéral. C’est une époque d’effervescence et
de polarisation du monde littéraire, à la suite du
mouvement du 4 mai (2), polarisation esthétique et
politique qui a aussi un aspect de clivage
géographique : « L’Association de Recherche littéraire »
(文学研究会)
est
fondée début janvier 1921 à Pékin par les figures de
proue de la nouvelle littérature, dont le frère de
Lu
Xun, Zhou Zuoren
(周作人),
tandis qu’un groupe de jeunes partis étudier au Japon et
sans liens avec les gauchistes du continent, dont Guo
Moruo (郭沫若)
et
Yu Dafu
(郁达夫),
créent à la même date une autre société littéraire, la
société « Création » (创造社),
qui est transférée à Shanghai un peu plus tard la même
année.
Or, si
l’association pékinoise était un mouvement à tendance
gauchiste né de celui du 4 mai et prônant une
littérature réaliste et engagée, la société « Création »
|
exaltait au contraire
une esthétique romantique de l’art pour l’art. Les événements
historiques, cependant, devaient amener une partie des auteurs
dans sa mouvance à prendre parti politiquement. Ainsi, en mai
1926, Guo Moruo publiait-il, dans le journal de
la société « Création », un
article dans lequel il préconisait une littérature
révolutionnaire nouvelle parlant au nom des classes opprimées et
visant à favoriser une révolution sociale de type marxiste.
|
Le Guomingdang
intensifia alors sa lutte contre les communistes qui
culmina avec le massacre de Shanghai du 12 avril 1927,
suivi d’une « terreur blanche » et du repli des
gauchistes dans les campagnes. Dans ce contexte, les
écrivains furent incités à l’union, surtout lorsque le
Guomingdang s’attaqua aux sociétés littéraires, dont la
société « Création », dissoute en février 1929. Sous
l’égide de
Lu Xun (魯迅)
fut
alors créée la « Ligue chinoise des écrivains de
gauche » (中国左翼作家联盟) et
c’est à Shanghai qu’elle fut lancée, le 2 mars 1930,
Il semblait dès
lors ne plus y avoir d’autre alternative valable dans le
monde littéraire. Les rares à défendre une littérature
non engagée étaient, à Pékin, le frère de
Lu Xun,
Zhou Zuoren (周作人),
et Lin Yutang (林语堂),
|
|

Lu Xun (魯迅)
|
dans leurs journaux respectifs, ‘Camel Grass’
(《骆驼草》)
et ‘Les entretiens’ (《论语》) ;
les grands écrivains de la mouvance du 4 mai,
Ba Jin
(巴金),
Lao She
(老舍), Wen Yiduo (闻一多)
ou
Shen Congwen
(沈从文)
restant, quant à eux, dans une réserve distante leur permettant
de continuer leurs expérimentations personnelles sur de
nouvelles formes littéraires, en marge du didactisme ambiant.
|

« Biographie des Fleurs
de Shanghai »
(《海上花列传》) |
|
Dans ces
conditions, la littérature urbaine du haipai ne
pouvait qu’être, plus que jamais, décriée comme une
littérature de divertissement, cultivant l’aspiration
aux plaisirs et à une vie débridée typiquement associée
à la société shanghaïenne. Le modèle emblématique en est
le roman écrit à la fin du 19ème siècle par
Han Bangqing (韩邦庆
) : « Biographie des Fleurs de
Shanghai » (《海上花列传》);
le livre décrit, sur un ton réaliste et sobre, les lieux
de plaisir fréquentés par les hommes d’affaires
shanghaiens qui y trouvent le lieu idéal pour
rechercher, voire conclure des affaires. Sans doute trop
sobre, justement, ce ne fut pas un succès de librairie.
Dans les années
1920 se multiplient ensuite les romans licencieux sur
des thèmes proches, succédant aux romans
d’amour
sentimentaux extrêmement populaires du genre « canards
mandarins et papillons »
(《鸳鸯蝴蝶派》) qui
avaient
fleuri après la révolution de 1911. Ces nouveaux
|
romans, qui
s’adressent à un public de masse, racontent, pour la plupart,
des histoires sur les dessous de la vie des prostituées et
poussent le genre vers la trivialité. Eux ont du succès, et
c’est à ces romans qu’est alors assimilée la littérature du
haipai, quand éclate la fameuse querelle qui popularise d’un
coup les deux concepts de haipai et jingpai, en
les opposant, mais sans les définir précisément.
La querelle haipai-jingpai
|
Elle éclate en
1933 et, après une escarmouche en trois temps, retombe
aussi vite qu’elle a commencé.
1) C’est
Shen Congwen (沈从文)
qui ouvre le
feu, avec un article publié en octobre 1933 dans le
supplément « Arts et Lettres » du ‘Dagongbao’, également
connu sous le nom de « L’impartial », dont il était l’un
des directeurs (3). Intitulé « L’attitude des hommes de
lettres » (《文学者的态度》),
l’article se voulait une défense de la littérature
« sérieuse », mais en profitait
|
|
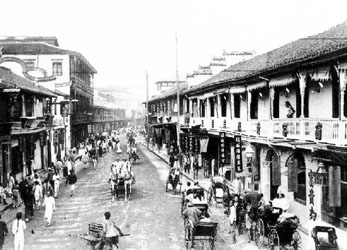
Fuzhou Lu et le quartier des
divertissements
dans les années 1890 (époque du livre) |
pour attaquer les « amateurs » (票友)
et les « dilettantes » (白相人)
qui, selon lui,
se sont multipliés dans la littérature « ces dernières années »
(近些年来)
et, motivés par la vanité et
l’appât du
gain, ne cherchent qu’à flatter bassement les goûts des lecteurs
(4).
Le mot de haipai
n’apparaît pas, mais le nom de Shanghai est cité, et le terme
de "白相人"
est une expression typique du lexique shanghaïen, avec une
connotation méprisante de "不学无术" : ignorant et incompétent. Autant dire que l’attaque était claire, et
elle concerne non point des valeurs esthétiques, mais
« l’hygiène morale et culturelle », pour reprendre les termes
d’un article ultérieur de Shen Congwen.
2) La riposte ne se
fait pas attendre. Comme souvent dans ces cas-là, ce ne sont pas
ceux qui étaient ouvertement visés qui prennent la plume, mais
deux écrivains qui en profitent pour régler des comptes
antérieurs, concernant leurs conceptions esthétiques, mais
aussi, implicitement, leurs divergences en matière d’engagement
politique.
|

Shen Congwen (沈从文)
|
|
Le premier à
répondre est Du Heng (杜衡),
deux mois plus tard, dans un article publié sous son
pseudonyme de Su Wen (苏汶),
dans la revue des « modernistes » de Shanghai :
‘Xiandai’ (《现代》)
(5).
Intitulé
« Les hommes de lettres à Shanghai » (《文人在上海》),
il est
purement polémique. Il reproche à
Shen Congwen de
reprendre le vieux travers des intellectuels chinois qui
consiste à « se mépriser entre eux » (文人相轻)
(6) ; pire, continue-t-il, son attitude illustre le
dédain bien connu des lettrés du Nord envers leurs
collègues du Sud. |
Examinant ensuite le
fond des critiques de
Shen Congwen
concernant le mercantilisme et l’amour du gain qui seraient
propres aux écrivains visés par son article, il rétorque
qu’ils dépendent de la vente de leurs livres pour vivre, n’ayant
pas, eux, de sinécure universitaire pour assurer leurs fins de
mois (allusion acerbe à Shen Congwen lui-même qui, en 1927,
malgré son manque de formation académique, avait obtenu un poste
de professeur grâce à la médiation de Hu Shi
胡适).
Il termine en disant
qu’on ne peut pas éliminer d’un coup de plume tous les écrivains
qui vivent à Shanghai en leur collant l’étiquette infamante
d’ « hommes de lettres du haipai » (海派文人) :
le mot est lancé, et on se doute qu’il vient de plus loin. En
fait,
Shen Congwen avait dès
l’été 1929, alors qu’il séjournait à Shanghai, dénoncé une
nouvelle littérature haipai dont il dira par la suite
qu’elle entraînait une dégénérescence de l’esprit créatif. La
querelle, à ce niveau, est donc bien esthétique et morale.
Shen Congwen
enfonce ensuite
le clou, en janvier puis en février 1934, dans deux articles
« sur le haipai ». Le premier, en particulier, en réponse
explicite à Du Heng, est vindicatif à l’extrême, fustigeant les
pires excès d’une littérature qui, selon lui, non contente
d’être bassement commerciale, est en outre, telle un timonier
navigant selon le vent
(“见风转舵”),
prône à changer d’attache politique en fonction de celui qui lui
versera le plus de subsides. Et de terminer chacune de ses
semonces par un coup de plume vengeur : « cela aussi, c’est ce
que l’on appelle le haipai. » (这就是所谓海派)
(7).
Mais il ajoute que le
haipai n’est plus propre à Shanghai : que l’on peut habiter
la métropole et ne pas en faire partie (il cite Du Heng en
exemple), et que l’on peut au contraire habiter le Nord et
s’être laissé contaminer. C’est pourquoi il est de la
responsabilité de tous, écrivains et éditeurs, de « balayer
cette influence néfaste exercée par le haipai » (扫荡这种海派的坏影响).
3) La polémique faisant
rage,
Lu Xun se décide à
intervenir : les 3 et 4 février, il signe d’un nouveau
pseudonyme créé pour l’occasion, Luan Tingshi (栾廷石), deux
articles intitulés « Jingpai et Haipai » (《京派与海派》)
et « Gens du
Nord et gens du Sud » (《北人与南人》)
( (8). Il tente
de mettre tout le monde d’accord en soulignant les faiblesses de
l’argumentation de Du Heng tout en reconnaissant qu’il n’avait
pas totalement tort, mais surtout en renvoyant dos à dos les
deux parties auxquelles il attribue des torts partagés, en
quatre vingt six caractères restés dans les annales :
“北京是明清的帝都,上海乃各国之租界,帝都多官,租界多商,所以文人之在京者近官,没海者近商,近官者在使官得名,近商者在使商获利,而自己也赖以糊口。要而言之,不过‘京派’是官的帮闲,‘海派’则是商的帮忙而已。”
Pékin a été la capitale des Ming et des Qing, Shanghai abrite, elle, les
concessions de divers pays ; dans la capitale nombreux sont les
fonctionnaires, dans les concessions nombreux sont les
commerçants ; c’est ainsi que, à Pékin, les hommes de lettres
sont proches des fonctionnaires, et à Shanghai, ils sont proches
des commerçants ; ceux qui sont proches des fonctionnaires
contribuent à leur renom, ceux qui sont proches des commerçants
contribuent à leurs bénéfices, mais tout en dépendant des uns et
des autres pour leur pitance. En résumé, les gens du jingpai
sont à la solde des fonctionnaires, ceux du haipai à la
solde des commerçants. »
Mais, termine-t-il,
comme les fonctionnaires, en Chine, ont toujours méprisé les
commerçants, cela contribue à accroître le mépris du jingpai
pour le haipai.
Il reviendra une
dernière fois sur la question en mai 1935, pour préciser que,
pour lui, il n’y a pas vraiment de différence entre les deux,
car leur rejet commun de l’engagement politique les rend
équivalents à ses yeux. Comme on dit chez Molière, voilà
pourquoi votre fille est malade…
La polémique était
close, mais il faut souligner que Lu Xun, le premier, utilisait
dans son article du 3 février le terme de jingpai, en
opposition au haipai dont il avait été question
jusqu’ici. Et s’il les confond, finalement, dans un même rejet
pour des raisons politiques, les deux concepts, comme marqueurs
d’une mentalité autant que d’une spécificité socio-culturelle,
n’en ont pas moins continué régulièrement à renaître de leurs
cendres, jusqu’à aujourd’hui, en particulier le haipai.
2. Le Haipai
3. Le Jingpai
Notes
(1) Nous limitons ici
notre sujet au domaine de la fiction, à l’exclusion de la poésie
et du théâtre.
(2) Voir
:
Repères historiques II.
(3) Le Dagongbao (《大公报》), créé à Tianjin
en 1902, avait été repris en 1925 après avoir été pendant une
décennie un journal pro-japonais. Il devint alors un magazine
libéral, avec une position éditoriale non partisane, se voulant
libre de toute affiliation politique, ce qui était la ligne de
Shen Congwen. Dans les années trente, il était devenu l’un des
quotidiens les plus réputés et les plus influents en Chine. Il
fut transféré à Hong Kong au début de la Révolution culturelle,
où il continue à paraître, sous le nom de Takungpao.
(4) Voir le texte
chinois :
www.ccview.net/htm/xiandai/wen/shencongwen069.htm
Comme Mencius, il part
de l’exemple d’un vieux cuisinier modeste et consciencieux,
passé maître dans son art, le vieux Jing (老景).
(5) Le critique
littéraire Du Heng s’était rendu célèbre comme farouche avocat
de la liberté d’expression et d’une littérature libre de tout
engagement politique, en prônant la position du « troisième
homme » (第三种人),
ne penchant ni à droite ni à gauche. De ce côté-là, il était
donc du même avis que Shen Congwen.
(6) L’expression vient
de la première partie du fameux essai sur la littérature (《典论•论文》)
du poète Cao Pi
(曹丕), fils aîné
de Cao Cao (曹操)
auquel il
succéda sur le trône de Wei en
220. C’est assez
dire la permanence du trait incriminé.
(7) Les deux articles
furent publiés dans le même supplément « Arts et lettres » du
‘Dagongbao’, les 10 janvier et 21 février 1934. Le premier est
intitulé «A propos du "haipai" »《论“海派”》 :
Texte chinois :
www.ccview.net/htm/xiandai/wen/shencongwen071.htm
Le deuxième, qui fait
référence au premier, est intitulé « Au sujet du haipai »
(《关于海派》).
Texte chinois :
www.ccview.net/htm/xiandai/wen/shencongwen072.htm
(8) Le premier est très
court, mais resté célèbre pour la concision et la beauté de
l’expression :
Texte chinois :
www.xys.org/xys/classics/Lu-Xun/essays/huabian_wenxue/Beijing_and_Shanghai.txt
|
|

