|
|
Brève histoire du «
roman anti-corruption » (1995-2002)
par
Brigitte Duzan, 22 août 2015
« Corruption is the evil twin of reform »
Jeffrey Kinkley
C’est à partir du milieu des années 1990 qu’est apparu en Chine
ce qu’on a appelé “le roman anti-corruption” (反腐小说),
nouvel avatar du roman politique né du développement d’un
phénomène qui avait déjà en partie provoqué le mouvement pro-démocratie
de 1989 comme l’explique Jeffrey Kinkley dans l’introduction à
son ouvrage sur le sujet
:
« Le mouvement démocratique avorté de 1989 était en partie causé
par la perception de la corruption dans la population, et
c’était avant que les réformes lancées par Deng Xiaoping en 1992
lui permettent de se développer, en prenant une autre envergure.
En entraînant d’énormes disparités de revenus, la croissance et
la prospérité ont accru le sentiment d’une corruption
généralisée, endémique et omniprésente, et liée à l’effondrement
des valeurs morales. […] C’est en fait l’excès de pouvoir, et de
pouvoir centralisé, qui est perçu comme facteur de corruption ;
c’est l’une des raisons majeures des appels à la démocratie.
S’ils restent limités et étouffés, ils n’en sont pas moins l’un
des éléments qui menacent la stabilité du pouvoir communiste. »
C’est ce phénomène tentaculaire, et le malaise général qui en
résulte, qui ont suscité une véritable vague de romans dits
« anti-corruption », souvent adaptés au cinéma, et encore plus à
la télévision, s’attachant à le décrire et le dénoncer. Bien que
prenant souvent la forme de romans policiers, ces œuvres sont
inspirées de faits réels et ce sont toujours plus ou moins des
romans à clef, cherchant à déterminer la source des problèmes.
En même temps, ils adoptent des modes narratifs qui renouent
avec des formes littéraires antérieures critiquant le pouvoir
des nantis et les modes de vie décadents des riches.
Antécédents et précurseurs
Antécédents littéraires
Pour trouver dans la littérature classique le précédent qui
représente le modèle le plus proche
,
il suffit de remonter aux romans de la fin des Qing exposant les
abus et malversations des fonctionnaires corrompus de la cour :
les
guānchǎng xiǎoshuō
(官场小说).
|
Le plus célèbre,
et l’un des premiers, de ces romans satiriques est la
« Chronique indiscrète des mandarins » ou Rulin
waishi (《儒林外史》)
de Wu Jingzi (吴敬梓),
achevé vers 1750, mais publié au début du 19ème
siècle : ensemble assez décousu, mais très vivant,
offrant un tableau incisif de la société de l’époque,
avec des attaques contre le système des examens
apparaissant comme la principale cause de la décadence
morale des lettrés, d’abord, mais aussi de l’ensemble de
la société.
La satire de Wu Jingzi reste un exercice littéraire,
comme les romans qui s’en sont inspirés. Par la suite,
l’échec du mouvement réformiste de 1898, puis la révolte
des Boxers et les troubles croissants |
|
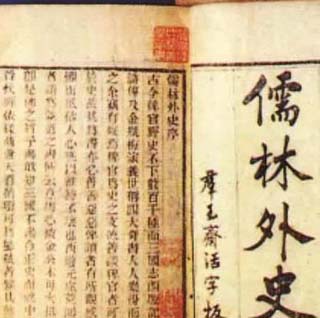
Chronique indiscrète des mandarins,
Rulin waishi |
à partir de 1900 entraînent une perte de confiance dans la
capacité des gouvernants à diriger l’empire, et l’apparition
parallèle d’écrits cette fois violemment critiques. C’est ce que
Lu Xun (魯迅)
a appelé « romans de dénonciation [de la société] » (谴责小说)
.
Le précédent des Cent Fleurs
C’est à ce genre de romans « de dénonciation » que peuvent être
rattachés les écrits d’un écrivain comme Liu Binyan (刘宾雁),
d’abord au moment de la Campagne de Cent Fleurs, puis à partir
de 1978.
En 1956, « Sur le chantier du pont » (《在桥梁工地上》)
dénonce non tant la corruption des bureaucrates dans la Chine de
Mao que leur désir fondamental de rester en place, donc de ne
prendre aucun initiative risquée pouvant nuire à leur
promotion : c’est le premier roman critique du pouvoir
communiste après les injonctions de Mao Zedong au Forum de
Yan’an, en 1942, invitant les écrivains à être positifs et ne
pas souligner les aspects sombres de la vie et de la société.
|

Le nouveau venu au service
de l’organisation, 1956 |
|
Liu Binyan enfonce le clou avec l’autre roman qu’il
publie la même année, « Nouvelles confidentielles de
notre journal » (《本报内部消息》),
où il dépeint une jeune journaliste enthousiaste qui se
heurte au conservatisme du bureaucrate à la tête de
l’agence de presse où elle est affectée : là aussi, le
désir le plus cher de ce bureaucrate modèle est
d’appliquer les directives du Parti, considérant que son
plus grand mérite est la dévotion qu’il lui porte ; le
journal qu’il dirige devient tellement ennuyeux que ses
ventes chutent de moitié.
Ce roman vaudra à Liu Binyan d’être déclaré droitier et
exclu de ce même Parti. La controverse déchaînée par son
second roman, bien plus vive que pour le premier, inclut
d’ailleurs des attaques contre la nouvelle de
Wang Meng (王蒙)
publiée au même moment : « Le nouveau venu au service de
l’organisation » (《组织部来了个年轻人》).
Wang Meng sera envoyé se réformer au Xinjiang. |
Les précurseurs : fin des années 1970 / années 1980
|
Après la Révolution culturelle, après avoir été
réhabilité, Liu Binyan reprend ses écrits critiques en
se tournant vers la « littérature de reportage » Il fait
scandale car il ne dénonce plus simplement les excès du
système bureaucratique, mais carrément la corruption des
fonctionnaires, en se fondant sur des études de terrain.
Ainsi, en 1979, « Entre hommes et démons » (《人妖之间》)
est le résultat d’une enquête sur un réseau de
corruption locale dans la province du Heilongjiang ;
c’est une dénonciation des abus de pouvoir des cadres
locaux, en défense du petit peuple qui en a été victime.
De cette même année 1979 date aussi le célèbre récit de
Jiang Zilong (蒋子龙)
« Directeur Qiao prend son poste » (《乔厂长上任记》),
qui rappelle le récit de Wang Meng de 1956. Quelques
romans paraissent encore dans les années 1980, comme le
roman de Ke Yunlu (柯云路) « Nouvelle
étoile » (《新星》),
originellement publié dans la revue Dangdai (《当代》)
en mars 1984, bâti sur |
|
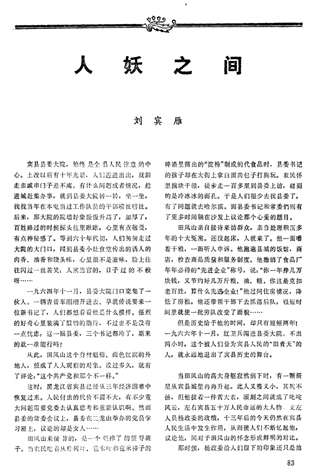
Entre hommes et démons, Liu Binyan 1979
|
|
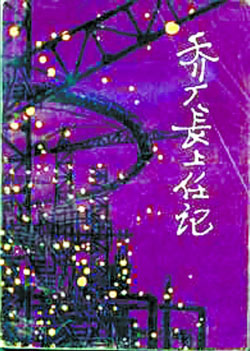
Le Directeur Qiao prend son poste, 1979 |
|
une trame narrative qui sera reprise de nombreuses fois
par la suite : un homme revient dans son village pour se
rendre compte que tout a changé en son absence, et que
son village est lui aussi atteint par l’affairisme et le
déclin général de la morale publique qui lui est lié.
Dans sa
préface à sa traduction d’un recueil de textes de Liu
Binyan parue chez Gallimard en 1989, Jean-Philippe Béja
commente :
« Sa position correspond en somme à
celle du censeur de la Chine ancienne, cet envoyé
spécial de l'Empereur qui
fait connaître au souverain les abus de pouvoir des
fonctionnaires dépravés ». La
différence essentielle est que Liu Binyan – comme les
autres - n’est pas un envoyé spécial du pouvoir, mais le
dénonce de l’extérieur, position intenable dans le
contexte de crispation croissante des années 1980, qui
lui vaudra d’être expulsé de Chine, et contraint à
l’exil aux Etats-Unis en 1988. |
|
1989 marque une coupure : les critiques sont réduits au
silence. Les romans critiques reprennent au début des
années 1990, mais sous une autre forme, et surtout avec
l’aval du pouvoir qui s’en sert pour promouvoir son
image. C’est là que réside la différence fondamentale et
le sens véritable des « romans anti-corruption » qui
fleurissent dans les années 1995-2002.
Après 1989
Quand les romans satiriques reprennent au début des
années 1990, ils reviennent d’abord au style de la fin
des Qing. C’est le genre du
guānchǎng
xiǎoshuō
qui est la référence indirecte des nouvelles et romans
critiques publiés au début de la décennie,
qui participent en même temps du « nouveau réalisme » en
littérature (“新写实”)
qui se développe alors : réalisme désabusé plus que
dénonciateur. |
|
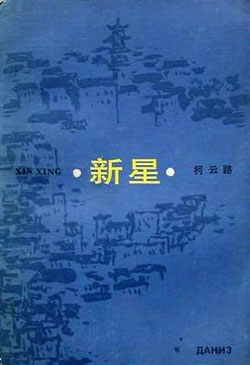
New Star, Ke Yunlu 1984 |
|

Parmi les dignitaires, Liu Zhenyun 1992 |
|
C’est du guānchǎng xiǎoshuō que se
réclame par exemple un écrivain comme
Liu Zhenyun (刘震云),
avec des nouvelles qui ne traitent pas directement de
corruption ou de fraude, mais, sur le mode humoristique,
des modes de vie et de travail des fonctionnaires en
tant que groupe privilégié. Le choix des titres de deux
de ses nouvelles publiées en 1990-92 est significatif :
guānrén
(《官人》)
ou « Les mandarins » et guānchǎng (《官场》)
ou « Parmi les dignitaires »
renvoient directement à la référence du genre romanesque
correspondant des Qing.
Côté romans, « Le pays de l’alcool » (《酒国》)
de
Mo Yan (莫言),
initialement publié à Taiwan en 1992, est aussi un roman
précurseur sur le même thème, ou une variation du même
thème : dénonciation du népotisme de la bureaucratie
|
sous la forme métaphorique de pratiques cannibales renvoyant
directement, cette fois, à
Lu Xun
(魯迅)
et à sa critique du pouvoir chinois, à tous les niveaux.
Par ailleurs, la littérature de reportage se transforme en
littérature sur la vie des entreprises, au moment où,
parallèlement, la corruption se développe sous l’effet de la
croissance économique incontrôlée, après la relance des réformes
en 1992. Ce sont les conditions qui favorisent alors la
naissance du roman « anti-corruption », sous l’œil bienveillant
du Parti qui s’en sert à ses propres fins en en assurant la
promotion.
Origine et développement
Les faits : boom économique et corruption généralisée
Après son « voyage dans le sud », en 1992, Deng Xiaoping relance
le processus de réforme et d’ouverture qui avait été enrayé par
le repli conservateur entraîné par les événements de 1989. C’est
un processus de restructuration industrielle et de privatisation
dans tous les domaines qui doit mettre fin à l’emprise de l’Etat
sur l’appareil économique, en permettant à l’initiative privée
de se développer.
C’est une période où se forment des empires industriels, sur les
ruines des entreprises d’Etat, dans des circonstances plus ou
moins claires. Beaucoup des grandes fortunes chinoises
d’aujourd’hui se sont constituées à l’époque, en reprenant des
actifs dévalués, dans un climat d’affairisme incontrôlé.
La croissance se fait aussi au prix de vagues de dégraissages
brutaux qui mettent à pied une bonne partie des effectifs
industriels, les ouvriers perdant, avec leur emploi, les
avantages sociaux qui y étaient liés et se retrouvant dans des
situations souvent sans issue. Les années 1990 sont souvent
décrites comme la période du boom économique chinois ; on en
oublie la misère humaine qui l’a accompagné.
Or, cette misère est d’autant plus choquante qu’elle se
développe dans un contexte où certains s’enrichissent de façon
éhontée en abusant du pouvoir que leur confère leur position.
C’est à cela que s’attaquent les romans « anti-corruption », au
sens large : leurs auteurs s’attachent aux zones grises de la
croissance, aux pots de vin, à la concussion, aux fraudes et
pillages d’entreprises… autant de trafics liés à désintégration
de la société, de ses valeurs, de la moralité publique. On parle
de "corruption spirituelle".
Corruption devient un terme codé pour désigner toutes les formes
d’injustices sociales perçues comme étant causées par une
accumulation indue de pouvoir, entre les mains d’individus ou de
groupes,
|
permettant de s’approprier des biens et de vastes sommes
d’argent. Mais il y a en arrière-plan la notion maoïste
que la corruption est liée au gaspillage et à une
gestion frauduleuse, ainsi que la vieille idée que la
corruption mène à la chute du régime (par perte du
Mandat du Ciel), le déclin moral de la société menant à
la contestation et à la résistance populaire, et tôt ou
tard à l’effondrement du système.
Le roman anti-corruption est né de la conjonction d’un
désir spontané de dénoncer les injustices et abus sous
toutes leurs formes, dans un souci de réalisme, et de la
nécessité pour le pouvoir de désamorcer la contestation
née du malaise en résultant. Les romans dénoncent en
bloc la corruption sous toutes ses formes et tout ce qui
lui est lié : l’incompétence, l’inflation,
l’inadéquation des infrastructures, le déclin de la
conduite civique, les expropriations, la manipulation
des marchés, autant d’éléments menant à l’instabilité
sociale et politique, y compris à un débat toujours
larvé sur la démocratie. Ils sont en fait un vecteur
médiatique pour prôner un retour aux valeurs morales,
seules garantes de stabilité.
1995 : année charnière
Avec ses romans publiés à partir de 1991, comme « Le
réseau céleste » (《天网》)
ou « Le meurtrier » (《凶犯》),
Zhang Ping (张平)
fait figure de précurseur de la nouvelle vague de romans
critiques de la société et du régime qui va prendre une
ampleur sans précédent dans le reste de la décennie.
Mais ils ne prennent véritablement le nom de romans
anti-corruption qu’à partir de 1995 qui fait figure à
cet égard d’année charnière. D’abord il y a diminution
des salaires réels et pic de chômage. Mais surtout c’est
l’année du suicide du maire-adjoint de Pékin, Wang
Baosen (王宝森),
le 4 avril, suicide qui entraîne le premier acte du
scandale de corruption du maire de la capitale, Chen
Xitong (陈希同),
alors démis de ses fonctions, puis condamné en 1998 à
une peine de prison de seize ans.
Le roman de Fang Wen (方文)
« The Wrath of Heaven » ou « La colère du Ciel – le
Bureau anti-corruption en action » (《天怒-反贪局在行动》),
publié en 1996, est un récit romancé de cette affaire,
écrit du point de vue d’un enquêteur, mais rapidement
interdit.
C’est à partir de là que les romans anti-corruption se
multiplient, publiés par les maisons d’édition
officielles et adaptés à la télévision. Ce sont des
affaires autant politiques que commerciales, rondement
menées, en capitalisant sur l’intérêt suscité par
l’affaire Wang Baosen.
En 1996, le roman de
Lu Tianming (陆天明)
« Heaven Above » (《苍天在上》)
est adapté en feuilleton télévisé qui a un énorme
succès. Le roman et son scénario annoncent le genre de
récit qui va devenir courant dans les romans
anti-corruption – un bureaucrate aux prises avec la
corruption en revenant dans son village –comme dans le
roman de 1984 de Ke Yunlu (柯云路)
« Nouvelle étoile » (《新星》).
Le thème n’est pas nouveau, il est actualisé.
C’est ensuite le long roman de
Zhou Meisen (周梅森),
publié aussi en 1996, qui fournit l’étape suivante du
développement du genre. « Le droit chemin en ce monde »
(《人间正道》)
traite des dysfonctionnements dans le gouvernement
municipal et la gestion des entreprises d’Etat, suivi
l’année suivante de « Richesse ici-bas » (《天下财富》).
Ils sont adaptés à la télévision, comme les trois romans
suivants du même auteur. |
|

Le meurtrier, Zhang Ping 1992
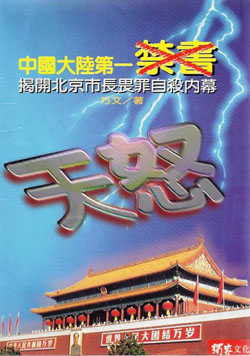
La colère du Ciel, Fan Wen 1996

Heaven Above, Lu Tianming 1996

Le droit chemin en ce monde,
Zhou Meisen 1996 |
|
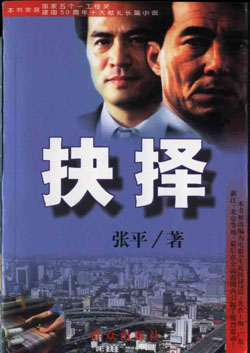
Decision, Zhang Ping 1997
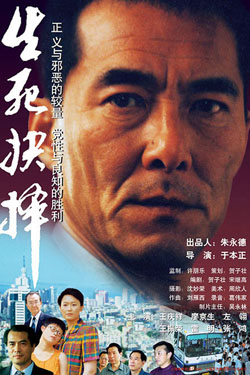
Final Decision, le film |
|
En 1997, Zhang Ping revient sur le devant de la scène
avec l’un des grands classiques du genre : « Décision »
(《抉择》),
adapté au cinéma en 2000 ; produit par le studio de
Shanghai, le film est réalisé par Yu Benzheng (于本正)
et sort en juillet sous le titre « Final Decision » (《生死抉择》).
Malgré sa longueur (162’) et son caractère de pamphlet
pro-gouvernemental, le film a un énorme succès, mais
justement, en grande partie, parce que le Parti a
déployé toute une machine publicitaire pour le
promouvoir, avec, comme dans le passé, incitation
directe aux danwei à emmener leurs membres le
voir.
C’est le paradoxe du genre : romans, films et
feuilletons télévisés dénoncent les abus et la
corruption, y compris, dans le cas de « Final Decision »
au sein du Parti, et même dans la famille du héros ; en
échange, ils prônent ce que défend le gouvernement et le
Parti : le programme de réformes dont l’effet
revitalisant sur les vieilles entreprises d’Etat est
montré avec réalisme, tout en soulignant la nécessité de
préserver les valeurs morales.
Le roman de Zhang Ping est même couronné du 5ème
prix Mao Dun en 2000, après avoir été loué par Jiang
Zeming. Le prix déclencha une vague de « pseudo-romans
anti-corruption » (jiǎmào
fǎnfǔ
xiǎoshuō
假冒反腐小说),
souvent publiés sous le label du genre, mais traitant de
tout autre chose, la simple mention « anti-corruption »
sur la jaquette assurant de bonnes ventes. |
|
Mais la censure intervient quand le roman va trop loin
en attaquant directement l’image du Parti. C’est le cas,
par exemple, du roman de
Li Peifu (李佩甫)
publié en 1999 : « La porte de moutons » (《羊的门》).
Le roman décrit les villageois comme des moutons bien
nourris, et les cadres à tous les niveaux comme des
loups affamés usant de leurs positions pour servir leurs
intérêts personnels. Le roman est interdit car, derrière
le « parrain » du village, se profilait l’ombre de Deng
Xiaoping. C’est une semonce, et une leçon qui fixe les
limites à ne pas dépasser.
2001 : L’apogée du genre
« En 2001, dit Jeffrey Kinkley dans son ouvrage précité,
on pouvait aller au rayon fiction dans n’importe quelle
librairie et prendre une pile de livres dont la
couverture portait les caractères « pouvoir » ou
« noir » : on pouvait être sûr qu’il s’agissait de
romans sur la corruption. » |
|
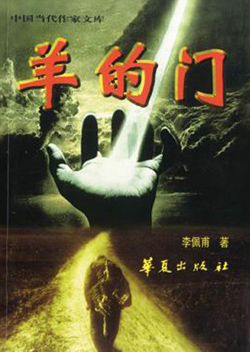
La porte des moutons |
Le genre était en pleine floraison, bien que n’étant pas reconnu
par la critique littéraire, et il y avait une liste croissante
d’auteurs considérés comme des maîtres du genre, chacun ayant sa
particularité. Ils apparaissaient comme des « héros
anti-corruption », et des écrivains comme Zhang Ping ou Lu
Tianming recevaient du courrier de lecteurs ayant été victimes
de fonctionnaires corrompus, leur demandant d’exposer
l’injustice subie et de les soutenir.
|
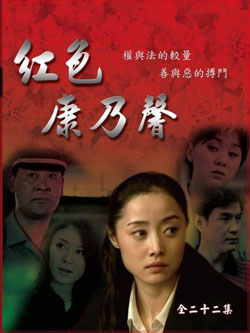
L’œillet rouge, film d’après le roman
de
Chen Xinhao 2000 |
|
Des feuilletons télévisés capitalisent sur le succès des
romans, mais sans leur faire d’ombre. Des 17
best-sellers de la première moitié de 2001, six sont des
romans anti-corruption, et la plupart des maisons
d’édition avaient une demi-douzaine de titres ou plus
sous presse en même temps ; elles en ont fait des
collections spéciales.
En même temps,
des histoires anti-corruption commencent à paraître
sérialisées dans des grandes revues littéraires, comme
Chinese Writers (中国作家),
Dangdai (当代),
ou World of Fiction (小说界).
Le pic est atteint cette année-là avec des romans
utilisant d’autres thèmes pour aborder la corruption,
par exemple la contrebande (à cause d’un cas célèbre) ou
des histoires de flics ou d’extorsion de fonds. Mais des
thèmes nouveaux apparaissent aussi, comme la montée en
puissance des |
femmes à la tête d’entreprises, ou la recapitalisation des
usines d’Etat en vendant des actions aux employés.
Reflux à partir de 2002
Ces romans commencent cependant àmoins bien se vendre à partir
de 2002. Le mouvement
est stoppé, en fait, avant la 1ère session plénière
du 16ème Comité central du Parti, tenue le 15
novembre 2002 : comme au moment des Cent Fleurs, les choses
allaient trop loin. Le Bureau anti-corruption du Parti commença
par se glorifier des victoires qu’il avait remportées, ce qui
signifiait clairement que, le Parti faisant son travail, toute
dénonciation de faits de corruption devenait un acte
contestataire, donc répréhensible.
|
Des articles dénonçant la boue soulevée par ces
histoires se multiplient à partir de juillet ; ils
s’élèvent en particulier contre les dérives des romansà
la limite de la pornographie, avec des intrigues
regorgeant de maîtresses et prostituées et des
descriptions de modes de vies extravagants, voire
absurdes (affaires sordides de cadres entretenant leur
secrétaire et se liguant avec elle pour assassiner leur
épouse, femmes et enfants offertes à des fonctionnaires
corrompus, et soumises à des traitements sexuels
violents…).
Mais le principal défaut reproché à ces romans – comme
auparavant - est l’atteinte à l’image du Parti, et leur
pessimisme excessif. Ils ne sont plus qualifiés deromans
anti-corruption, mais de romans à scandale (hēimù
xiǎoshuō
黑幕小说 –
littéralement : romans exposant de noirs secrets).
Le déclin a cependant été graduel. Ce sont les
feuilletons télévisés sur ce thème qui ont continué le
plus longtemps à être produits : encore trois furent
adaptésen 2003 |
|
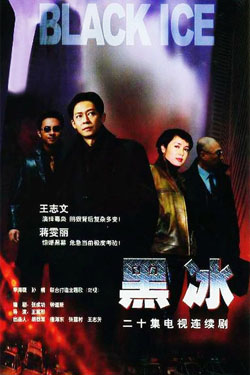
Black Ice, adaptation télévisée du
roman de Zhang Chenggong, 2001
avec Wang Zhiwen et Jiang Wenli |
de romans de
Zhou Meisen (周梅森),
qui reste l’un des grands spécialistes du genre, avec Zhang Ping
(张平)
et Lu Tianming (陆天明) :
ce sont eux qui ont donné leurs lettres de noblesse au genre et
une sorte de légitimité culturelle et politique. Ils ont été
aussi les principaux scénaristes des films télévisés et
feuilletons, conçus pour prôner une meilleure action
gouvernementale et des réformes (limitées).
|
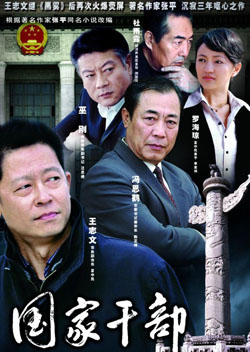
Les fonctionnaires chinois, feuilleton
télévisé 2004 avec Wang Zhiwen |
|
Zhang Ping est l’un des plus prolixes, et celui qui a
publié le plus longtemps. En fait, il était
protégé par ses fonctions, car élu en 2002
vice-président de l’Association des écrivains, et ses
romans étaient en outre une grosse source de profits
pour les éditions des Ecrivains (作家出版社).
Encore en 2004, il continue à publier des romans sous le
label « anti-corruption » : c’est le cas de
« Fonctionnaires chinois » (《国家干部》),
qui est aussi adapté à la télévision, en un feuilleton
de trente épisodes
,
avec, dans le rôle principal, l’acteur Wang Zhiwen (王志文)
qui a joué dans la plupart des adaptations télévisées
des romans anti-corruption de la période, en acquérant
une sorte d’image emblématique très « clean » de xia des
temps modernes.
Des articles contre le pire de cette littérature
apparaissent encore en 2004, alors que le Parti
renouvelle son engagement à lutter contre la corruption.
En ridiculisant les cadres de base, Zhou Meisen, en
particulier, mettait en |
question le système et une culture politique engendrant, avec
l’opportunisme et le respect aveugle de l’autorité, des
mentalités et des attitudes absurdes. Mais c’est justement la
mise en cause du système politique qui posait problème.
Signe des temps et du retournement du « marché » : des romans de
« fiction économique » apparaissent, dont certains sur la
faillite des entreprises d’Etat, sans thèmes de corruption ou
abus de pouvoir, et moins audacieux dans leur fonction de
peinture de la réalité. En 2004, l’organe de contrôle de la
radio-télévision, le SARFT, annonce que les programmes télévisés
sur le thème de la criminalité ne seraient plus diffusés en
prime time. Dans les années 2004-2005, les thèmes désormais
privilégiés sont les repentirs et pénitences des fonctionnaires
corrompus, nouveau sous-genre littéraire à fonction didactique
qui a cependant du mal à prouver son authenticité et affirmer
ses qualités littéraires.
Genre populaire et commercial, le roman anti-corruption est mort
de ses excès et de la saturation du marché autant que des
nécessités politiques, celles-ci venant cependant in fine signer
son coup de grâce.
Cependant, à partir du moment où le roman sur la corruption
n’avait plus de soutien officiel, il était condamné à repasser
dans la contestation et l’opposition et à être interdit, avec
sans doute une meilleure qualité littéraire, mais une diffusion
limitée surtout à l’étranger. C’est le sort réservé aux écrits
d’auteurs comme
Murong Xuecun (慕容雪村)
ou
Li Chengpeng (李承鹏).
Note sur la terminologie
Ces romans sont désignés par le terme de fǔbài
腐败,
acronyme pour
fǎn fǔbài tícái
xiǎoshuō
反腐败题材小说,
qui recouvre tous les aspects possibles de corruption, y compris
au figuré.
Sous Mao, les termes utilisés désignaient les diverses formes de
corruption : subornation
shòuhuì
受贿
ou accepter des pots de vin - malversations
tānwū
贪污
– privilèges tequán
特权.
A la suite des réformes, de nouvelles formes sont apparues, et
le terme
fǔbài traduit le passage à la grande corruption, dans
son aspect généralisé.
Mais le terme a aussi l’avantage de permettre un grand nombre
d’expressions utilisant le premier caractère, utilisées dans les
romans :
腐化
fǔhuà
dégénéré, pourri,
腐烂
fǔlàn
pourri, décadent 腐蚀
fǔshí
corrodé… Et on peut faire le même exercice avec le second
caractère
败
bài qui
indique le déclin, la dégénérescence après une défaite :
败落
bàiluò
décliner -
败类
bàilèi
rebut, lie de la société, dont les cadres corrompus.
On a là de riches possibilités métaphoriques. On a l’impression
que le champ lexical s’élargit au fur et à mesure que le
phénomène s’étend.
Eléments bibliographiques
Jeffrey Kinkley, Corruption and Realism in Late Socialist China
: The Return of the Political Novel, Stanford 2006.
Bai Rouyun, Staging Corruption : Chinese Television and Politics,
University of British Columbia Press 2014.
Brève histoire du roman chinois (中国小说史略),
chapitre 28 : Les romans de dénonciation de la société à
la fin de la dynastie des Qing (第二十八篇 清末之谴责小说)
[traduction Charles Bisotto]
Parmi les autres écrivains qui ont publié des romans
« anti-corruption » à succès pendant cette période,
citons aussi : Zhang Chenggong (张成功),
auteur de la trilogie « Glace noire » (《黑冰》),
« Trou noir » (《黑洞》),
« Brouillard noir » (《黑雾》),
etc…, Chen Xinhao (陈心豪),
pour « L’œillet rouge » (《红色康乃馨》)
adapté à la télévision en 2000, ou Zhang Hongsen (张宏森)
pour « Le juge en chef » (《大法官》).
|
|

