|
|
Lu Tianming
陆天明
Présentation
par Brigitte Duzan, 10 juin 2016
|
Lu Tianming est un écrivain représentatif de ce
qu’il est usuel d’appeler la « littérature des
jeunes instruits » ou zhiqing wenxue (知靑文学),
l’un des nombreux courants littéraires qui forment
la littérature dite « de l’ère nouvelle » (新时期文学),
de la chute de la Bande des quatre en 1976 aux
événements de Tian’anmen en 1989.
Cette « littérature des jeunes instruits » s’est
développée, parallèlement à la
« littérature des cicatrices »,
au retour des jeunes instruits de leur exil prolongé
à la campagne, pour dépeindre leur expérience. Lu
Tianming est un cas peu courant, puisque, d’une
part, c’est au Xinjiang qu’il a passé la période de
la Révolution culturelle, etd’autre part qu’il y est
parti volontairement, après quelques années dans
l’Anhui.
Contrairement à d’autres, qui ont développé une
vision idéalisée et nostalgique de leur séjour
prolongé dans des zones rurales excentrées et peu
amènes, il a adopté une |
|

Lu Tianming |
position volontairement réaliste pour raconter sa vie et ses
souvenirs, une fois son enthousiasme initial douloureusement
expurgé.
Volontaire enthousiaste à quatorze ans
Né en 1943 à Kunming (昆明),
et grandi à Shanghai, Lu Tianming a perdu son père à l’âge de
dix ans. C’est sa mère qui l’a élevé, lui et ses quatre frères
et sœurs cadets
.
Il a donc eu l’habitude très tôt d’aider aux tâches ménagères et
d’acquérir un certain esprit de dévouement.
De l’Anhui …
|
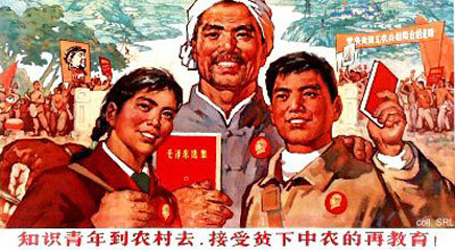
L’appel aux jeunes de 1957 |
|
A 12 ans, il entre dans une petite troupe culturelle
et fait preuve de dons et de goût pour l’écriture.
Mais, deux ans plus tard, en 1957, au tout début du
Grand Bond en avant, est lancé l’appel aux jeunes
qui viennent de terminer le secondaire : « Soyez la
première génération de paysans instruits de la
nation » (“祖国第一代有文化的农民”)
.
|
C’est
l’enthousiasme, avec défilés de tambours et gongs dans les
rues, et des articles dans les journaux incitant les
étudiants à se porter volontaires et partir. Lu Tianming a
14 ans, qu’à cela ne tienne, il trafique ses papiers
d’identité pour se donner deux ans de plus.
Mais sa mère n’est pas d’accord ; alors, pour tenter de la
convaincre, il lui écrit un mot tous les jours, qu’il glisse
sous son oreiller : elle finit pas céder. Il part dans l’Anhui,
dans un petit village au pied des monts Huangshan, comme simple
paysan. Il est le plus jeune de l’équipe de « jeunes
instruits », le plus âgé est un étudiant de première année de
l’Institut d’art dramatique de Shanghai. Il est paysan, mais
« instruit », alors il enseigne dans la ferme et participe à la
campagne pour instaurer les communes populaires. C’est alors
qu’il entre à la Ligue de la jeunesse.
|
Il s’inspirera de cette expérience pour écrire le
scénario du film « Sortir de la ligne d’horizon » (zǒuchū
dìpíngxiàn《走出地平线》),
réalisé par Yu Benzheng (于本正)
et produit par le studio de Shanghai en 1992.
Il est dans l’Anhui au moment de la Grande Famine,
et il survit parce que, étant enseignant, il a un
traitement préférentiel ; mais il attrape la
tuberculose pour cause de malnutrition, et rentre à
Shanghai se faire soigner. Il aurait pu y rester. |
|
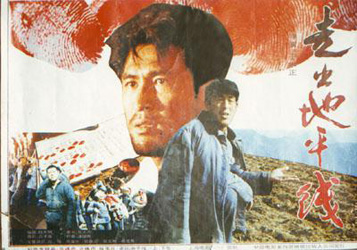
Sortir de la ligne d’horizon |
…. au Xinjiang
|

Lu Tianming en 1964, lors de
son départ pour le Xinjiang |
|
En 1964, pourtant, une fois guéri, il repart,
toujours porté par le même enthousiasme et le même
idéalisme, et cette fois il va au Xinjiang. Il a en
effet entenduun discours du directeur du bureau de
mise en valeur de la province, Wang Zhen (王震)
,
appelant les jeunes diplômés à partir aider au
développement rural du Xinjiang.
Lu Tianming prend le train, et voyage cinq jours et
cinq nuits pour rejoindre une ferme militaire
dépendant du Corps de production et construction du
Xinjiang (新疆生产建设兵团)
où il travaille dans une équipe de défrichage, selon
le principe « Construire la frontière, protéger la
frontière » (“建设边疆,保卫边疆”).
L’approvisionnement était encore difficile, ils se
nourrissaient de nouilles de farine de maïs. En
1964, les paysans n’avaient pas le droit d’élever
des poulets ou des porcs, c’était |
considéré comme « la queue du capitalisme » (资本主义尾巴).
Même les femmes qui venaient d’accoucher devaient faire une
demande spéciale pour avoir des œufs. Pourtant le but des
fermes militaires était de construire une économie
auto-suffisante.
Ils étaient une quarantaine, moitié hommes moitié femmes, et ils
dormaient dans des dortoirs séparés. Les lits du bas étaient
au-dessous du niveau du sol, à même la terre, et ils mangeaient
avec des tiges de roseaux en guise de baguettes. Ils
travaillaient toute la journée, sauf une courte sieste
l’après-midi et, le soir, avaient des discussions sur le travail
réalisé dans la journée.
Ecrivain pour témoigner
Ils n’avaient pas beaucoup de temps à eux dans ces conditions,
mais Lu Tianming a commencé à raconter des histoires à ses
camarades pour égayer leurs soirées libres.
Des histoires pour distraire les camarades
Il était chef d’équipe, dans la ferme, et avait la charge d’une
quinzaine de jeunes instruits comme lui. La vie était monotone
et ils avaient très peu de divertissements. Alors il leur
racontait des histoires, et, au bout de plusieurs années, au
début des années 1970, il a eu le désir de les écrire. C’était
entièrement spontané, contrairement à ce qui s’est passé pendant
la Révolution culturelle. Il dit avoir toujours eu envie
d’écrire. L’une des raisons pour lesquelles il a choisi de
partir au Xinjiang est qu’il voulait « se plonger dans la vie »
(到生活中去) ;
or, ce faisant, il avait des pans de vie à raconter. Tous les
zhiqing ont fait cette expérience, et cette authenticité
fait une grande partie de l’intérêt de cette littérature.
La première œuvre qui a fait connaître Lu Tianming est la
nouvelle « Mettre les voiles » (yangfang wanli《扬帆万里》),
écrite en quelques jours d’un hiver très froid au début des
années 1970 en hommage au mouvement d’envoi des jeunes instruits
à la campagne. Adaptée en pièce de théâtre huaju, publiée
en 1973, elle a été mise en scène à Xi’an, puis a tourné dans
toute la Chine en 1974-75.
Elle a eu un grand impact à l’époque.
Zhang Kangkang (张抗抗)
a dit qu’elle en avait collé des pages sur le mur de sa chambre,
quand elle était, elle, dans le Grand Nord. Lu Tianming était
sincère, persuadé qu’aller au Xinjiang pour améliorer la vie des
paysans était le mieux à faire pour des jeunes comme lui. Ses
convictions ont commencé à changer seulement quand il a été
transféré à Pékin.
Transfert à Pékin
En 1975, après le succès de sa pièce, Lu Tianming est transféré
à Pékin avec sa femme et ses deux enfants
- non sans crise de conscience car il était parti pour instaurer
la révolution, et le but n’était pas atteint. Son transfert
avait d’abord pour but de lui permettre de diriger les
représentations de sa pièce, puis il a été affecté à l’unité
centrale de production radio-télévisée de Chine (中央电视台电视剧制作中心)
pour écrire des pièces.
C’était une chance inespérée à l’époque, personne ne pouvait
encore revenir en ville ; d’ailleurs, en 1977, on l’a accusé
d’avoir bénéficié d’un passe-droit et d’avoir été transféré par
la Bande des quatre. Heureusement, ces accusations se sont vite
révélées sans fondement.
Après la chute de la Bande des quatre, en 1976, il traverse une
période difficile d’adaptation. Pour un jeune instruit qui avait
délaissé une carrière à Shanghai pour aller travailler la terre
pendant dix ans au Xinjiang, la graduelle prise de conscience de
l’absurdité du mouvement des jeunes instruits a été extrêmement
douloureux, pour lui comme pour tant d’autres. Il a dès lors
vécu pour témoigner, témoigner que tout n’était pas inutile dans
cette expérience.
La fiction en renfort des souvenirs
Une vision sobre et réaliste
Lu Tianming s’est lancé à corps perdu dans l’écriture, et, à
partir du début des années 1980, a d’abord publié nombre de
nouvelles, dont, en 1984, la nouvelle moyenne « Fleurs de
chanvre sauvage » (《啊,野麻花》)
est l’une des plus connues et a donné son titre à un recueil.
Mais c’est son roman « Le soleil des hauteurs de Sangna » (《桑那高地的太阳》),
publié en 1987, qui l’a rendu célèbre. C’est le premier volet de
ce qui devait être une « trilogie du soleil » (太阳三部曲)
inspirée par son expérience au Xinjiang, mais s’est limitée à un
second volet, « Soleil boueux » (《泥日》)
en 1992.
Ce roman est important pour le développement de la littérature
« des jeunes instruits » d’une part parce qu’il dépeint le
mouvement des jeunes instruits au Xinjiang au début des années
1960, peu connu par ailleurs, et d’autre part parce qu’il
fournit un témoignage sensible sur les destins tragiques des
jeunes qu’il dépeint, et leur assimilation dans le monde paysan.
Ce premier roman traite en effet du conflit entre culture
urbaine et culture rurale, en décrivant comment elles ont lutté
pendant les décennies maoïstes, et comment, finalement, ce sont
les ruraux qui ont vaincu les intellectuels.
Lu Tianming ne dépeint pas que des jeunes instruits, mais aussi
toute une série de personnages autour d’eux. L’un des portraits
les plus réussis est celui du vieux chef de la ferme militaire,
un soldat démobilisé parti au Xinjiang ; il est victime du
système, mais il se retourne contre les zhiqing. Il
apparaît comme le symbole du monde rural en lutte contre la
culture urbaine, et intellectuelle.
« Le soleil des hauteurs de Sangna » est une critique acerbe du
concept de faire éduquer les jeunes instruits par les paysans
pauvres et moyen-pauvres, et un rejet de la politique
discriminatoire du Parti envers les intellectuels.
Lu Tianming en a eu une vision très nette quand il est revenu au
Xinjiang en 1985. Il a revu certains de ses amis qu’il avait
entraînés là-bas et qui, eux, n’ont jamais pu retourner à
Shanghai parce qu’ils avaient épousé des filles de la région, ou
qu’ils étaient des travailleurs modèles qui n’ont pas été
autorisés à partir. Mais le plus tragique est qu’ils étaient
convaincus dans l’ensemble qu’ils devaient rester … La machine
s’était refermée sur eux.
Des romans « anti-corruption »
|
En 1995, le roman « Le firmament sur la tête » (《苍天在上》)
est le premier d’une série de quatre qui
s’inscrivent dans le contexte de la
« littérature
anti-corruption »
(“反腐四部曲”).
Ce type de roman apparaît, chez Lu Tianming, comme
une autre façon de retrouver l’idéalisme de sa
jeunesse, en dénonçant les dérives d’une société qui
a trahi les idéaux pour lesquels il a sacrifié de
nombreuses années de sa vie.
La première vague
Selon ses propres dires, il appartient à la première
vague de la littérature de zhiqing ; comme il
s’est engagé très tôt, il est même l’un des plus
âgés. Son sentiment est que, s’ils ont énormément
sacrifié, ils ont aussi beaucoup appris. Il n’y a
pas trace d’amertume dans son œuvre ni ses
déclarations.
La seconde vague est différente, a-t-il expliqué,
c’est celle d’auteurs comme Liang Xiaosheng (梁晓声)
– parti dans le Grand Nord en juin 1968 - qui ont
développé une véritable nostalgie des dix ans passés
loin de chez eux et ont créé une vision idéalisée de
la vie de zhiging, qu’ils peignent avec des
couleurs romantiques et révolutionnaires alors que
la vie en ville leur a semblé terne et ennuyeuse à
leur retour.
Ils se sont surtout sentis perdus et démunis car ils
sont revenus les mains vides, sans formation pour
pouvoir travailler en ville. Quand ils sont arrivés
chez eux, ils ont d’abord été accueillis avec
enthousiasme et les bras ouverts par leurs parents
et amis ; mais la vie en ville était difficile, les
logements exigus, ce qui a créé des tensions, en
particulier à Shanghai. Les zhiqing ont eu du
mal à trouver leur place ; c’est ce que décrit la
superbe nouvelle de Wang Anyi (王安忆)
« Terminus » (《本次列车终点》),
l’une de ses premières, datée de 1981.
Ces tensions ont conduit à des manifestations : une
dizaine de milliers de zhiqing ont manifesté
à Shanghai au printemps 1979. Mais le mouvement ne
s’est pas limité à Shanghai, il y a eu des
manifestations aussi au Xinjiang. C’est alors que
s’est cristallisée une nostalgie pour cette sorte de
paradis perdu réinventé, que l’on trouve dans
l’œuvre de
Wang Meng (王蒙),
par exemple, autre écrivain qui a passé de longues
années au Xinjiang, mais, lui exilé, comme les
ministres châtiés par l’empereur sous les Qing.
Lu Tianming est un cas spécial : sa vision du
Xinjiang a le réalisme de ceux qui ont vécu une
passion, et se sont rendu compte qu’elle n’était pas
totalement justifiée. Son approche dépassionnée est
d’autant plus intéressante.
Principales œuvres
Nouvelles
1984 Fleurs de chanvre sauvage
《啊,野麻花》
Romans
1987 Le soleil des hauteurs de Sangna 《桑那高地的太阳》
1992 Soleil boueux
《泥日》
1995 Le firmament sur la tête
《苍天在上》
1998 Reliefs en bois
《木凸》
2000 Neige immaculée
《大雪无痕》
2002 Le secrétaire du comité provincial
《省委书记》
2004 Vols de moineaux noirs 《黑雀群》
Scénarios
1992 Scénario du film « Sortir de la ligne
d’horizon »
《走出地平线》
Dix scénarios pour la télévision, dont les
adaptations de |
|

Le firmament sur la tête
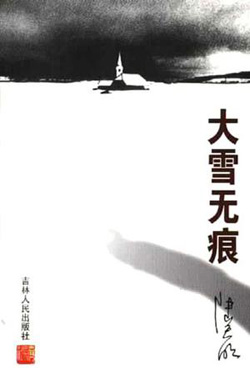
Neige immaculée

Vols de moineaux noirs
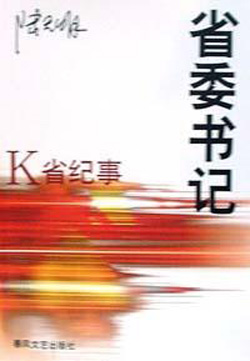
Le secrétaire du comité provincial |
Le firmament sur la tête
《苍天在上》
(feuilleton en 17 épisodes)
Neige sans traces
《大雪无痕》
(feuilleton en 20 épisodes)
Le secrétaire du comité provincial
《省委书记》(feuilleton
en 20 épisodes)
Bibliographie
Morning Sun: Interviews with Chinese Writers of the Lost
Generation, by Laifong Leung, M.E. Sharpe East Gate Book, 1994.
pp. 121-132 Lu Tianming, volontaire au Xinjiang.
Sa sœur cadette Lu Xing’er (陆星儿),
née en 1949 à Shanghai, a été influencée par son frère
lorsqu’elle était adolescente. Malgré les objections de
sa mère, elle a écrit avec son sang une demande pour
partir dans le Grand Nord. Elle est restée dans le
Heilongjiang de 1969 jusqu’à ce qu’elle entre à
l’Institut central d’art dramatique de Pékin en 1978.
Elle a été dramaturge, avant d’écrire des séries de
nouvelles et plusieurs romans.
Dont le réalisateur Lu Chuan (陆川)
qui a vécu ses quatre premières annéesau Xinjiang.
|
|

