|
|
Le 6ème prix
Hongloumeng décerné à Yan Lianke pour son roman « La Mort
du soleil »
par
Brigitte Duzan, 22 juillet 2016,
actualisé 25 février 2020
|
Créé en 2006
par l’Université Baptiste de Hong Kong pour distinguer
les meilleurs romans écrits en langue chinoise
,
le prix Hongloumeng, ou prix du Rêve dans le
pavillon rouge (“红楼梦奖:世界华文长篇小说奖”)
a été décerné, pour l’année 2016, à
Yan Lianke (阎连科)
pour son roman Rixi (《日熄》),
traduit en français
« La Mort du soleil »
et paru aux éditions Philippe Picquier en février 2020.
Initialement
paru fin décembre 2015 aux éditions Rye Field (麦田出版社),
à Taiwan, ce roman a été annoncé par son auteur comme un
tournant dans son œuvre, marqué par l’abandon de la
grande narration historique et une recherche stylistique
visant à trouver le mode d’expression le plus approprié
à cette nouvelle forme narrative.
Somnambules dans l’obscurité
Un monde
somnambule |
|
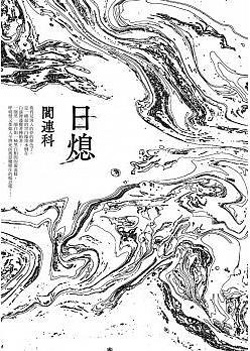
Rìxī / Death of the Sun |
L’histoire est celle
d’un petit village de montagne qui, un soir d’août caniculaire,
la nuit tombée, devient somnambule, comme sous l’effet d’une
épidémie. Le somnambulisme, cependant, devient vite une
allégorie du monde réel, de l’effondrement des valeurs et de
l’ordre moral ; libérés des contraintes morales et sociales
usuelles, les somnambules commencent à faire ce dont ils
rêvaient mais qu’ils n’ont jamais osé faire : ils volent et
tuent sans vergogne.
Dans le désordre
général, ils espèrent que tout cela n’est qu’un cauchemar qui va
s’achever quand le soleil va se lever. Mais le jour qui
s’annonce n’est pas plus clair que la nuit. En fait, les
somnambules semblent être plongés dans une nuit sans fin, comme
le suggère la structure même du récit, articulé en douze
chapitres comme autant de « veilles » (gēng
更),
qui étaient autrefois la manière de compter les heures de la
nuit ; le récit commence avec la première des cinq veilles de
nuit (yīgēng
一更),
entre 19 et 21 heures, mais le chapitre neuf est intitulé
« après la (dernière) veille (更后),
et le dixième « plus de veille » (无更).
Il semble donc bien
que l’on soit désormais hors du temps, et qu’il n’y ait pas
d’échappatoire à cet état de somnambulisme délétère. On ne peut
espérer la salvation classique de la fin des temps.
Une narration en
miroir
L’originalité du roman
tient en grande partie à son mode narratif. L’histoire est
contée par un jeune villageois de quatorze ans, Li Niannian (李念念),
dont la famille tient un magasin d’articles funéraires (冥店).
Il est le voisin d’un
écrivain nommé Yanba (“阎伯”)
,
qui est évidemment un double de Yan Lianke, mais qui est à court
d’inspiration et n’arrive plus à écrire ; alors le jeune
Niannian invoque tous les esprits du monde pour qu’ils lui
viennent en aide et qu’il puisse finir son roman, intitulé « Une
nuit pour les hommes » (《人的夜》).
Mais c’est une tache sans fin comme cette nuit est sans fin.
C’est un récit à
tiroirs autant qu’en miroir, qui a été d’autant plus difficile à
écrire qu’il représente, de la part de Yan Lianke, une volonté
initiale de rompre avec la grande tradition narrative qui est
celle de sa génération.
Du mythoréalisme
à l’hypnoréalisme
Fin de la narration
historique
Yan Lianke dit avoir
révisé son manuscrit une bonne dizaine de fois pour trouver le
ton juste, le mode d’expression qui convienne à ce qu’il a conçu
dès le départ comme une œuvre de rupture et de forme
expérimentale : rupture avec la grande narration historique qui
est la forme traditionnelle du grand roman chinois de la période
contemporaine, et recherche d’une narration différente, plus
près du réel, pour la remplacer.
Le récit lui a été
inspiré très concrètement par ses souvenirs d’enfance. Il a
expliqué que, quand il était petit, dans son village, il a
souvent vu des phénomènes de somnambulisme. L’été, quand il
faisait très chaud, que les moissons étaient terminées, les
villageois dormaient parfois sur l’aire de battage, et il y en
avait régulièrement qui étaient somnambules ; on les tapait pour
les réveiller, dit-il. Dans « Les jours, les mois, les années »
(《年月日》),
l’un des récits, d’ailleurs, est l’histoire d’un vieil homme
somnambule.
Ce n’est donc pas une
invention fortuite. Quand Yan Lianke a décidé de se libérer de
la narration historique, et a cherché quelque chose pour
remplacer l’Histoire, il pensé au somnambulisme. La soumission
des esprits à l’Histoire en Chine – à travers les codes, la
morale et autres - est quelque chose de très profond et
d’insidieux, qui bride la créativité. Dans l’état de
somnambulisme, les gens en sont libérés, et ils peuvent réaliser
tout ce qu’ils veulent, que ce soit bien ou pas.
L’hypnoréalisme
comme uchronie
Cette idée a donc
amorcé un récit fondé non plus sur l’Histoire, mais sur une
fresque allégorique du quotidien.
« Les
chroniques de Zhalie » (《炸裂志》)
amorçait déjà ce tournant, et le début d’une autre narration, où
la satire socio-politique se fait allégorie pour remplacer la
fresque historique.
« La Mort du soleil »
est - dans son principe - une histoire très simple qui se passe
une nuit, dans un village, avec peu de personnages : une dizaine
tout au plus, outre Li Niannian et sa famille qui en sont le
centre. Il n’y a aucun souvenir, aucun flashback, qui puisse
introduire, indirectement, un élément d’histoire.
Yan Lianke, il est
vrai, ne peut s’empêcher de revenir à l’Histoire, mais ce sont
plutôt ses personnages qui ne peuvent s’en détacher, comme s’ils
étaient formatés par l’Histoire jusque dans leur inconscient.
Dans son roman, l’un des villageois amorce une révolte calquée
sur celle du célèbre rebelle paysan de la fin des Ming Li
Zicheng (李自成),
en se proclamant à sa suite « Roi intrépide » - ou Roi vagabond
selon les interprétations (Chuǎng wáng
闯王).
On nage en plein délire, en fait, dans ce roman, le
somnambulisme ayant supprimé toute restreinte et toute
contrainte.
|

Coucher de soleil en été |
|
Parallèlement
à la narration historique, Yan Lianke a abandonné le
mythoréalisme (“神实主义”)
des
« Chroniques
de Zhalie » comme
mode narratif. Avec « La Mort du soleil », on peut
parler d’hypnoréalisme, un récit somnambulique aux
confins du réel, ou qui le transcende en considérant la
réalité à distance, comme on le ferait du royaume des
morts.
En même temps,
« La Mort du soleil » semble faire être un clin
d’œil à son premier roman, en 1994 : « Coucher de soleil
d’été » (《夏日落》),
comme s’il avait réussi, en amorçant une nouvelle phase
narrative, à revenir à ses sources. Il est significatif
que le prix Hongloumeng ait couronné ce roman,
c’est une reconnaissance.
Tout le
problème va être maintenant de poursuivre au-delà de ce
roman. Yan Lianke dit avoir la tête pleine d’idées de
récits, mais il lui faut trouver le meilleur mode
d’expression pour les dire. |
|
|

