|
|
Chinese Arts & Letters : excellente revue de littérature
chinoise éditée à Nankin en anglais
par
Brigitte Duzan, 9 août 2016
|
Chinese Arts & Letters (CAL), en est à sa troisième
année - et à son cinquième numéro - et s’affirme comme
une revue décidément impeccable pour quiconque
s’intéresse de près ou de loin à la littérature
chinoise.
Philosophie et pratique
Editée par l’Ecole des langues et cultures étrangères de
l’Université normale de Nankin, elle a vu le jour sous
les auspices conjugués des principaux acteurs en matière
littéraire et artistique de la province du Jiangsu
,
avec pour objectif de promouvoir la littérature et des
arts chinois auprès du lectorat occidental, dans un
esprit humaniste d’échange, d’innovation et de
recherche.
La meilleure image de cet esprit d’ouverture sur le
monde a été le choix de lancer la revue à la Foire du
livre de |
|

Chinese Arts & Letters, 1er numéro |
Londres,
le 8 avril 2014. Pour l’instant bisannuelle, elle devrait
devenir trimestrielle dans un avenir plus ou moins lointain.
|

Chinese Arts & Letters, 5ème numéro |
|
Telle qu’elle se présente aujourd’hui, sur la base des
cinq numéros déjà publiés, la revue traduit une volonté
de faire connaître les meilleures œuvres de la
littérature chinoise contemporaine et leurs auteurs
,
en donnant des traductions en anglais de plusieurs de
leurs nouvelles, mais aussi des traductions d’interviews
et articles critiques par des grands noms de la critique
littéraire chinoise. Cette approche permet de dépasser
le cercle habituel des critiques et sinologues
occidentaux, et d’offrir une vision différente des
œuvres présentées, une vision de l’intérieur.
Chaque numéro est dédié à la présentation d’un écrivain,
et offre en complément des traductions de textes
d’autres auteurs, ainsi que des articles d’analyse et de
réflexion sur divers sujets. Par ailleurs, comme le
faisait en son temps la revue "Littérature chinoise" de
Yang Xianyi, dans le même esprit d’ouverture sur une
culture où l’écrit et la peinture |
ont
longtemps procédé du même trait de pinceau, chaque numéro de CAL
comporte un volet dédié à la présentation d’une œuvre
artistique.Il faut souligner la qualité des articles, mais aussi
des traductions.
Année 3, numéro 1 : Su Tong, Chen Cun et alia…
|
Le cinquième numéro de la revue, paru en mai 2016 (Vol.
3 n° 1),
est consacré à
Su Tong (苏童),
avec d’une part la traduction,
par Josh Stenberg, de deux nouvelles initialement
publiées en 2004 dans la revue Littérature de Shanghai (上海文学) -
« The Private Banquet » (《私宴》)
et « Cousins » (《堂兄弟》)
- et d’autre part une analyse et un entretien, par Zhang
Xuexin (张学昕).
Particulièrement intéressant est l’entretien : un
dialogue sur les nouvelles de Su Tong, qui méritent
aujourd’hui d’être mises en valeur car toute l’attention
est généralement portée sur ses romans ; or Zhang
Xuexin est un spécialiste de la nouvelle courte, dont il
prépare une histoire qui devait commencer au début des
années 1950, et son regard est d’autant plus perçant.
Ces traductions et articles font suite à ceux du premier
numéro de la revue, dont l’auteur présenté était
|
|

Le rédacteur en chef Yang Haocheng |
Bi
Feiyu (毕飞宇),
mais avec une large part consacrée à Su Tong ; ce premier numéro
comportait la traduction de deux autres de ses nouvelles les
plus connues des années 2000, toutes deux publiées dans un
recueil en 2011, « The Foundling » (ou « Chronique du bébé
trouvé » (《拾婴记》)
et « Rising Dragon
Temple » (《上龙寺》).
|

Zhang Xuexin |
|
Ce cinquième numéro fait aussi la part belle à deux
auteurs représentatifs d’une écriture très personnelle,
une littérature que l’on peut dire « d’avant-garde »,
mais plus spécifiquement teintée des couleurs du Sud:
Chen Cun (陈村)
et
Jing Ge (荊歌).
Ce sont des auteurs dont on a peu l’occasion de lire des
traductions, le second surtout ; c’est donc une
aubainede découvrir en traduction anglaise la nouvelle
« Magpies » (《喜鹊》),
qui a été publiée en chinois dans un recueil de décembre
2014, « L’encens comme dans le temps » (《香如故》).
Il y a là une parfaite continuité avec l’œuvre autant de
Su Tong que de Bi Feiyu ; le choix éditorial est
particulièrement judicieux. Mais c’est aussi un choix
personnel, que l’on retrouve dans celui du poète de ce
numéro : Yu Jian (于坚)
(p. 165). Affinité toujours |
géoculturelle, Yu Jian est poète du
Sud, poète en marge, contre l’hégémonie du centre,ou perçue
comme telle, mais en plus, ici, affinité générationnelle,
pourrait-on dire. Le « File 0 » (《0档案》)
dont ce numéro de CAL donne des extraits n’est plus à présenter
à des lecteurs français puisqu’il a été traduit dans leur langue
,
mais les extraits sont ici donnés en version bilingue, ce qui
devrait être le cas de toute poésie publiée en traduction.
|
C’est bien aussi le cas des quatre poèmes classiques de
Lu Xun (魯迅),
donnés ici (p. 102) avec le facsimilé du manuscrit
original, de la main de Lu Xun, et dans la traduction du
professeur Jon Eugene von Kowallis.
On est dans la problématique de la traduction, et c’est
ce sujet qui est justement analysé dans l’article qui
précède (p. 65) : « Further thoughts on Yan Fu and his
Translations », par le professeur "Ted" Huters,
professeur du département des langues et cultures d’Asie
à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et,
depuis juillet 2010, rédacteur en chef de la revue
Renditions.
C’est une formidable réflexion sur un aspect peu abordé
de la traduction, de l’anglais vers le chinois, et tout
particulièrement de l’importance qu’a eue la traduction
au début du 20ème siècle en Chine pour créer
le vocabulaire |
|
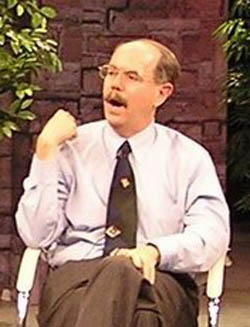
Theodore Huters |
nécessaire à l’importation et l’assimilation éventuelle de
notions philosophiques et de concepts scientifiques occidentaux
tellement étrangers à la culture chinoise que la langue n’avait
pas de termes pour les exprimer. Ce sont les traducteurs qui les
ont inventés.
L’article du professeur Huters analyse, en les comparant, les
traductions d’un même texte– Evolution and Ethics, de Huxley -
publiées la même année 1903 et effectuées par le lettré de la
vieille école Yan Fu (严复)
et par son jeune collègue Ma Junwu (马君武).
L’un cherche dans la langue classique les racines lui permettant
de traduire au mieux, dans l’esprit de la langue, l’autre
emprunte des termes du japonais en synthétisant la pensée de
Huxley.
On est là dans une problématique de traduction que l’on retrouve
sous des formes variées dans toute traduction de texte
littéraire. Et il est intéressant que CAL, en tant que « passeur
de textes », aborde la question, une question qui se pose de
manière particulièrement aiguë pour des auteurs, comme ceux
présentés par la revue, dont le style est un élément déterminant
de l’œuvre. C’est ce que remarquait Li Jingze (李敬泽)
dans le premier numéro de la revue
,
en parlant de Bi Feiyu, et en déplorant que toute traduction ne
parvienne à transmettre qu’une petite moitié de ce qu’il a
écrit…
|
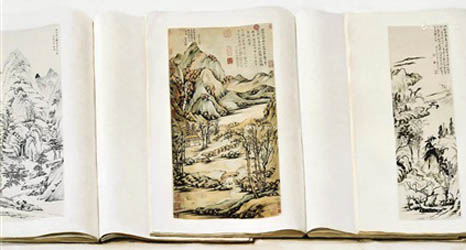
Un album de Chen Danqing |
|
L’article conclusif de ce numéro, celui sur les albums
de peinture de Chen Danqing (陈丹青),
semble totalement déconnecté du reste. Pas tout à fait,
puisqu’il est question d’appropriation d’œuvres
étrangères, dans un « déplacement du temps et de
l’espace », ce qui est, après tout, une définition parmi
d’autres de la traduction… |
Ce numéro est d’une telle richesse qu’il faut bien les six mois
à venir jusqu’au prochain numéro pour en venir à bout…
Le site de la revue :
http://english.jschina.com.cn/chineseartsletters/
Les trois premiers numéros sont numérisés, à feuilleter et
lire en ligne :
Chinese Arts & Letters, 1er numéro (2014.1) – auteur
présenté :
Bi
Feiyu (毕飞宇)
http://english.jschina.com.cn/chineseartsletters/vol1_2014/index.html
Chinese Arts & Letters, 2ème numéro (2014.2) – auteur
présenté :
Huang Beijia (黄蓓佳)
http://english.jschina.com.cn/chineseartsletters/vol2_2014/index.html
Chinese Arts & Letters, 3ème numéro (2015.1) - auteur
présenté :
Ye
Zhaoyan (叶兆言)
http://english.jschina.com.cn/chineseartsletters/vol1_2015/index.html
4ème numéro – 2015.2 – numérisation en cours - auteur
présenté :
Fan Xiaoqing (范小青)
Bi Feiyu’s Voice, by Li Jingze (李敬泽), trad. Jesse Field, pp. 49-53
|
|

