|
|
Ge Fei
格非
Présentation
par Brigitte Duzan, 13 avril 2016,
actualisé 10 novembre 2022
|
Né en 1964,
professeur de littérature à l’université Qinghua à Pékin,
Ge Fei a été, avec
Yu Hua (余华)
et
Su Tong (苏童),
l’un des principaux écrivains dits d’avant-garde qui ont
émergé en Chine à la fin des années 1980.
Comme la
plupart des auteurs de cette génération, il est aussi
d’une culture prodigieuse ; il a fait des recherches sur
la littérature de fiction et écrit des analyses sur les
œuvres de Kafka, Borges et autres
;
ses récits sont souvent truffés de référence à des
œuvres étrangères, voire à la musique classique.
S’il n’est plus d’avant-garde, il reste l’un des
écrivains chinois les plus profonds et les plus
fascinants aujourd’hui.
En 2015, sa « Trilogie du Jiangnan » (ou « Trilogie |
|

Ge Fei |
du Sud
du fleuve » “江南三部曲”)
a été
couronnée du 9ème prix Mao Dun.
Mais ses plus belles œuvres, les plus intéressantes d’un point
de vue tant stylistique que formel, restent cependant ses
nouvelles ‘moyennes’
(中篇小说).
Auteur
expérimental d’avant-garde à la fin des années 1980
|
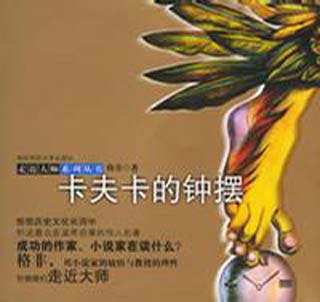
Le pendule de Kafka (édition 2004) |
|
De son vrai nom
Liu Yong (刘勇),
Ge Fei (格非)
est né en août 1964 à Dantu (丹徒),
dans le Jiangsu. En 1981 il est admis en classe de
littérature chinoise à l’Université normale de la Chine
de l’Est, à Shanghai (上海华东师范大学),
et il obtient son diplôme quatre ans plus tard, en 1985.
Il reste à l’université pour y enseigner comme
assistant, puis chargé de cours, et enfin professeur en
1998. En 2000 il obtient son doctorat de littérature
chinoise, et il est transféré à l’université Qinghua (清华大学),
à Pékin.
|
1986-1988 : Trois
premières nouvelles
Il commence à écrire
dans la turbulence littéraire et artistique du milieu des années
1980 et publie une première nouvelle en 1986 – « A la mémoire de
monsieur Wu You » (《追忆乌攸先生》)
– qui annonce sa thématique fondamentale à venir : les relations
profondes entre vie, mémoire et écriture. La plupart de ses
récits seront une tentative de reconstitution du passé, dans une
lutte contre l’oubli qui est aussi lutte contre le temps,
tentative menée très souvent par le biais d’un narrateur, et le
plus souvent à la première personne. Mais ce n’est plus le
narrateur traditionnel, omniprésent ; le regard se fait
multiple, la perception du passé toujours incomplète, floue et
fragmentaire, comme la mémoire en réalité.
|
L’univers que
construit Ge Fei à ce premier stade est un monde
onirique et étrange, entre rêve et réalité, souvenirs et
présent.
Il décrit ainsi
sa découverte de l’importance de la mémoire dans l’essai
« Fiction et mémoire » (《小说与记忆》),
publié dans la première partie du recueil « Le chant des
sirènes » :
«
Je ressentais
avec joie que, avant la nouvelle « A la mémoire de
monsieur Wu You », ma mémoire était endormie, plongée
dans des ténèbres, mais que, à présent, elle
s’éveillait, que des pans de souvenirs surgissaient
soudain comme des rêves oubliés depuis longtemps, me
faisant ressentir leur mystère, leur richesse et leur
profondeur illimitée. Quant à la langue qui se frayait
un chemin dans ces vastes ténèbres pour explorer les
confins de la mémoire, elle balisait comme de bornes
cette contrée intérieure ouverte sur l’infini. » |
|
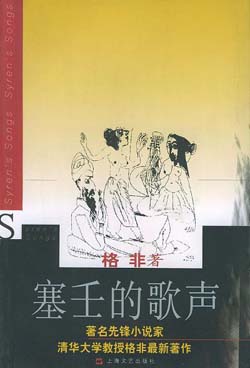
Le chant des sirènes (2001) |
|
Ge Fei poursuit
cette expérience avec deux nouvelles ‘moyennes’ publiées
en 1987 et 1988 : «
La barque égarée» (《迷舟》) et « Nuée
d'oiseaux bruns » (《褐色鸟群》).
La première, inspirée du style de Borges, le rend
célèbre comme auteur de textes expérimentaux de
métafiction, et la seconde est généralement considérée
comme l’une des nouvelles les plus complexes de la fin
des années 1980.
1988 aussi : Vert jaune
Initialement
publiée dans la revue Shouhuo (收获)
en 1988, la nouvelle « Vert Jaune » (《青黄》)
est une histoire déconstruite, dont le fil narratif est
une fausse enquête, qui pourrait être résumée comme la
recherche de la signification exacte de ce terme de
« vert jaune » qu’un professeur a mentionné dans un de
ses |
|
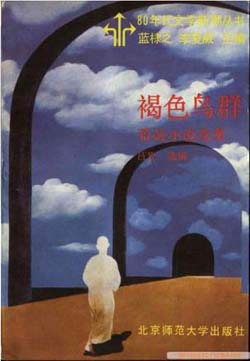
Nuée d’oiseaux bruns (édition 1989) |
ouvrages. Pour tenter de résoudre
l’énigme, un jeune chercheur va enquêter dans un village, sur
neuf familles de pêcheurs…
|
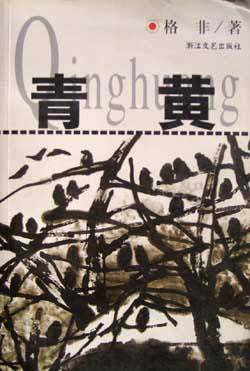
Vert jaune (édition 2001)
|
|
C’est
évidemment un prétexte à une tentative de reconstruction
du passé, œuvre d’imagination, mais à partir d’un fait
réel, décrit dans un article d’une revue… Un peu comme
dans « Sifflement », on est à la croisée des chemins de
l’histoire passée et de la réalité présente, avec
impossibilité de reconstitution exacte de la première,
ce qui laisse la seconde aussi dans le flou. A la fin,
on ne sait toujours pas ce que recouvre précisément ce
terme de « vert jaune ». Le réel est aussi mouvant que
l’eau, et la mémoire réduite à des fragments épars tout
au fond.
Dans ces récits
désormais classiques, Ge Fei suit un lent processus
d’extension du présent vers le passé, et c’est ce passé,
reconstruit à travers des éclairs de conscience
fragmentaires, qui permet au sujet/narrateur de se
reconstruire lui-même. Dans la préface à « La barque
égarée », Ge Fei évoque un espace imaginaire
|
qu’il tente d’atteindre par la perception de
« l’ineffable » que recèlent la réalité et la mémoire.
Avec ces premiers
récits, Ge Fei s’inscrit dans le
mouvement
d’avant-garde littéraire
(先锋文学)
qui fait suite, dans la seconde moitié des années 1980, au
courant dit de recherche des
racines (寻根文学)
et s’en distingue fondamentalement par son caractère
expérimental.
Ce style avant-gardiste
atteint son apogée avec la nouvelle publiée en 1991 :
« Sifflement » (《唿哨》). C’est un récit construit sur la notion de vide, de silence, et de jeu
extrêmement subtil sur la mémoire ambiguë et incertaine du
passé, ce qui rend sa relecture toujours possible, et toujours
possible, donc, une autre narration. La nouvelle mérite quelques
explications car, non traduite en français, on en parle peu et
elle est pourtant représentative.
1991 : Sifflement
|
« Sifflement »
est un récit d’autant plus complexe et ésotérique qu’il
faut connaître l’histoire dont il est inspiré pour
pouvoir le comprendre et l’apprécier. Il s’agit en effet
d’une reconstruction typiquement avant-gardiste, avec
différent niveaux de lecture, d’une anecdote historique
concernant deux célèbres taoïstes de la dynastie Wei-Jin
(220-420).
Il s’agit de
deux des célèbres « Sept Sages de la forêt de bambous »
(竹林七贤) :
Sun Deng (孙登)
et Ruan Ji (阮籍).
Ruan Ji rend visite à l’ermite Sun Deng pour tenter
d’avoir une discussion avec lui. Mais, en dépit de tous
ses efforts, Sun Deng reste silencieux. Alors Ruan Ji
émet un long sifflement et repart. Arrivé à mi-pente,
dans la montagne, il entend l’écho d’un sifflement qui
lui parvient : c’est la réponse de Sun Deng.
Le silence, déjà, est un signe de refus d’engagement.
|
|
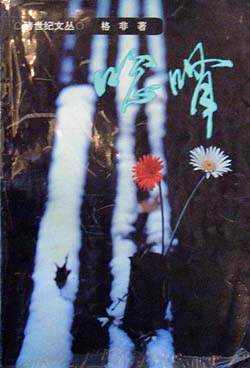
Sifflement (1992) |
Mais le
sifflement a un sens particulier dans le contexte de l’époque :
c’est ce qu’on a appelé le « long sifflement » (chángxiào 长啸),
traduit aussi « sifflement transcendent ». Il s’agit au départ –
dès le Shijing ou Classique de la poésie - d’une
technique grâce à laquelle un maître taoïste pouvait s’adresser
aux animaux, communiquer avec les esprits et agir sur les
phénomènes météorologiques ; elle a ensuite été associée à la
maîtrise du souffle et du qi.
C’est la période de la
dynastie des Jin, et au-delà des Six dynasties (de 220 à 589),
période d’instabilité et de division, qui est l’âge d’or de ce
sifflement. La pratique s’est étendue à toute la société pour
exprimer un sentiment de liberté sans frein ou une attitude
d’indignation, voire de désobéissance vis-à-vis des autorités.
C’est le sens du sifflement de Sun Deng, qui évoque le principe
de tout sage : « En période de désordre, on ne sert pas (le
pouvoir) » (luanshi bushi 乱世不侍).
Or Ge Fei inverse
l’histoire. Son récit commence alors que Sun Deng attend Ruan Ji
qui n’arrive pas, et il se termine sur un Sun Deng qui ne
parvient pas à émettre un sifflement en réponse à celui de Ruan
Ji : Ge Fei le décrit portant son pouce et son index à la
bouche, mais il est trop faible, il est pris de tremblement,
aucun son ne sort… Ce n’est donc même plus le sifflement, mais,
ironiquement, le silence même qui figure ici comme allégorie
politique.
Ge Fei se situe au-delà
de la narration d’un épisode historique, car non seulement il le
pervertit, mais en outre, il en comble les vides en recréant ce
que la mémoire historique a oublié, ou effacé : ce qui s’est
passé entre l’arrivée de Ruan Ji et son départ. Ge Fei est parti
d’un vide narratif appelant au travail de mémoire, mais les
petits détails du quotidien qui viennent le combler n’ont ni
sens ni importance, ils sont vite oubliés. Reste un sifflement
qui, finalement, ne vient pas, mais qui, par son absence même, a
un sens, donc est retenu par la mémoire.
|
Et ce sens est
politiquement subversif. Ce n’est pas pour rien que la
nouvelle a été initialement publiée à Hong Kong, après
les événements de la place Tian’anmen… « Sifflement »
est un chef d’œuvre de sens à peine audible, non sifflé,
mais susurré.
1994 :
Impressions à la saison des pluies
« Sifflement »
s’insère entre deux romans, « L’ennemi » (《 敌人》) et « Marges » (《边缘》),
mais Ge Fei revient aussitôt après vers la nouvelle
‘moyenne’ pour une autre de ses plus réussies, et l’une
de ses plus connues : « Impressions à la saison des
pluies » (《雨季的感觉》),
publiée en 1994.
La saison en
question, c’est celle de la pluie des prunes (printemps
ou début de l’été) dans le Jiangnan, c’est-à-dire le
pays au sud du fleuve, le Yangzi. La pluie est
|
|
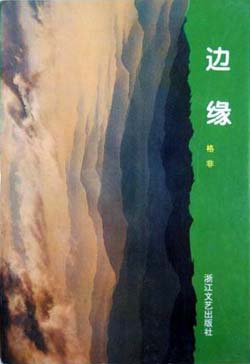
Marges (1993) |
incessante, noie tout, les esprits
comme le paysage, et semble diluer les souvenirs autant que la
perception de la réalité.
|
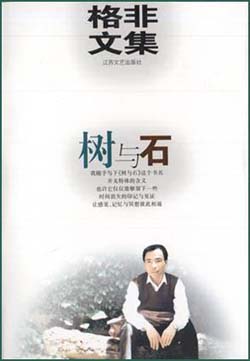
L’arbre et la pierre (1996) |
|
Le récit est
une suite d’événements incohérents, sans lien apparent,
et l’intrigue n’est peut-être fondée que sur des
rumeurs, le rêve ou quelque jeu de l’imagination en
résultant : les Japonais
auraient bombardé une ville voisine, un détective privé
arrive au bourg sans que personne ne sache pourquoi… il
y a quelque chose de l’absurde de
Can Xue (残雪)
dans tout cela, mais c’est juste parce que tout le monde
a ses obsessions, ses troubles de mémoire, et que la
réalité, comme le temps, en finit par être
insaisissable, et d’abord par l’auteur/narrateur.
Et puis, à la toute fin, Ge Fei donne une clef de
lecture, qui n’est pas vraiment une solution, juste une
accalmie dans la pluie, un soudain rayon de soleil qui
vient éclairer le paysage, mais qui est tout aussi
trompeur, sans doute.
On se dit que
cette vision floue, ambiguë, |
un rien angoissante, des choses, dans
l’œuvre de Ge Fei, est peut-être due à cela, tout simplement : à ce
paysage imbibé d’eau qui est celui de chez lui, et qui est aussi
celui des shanshui de la peinture traditionnelle, avec
leur vide essentiel.
|
Ce style original,
souvent difficile d’accès, ces narrations sans fil logique, si
elles ont suscité les éloges des critiques, n’ont pas attiré un
large public. Alors, au milieu des années 1990, Ge Fei a opté
pour un style narratif plus accessible.
De
l’expérimentation à la réflexion sur la réalité et la mémoire
1996 :
récapitulation et fin de l’expérimentation
Il fait d’abord
la somme de ses recherches sur l’art narratif, en
publiant un recueil de textes qui sont en fait ses cours
à l’université de la Chine de l’Est. Puis il fait comme
une récapitulation, avec la publication de deux recueils
qui reprennent ses meilleurs nouvelles courtes et
moyennes des dix années écoulées. C’est la fin de sa
période expérimentale. Il s’est forgé un style. Il va
désormais le décliner sous diverses facettes.
C’est par un
roman que s’annonce une nouvelle période créatrice :
« La bannière du désir » (《欲望的旗帜》), publié en 1996, est sensé marquer l’abandon des expériences radicales
de ses dix premières années de création en matière de
structure narrative. Mais, s’ils sont moins déroutants,
ses récits continuent de dépeindre une certaine
désintégration de la réalité dans l’esprit qui tente d’y
trouver une logique, et d’en rechercher la cause dans
celle de la mémoire individuelle.
La réalité est
fragmentaire et lacunaire comme le souvenir qu’on en
garde. L’œuvre de Ge Fei conserve une grande unité
thématique, fondée sur le rejet de la narration
classique.
2001 :
Poèmes à l’idiot
|
|
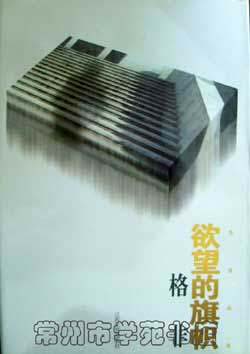
La bannière du désir (1996)
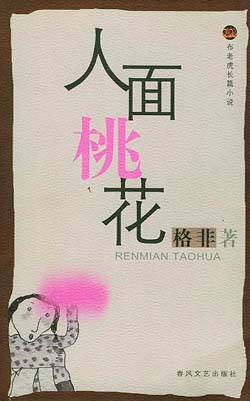
Une fille au teint de pêche (2004)
|
|
La nouvelle
« Poèmes à l’idiot » (《傻瓜的诗篇》)
se passe dans un asile psychiatrique où vient d’arriver
un nouveau psychiatre ; il tombe amoureux d’une jeune
patiente qui écrit des poèmes « à l’idiot ». Mais le
jeune médecin est un être torturé, qui n’aime pas son
métier, et analyse ses rêves, traversés
par de
douloureux souvenirs d’enfance, comme sa patiente : tous
deux croient être responsables de la mort de leur père
quand ils étaient enfants...
Tous deux sont donc hantés par leur mémoire, et le rêve
fait son office d’inconscient refoulé, la référence à
Freud est évidente.
A la fin,
l’étudiante sort guérie, tandis que le jeune médecin
attend son premier électrochoc… Le récit est construit
sur des leitmotivs comme des obsessions :
petite
musique d’harmonium lancinante, et le bruit de la pluie,
ici aussi…
2004-2011 :
la trilogie de l’utopie |
|
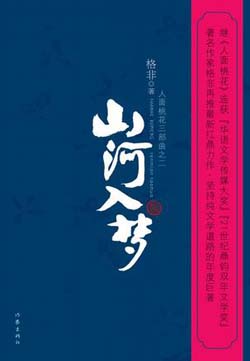
Fleuves et montagnes vus en rêve (2007)
|
|
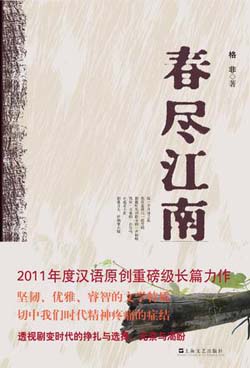
Fin de printemps dans le Sud (2011) |
|
Publié en 2004
et couronné en 2005 du prix Ding Jun (鼎钧文学奖),
« Une jeune fille au teint de pêche » (《人面桃花》)
est un roman conçu autour de l’idée d’utopie ; c’est le
premier volet d’une trilogie, celle du Jiangnan, appelée
aussi, justement, « trilogie de l’utopie » ("乌托邦三部曲"),
qui se poursuit avec « Montagnes et fleuves en rêve » (《山河入梦》)
et « Fin de printemps au sud du fleuve » (《春尽江南》),
publiés respectivement en 2007 et 2011.
Ces romans
plongent dans des réminiscences littéraires et
historiques qui les rattachent, en ce sens, à la
nouvelle « Sifflement ». A travers l’histoire de deux
personnages, la jeune révolutionnaire Xiumi (秀米)
dans le premier roman et son fils Tan Gongda (谭功达)
ensuite, de la fin de la dynastie des Qing à la période
moderne, Ge Fei analyse la notion d’utopie en termes
d’idéalisme politique, en liaison avec la question de
|
|
modernité ; il réfléchit sur les excès constatés
dans sa version chinoise, au niveau du village, en
soulignant, selon les
termes de Zhang Yinde, « la connivence désastreuse et
pernicieuse entre l’idéologie socialiste et le projet de
modernisation ». Surtout, il cherche à déceler le
moment, le point fatidique, où l’utopie a dégénéré, et
s’est transformée en son contraire.
Finalement, il
reconstruit une utopie sur la mort du collectif
unitaire, et sur la base d’un humanisme fondé sur la
division sociale, et l’élan individuel. La trilogie
apparaît ainsi comme une tentative de réconcilier
l’utopie et la désillusion qui en résulte en réservant
une part irrécusable d’espérance.
Ce thème de
réflexion est cependant enrobé dans une narration plus
traditionnelle que celles des nouvelles de Ge Fei, dans
un style rappelant celui des grandes sagas familiales de
la littérature chinoise classique.
|
|
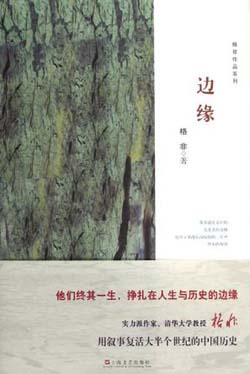
Marges (Bianyuan 2013) |
C’est une histoire pleine de rebondissements, non
plus comme un puzzle, mais plutôt comme un labyrinthe, avec
divers niveaux narratifs et récits en culs-de-sac.
Retour aux nouvelles
et essais
|
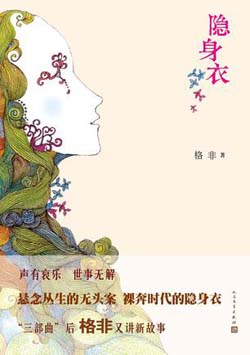
Les habits de l’homme invisible (2012)
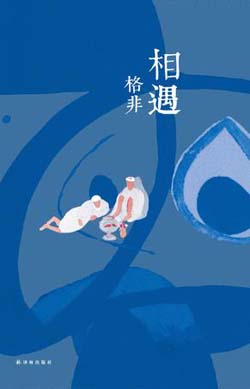
Rencontres (2014) |
|
En 2012, Ge Fei
a publié un nouveau roman, « Les habits de l’homme
invisible » (《隐身衣》),
nouvelle application de ce style labyrinthique qui noue,
en l’occurrence, les destins de plusieurs personnages,
en débouchant sur une énigme finale qui finit
d’embrouiller les pistes en terminant sur un point
d’interrogation. Depuis son premier roman, « L’ennemi »,
en 1990, construit à partir d’un mystérieux incendie
ayant causé la mort d’un non moins mystérieux
personnage, Ge Fei n’en finit pas de nous proposer des
énigmes sans solution.
Ici, cependant,
il y joint des traits de satire sociale. L’histoire
étant celle d’un spécialiste de systèmes hi-fi
sophistiqués, Ge Fei y fait preuve au passage d’une
étonnante érudition en matière de musique occidentale
classique, mais c’est ironique. Il se moque en fait des
bobos chinois prêts à dépenser des fortunes sur des
systèmes acoustiques dont ils ne sont pas capables
d’apprécier les qualités, les utilisant au besoin pour
écouter de la musique pop. A côté des nouveaux riches,
les vrais connaisseurs triment pour joindre les deux
bouts.
Comme l’ont
souligné certains critiques,
le roman est léger, il est vrai, mais divertissant,
comme inéluctablement gagné par l’air du temps. Le
plaisir est d’y retrouver les ingrédients qui font
depuis trente ans la subtilité des récits de Ge Fei,
subtilité dans l’inaboutissement : il laisse un vide au
lecteur pour lui laisser tout loisir de le combler.
Ce roman semble
en fait un scénario en attente d’un réalisateur. Il
rappelle que Ge Fei a été scénariste à son heure, auteur
du scénario du très beau film, encore |
trop peu connu, de Lu Sheng (卢晟)
« Ici, là-bas » (《这里,那里》).
2016 : nouveau roman
|
Publié en juin 2016, « En regardant
la brise printanière » (《望春风》) est le premier roman de
Ge Fei publié après le prix Mao Dun, couvrant cinquante
ans d’histoire de la Chine rurale, de 1958 à 2007. La
campagne restant une source spirituelle pour tout
Chinois, Ge Fei a opéré un retour aux sources. Le sujet
est toujours celui de la « trilogie de Jiangnan », mais
d’une manière différente, dans une optique plus proche
des détails de la vie quotidienne. L’histoire se passe
en effet dans un village pittoresque du sud du Yangtze
dont le roman dépeint l’évolution au fil du temps
pendant le demi-siècle considéré. C’est une façon de
dire adieu à la ruralité en train de disparaître.
Au-delà du roman
2021 : analyse littéraire
|
|

En regardant la brise
printanière |
|
En octobre 2021 est paru un recueil
d’analyses et de réflexion sur la littérature : « Aux
frontières de la civilisation » (《文明的边界》).
C’est une synthèse des cours de littérature donnés par
Ge Fei pendant trois ans, de 2018 à 2020, dans le cadre
du cursus de « Recherche sur l’art narratif » (“小说叙事研究”)
dans le département de chinois de l’université Qinghua.
L’ouvrage a été réalisé à partir des enregistrements et
des notes du cours.
Ge Fei a choisi trois œuvres majeures
de la période contemporaine (dans leurs traductions en
chinois) :
-
« L’homme sans qualités » (《没有个性的人》),
roman inachevé de l’Autrichien Robert Musil dont le
premier tome et le début du deuxième sont parus en 1930
et 1932 : l’un des romans fondateurs du XXe siècle selon
Thomas Mann, pour son « aspiration à redéfinir une
culture et une spiritualité sur les ruines du passé ». |
|

Aux frontières de la
civilisation |
-
« Errances dans la nuit » (《暗夜行路》),
roman unique du romancier japonais Shiga Naoya, un contemporain
de Tanizaki, mais plus proche de Sôseki : écrit en 1921, c’est
une littérature du « je » encore nimbée de naturalisme.
-
« Moby-Dick » (《白鲸》),
de Herman Melville (1819-1891), paru en 1851.
Partant de l’idée que toutes les grandes
œuvres littéraires depuis le 19e siècle offrent des
réflexions sur la civilisation moderne, Ge Fei analyse les trois
romans sélectionnés sous l’angle des problèmes qui reviennent
comme des leitmotivs dans ses propres romans, et ce faisant les
éclairant : ceux posés par le déclin de la civilisation rurale
et l’essor de l’urbanisation.
Principales
publications
(pour les nouvelles des
années 1980, voir
Ge Fei : les nouvelles moyennes)
|
1990 L’ennemi《 敌人》
(premier roman, initialement
publié dans Shouhuo)
1991 Sifflement
《唿哨》
1993 Marges《边缘》
(deuxième roman)
1994
Impressions à la saison des pluies
《雨季的感
觉》
1995 Etudes sur
divers aspects de l’art narratif
《小说
艺术面面观》
(cours)
1996 Recueil de
textes choisis 格非文集:
1.L’arbre
et la pierre 《树与石》
2.Vision
lointaine《眺望》
1996 La
bannière du désir《欲望的旗帜》
2001 Le chant
des sirènes 《塞壬的歌声》(essais)
2001 Poèmes à
l’idiot 《傻瓜的诗篇》
2004 Bien plus
sont morts d’un infarctus《更多的人死于
心碎》
2004 Le pendule
de Kafka 《卡夫卡的钟摆》
(essais)
2004 Une jeune
fille au teint de pêche
《人面桃花》
|
|

Le visage de Borges (2014) |
2007 Une
bague-fleur 《戒指花》
(sélection de nouvelle courtes)
Rien que des ordures
《不过是垃圾》
(sélection de
nouvelles moyennes)
2007 Fleuves et
montagnes vus en rêve 《山河入梦》
2010 Le sourire de Mona
Lisa 《蒙娜丽莎的微笑》
2011 Fin de printemps
au sud du fleuve 《春尽江南》
2012 Les habits de
l’homme invisible《隐身衣》
2013 Marges
《边缘》
2014 Rencontres
《相遇》
(sélection de 12
nouvelles des 20 dernières années)
2014 Le visage de
Borges 《博尔赫斯的面孔》
(recueil d’essais)
2016 En regardant la brise printanière 《望春风》
2021 Aux frontières de la civilisation 《文明的边界》
Traductions en
français
• Nuée d’oiseaux bruns,
trad. Chantal Chen-Andro, Philippe Picquier, 1996.
• Impressions à la
saison des pluies, trad.
Xiaomin Giafferri-Huang, l’Aube, 2003.
• Poèmes à l’idiot,
trad.
Xiaomin Giafferri-Huang, l’Aube, 2007.
• Coquillages, trad.
Xiaomin Giafferri-Huang, l’Aube, 2008.
• Une jeune fille au
teint de pêche, trad.
Li
Bourrit et Bernard Bourrit,
Gallimard Bleu de
Chine, 2012.
• Ondes de Chine, trad.
François Sastourné, Ming Books, 2015.
Traductions en
anglais
• The Lost Boat,
tr. Caroline Mason. In Henry Zhao (ed.), The Lost Boat:
Avant-Garde Fiction from China. London: Wellsweep Press, avril
1992, 77–100.
• Whistling, tr.
Victor Mair + Green Yellow, tr. Eva Shan Chou + Remembering Mr.
Wu You, tr. Howard Goldblatt. In Wang Jing (ed.), China’s
Avant-Garde Fiction. Durham: Duke University Press, 1998,
15–68.
• Meetings, tr.
Deborah Mills. In Henry Zhao and John Cayley, eds., Abandoned
Wine: Chinese Writing from Today, 2. London: Wellsweep, 1996,
15-49.
• The Mystified
Boat, tr. Herbert Batt. In Frank Stewart and Herbert J. Batt,
ed. The Mystified Boat and Other New Stories from China. Special
issue of Manoa: A Pacific Journal of International Writing 15, 2
(Winter 2003). Honolulu: University of Hawaii Press, 142-61.
• Remembering Mr.
Wu You, tr. Howard Goldblatt. In Chairman Mao Would not be
Amused: Fiction from Today's China, Goldblatt, ed. New York:
Grove Press, 1995. 236-243.
• The Invisibility Cloak, tr.
Canaan Morse, New York Review Books Classics, Oct. 2016.
A lire en
complément :
- Les nouvelles
moyennes (1986-2000)
- le roman "Une
jeune fille au teint de pêche" 《人面桃花》
En ligne :
Dans : Wang Jing,
High Culture Fever, Politics, Aesthetics, and Ideology in Deng's
China, University of California Press, 1996
Chapitre.6 : The
Pseudo-proposition of "Chinese Postmodernism" : Ge Fei and the
Experimentalist Showcase.
pp 233-259
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft0489n683;brand=ucpress
Dans le n° 72 (2011/2)
de la revue Rue Descartes :
Utopie et anti-utopie :
le cas de Ge Fei, par Zhang Yinde, pp. 69-80.
Une analyse des deux
premiers tomes de la « trilogie de l’utopie » ("乌托邦三部曲") :
Un Visage, un pêcher en fleur, tr. en français « Une
jeune fille au teint de pêche » (《人面桃花》),
publié en 2004 - En rêve, monts et rivières
(《山河入梦》)
publié en 2007.
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2011-2-page-69.htm#no1
La critique de “The
Invisibility Cloak » par Lucas Klein,
The Quaterly Conversation issue 46, Dec. 12, 2016.
http://quarterlyconversation.com/the-invisibility-cloak-by-ge-fei
Sur ce sujet, voir l’analyse du professeur Zhang Yinde : Utopie et anti-utopie, le cas de Ge Fei, Rue Descartes, 2011/2 (n° 72).
L’article a été écrit avant la publication du troisième
tome de la trilogie, donc l’analyse concerne les deux
premiers volumes (l’histoire de Xiumi et celle de Tan
Gonda de 1952 à 1962) :
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RDES_072_0069
Titre
emprunté au 10ème roman de Saul Bellow,
publié en 1987, qui sert de référence thématique et
stylistique : « More Die of Heartbreak ». Le recueil est
sous-titré « Une sélection de mes histoires d’amour
tragiques préférées »
《我最喜爱的悲情小说》
|
|

