|
|
Can Xue 残雪
Présentation
par Brigitte Duzan, 7 septembre
2013, actualisé 8 avril 2021
|
Née dans les
premières années de la République populaire, Can Xue (残雪)
a souffert dès son enfance des absurdités de la
politique maoïste. C’est l’univers intérieur que cette
expérience a créé que reflètent ses premiers récits,
publiés à partir de 1985, qui ont surpris par un ton et
un style totalement novateurs dans la littérature
chinoise de l’époque, et qui le restent encore
aujourd’hui.
Can Xue s’est
mise – entre autres - à l’école de Kafka et de Borges,
plus récemment d’Italo Calvino, pour produire une œuvre
originale et personnelle, reflet de son univers mental,
un univers intime entre cauchemar et rêve éveillé,
peuplé d’êtres fantomatiques et traversé de visions
oniriques.
|
|

Can Xue |
Brodant sans
discontinuer sur des thèmes similaires, elle a cependant
beaucoup évolué. Longtemps incomprise et se moquant de l’être,
elle a délaissé sa tour d’ivoire et prend aujourd’hui un
soin particulier à expliquer ses récits qui doivent aussi se
lire à la lumière des analyses des œuvres de ses auteurs favoris
qu’elle a publiées depuis une douzaine d’années.
Une jeunesse
sous Mao
De son vrai nom
Deng Xiaohua
(邓小华),
Can Xue (残雪)
est née en mai
1953 à Changsha, dans le Hunan (湖南长沙).
Son nom de plume est un jeu de mots révélateur sur l’adjectif
cán 残
qui signifie défectueux, et donc laissé de côté, restant ;
cánxuě 残雪,
c’est la neige qui reste, celle qui ne fond pas, mais à la fois
la neige sale, piétinée par les passants, qui reste sur le
bas-côté de la route, et celle, pure et brillante, qui forme les
neiges éternelles sur les plus hauts sommets des montagnes.
Can Xue se définit
ainsi dès l’abord comme un être dont les pieds foulent la fange,
mais dont les yeux sont résolument tournés vers le ciel, en
quête d’absolu et de pureté, dans un mouvement instinctif qui
n’a rien de religieux. Il s’agissait peut-être au départ tout
simplement d’un réflexe de survie.
Les traumatismes de
l’enfance
|
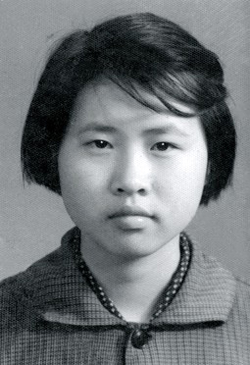
Can Xue enfant |
|
En effet, elle
n’a encore que quatre ans quand, en 1957, se déchaîne le
mouvement anti-droitiers qui détruit l’univers familial.
Ses parents travaillaient tous deux au journal du
Nouveau Hunan (新湖南报社),
à Changsha, dont son père – né en 1916 et entré au Parti
en 1938 - était directeur de la publication. Ils sont
déclarés droitiers et condamnés à la rééducation par le
travail. En 1958, la mère est envoyée travailler dans la
région du mont Heng (衡山),
non loin de Changsha, mais coupée de sa famille, tandis
que le père est muté à l’Ecole normale de Changsha, dans
les faubourgs de la ville : il y est balayeur, puis
gribouilleur dans la bibliothèque.
Toute la famille déménage alors dans un deux-pièces-cuisine
dans une grande maison partagée entre cinq familles, au
pied du mont Yuelu (岳麓山),
sur la rive ouest de la rivière Xiang (湘江).
Ils sont neuf, avec le père et la grand-mère, car Can
Xue a deux sœurs aînées, deux |
frères aînés, et deux cadets, nés en 1954 et 1955. Quand
survient la Grande Famine, à partir de 1959, la famille peine à
survivre. La grand-mère emmène les enfants ramasser des racines,
des champignons, des feuilles de chanvre sauvage supposées
calmer la faim en les mâchant, mais Can Xue et ses deux frères
cadets attrapent la tuberculose, et la grand-mère meurt de faim
en 1960.
|
C’est l’année où Can Xue entre à l’école primaire.
Heureusement, sa mère revient deux ans plus tard, en
1962 ; dans le climat de légère ouverture de la période,
elle reprend son travail au journal et la famille
déménage dans un logement de l’entreprise ; en 1963, Can
Xue est admise à l’école élémentaire des enfants des
employés du journal.
Elle n’ira pas plus loin que le primaire dans ses études, car,
quand elle s’apprête à entrer dans le secondaire, en
1966, c’est le début de la Révolution culturelle, les
collèges sont fermés et les élèves envoyés travailler à
la campagne.
Sa vie tourne au cauchemar : l’un de ses petits frères se
noie, son père est envoyé en prison par le Comité
révolutionnaire de l’Ecole normale, et sa mère
transférée dans une Ecole de cadres du 7 mai, pour être
à nouveau |
|

Can Xue jeune |
rééduquée. Le reste de la famille est dispersé. Can Xue
elle-même est renvoyée au dortoir de l’Ecole normale avec
permission de rendre visite à son père de temps en temps. Mais
il est souvent paradé dans les rues par les Gardes rouges, et
soumis à toutes sortes d’humiliations.
Le
travail au quotidien
En 1970, grâce l’une de ses sœurs aînées, Can Xue est admise
dans un poste médical de la banlieue de Changsha et devient
médecin aux pieds nus ; elle apprend l’acupuncture, les soins de
base, et va ramasser des herbes dans la montagne. L’année
suivante, elle est transférée dans une usine métallurgique et
passe les sept années suivantes à travailler comme ouvrière de
base à divers postes : fraisage, assemblage, tournage.
|

Can Xue avec son frère cadet en 2004 |
|
En 1977, elle rencontre son futur époux, Lu Yong (鲁庸) :
il revient alors à Changsha avec le frère aîné de Can
Xue, Deng Xiaomang (邓晓芒),
dont il était un ancien camarade de classe et avec
lequel il était parti comme « jeune instruit » à la
campagne où il était devenu menuisier. Le mariage a lieu
l’année suivante.
Can Xue devient adjointe d’enseignement dans une école
élémentaire. Ses parents sont réhabilités en 1979. Une
page est tournée. |
La
littérature enfin
La période de vaches maigres n’est pas terminée pour autant,
mais la situation s’améliore radicalement. En 1981, son père est
nommé secrétaire général adjoint du Comité de la Conférence
politique consultative populaire du Hunan, et Can Xue va vivre
avec lui, dans les locaux du Parti, avec son mari et son fils de
deux ans. En même temps, elle apprend à coudre avec son mari et,
en 1982, ils ouvrent une petite boutique de tailleur. Le
quotidien est assuré.
|
Pendant ce temps, Can Xue se remet aussi aux études
littéraires qu’elle n’a jamais pu mener à bien ; elle a
dû se borner à lire ce qui lui tombait sous la main, en
particulier à la bibliothèque de son usine. Elle repart
de la littérature chinoise,
Lu Xun (魯迅)
et
Xiao Hong (萧红)
en particulier, pour se tourner
très vite vers la littérature occidentale dont de
nombreux textes sont alors traduits, dans une atmosphère
d’effervescence intellectuelle et culturelle.
Et, en 1983, elle prend la plume et commence à écrire sa
première nouvelle : « La rue de la Boue jaune »
(《黄泥街》),
reflet d’un univers onirique et fantasmatique, émanation
de son moi le plus profond .
Un
univers onirique et fantasmatique
Can Xue se
présente d’emblée comme un ovni dans le
paysage littéraire chinois du début des
années 1980,
|
|
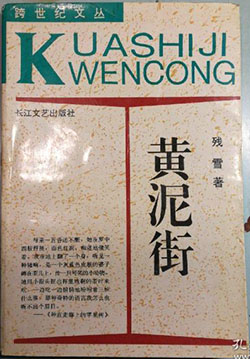
Rue de la Boue jaune, 1ère édition 1996 |
car elle se place
résolument dans une optique très personnelle, choisissant de
dépeindre son univers propre, dans un style influencé par
certains oeuvres occidentales où elle trouve un écho.
Les sources
personnelles
Quand elle commence à écrire, elle est conditionnée par son
passé récent et les histoires qu’elles couchent sur le papier
sont celles venues de son inconscient. Cette rue de la Boue
jaune est une rue misérable en bordure de la ville, proche sans
doute de celle de la banlieue de Changsha où elle a vécu pendant
des années, avec même une usine d’assemblage de machines comme
celle, sans doute, où elle a travaillé.
|
Il règne un climat paranoïaque, dans cette rue où chacun épie
son voisin dans l’obsession d’un complot et où se
multiplient les morts et disparitions mystérieuses.
Décrivant un monde en décomposition, le récit de Can Xue
se déroule entre une certaine réalité et la vision
hallucinée de cette réalité, sans que l’on sache où se
trouve la frontière entre les deux ; il n’y en a pas
vraiment. On devine les angoisses de l’enfant, puis de
l’adolescente prise dans les méandres d’une histoire
absurde qui soudain envoie ses parents en prison, en
rééducation, sans logique évidente. L’avenir est
incertain, et d’autant plus sombre que le monde autour
d’elle est sans raison.
A cela s’ajoute l’influence de la grand-mère qui l’a élevée un
temps, pendant la Grande Famine, en l’absence de sa
mère. C’était sa grand-mère maternelle (外祖母),
un
personnage étrange, dont elle a décrit les lubies, les
coutumes tirées du vieux fond de taoïsme populaire
du |
|

Dialogues au Paradis (1988) |
petit peuple chinois,
superstitieux et croyant aux esprits de toutes sortes. Alors
l’enfant est prise de peur, le soir, en entendant le bruit du
vent, et voit pulluler dans ses rêves insectes,
rats et chauve-souris que l’écrivain ensuite jette sur sa page
blanche.
Les influences
littéraires
Si Can Xue a tout de suite trouvé un style original, c’est
grâce à ses lectures, et à la découverte de Kafka et Borges.
Elle dira qu’elle a pratiqué une sorte de transplantation, comme
pour une plante : elle a pris un style et l’a transplanté en
terre chinoise avec ses racines.
Ce n’est pas une imitation, ni vraiment une influence. Ce que
Kafka et Borges lui apportent, c’est plutôt un univers parallèle
qui ressemble au sien, un univers spirituel avec lequel elle se
sent en symbiose.
Une
écriture instinctive
|
Mais tout reste extrêmement instinctif dans ses nouvelles des
débuts, et ce sont les plus célèbres, celles qui
continuent à être considérées comme ses œuvres
représentatives : outre « La rue de la Boue jaune »
publiée en 1987, « Dialogues
en Paradis » (《天堂里的对话》)
publiée en 1988,
« Old Floating Cloud »
(《苍老的浮云》)
publiée d’abord au Japon en 1989, et
« Five
Spice Street » (《五香街》),
roman publié d’abord à Hong Kong en 1990 sous le titre
de « Breakthrough
Performance » (《突围表演》),
puis en Chine continentale en 2002.
Si
« La rue de la Boue jaune » est l’œuvre où se révèlent
son univers et ses thèmes récurrents,
« Five Spice
Street » représente l’apogée de cette période, une sorte
d’achèvement dans l’absurde, mais un absurde bien
personnel qui tient de l’évanescence de la réalité. Le
personnage principal est une femme arrivée un jour dans
la rue aux cinq épices, où elle tient une petite
boutique avec son époux.
On ne sait
rien d’elle, même pas son nom ni son âge véritable, ce
qui attise d’autant plus la curiosité et les fantasmes
des habitants de la rue. Elle est méprisée et désirée,
adulée et vouée aux gémonies. Le roman entier est un jeu
sur les apparences et les rumeurs, et, pour brouiller
encore plus les pistes, Can Xue prétend que c’est son
autobiographie.
En quelques
années, elle a défini son univers et son style, mais,
quand on lui demande comment elle écrit, et ce que ses
histoires peuvent bien vouloir dire, elle répond qu’elle
ne sait pas, qu’elle écrit pour exister, parce qu’elle
n’existe que lorsque ses histoires sont là, sur le
papier, et qu’elles lui ouvrent la possibilité d’une
nouvelle existence.
Can Xue
l’insaisissable
|
|

Old Floating Cloud (2001)

Five Spice Street (2002) |
C’est alors – en 1992
- que sa traductrice française
Françoise Naour, qui
venait de traduire « Dialogues en Paradis », a fait tout le
chemin jusqu’à Changsha pour la rencontrer, arrivant avec trois
heures de retard, en fin de journée, dans un aéroport où
personne ne l’attendait : Can Xue inaccessible, dans une ruelle
introuvable, dans un quartier où personne ne la connaissait… et
finalement localisée grâce au Comité d’Education du quartier.
La traductrice un peu
perdue se retrouve face à une jeune Chinoise très maigre, qui
habite un rez-de-chaussée sombre éclairé aux néons, comme
partout à l’époque. Ce qu’elle constate, c’est que l’univers en
décomposition des nouvelles de Can Xue est là, devant ses yeux,
rien n’est inventé : la pièce est dans une obscurité permanente
depuis qu’on a construit un immeuble qui lui cache le soleil ;
dans la touffeur de l’été, le plancher moisit, et grouille de
petits vers ; il y a les bruits du voisinage, mais surtout les
odeurs terribles des latrines publiques apportées par le vent…
C’est la rue de la Boue jaune, dans la chaleur infernale de
l’été de Changsha.
Alors Can Xue se
dévoile, dit que les gens la méprisent et la jalousent parce
qu’elle touche son salaire d’écrivain professionnel, comme un
fonctionnaire, alors que son plus grand désir, c’est « qu’on la
laisse tranquille, qu’on l’ignore ». Elle emmène sa traductrice
au marché, lui montre les serpents, ses animaux favoris, comme
les chauves-souris, les lézards et les rats. C’est encore
l’univers de ses nouvelles, impossible de dissocier le réel de
la fiction.
Elle fait encore un
détour par la maison du Mont Yuelu qui est toujours là, adossée
à la montagne, toujours partagée entre cinq familles, et
toujours aussi misérable. Même si la bâtisse est maintenant
perdue au milieu d’immeubles, elle reflète toujours la solitude
qui fut celle de l’enfance de Can Xue, et qu’elle cultive
désormais, en fuyant les autres et leurs regards.
On comprend que,
confrontée à une réalité aussi pesante, elle ait eu besoin de
s’évader, de se libérer de tout cela : elle dit écrire pour
elle, pas pour être lue – sauf peut-être à l’étranger. Elle dit
aussi vouloir trouver son propre style, sans être influencée :
elle déclare ne plus lire, alors qu’elle a beaucoup lu quand
elle a commencé à écrire, dix ans auparavant, en 1983.
|
Peu à peu,
cependant, elle s’est ensuite remise à la lecture. A
partir de 1999, elle publie même des livres sur les
œuvres de ses auteurs favoris pour en donner son
interprétation, qui est autant un éclairage sur ses
propres écrits. A partir de là, Can Xue relève la tête,
prend de l’assurance, elle n’est plus du tout celle qui
ne se souciait pas de savoir si on la lisait et comment.
Elle explique aussi comment on doit lire ce qu’elle
écrit…
Le
tournant du millénaire
En 1999, elle
publie un ouvrage sur Kafka qui reste son auteur de
référence : « Le
château de l’âme
–
Comprendre Kafka » (《灵魂的城堡一理解卡夫卡》).
Dès lors, tout au long des années 2000, elle multiplie
les publications : plusieurs livres d’elle paraissent
chaque année, alliant essais littéraires et œuvres de
fiction, les uns venant éclairer les autres. Mais ce
travail de recherche |
|
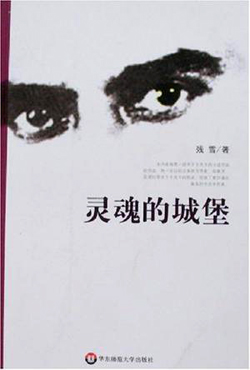
Le château de l’âme (1999, rééd. 2008) |
et d’analyse
littéraire se reflète aussi dans l’évolution de son écriture.
Rencontre de Calvino
|

La revanche de l’art (2003) |
|
Ses deux
auteurs fétiches restent Kafka et Borges.
Aussitôt après le livre sur Kafka, elle en a écrit un
sur Borges, paru en 2000 : « Décryptage de la lecture de
Borges » (《解读博尔赫斯》).
On passe subtilement du
理解
lǐjiě
du premier
titre – analyser pour comprendre en profondeur – au
解读
jiědú
du
second – déchiffrer un texte et l’interpréter.
Ce sont ensuite
Shakespeare, Goethe et Dante qu’elle « décrypte », en
2003 et 2004. Elle cherche délibérément à se replacer
dans le contexte de la grande littérature classique et
explore aussi le fonds commun d’imaginaire des anciens
mythes et légendes, en partant des mythes de la Grèce
ancienne et des épopées d’Homère, tout cela, de son
propre aveu, pour dépasser la seule culture chinoise.
|
Elle publie d’ailleurs
un ouvrage sur le sujet, en 2006 : « Les trésors des contes et
légendes » (《传说中的宝藏》).
|
Mais l’auteur
qui est pour elle une révélation et marque un tournant
dans son œuvre : c’est Italo Calvino, auquel elle
commence à s’intéresser dès 2002 et sur lequel elle
publie un premier ouvrage en 2005. Qualifié de « doux
tisseur » (温柔的编织工),
comme on dit doux rêveur, Italo Calvino lui apporte la
révélation d’un univers proche du sien, mais, en même
temps, elle découvre une œuvre beaucoup plus construite
et subtile, par la profondeur des lectures allégoriques
et symboliques qu’elle permet : une autre manière
d’écrire l’irrationnel.
Elle ne cesse
de l’approfondir, publiant un autre ouvrage sur Calvino
en 2009 : « La brillante fission » (《辉煌的裂变》).
Ses propres écrits prennent alors une autre tournure.
Ce n’est plus l’écriture instinctive, inconsciente, dont
elle se targuait à ses débuts et qui risquait de
s’enliser dans une voie sans issue, en répétant à
l’infini les mêmes thèmes et fantasmes. |
|

Œuvres choisies (2004) |
|

Can Xue avec son traducteur japonais
Kondo Naoko,
en octobre 2004 à Beida |
|
Mais sa
réflexion se poursuit aussi avec son frère aîné, le
philosophe Deng Xiaomang (邓晓芒),
avec lequel elle a publié plusieurs ouvrages et dont on
sent une certaine influence en particulier dans
l’évolution de ses conceptions littéraires et
artistiques.
Elle souligne
en particulier le rôle de la raison comme contrepoids à
l’irrationnel. Elle continue à se vouloir
« une
romancière qui écrit sous la dictée de l’inconscient » (靠发动潜意识来写作的小说家)
mais refuse l’idée que l’inconscient ne soit pas
contrôlé par la raison. Elle pense au
contraire que
|
l’inconscient est le
fruit d’une raison poussée à ses extrêmes, et que l’esprit de
raison au cœur de la philosophie occidentale est étroitement lié
à l’imaginaire en littérature. L’imagination ne peut naître,
selon elle, que de la raison (« 有理性才有幻想,没有理性也没有幻想。») :
c’est quand on parvient à en briser les limites que naît
l’imagination.
Un style en
évolution
|
Fruits de cette
réflexion et de ces recherches, ses nouvelles et romans
reprennent bien toujours les mêmes thèmes
fantasmatiques, mais leur style a évolué. Ce ne sont
plus des histoires ancrées dans le souvenir d’un passé
glauque et douloureux, mais des récits plus universels
qui traduisent plutôt l’absurdité du monde, et
l’impossibilité de le comprendre et d’y trouver sa
place. Ses personnages se meuvent dans des lieux
improbables, impossibles à localiser, souvent
souterrains ou au contraire suspendus dans les airs,
cherchant des issues qui n’existent pas ou changent à
l’infini, sans but évident et ni logique apparente.
Le pire est que
l’irrationnel, justement, semble réglé par un ordre
rationnel que la raison s’épuise à chercher, ou encore
que l’irrationnel côtoie le rationnel sans que la
frontière entre les deux soit clairement définie. Le
monde du rêve peut alors devenir un monde salvateur –
comme dans la nouvelle de 2007 « Danse sous la lune » (《月光之舞》)
où un malheureux personnage s’épuise à creuser le sol
comme un ver de terre, et entouré de vers de terre, ne
remontant qu’occasionnellement à la surface pour aller
voir le lion qui l’obsède, et revenant creuser,
peut-être à la recherche de son grand-père, qui est
peut-être vivant… victime de ses obsessions, il ne
semble revenir à un semblant de réalité reposante que
lorsque, fourbu, il s’endort et rêve.
Depuis une
dizaine d’années, au long de ses récits, Can Xue a
construit tout un bestiaire fantastique peuplé de ses
animaux favoris (serpents, chauves-souris, crocodiles,
vers de terre…) et tout un réseau d’allégories
récurrentes et de lieux incertains où errent ses
personnages, dont la quête est indéterminée, et donc
illusoire – comme dans la nouvelle « Le marécage »
(《沼泽地》),
ou plutôt « L’endroit marécageux », endroit indéfini qui
pourrait être sous la ville, quelque part derrière une
porte, ou dans l’obscurité en haut d’un escalier, et
auquel cherche à accéder un homme qui se dit maçon mais
que l’on prend pour un marchand de cobras … cela tient
de la quête du Graal, mais un Graal plus qu’illusoire,
un Graal inexistant, le rêve d’un Graal.
Approfondissement des thèmes
Son roman de
2008, « La Frontière » (《边疆》),
est caractéristique de la recherche stylistique que mène
aujourd’hui Can Xue, au-delà du pur irrationnel. C’est
un chef
d’œuvre surréaliste, mais qui plonge ses racines dans la
culture de l’ancien Etat de Chu (qui couvrait les
provinces actuelles du Hubei/Hunan). Pour l’écrire,
|
|
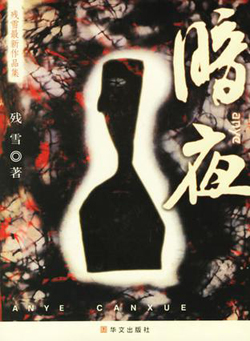
Nuit noire (2006)
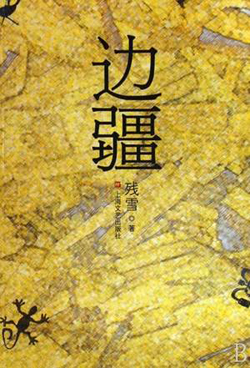
La frontière (2008)
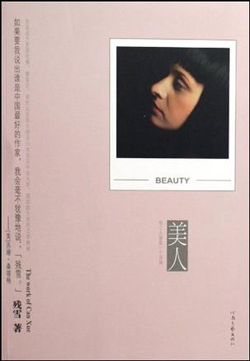
Beauty (2009) |
Can Xue dit avoir été
influencée par les « chants de Chu » (楚辞)
aussi bien que par les cinéastes Bunuel et Antonioni (dans leur
jeu sur le rêve et l’absurde).
|
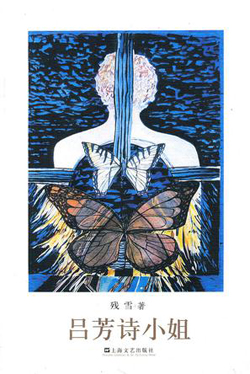
La jeune Lü Fangshi (2011) |
|
Le roman décrit
la vie mystérieuse d’une inconnue nommée Liu Jin (六瑾)
dans une étrange « petite ville de pierre » à la
frontière, ou une frontière. Des années
auparavant, ses parents étaient venus là à la recherche
de l’amour, mais pour finalement se rendre compte que
c’est un endroit où tout est irréel. Adulte, Liu Jin
décide de revenir sur les traces de ses parents. Elle y
rencontre toutes sortes d’êtres et animaux plus ou moins
fabuleux, et la ville de pierre devient alors pour elle
une sorte de « terre pure » (le « paradis de l’ouest »
des textes bouddhiques, mais hors connotation
religieuse).
Can Xue en a
fait le pendant fictionnel de son livre de souvenirs
publié la même année, comme, dit-elle, deux volets yin
et yang du même thème (« 一部写实,一部虚构,俨然一对阴阳版 ») :
« Exercice d’héliotropisme -
retour à l’univers spirituel
de mon enfance » (《趋光运动——回溯童年的精神图景》).
|
|
Transition ?
Ces dernières
années, elle a surtout publié des livres de critique
littéraire et des textes divers sur l’art et la
littérature qui témoignent de la poursuite de sa
réflexion et de ses recherches. Elle semble de plus en
plus opter pour des publications groupées, œuvre de
fiction/essai. Elle semble en outre opérer une
transition vers un style différent.
Récemment,
faisant suite au roman de 2011 « La
jeune Lü Fangshi »
(《吕芳诗小姐》),
son roman
« Histoires
d’amour du 21è siècle
» (《新世纪爱情故事》),
publié
en juin 2013, semble préfigurer une orientation
différente, plus axée vers une réflexion sur la société
moderne, en l’occurrence le besoin universel d’amour.
Un auteur
avide de se faire comprendre |
|

La boule de roses en cristal (2010) |
|
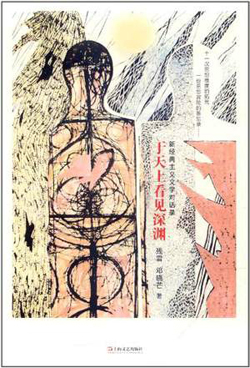
Sonder l’abîme du ciel (2011) |
|
Can Xue a
profondément évolué. Elle n’a plus rien de la jeune
femme sauvage et solitaire qu’a rencontrée Françoise
Naour en 1992, ni de l’écrivain instinctif qu’elle se
voulait être, en refusant de se préoccuper de ses
lecteurs. Le papillon est sorti de sa chrysalide. Vingt
ans plus tard, Can Xue est sortie de sa réserve et a
surmonté ses frayeurs maladives d’antan. En ce sens,
l’écriture a bien eu l’effet salutaire dont elle parlait
elle-même quand elle disait écrire pour changer sa vie.
Elle s’affirme
aujourd’hui comme un écrivain sûr de son talent, et qui,
loin de mépriser ses lecteurs, prend un soin extrême à
expliquer son œuvre pour éviter les incompréhensions.
Elle a même un blog où l’on trouve nombre de ses
interviews. Dans l’un de ces entretiens, elle répond à
un journaliste qui lui demandait comment elle pouvait
justifier vouloir dicter aux lecteurs sa propre
interprétation de récits pourtant énigmatiques, et
qu’il |
conviendrait
donc peut-être mieux de laisser à l’interprétation de chacun.
|
Elle répond, de
façon caractéristique, par une analyse de la différence
entre l’écrivain classique et l’écrivain contemporain,
et débouche sur une explication générale de sa réflexion
actuelle sur sa propre création :
Dans la
littérature classique, la conscience du moi n’était pas
très développée. Le courant dominant du réalisme dans la
littérature moderne n’a guère été qu’une réaction à la
création conceptuelle… Et tout le style de notre époque
peut se résumer en gros à un mode de « description
objective », l’écrivain se posant en observateur
extérieur décrivant une histoire laissée au jugement du
lecteur, formé selon une approche formelle semblable à
la méthode kantienne qui appuie l’analyse sur de mots
clés… mots-clés fournis par les critiques…
Mais les
temps ont changé, il y a personnalisation de l’œuvre
littéraire, l’écrivain et sa création ne font plus
qu’un. La création littéraire est caractérisée par un
|
|
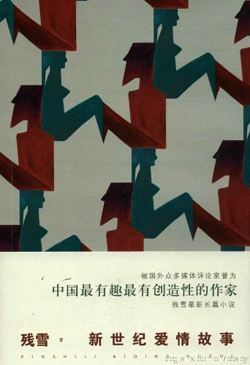
Histoires d’amour des
temps nouveaux (2013) |
haut degré de
conscience
individuelle qui est le
garant de la vérité humaine de l’œuvre ; la littérature tend à
rendre l’essence des choses. En raison même de cette conscience
exacerbée de l’ego dans la littérature moderne, un auteur ne
peut refuser d’écrire des critiques de ses propres œuvres, mais
aussi d’écrivains passés à la postérité, comme Kafka, Dante,
Borges, etc… Il n’y a plus tellement de différence entre
création littéraire et critique….
Can Xue s’inscrit
résolument comme une voix originale dans la littérature moderne.
Une auteure de
nouvelles avant tout
Sa première
publication, en 1988, celle qui l’a fait connaître, « Dialogues
en Paradis » (《天堂里的对话》), est un recueil de treize nouvelles courtes. Au total, entre
1988 et 2020, elle a écrit et publié 23 recueils de nouvelles,
contre neuf romans entre 1990 et 2019. Bien plus important, ce
sont ses nouvelles qui ont contribué à forger son style et son
univers si particulier. Les années 2000 sont une période
particulièrement prolifique, jusqu’en 2006. À part un recueil en
2009, il faut attendre 2014 pour retrouver des publications de
nouvelles, mais c’est alors une série de quatre recueils qui
sont publiés d’un coup dans l’année, suivis encore de trois de
2016 à 2020.
C’est
un recueil de seize nouvelles traduites en anglais –
I Live in
the Slums (《贫民窟是我的家》)
- qui lui vaut une nomination pour l’International
Booker Prize annoncée en mars 2021.
Parallèlement, il est intéressant de voir l’entrelacs de
publications de textes de fiction et d’essais sur les auteurs
qu’elle étudie, et qui l’influencent, à partir de 1999.
Principales
publications en chinois
1988年《天堂里的对话》,作家出版社
Dialogues
en Paradis, recueil de nouvelles
1989年《苍老的浮云》,日本河出书房新社
Old Floating Cloud,
publié au Japon
1990年《突围表演》,香港青文书屋
Breakthrough Performance,
titre initial de « Five Spice Street, publié à Hong Kong
《种在走廊上的苹果树》,台湾远景出版社
1994年《思想汇报》,湖南文艺出版社
Rapport
idéologique (recueil de nouvelles)
1995年《辉煌的日子》,河北教育出版社
Jours
de gloire (recueil de nouvelles)
1996年
《黄泥街》,长江文艺出版社
Rue
de la Boue jaune (1ère édition en Chine)
1998年《残雪文集》(四卷),湖南文艺出版社
Anthologie
en 4 volumes, aux éditions du Hunan
1999年《灵魂的城堡一理解卡夫卡》(评论),上海文艺出版社
Le Château de l’âme
–Comprendre Kafka
2000年《解读博尔赫斯》(评论),人民文学出版社
Décryptage de la
lecture de Borges
《奇异的木板房》,云南人民出版社
Une étrange cabane de
bois (recueil de nouvelles)
《美丽南方之夏日》,云南人民出版社
Jours d’été dans le
sud somptueux (mémoires)
《残雪散文》,浙江文艺出版社
Recueil d’essais, aux
éditions du Zhejiang
2001年《黄泥街》,长江文艺出版社
Rue
de la Boue jaune
2002年《五香街》,海峡文艺出版社
Five Spice Street
(roman), réédité en 2011 aux éditions des Ecrivains
《松明老师》,海峡文艺出版社
Recueil
de nouvelles et une pièce de théâtre
2003年《地狱的独行者》(评论),北京三联书店
Promeneur
solitaire en enfer (essai sur Shakespeare et Goethe)
《艺术复仇》(评论),广西师大出版社
La revanche de l’art
(essais littéraires)
《残雪访谈录》,湖南文艺出版社
Recueil d’interviews
2004年《残雪自选集》,海南出版社
Œuvres choisies
(nouvelles courtes et moyennes)
《永生的操练:解读但丁
》(评论),北京十月文化出版社
Préparation à la vie
éternelle, décryptage de Dante
2005年《双重的生活》,台湾木马文化
Vie double, publié
à Taiwan
《温柔的编织工:残雪读卡尔维诺与波黑士》(评论),台湾边城出版社
Le doux tisseur,
lecture d’Italo Calvino par Can Xue, publié à Taiwan
《最后的情人》(长篇),花城出版社
Le
dernier amant (roman)
2006年《传说中的宝藏》,春风文艺出版社
Trésors
de contes et légendes
《暗夜》,华文出版社
Nuit
noire (recueil de nouvelles)
《末世爱情》,上海文艺出版社
Amour
fin de siècle (recueil de nouvelles)
2007年《残雪文学观》,广西师范大学出版社
Les idées de Can Xue
sur la littérature
《把生活变成艺术-我的人生笔记》
,时代文艺出版社
La vie comme art – notes sur ma vie (recueil d’essais)
2008年
《趋光运动——回溯童年的精神图景》,上海文艺出版社
Exercice
d’héliotropisme – retour à l’univers spirituel de mon enfance
《边疆》,上海文艺出版社
La Frontière (roman)
2009年《黑暗灵魂的舞蹈:残雪美文自选集》,文汇出版社
La danse
d’une âme obscure : textes choisis sur l’art et la littérature
《辉煌的裂变》
,上海文艺出版社
La brillante fission (réflexions sur Italo Calvino)
《美人》
,河南文艺出版社
Beauté (recueil de nouvelles)
2010年《玫瑰水晶球:残雪散文》,鹭江出版社
La boule
de roses de cristal (essais littéraires)
2011年《吕芳诗小姐》,上海文艺出版社
La
jeune Lü Fangshi (roman)
《于天上看见深渊》,上海文艺出版社
Sonder l’abîme du ciel (dialogues avec
Deng Xiaomang
邓晓芒)
2013年《新世纪爱情故事》,作家出版社
Histoires
d’amour du 21e siècle (roman)
2014年
4 recueils de
nouvelles aux éditions du Hunan
湖南文艺出版社
《侵蚀》 Corrosion
《情侣手记》
Notes
d’amoureux
《垂直的阅读》 Lecture
verticale
《紫晶月季花》 Les
fleurs de la rose d’améthyste
2015年/2017年
《黑暗地母的礼物》,湖南文艺出版社
Le Cadeau de la sombre
terre-mère (roman en deux volumes)
2016年
《神秘列车之旅》,漓江出版社
Voyage dans un train
fantôme (recueil de cinq nouvelles zhongpian)
2019年
《一株柳树的自白》,中国工人出版社
Monologue
d’un saule pleureur (recueil de nouvelles)
《赤脚医生》,湖南文艺出版社
Médecin aux pieds nus (roman)
2020年
《茶园》(残雪全新小说自选集),山东文艺出版社
La
Plantation de thé (sélection de 17 nouvelles choisies par
l’auteure)
Traductions en
français
- La
petite cabane dans la montagne, in :
Les
meilleures œuvres chinoises 1949-1989,
éditions Littérature chinoise, coll. Panda, Beijing 1989, pp.
364-368.
-
Dialogues en Paradis,
traduit par
Françoise Naour. Gallimard, janvier 1992.
- La
Rue de la Boue Jaune,
traduit par Geneviève Imbot-Bichet. Bleu de Chine, avril 2001.
Traductions en
anglais
- Dialogues in Paradise
《天堂里的对话》,
Collection of thirteen short stories.
Translated by
Ronald R. Janssen and Jian Zhang. Northwestern University Press,
1989.
- Old Floating Cloud: Two Novellas
(Yellow Mud Street
《黄泥街》/
Old Floating Cloud
《苍老的浮云》).
Translated by
Ronald R. Janssen and Jian Zhang. Northwestern University Press,
1991.
- The Embroidered Shoes
《绣花鞋》.
Translated by
Ronald R. Janssen and Jian Zhang. Henry Holt, NY 1997.
- Blue Light in the Sky and Other Stories.
Translated by Karen
Gernant and Chen Zeping.
New Directions Books,
New York 2006.
Recueil de 14 nouvelles
datant de 1992-2006.
Extrait numérisé de la
première nouvelle (Blue Light in the Sky) et de la postface :
http://www.amazon.fr/Blue-Light-Sky-Other-Stories/dp/0811216489/ref=sr_1_10?s=english-
books&ie=UTF8&qid=1378362892&sr=1-10&keywords=can+xue#reader_0811216489
- Five Spice Street
《五香街》.
Translated by Karen
Gernant and Chen Zeping. Yale University Press, 2009.
- Vertical Motion.
Collection of short stories.
Translated by Karen
Gernant and Chen Zeping. Open Letter, 2011.
Excellente critique :
http://quarterlyconversation.com/vertical-motion-by-can-xue
- The Last Lover
《最后的情人》,
Translated by
Annelise
Finegan Wasmoen,
Yale University
Press, 2014.
- Frontier
《边疆》,
translated
by Karen Gernant and Chen Zeping, Open Letter, 2017.
-
Love in the New
Millenium 《新世纪爱情故事》,
translated by
Annelise
Finegan Wasmoen, foreword by Eileen Myles, Yale University
Press, Nov. 2018,
A lire en complément
Histoires d’amour du 21è siècle, notes de
lecture.
I
Live in the Slums, sélection International Booker Prize
C’est ce qu’elle déclare dans la postface au recueil
« The Blue Light in the Sky » (《天空里的蓝光》).
Borges, et non García Márquez, car celui-ci, dit-elle,
décrit le monde extérieur, ce qui ne l’intéresse pas.
La nouvelle a été publiée dans le numéro 13 d’avril 2013
du magazine Chutzpah/Tian Nan 天南,
pp 171-188. Elle se prêtait particulièrement bien à
l’illustration du thème du numéro : « A suivre » (没完成),
évoquant une sorte de mouvement perpétuel à jamais
inachevé, et célébrant l’inachèvement et l’incertitude.
https://www.douban.com/group/topic/39221685/
|
|

