|
|
Club de lecture du
Centre culturel de Chine
Compte rendu de la
troisième séance
et annonce de la
séance suivante
par
Brigitte Duzan, 11 avril 2018
|
La troisième séance du Club de lecture du Centre
culturel de Chine s’est tenue le 10 avril 2018, dans
la médiathèque du Centre.
Elle était consacrée au roman de
Bi Feiyu (毕飞宇)
Tuina (《推拿》),
paru en Chine en 2004, couronné du prix Mao Dun en
2011 et publié en traduction française en 2011
également, sous le titre « Les Aveugles », aux
éditions Philippe Picquier. Animée par Brigitte
Duzan, la séance s’est déroulée en présence du
Directeur des études du Centre culturel, Zhu Ming,
et avec le concours de la traductrice du roman,
Emmanuelle Péchenart.
Selon le protocole désormais bien établi, les
membres présents ont d’abord exposé leurs
impressions de lecture, en ajoutant commentaires et
questions suggérés par le roman. |
|
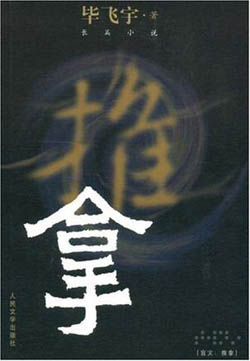
Tuina, le roman en chinois |
Deux types de réactions
Les réactions, dans leur ensemble, se sont partagées entre
l’expression d’un grand plaisir de lecture, et, mais dans une
moindre mesure, celle d’une angoisse croissante au fur et à
mesure de celle-ci.
-
Profonde angoisse
Trois lectrices ont exprimé ce sentiment d’anxiété né de la
description très évocatrice du monde des aveugles, une sorte de
peur instinctive, et profonde, allant jusqu’à les empêcher de
poursuivre la lecture jusqu’au bout. L’une décrit son
appréhension du noir déclenchant, à la lecture, une impression
d’étouffement à la limite de la claustrophobie, la poussant à
arrêter de lire ; une autre parle de la montée graduelle de son
angoisse tout en reconnaissant avoir beaucoup aimé la peinture
des rituels de la vie quotidienne des aveugles, et celle de
leurs rêves, de leurs espoirs, de leurs trésors d’imagination.
Celle-ci a laissé « Les Aveugles » pour se plonger dans le « Don
Quichotte sur le Yangtsé » et a trouvé dans ce livre un grand
plaisir : des chapitres courts, un texte fluide, léger malgré
les souffrances décrites, et lu d’un bout à l’autre sans hiatus.
-
Intérêt et plaisir
|
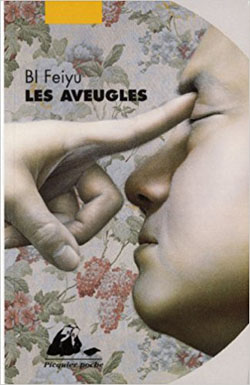
Les Aveugles, traduction en français |
|
Le plaisir, voire l’enthousiasme, était la réaction dominante
dans l’ensemble, avec des nuances dans l’appréciation. Même la
lectrice déclarant ne pas avoir aimé le livre reconnaît que
c’est plutôt parce qu’elle n’aime pas beaucoup lire en général,
et dit avoir trouvé l’approche intéressante, et en particulier
la peinture très fouillée de chacun des personnages ; simplement
elle n’a pas « accroché » - un livre, commente un autre
participant, est une rencontre qui dépend de la personnalité de
chacun.
Ce participant enchaîne sur son propre plaisir de lecture,
suivant et complétant celui ressenti à la lecture de « L’opéra
de la lune » (《青衣》)
,
l’évocation du monde des aveugles suivant celle du monde de
l’opéra, et tout aussi réussie à ses yeux
.
Il a particulièrement aimé le traitement du récit, par petites
touches introduisant des allusions à l’économie, la société, la
|
vie quotidienne, ainsi que des tableaux très personnels, la
description des mariages, par exemple (mariage-bicyclette et
mariage-cacahuètes), allant jusqu’à acheter des cacahuètes non
décortiquées pour vérifier l’image. La seule critique qu’il
exprime vient d’un trait caractéristique des aveugles qu’il a pu
constater : ils ont beaucoup d’humour, et il n’en a pas trouvé
dans le livre.
|
Critique
aussitôt contrée par un autre participant qui lui
oppose certains dialogues du livre : il y a de
l’humour, mais il est subtil. Il a beaucoup aimé
« Les Aveugles », contrairement à « La Coquette de
Shanghai »
dont il avait détesté la sécheresse du ton et du
style. Il a trouvé « Les Aveugles » bien écrit, et
traduit. Les seules critiques qu’il aurait à
exprimer tiennent à sa frustration de ne pas
connaître le sort de certains personnages, celui-ci
étant laissé, finalement, à l’imagination du
lecteur. Il a aussi regretté le manque de liens
entre les différents chapitres. En revanche, la fin
lui a semblé remarquable, avec cette inversion des
deux mondes des aveugles et des voyants, les voyants
étant ceux, finalement, qui ne « voient » rien, et
l’infirmière, à la toute fin, découvrant dans le
force du regard de la seule voyante du groupe le
gouffre inconnu de la non voyance qui soudain se
révèle à son esprit.
L’une des participantes dit avoir lu le livre très
vite, en une |
|
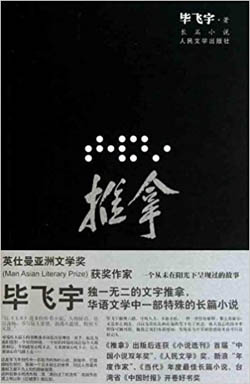
Couverture avec le titre en braille |
semaine, et avoir découvert un monde qu’elle ne soupçonnait pas.
Une autre, enfin, dit n’avoir pas terminé parce qu’elle ne cesse
de lire et relire des passages qu’elle trouve formidables,
passages sur le silence, toutes sortes de silences, passage sur
la beauté, comme scandé (qu’est-ce que… qu’est-ce que…), passage
sur le temps, où le rythme s’impose. Elle s’anime en parlant et
montre les pages évoquées, cornées et recornées, un livre
martyrisé, mais qui vibre de sa lecture, un livre qui affiche à
lui seul le plaisir de cette lecture.
|
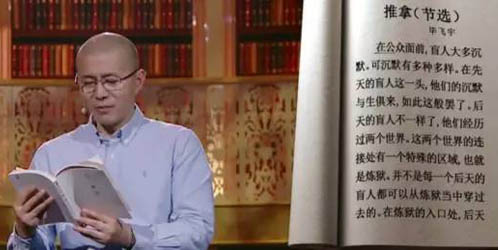
Bi Feiyu lisant son roman en mémoire
de son père, aveugle à la fin de sa vie |
|
Dans l’ensemble, le roman suscite des réflexions approfondies
sur les aveugles, et en particulier sur leur caractère gai,
contrairement aux sourds-muets, beaucoup plus coupés de leur
environnement, les uns faisant souvent des études
universitaires, et les autres plutôt
|
l’apprentissage d’activités manuelles, explique l’un des
lecteurs présents. Et cette gaieté se retrouve, justement, dans
le livre.
Certains – dont la lectrice qui a déclaré ne pas avoir aimé le
livre - ont même poussé l’intérêt jusqu’à vouloir faire
l’expérience concrète de la cécité, en allant dans un restaurant
parisien dont les repas sont servis dans le noir le plus absolu.
Comme disait l’un des participants au début, un livre est une
rencontre, que chacun vit à sa manière.
Commentaires de l’animatrice et de la traductrice
Brigitte Duzan reprend brièvement certains des
points restés en suspens, dont celui concernant le
flou dans lequel Bi Feiyu, à la fin de son récit,
laisse le sort ultérieur de certains de ses
personnages, et en particulier celui de Sha Fuming.
C’est un reproche qui lui a souvent été adressé,
dans le cas de ses nouvelles surtout, laissées pour
la plupart avec des fins ouvertes. Il a toujours
répondu à ces critiques en invoquant son souci de
réalisme : c’est normal, dit-il, car il en est ainsi
dans la vie.
Exploration d’un monde intérieur
|
La parole est ensuite revenue à la traductrice,
Emmanuelle Péchenart. Elle avait déjà répondu à l’un
des participants qui louait sa traduction, pour son
sens du rythme, en disant que, justement, rendre
le rythme du texte dans la traduction était une
chose à laquelle elle était particulièrement
attachée.
Elle commence par souligner la maîtrise avec laquelle, dès le
début, Bi Feiyu parvient à dépeindre son groupe d’aveugles sans
recours à des éléments
|
|

La traductrice Emmanuelle Péchenart
(à dr.), avec Brigitte Duzan |
visuels, comme on le ferait instinctivement.
Elle donne pour exemple la métaphore que donne l’auteur dans sa
description de la beauté féminine : belle comme un plat de
porc au caramel.
Tous les autres sens viennent se substituer à la vue, le sens
olfactif comme l’ouïe ou le toucher. Ce que nous livre Bi Feiyu,
c’est avant tout une exploration d’un monde intérieur, magnifié
par la cécité.
Problème de titre
En ce sens, le titre français choisi par l’éditeur oriente le
lecteur vers une perception du roman qui est contraire et au
titre chinois et au début du texte original. En effet, ce que
décrit Bi Feiyu pour commencer, c’est le centre de tuina
qui va être le cadre de son récit, et les professionnels qui
pratiquent ce genre de massage ; seules des indications
indirectes suggèrent qu’ils sont non-voyants (ils distinguent
l’importance de leurs clients à leur voix).
Le titre français est le choix de
l’éditeur.
A sa décharge, le terme de tuina était
inconnu au moment de la parution du livre en France, mais les
Britanniques ont préféré titrer Massage. C’est également
le titre anglais choisi, en Chine, pour la pièce de théâtre
adaptée du roman et donnée à Nankin en 2014
.
Choix de traduction
|

Une nouvelle participante, plongée
dans la lecture des Aveugles |
|
Emmanuelle Péchenart évoque ensuite le problème du
choix des temps, qui est récurrent et fondamental
dans les traductions du chinois, langue qui ne
connaît pas la flexion des verbes. Elle a opté pour
une double solution : récit au passé, et passage au
présent narratif pour indiquer
une situation plus actuelle. Exemple au chapitre 2 : il commence
par un présent qui dénote l’action en cours quand débute ce
chapitre ; il se poursuit au passé pour décrire la santé de Sha
Fuming, et son évolution au fil du temps. |
Une question est posée concernant la traduction des noms
propres, également problématique dans le cas de traductions du
chinois. Ici, aucun nom n’est traduit, alors que la
signification n’est pas anodine parfois. C’est le cas du prénom
Fuming (复明),
par exemple, dont il est mentionné indirectement (p. 67) qu’il
signifie « retrouver la lumière ». Une note sur les noms aurait
pu être utile
.
Dans le même ordre d’idée, si le roman est remarquablement
construit, les liens entre les chapitres, comme il a été
mentionné, sont un peu flous, et les titres n’aident pas le
lecteur à se retrouver dans l’intrication des multiples
personnages entre eux. De l’avis général, il manque une table
des matières pour mieux visualiser l’ensemble. Elle est donnée
dans la publication en chinois.
Table des matières
Chaque titre reprend un nom de personnages, voire plusieurs.
Leur imbrication montre celle des personnages entre eux. Le
récit est encadré par un préambule et un épilogue.
|
引言 定义
第一章 王大夫
第二章 沙复明
第三章 小马
第四章 都红
第五章 小孔
第六章 金嫣和泰来
第七章 沙复明
第八章 小马
第九章 金嫣
第十章 王大夫
第十一章 金嫣
第十二章 高唯
第十三章 张宗琪
第十四章 张一光
第十五章 金嫣、小孔和泰来、王大夫
第十六章 王大夫
第十七章 沙复明和张宗琪
第十八章 小马
第十九章 都红
第二十章 沙复明、王大夫和小孔
第二十一章 王大夫
尾声 夜宴 |
|
Préambule : Définitions
Chap. 1 : Dr Wang
Chap. 2 : Sha Fuming
Chap. 3 : Xiao Ma
Chap. 4 : Du Hong
Chap. 5 : Xiao Kong
Chap. 6 : Jin Yan et Tailai
Chap. 7 : Sha Fuming
Chap. 8 : Xiao Ma
Chap. 9 : Jin Yan
Chap. 10 : Dr Wang
Chap. 11 : Jin Yan
Chap. 12 : Gao Wei
Chap. 13 : Zhang Zongqi
Chap. 14 : Zhang Yiguang
Chap. 15 : Jin Yan, Xiao Kong et Tailai, Dr Wang
Chap. 16 : Dr Wang
Chap. 17 : Sha Fuming et Zhang Zongqi
Chap. 18 : Xiao Ma
Chap. 19 : Du Hong
Chap. 20 : Sha Fuming, Dr Wang et Xiao Kong
Chap. 21 : Dr Wang
Epilogue : Le banquet |
Texte chinois en ligne :
https://www.kanunu8.com/book3/7339/index.html
Note sur « Don Quichotte sur le Yangtsé »
Emmanuelle Péchenart est revenue sur le « Don Quichotte »
suggéré en lecture complémentaire : un texte à teneur
cathartique, écrit par Bi Feiyu pour son fils. Comme souligné
par l’un des lecteurs qui l’avait lu et beaucoup aimé, c’est un
texte qui se lit aisément. Le ton est empreint de nostalgie, et,
contrairement à l’opinion du participant qui avait regretté un
ton trop lisse, n’est pas totalement dépourvu de critique, même
dans le fameux passage où il relate sa dénonciation d’un
camarade, « comme tout le monde à l’époque ».
Emmanuelle Péchenart, cependant, s’est demandé si le témoignage
n’était pas un tantinet enjolivé, mais reste quand même sous le
charme de certains épisodes, celui de la grand-mère et des fèves
en particulier, l’un des points d’orgue du récit.
Le roman est comme un superbe documentaire sur les mentalités et
les coutumes de l’époque, mais aussi sur le caractère de
l’écrivain lui-même, doublement privé d’identité : identité liée
à la terre ancestrale ruinée par les nombreux déménagements,
identité familiale anéantie par la découverte du nom d’emprunt
de son père, ouvrant un vide autour de lui. Un roman, au final,
qui recèle les mêmes qualités d’écriture que « Les aveugles »
dans la description fouillée des personnages et des détails de
la vie quotidienne.
Cette troisième séance confirme l’intérêt de ce Club pour
affiner la lecture de textes chinois et mieux les faire
comprendre des lecteurs, tout en soulignant leur perception des
qualités, mais aussi des défauts d’une œuvre, dans sa traduction
et son édition en français, défauts qui, en retour, peuvent
nuire à la lecture.
Prochaine séance
La quatrième et dernière séance de l’année (scolaire) en cours
est fixée au mardi 12 juin, et sera consacrée à
Ge Fei
(格非)
et à son court roman
paru en Chine en 2001 : « Poèmes à l’idiot » (《傻瓜的诗篇》).
Poèmes à l’idiot, trad. Xiaomin Giafferri-Huang, l’Aube, 2007,
124 p.
Lecture complémentaire proposée
Impressions à la saison des pluies, trad. Xiaomin
Giafferri-Huang, l’Aube, 2003
|
|

