|
Club de lecture du
Centre culturel de Chine
Séance « hors les
murs » du 15 juin 2021
Compte rendu de la
séance et avant-programme 2021-2022
par
Brigitte Duzan, 20 juin 2021
|
Le Centre culturel de Chine étant toujours fermé, la
séance de clôture de l’année 2020-2021 s’est tenue
le 15 juin 2021 « hors les murs », en l’occurrence
dans un lieu emblématique de la création
littéraire : le Café de la Mairie de la place
Saint-Sulpice à Paris, ce café même où,
observant les passants devant lui sur la place,
Georges Pérec écrivit en 1974
« Tentative d'épuisement d'un lieu parisien ».
Aucune d’entre nous n’a pensé à prendre
|
|
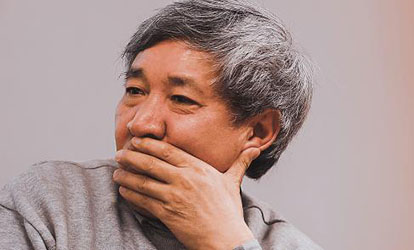
Yan Lianke
(qui rappelle la phrase de Camus
« Il faut
imaginer Sisyphe heureux ») |
une photo de nous, l’ombre de Pérec planait au-dessus de nos
têtes, mais surtout nous étions absorbées par le sujet à l’ordre
du jour et nous avons fait de cette séance exceptionnelle un
« Yan Lianke mode d’emploi ».
C’était en effet
Yan
Lianke (阎连科)
qui était au programme, et plus exactement ses deux derniers
romans écrits et traduits en français, ainsi que trois textes
complémentaires :
- « Les
Chroniques de Zhalie » (《炸裂志》),
2013,
- « La
Mort du soleil » (《日熄》),
2015,
- Deux
nouvelles dites « moyennes » : « Les Jours, les mois, les
années » (《年月日》),
2002, et « Un Chant céleste » (《耙耧天歌》),
1998.
- Plus
le
récit autobiographique « En songeant à mon père » (《想念父亲》),
2009.
Dans le plus parfait respect des normes sanitaires en vigueur,
nous étions six,
microcosme certes, mais représentant pourtant très bien la
diversité du Club. D’ailleurs, après une discussion préalable
sur les joies de la lecture en période de confinement et les
perspectives à venir du Club, quand nous en sommes venues au
cœur du sujet, l’échange de vue a commencé, du bout de la table,
comme du fond de la classe, sur un ton un résolu : « Eh bien
moi, je n’ai pas aimé, mais pas du tout. »
Elle n’avait rien aimé, Martine, ni le fond ni la forme, et
n’avait même pas pu arriver au bout des « Chroniques de Zhalie ».
C’était inattendu.
Une telle déclaration a d’habitude pour résultat immédiat de
jeter un froid dans l’assistance, selon la formule quasiment
consacrée. Mais il faisait bien trop chaud ce jour-là, et la
discussion initiale avait délié les langues et les esprits. Ce
fut en fait la pierre dans la mare qui déclenche des ondes sur
une eau jusque-là parfaitement tranquille.
Eloge des zhongpian
|
La première réplique fut mesurée, comme ménageant un
compromis : « J’ai surtout aimé les zhongpian. »
Exit les Chroniques, pleins feux sur les nouvelles,
en commençant par « Les Jours, les mois, les
années », son vieil homme attachant, resté seul avec
son chien aveugle à lutter contre la sécheresse et
les loups en soignant son unique pied de maïs… Le
plus étonnant, dans tout cela, souligne Sylvie : les
odeurs, l’odeur du chapeau de paille blanche,
piétiné pour s’être laissé emporter par le vent,
mais surtout celle des feuilles du maïs :
« Le jeune vert de la plante jaillissait comme une
source fraîche sous le soleil rouge et brun. As-tu
senti, demanda-t-il au chien. Comme c’est odorant !
A quatre ou cinq kilomètres on peut sentit cette
humidité fraîche et tendre… »
« Les Jours, les mois, les années » a également été
commenté dans un avis
parvenu par courriel. Le texte est dépeint comme un
« hymne à la vie » dans un monde hostile et
sinistre, où le danger est partout, avec la
figure touchante du chien aveugle, fidèle compagnon
de « L’aïeul », pathétique dans sa résignation
patiente et muette. « C’est « un roman "darwinien",
tout en symboles, se prêtant à
plusieurs interprétations possibles selon l’humeur
et l’état d’esprit de lecteur. »
« Un Chant céleste » reprend la même poésie, d’où
émerge, mémorable, le dialogue avec le père suicidé.
À quoi on peut ajouter le récit autobiographique
« En songeant à mon père », en petites vignettes
d’une intense sensibilité.
Eloge des « Chroniques de Zhalie »
Le tour de table s’est poursuivi tandis que
s’élargissait l’onde autour de la pierre jetée dans
la mare. Ce sont « Les Chroniques de Zhalie » qui
ont emporté l’adhésion de Geneviève et qui l’a
développé : roman, nous dit-elle, sur la
métamorphose du territoire chinois au début du 21e
siècle, roman à la fois de science-fiction et de
« réalisme magique » cachant un réseau de rouages
politico-mafieux qui privilégient la fin quels que
soient les moyens. L’inventivité constante se saisit
du réel pour en faire un récit mythique. C’est un
roman aux accents poétiques et bucoliques,
humoristique et drôle.
Yan Lianke joue avec maestria sur l’absurde
complexité de ce pays vieux de 4 000 ans, qui
pourraient bien passer bientôt à 5 000 et dépasser
les grandes civilisations concurrentes car telle est
la volonté de puissance du gouvernement actuel comme
le soulignait récemment Anne Cheng dans son cours au
Collège de France. |
|
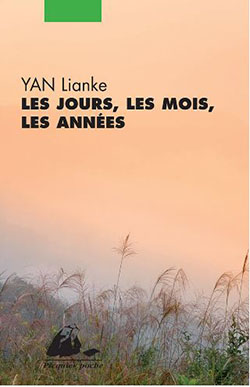
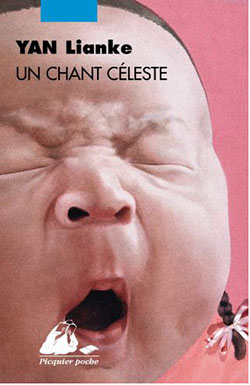
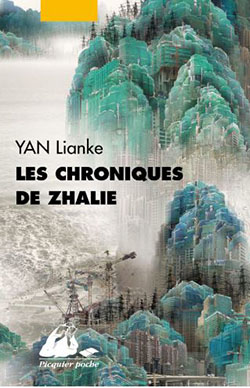 |
C’est Yan Lianke qui l’a dit : « Le réalisme chinois nous
contraint à une nouvelle forme d’écriture ». Il s’agit de
« mettre en évidence la réalité invisible ».
|
C’est donc un roman comme un conte. Le village
initial s’enrichit par le vol et la prostitution,
les deux clans rivaux s’unissent par les liens du
mariage, la corruption règne, ils le disent
eux-mêmes : « Mon vieux, nous sommes corrompus. » On
s’attend forcément à une déflagration finale. Elle
arrive sous un jour très inventif, le village est
vidé de sa substance, il faudra des dizaines
d’années pour qu’il renaisse. Mais c’est constant
dans l’histoire de la Chine.
Le dernier épisode n’est pas moins savoureux,
termine Geneviève. L’écrivain Yan Lianke revient à
Zhalie en avion remettre son manuscrit au maire, qui
fait brûler ces Chroniques sulfureuses et lui
ordonne de déguerpir. Sur quoi l’écrivain le
remercie d’avoir lu le livre et de l’avoir trouvé
suffisamment bon pour mériter d’être brûlé…
Malgré les derniers chapitres dont on peut trouver
les développements un peu exagérés, selon l’avis
quasi général, le roman reste un plaisir de lecture.
Avis enthousiaste sur six romans et les nouvelles
Après ces témoignages positifs, avec des nuances
pour les « Chroniques », il manquait encore une
appréciation de « La Mort du soleil ». On semblait
tourner autour. Christiane s’en est chargée, mais en
le dépassant allègrement : outre les nouvelles, ce
sont six romans, et non seulement les deux proposés,
qui ont fait l’objet de son avis enthousiaste, car,
ayant aimé ceux du programme, elle avait lu dans la
foulée les quatre romans précédents : « Bons baisers
de Lénine » (《受活》)
et « La Fuite du temps » (《日光流年》)
parus en 2004, « Le Rêve du village des Ding » (《丁庄梦》),
en 2006, et
« Les
Quatre livres » (《四书》),
en 2011.
À partir de notes copieuses prises au fil de ses
lectures, stylo à la main, elle a fait, selon ses
propres termes, « un survol de ce qui fait pour moi
la force de cet auteur », en commençant par les
thèmes et en continuant avec le style, en montrant
toute la diversité et la complexité de l’écriture de
l’auteur qui l’avait poussée, de livre en livre, à
poursuivre ses lectures.
Elle a fait elle-même une synthèse de ses notes de
lecture– donnée ci-dessous en Note complémentaire.
Conclusion
On pouvait
difficilement imaginer avis de lecture plus complets
et plus propres à inciter à la lecture de ces œuvres
qu’on a la chance d’avoir en traduction, et en
bonnes traductions
.
C’est là que le Club de lecture |
|

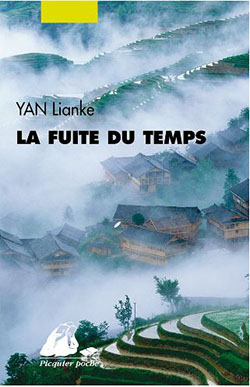
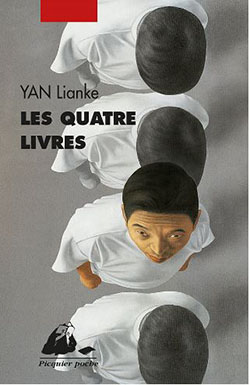 |
montre toute son utilité, avec l’attrait d’une discussion
soutenue permettant la confrontation des points de vue. On
ressortait de là en ayant l’impression d’avoir, non point épuisé
le sujet, mais ouvert de nouvelles pistes de lecture, avec
l’envie éventuelle d’en lire plus.
Avant-programme 2021-2022
En fin de séance ont été abordées les perspectives pour la
rentrée et l’année prochaine. Il est encore impossible de savoir
quand exactement va rouvrir le Centre culturel de Chine. Quoi
qu’il en soit, le Club se réunira à la rentrée, en respectant
les normes sanitaires qui seront alors en vigueur. Plusieurs
possibilités sont à l’étude, mais il sera toujours possible de
revenir au Café de la Mairie, et peut-être alors au premier
étage.
Pour ce qui concerne le programme, l’auteur choisi pour
commencer l’année sera sans doute
Liu
Xinwu (刘心武) :
écrivain un peu oublié aujourd’hui, mais auteur d’une œuvre très
intéressante dont beaucoup de textes ont été traduits en
français, et la plupart par l’excellent traducteur et sinologue
qu’est Roger Darrobers. Il offrirait aussi la possibilité d’une
séance de cinéma, avec l’un des meilleurs films du début des
années 1980, adapté de sa nouvelle Ruyi (《如意》).
Comme déjà évoqué à plusieurs reprises, l’œuvre proposée ensuite
serait« Le Pavillon aux pivoines » (ou Mudanting
《牡丹亭》)
de
Tang Xianzu (汤显祖),
le chef-d’œuvre de la fin du 16e siècle qui nous
retiendrait vraisemblablement pour deux séances, avec là aussi
la possibilité d’un détour au cinéma.
http://www.chinese-shortstories.com/Histoire_litteraire_xiaoshuo_IV_Du_chuanqi_des_Tang_
au_chuanqi_des_Ming.htm
Note complémentaire
Avis de Christiane Pompei sur la force d’écriture ressentie à la
lecture des romans et nouvelles de Yan Lianke, selon deux axes
principaux, les thèmes et le style.
1.
Les thèmes
 Thèmes sociopolitiques :
Thèmes sociopolitiques :
Hormis La mort du soleil, construit comme une
métaphore du monde contemporain, le thème central des romans est
l'histoire de la Chine et ses problèmes socio-politiques : le
scandale de la vente du sang et de la contamination par le sida
dans Le rêve duvillage des Ding ; la modernisation
galopante de la Chine et ses répercussions, notamment dans les
campagnes, dans Les chroniques de Zhalie ; la
pollution des sols et les problèmes de santé qui en résultent
dans La fuite du temps ; la confrontation
capitalisme/communisme dans Bons baisers de Lénine ;
les camps de rééducation dans Les quatre livres.
Mais ce ne sont que le centre apparent du roman. Derrière eux,
d'autres problèmes sont abordés. Ainsi :
- dans La fuite du temps, les dégâts causés par la
politique du Grand Bond en avant et la famine qui a suivi,
- La corruption et la mégalomanie des dirigeants, le courage et
la misère des paysans, les abus des administrations dans
Bons baisers de Lénine),
- L'auto-censure des médias et le travestissement de la
réalité dans La mort du soleil par le biais d’un
article d'une demi-page pour rendre compte d'un phénomène qui a
ravagé tout un district, et le présenter comme un incident
bénin :
« Episode mineur de somnambulisme(...). Une rumeur mensongère
s'est répandue (...). Afin de faire cesser cette rumeur et de
rétablir le bon ordre social, le gouvernement a missionné un
grand nombre de cadres et de policiers pour enquêter et aider la
population à retrouver rapidement la stabilité. » (Mort du
soleil, p.377).
...
 Thèmes qui touchent à l'universel humain,
mais souvent abordés de façon singulière :
Thèmes qui touchent à l'universel humain,
mais souvent abordés de façon singulière :
- Le thème du temps dans La mort du soleil
(p.319) :
« Les gens du bourg rêvent du passé » / « Les
campagnards rêvent de l'avenir »
« D'un côté comme de l'autre, personne ne parlait du
présent. »
Le « vivre le présent »présenté sous un angle
collectif, une trouvaille.
- Le temps est également présent dans la construction
même des romans, notamment dans La fuite du temps.
- Les âges de la vie font l'objet de fines analyses :
dans La fuite du temps, superbes passages sur les
amours d'enfance et sur la façon dont émergent des figures de
chefs dans les groupes d'enfants; la vieillesse et ses attitudes
face à la vie illustrées par de beaux personnages, comme le
vieil homme dans Les jours, les mois, les années,
le grand-père du Rêve du village des Ding, ou
Maozhi dans Bons baisers de Lénine.
- Le thème de l'humain :
= La distinction entre « gens complets « et « handicapés », qui
joue un rôle-clef aussi bien dans la nouvelle Le chant
céleste que dans Bons baisers de Lénine et
dans La fuite du temps, porte à s'interroger sur
le vrai sens des valeurs de l'humain et de la bienveillance, le
ren 仁
prôné par Confucius.
= La distinction enfants/adultes amène un questionnement du même
ordre quand, dans Lafuite du temps, on voit les
enfants du village partir chercher les handicapés rejetés dans
une ravine lors de la grande famine et les enterrer par couples
pour les soustraire aux corbeaux et les préserver de la
solitude.
 Autres thèmes, plus personnels, aperçu de l’univers intérieur de
Yan Lianke
Autres thèmes, plus personnels, aperçu de l’univers intérieur de
Yan Lianke
-
Le thème du sacrifice, présent dans plusieurs ouvrages.
= dans La Mort du soleil : le père du narrateur
Niannian se sacrifie pour sauver le village en proie à une
épidémie de somnambulisme en servant de pilier à un feu
gigantesque pour fabriquer un soleil factice destiné à sortir le
monde du sommeil (à noter que pour ce feu il utilise l'huile de
crémation qu'il a récupérée au crématorium, ce qui donne lieu à
une réflexion sur l'incinération que déplorent les paysans, et
sur le sacré.
= dans Les quatre livres : l'Enfant du ciel se
crucifie lui-même (au milieu des fleurs rouges que lui ont
attribuées les autorités, symbole de son mérite) en expiation
des crimes inhumains liés à la grande famine et aux camps de « novéducation ».
= la mère du Chant céleste se donne la mort pour
que ses enfants nés idiots puissent, en consommant une potion
faite avec ses os, devenir des « gens complets ».
- Notons aussi que dans Songeant à mon père Yan
Lianke évoque sa découverte des vertus de la prière, et que
Les quatre livres comme La fuite du temps
sont ponctués de référence à la Bible et au Bouddha. Dans
La mort du soleil, le narrateur invoque les dieux et
leur soumet son récit.
Faut-il pour autant parler d'accents religieux ou mystiques ?
Pas sûr, car dans toutes ces œuvres on trouve plus de questions
que de réponses dogmatiques ou de professions de foi.
 Thèmes liés à la création littéraire elle-même
Thèmes liés à la création littéraire elle-même
La mort du soleil
évoque à la fois la question de l'inspiration et celle du
rapport auteur/lecteur.
- Yan Lianke se trouve en proie à une panne d'inspiration et
semble suggérer qu'une crise de somnambulisme pourrait y
remédier (p.227 sq).
- En choisissant de confier le rôle de narrateur à un jeune
idiot de son village, Yan Lianke en tire parti pour se mettre en
scène dans le roman et poser la question: pour qui écrit-on ?
Qui touche-t-on, peut-on toucher, et comment ?
L'auteur s'adresse à son narrateur (Mort du soleil
p.235):
« Niannian, je te le demande comme une prière,
peux-tu me raconter les histoires de ta
famille ?
Je voudrais écrire un livre qui parle de cela, des
questions de vie et de mort chez nous.
Ce livre-là, peut-être que tu ne seras pas le seul à l'aimer,
peut-être qu'au village et au bourg ceux qui savent lire
l'aimeront ».
A travers ces thèmes, Yan Lianke ne se contente pas de dénoncer
des abus, mais s'attache plutôt à faire surgir des
questionnements.
- Dans Bons baisers de Lénine, questionnement sur
la façon dont le capitalisme en Chine instrumentalise des idoles
communistes: le chef de district veut acheter la momie de Lénine
pour enrichir le district et y développer le tourisme.
-
Dans le même roman, questionnement sur ce qu'est le
« Bien-Vivre » :
= vivre tranquille en vivant « caché », soustrait aux directives
des autorités, comme le village de Benaise avant la « jointaie »,
ou bénéficier de la solidarité de l'Etat au risque de perdre ses
libertés et d'être soumis à l'arbitraire, voire à la violence,
de décisions venues d'en-haut ?
= être handicapé mais humain, ou « gens complet » et d'un
égocentrisme qui peut mener à la mort des autres ?
= privilégier l'argent et la prospérité économique, ou la vie
rurale dans une société qui se contente de vivre, dans
l'aisance, du travail d'une terre fertile ?
Ces distinctions sont abordées de manière subtile, sans
caricature. Ainsi, les personnages ne sont ni tout bons
ni tout mauvais, même s'ils peuvent le devenir sous la pression
des circonstances. Ils sont complexes comme la réalité.
Mais c'est surtout le style de Yan Lianke qui est enchanteur,
et chaque fois différent.
2.
Le style
L’attrait de ce style en perpétuel changement peut être lié à
quatre facteurs différents: la force des images, le sens du
rythme du récit, la richesse des symboles, et la créativité
époustouflante dans la construction des romans.
 La force des images
La force des images
Liée aux correspondances incessantes tissées entre les sons, les
couleurs ou les lumières, les odeurs. Il est vrai que cela peut
parfois paraître un peu trop systématique, comme dans le début
de La fuite du temps, mais les descriptions sont
frappantes. Témoin ce passage de Bons baisers de Lénine
dans lequel l’auteur exprime la stupeur d'un paysan qui découvre
la grande ville, à travers les odeurs – ce qui rejoint la
remarque précédente sur les odeurs dans
Les Jours, les
mois, les années :
« (...) des gens partout. Et partout des automobiles. Leur
essence sentait encore moins bon que le purin dans les
porcheries ou les étables de Balou, c'était une odeur chaude,
visqueuse et puissante. Au moins, à la campagne, le fumet
s'échappe par filets, par effluves, là la puanteur engluait la
ville comme un paquet, on la trouvait dans les rues, dans les
venelles, partout. » (livre IX, début du chapitre 5).
 Le sens du rythme
Le sens du rythme
- Dans Servir le peuple, crescendo dans le délire
et la frénésie dans la relation entre le jeune soldat Wu Dawang
et la femme de son colonel, jusqu'au moment où, brusque rupture
de rythme, on lui signifie son congé et le régiment est dissous.
- Dans La mort du soleil, montée progressive puis
accélérée de la violence des somnambules qui fait penser au
rythme de l'air des gnomes pourchassant Peer dans le Peer Gynt
de Grieg (suite 1/Palais du roi de la montagne).
Son sens du rythme est fait de lenteurs et d'accélérations, de
sauts dans l'inconnu et de répétitions, avec un art du
retournement final qui laisse en plein questionnement. Ainsi
pour la fin de Servir le peuple : on comprend que
Wu Dawang a été instrumentalisé pour donner un enfant à la femme
du colonel impuissant, mais on ignore pourquoi celle-ci a
disparu à la fin du roman : n'était-elle à son tour qu'un pion
au service du pouvoir, représenté en ce cas par le colonel, ou
était-ce un élément secret du pouvoir lui-même, en ce cas
au-dessus du colonel ?
 La richesse des symboles
La richesse des symboles
- Symbolisme des nombres
= « le troisième jour, lorsque le soleil s'est enfin levé » (
La mort du soleil) :
retour à la vie ?
= Quatre livres comme les quatre Evangiles.
= Dans Bons baisers de Lénine, ce symbolisme des
nombres prend un caractère délirant avec le détail des nombres
de piliers choisis pour le mausolée de Lénine, les pins et les
cyprès dont le nombre et même la circonférence ont un rapport
avec les grandes dates de la vie de Lénine, etc.
L'accumulation de détails finit par créer ici un effet
comique.
- Symbolisme des couleurs
Dans La mort du soleil, les gens du bourg, au plus
fort de leur lutte contre ceux des villages environnants,
doivent se coiffer d'un turban jaune. Jaune évoquant les Turbans
jaunes de Zhang Jiao qui souleva le peuple chinois contre la
dynastie han jugée décadente ? Ou comme la couleur des Taiping,
ou encore celle des empereurs? Le texte évoque le désir des gens
du bourg de retourner à l'époque des Ming, tout en évoquant
aussi « le roi Chuang », Li Zicheng...
Le symbolisme du texte ouvre toutes ces pistes.
 L'inventivité dans la construction de chacun des romans
L'inventivité dans la construction de chacun des romans
La fuite du temps
Division en cinq livres qui remontent le temps à rebours, de la
mort du chef Sima Lan au livre I à sa naissance au dernier
livre. Au chapitre 1 du livre III, quand Yan Lianke écrit : « Toute
chose poursuit son retour vers l'état originel », il semble
nous offrir une clef de cette construction?
Chaque livre correspond à une époque de la vie de Sima Lan, mais
aussi à la gouvernance de tel ou tel chef de village, chacun
ayant un projet pour contrer la « maladie de la gorge qui
obstrue » et qui condamne les villageois à mourir avant la
quarantaine, chaque projet échouant après avoir mobilisé les
forces de tous les villageois.
De plus, chaque livre s'ouvre sur un passage d'un texte sacré,
soit un texte bouddhique soit la Bible, comme si Yan Lianke
s'interrogeait sur la Providence (titre du premier chapitre du
livre). Mais... providence ou destin ?
Les chroniques de Zhalie
Dans une préface éclairante, Yan Lianke souligne que le monde
qu'il voit devant lui est « une réalité où l'impossible est
possible ». Il se réfère à Kafka, à la littérature
sud-américaine, mais aussi à la Bible : « lorsque Dieu dit
que la lumière doit être et qu'elle est ». Et cela fait
penser à Mingyao qui, dans le roman, décide de faire surgir un
immense aéroport en moins d'une semaine, et y parvient. On a
affaire à ce qu'il appelle une « vérité mytho-réaliste »,
qui évoque un monde contemporain fait « d'absurdité
ordinaire » et de chaos, et où la Nature est sens dessus
dessous: le printemps surgit en plein hiver, les poiriers
donnent des pommes et les animaux parlent, comme si la Nature
était à la botte du rêve de toute puissance des hommes.
Là encore, la construction est « travaillée », le préambule
évoque la liberté accordée à Yan Lianke d'écrire ces chroniques
comme il l'entend, le chapitre XIX évoque sa remise des
chroniques au maire qui refuse de les publier et l'expulse de la
ville. Mais comme le maire Mingliang est mort tué par son frère
au chapitre précédent, de quel maire s'agit-il? Celui du
préambule, ce qui inscrit le récit dans une sorte de mise en
abyme. Yan Lianke joue ici encore du réel et de l'irréel, mais
la vérité est bien que son livre est refusé, et qu'il y voit la
marque qu'il est « vrai », puisqu'il dérange.
Bons baisers de Lénine
Chaque chapitre est suivi de « commentaires » sous forme de
notes linguistiques et historiques qui dévoilent l'arrière-plan
du récit en jetant une lumière sur la culture du village de
Benaise.
Le rêve du village des Ding
La construction est moins complexe dans ce roman de 2006. Elle
repose sur une juxtaposition entre les rêves du grand père et le
récit des événements, dont les rêves étaient comme une
prémonition. Une curiosité cependant : le narrateur,« en
première personne », est mort, c'est le petit-fils du grand
père, empoisonné à l'âge de douze ans.
Les quatre livres
Le roman est constitué de trois séries de textes qui alternent.
- un texte au ton biblique sur l'Enfant du ciel (à noter que les
personnages ont tous un caractère faut-il dire « générique » ou
symbolique ? Le Religieux, l'Ecrivain, l'Erudit, et une femme,
Musique).
- un récit intime de l'écrivain qui raconte le quotidien du camp
de rééducation : le vieux lit
-
un carnet de délation du même écrivain, destiné aux autorités :
les criminels.
- le quatrième livre n'apparaît qu'à la fin, c'est Le
nouveau mythe de Sisyphe, écrit par l'érudit qui avait
chargé l'Enfant de le remettre aux autorités. On y trouve une
version inversée du Mythe de Sisyphe : la pierre doit être
poussée avec force pour pouvoir descendre, mais arrivée en bas
de la pente elle remonte toute seule. Ce nouveau mythe est comme
un écho du chapitre du livre sur « la pente enchantée »
(p.172sq). Cela ne semble pas anodin car cette pente magique est
découverte par l'Enfant et le Religieux alors qu'ils se rendent
au bourg et alors que le Religieux vient de raconter à l'Enfant
le mystère de l'Incarnation en évoquant l'Immaculée conception.
Or, on s'aperçoit au fil du récit que l'Enfant finit par faire
d'une Bible en BD son livre de chevet, et pour finir il meurt en
se crucifiant comme s'il s'assimilait au Christ Rédempteur.
Mais le livre évoque aussi le bouddhisme, et suscite une
multiplicité de niveaux d'analyse, ou de pistes de réflexion.
Par exemple, page 406 : « De ce côté-ci de la montagne,
Sisyphe est le Sisyphe occidental.
De ce côté-là, l'oriental ».
Que veut dire Yan Lianke ? Quand Sisyphe fait rouler son rocher
du bas de la montagne vers le sommet, il parvient à donner un
sens à sa souffrance absurde grâce à la rencontre d'un Enfant
lumineux qui lui fait découvrir l'amour. Dans la seconde version
du mythe, quand il fait rouler avec peine son rocher du haut de
la pente vers le bas, ce qui finit par lui rendre acceptable son
destin est la rencontre de la vie réelle des hommes, les
villages au loin, les fumées de la vie quotidienne, les
enfants qui jouent. Un Sisyphe chrétien mais
individualiste, un nouveau Sisyphe oriental sensible aux
collectivités humaines ? C'est peut-être une piste, mais
réductrice eu égard à la richesse de ce texte.
La mort du soleil :
l'un des plus violents mais des plus beaux romans de Yan Lianke.
Ici, l'originalité est d'abord que le narrateur est un jeune
idiot du village de Yan Lianke, qui le connaît et le lit, ce qui
permet à l'auteur de faire maintes remarques pleines d'humour
sur son œuvre et de se mettre lui-même en scène sous le regard
de cet idiot. D'autre part le narrateur, au départ, invoque les
dieux, les supplie de l'écouter et de l'aider à mettre en ordre
son récit.
Le roman se décline en cinq livres dont chacun correspond à une
« veille », jusqu'au livre IX « Après les veilles »*. A
l'intérieur de chaque livre, de chapitre en chapitre, le temps
se met à balbutier et buter sur des périodes de temps de plus en
plus courtes, jusqu'au livre X : « Nulle veille », qui commence
à 6 heures... et s'arrête à 6 heures; le temps s'est arrêté,
comme le soleil a cessé de briller, jusqu'au sacrifice du père.
Cela donne au récit un rythme effréné, malgré les répétitions,
ou peut-être plutôt renforcé par les répétitions. L'usage
des répétitions donne une couleur de conte oral à cette histoire
métaphorique d'une épidémie de somnambulisme qui déchaîne toutes
les pulsions primaires et les désirs inconscients : vol, viol,
pillage, meurtre, violence paroxystique.
Mais pourquoi le titre de chaque livre fait il référence aux
oiseaux? Quel est le sens de ce symbolisme poétique ? **
Un mot pour finir de la nouvelle Les jours, les mois,
les années : un petit bijou d'écriture.
Même si on y retrouve le sens des images propre à l'écriture de
Yan Lianke, il y a ici une épure qui donne toute sa force au
récit. Le texte est tout entier centré sur l'unique vieillard
resté dans un village déserté par les paysans qui ont fui la
sècheresse, sur l'unique relation qu'il entretient avec son
chien aveugle, sur l'unique pied de maïs qu'il s'acharne à
sauver malgré la sècheresse, et sur l'espace d'une année.
On y trouve en outre de superbes passages sur cette nuit où le
vieillard, parti à la recherche d'eau, se trouve nez à nez avec
une meute de loups et doit veiller la nuit entière pour parvenir
à leur échapper ; ou encore sur la relation du vieillard à ce
chien qui finit par être assimilé à un être humain, puisque son
maître le charge de recouvrir de terre son cadavre quand il se
voit près de mourir.
Si Les quatre livres tient de l'oratorio, cette
nouvelle a la force d'une tragédie.
Commentaires de Brigitte Duzan
* Commentaire 1 : les veilles
Yan Lianke reprend ici le concept de « veille » qui correspond à
une ancienne division de la nuit en cinq « veilles » (ou
gēng
更).
Voir :
La nuit et ses cinq
veilles : origine et utilisation dans la littérature et à
l’opéra
** Commentaire 2 : les oiseaux
Cette présence des oiseaux dans les titres de chapitres du roman
« La Mort du soleil » est effectivement frappante et intrigante.
Je pense que c’est parce que l’oiseau est un symbole de liberté
chez Yan Lianke, témoin ce texte qu’il a écrit pour une commande
en 2018 : « Les oiseaux en cage en Chine » (《中国笼鸟》),
dont on trouve le texte avec une traduction en anglais sur le
site du Salon du livre international d’Edinbourg qui en était le
commanditaire :
https://www.edbookfest.co.uk/look-and-listen/writing/freedom-papers/china-s-caged-birds
Le texte a pour sujet la liberté. Yan Lianke y parle des pays où
l’on ne voit qu’une faible lumière filtrant à travers la porte,
que l’on regarde comme un homme affamé voyant quelqu’un jeter
une boîte contenant de la nourriture. Mais, dit-il, c’est aussi
comme un oiseau enfermé dans une cage qui siffle ses plus beaux
chants pour que son maître sorte sa cage et l’accroche dehors à
la branche d’un arbre. Mais dehors, sous le ciel bleu, l’oiseau
en cage voit les autres oiseaux en liberté et ne peut que
comparer leur sort au sien.
Le titre du premier chapitre précise que ce sont « les oiseaux
sauvages » (野鸟) qui
ont pénétré l’esprit des hommes, d’où l’on peut penser qu’avec
eux, c’est l’esprit de liberté qui s’est emparé d’eux. Mais
ensuite les oiseaux sont morts « au cœur de la nuit » …
|

