Lu Wenfu « Nid
d’hommes »
陆文夫 《人之窝》
par Brigitte Duzan, 2
décembre 2019
|
Initialement paru dans
la revue « Le monde de la fiction » (《小说界》), « Nid
d’hommes » (Ren zhi wo 《人之窝》)
[1] est un
roman publié en 1995 par
Lu Wenfu (陆文夫)
[2]. C’était
douze ans après « Un Gastronome » (《美食家》), la
nouvelle qui l’a rendu célèbre et reste considérée
comme son œuvre la plus représentative. Cependant,
si cette nouvelle était une célébration relativement
optimiste et pleine d’humour de la culture raffinée
de Suzhou au lendemain de la Révolution culturelle
qui n’avait pu l’annihiler, « Nid d’hommes » est un
douloureux regard sur le passé récent qui a failli
anéantir la ville : le roman couvre la période
allant de la fin des années 1940 à la fin des années
1960, mais en sautant « les dix-sept années » entre
1949 et 1966, en prenant comme épicentre du récit la
vaste demeure de la famille Xu (许家大院子) dont le
dédale de cours forme le cadre de vie des
personnages et dont la décadence progressive est
l’image de celle de la ville. |
|
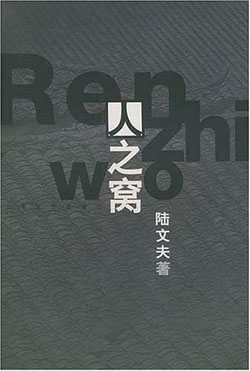
Ren zhi wo, édition 1995 |
Le récit est divisé en deux parties, avant 1949 et de 1966
jusqu’au grand départ des citadins pour la campagne trois
ans plus tard. Au début, la vieille demeure délabrée sort
peu à peu de son atonie quand une bande de jeunes, étudiants
et artistes, invités par leur ami Xu Dawei (许达伟), unique
héritier de la famille, viennent s’installer dans une cour
du logis vidée de l’un de ses occupants.
Le roman dépeint la vie remuante de ces jeunes dans
l’immense demeure dont les innombrables cours sont peuplées
d’anciens protégés du pater familias qui s’accrochent à
leurs mètres carrés en essayant de rogner sur ceux du voisin
dans une tentative désespérée d’agrandir son espace vital.
C’est une sorte de cour des miracles, un monde clos où
rumeurs et intrigues vont bon train et où ne parviennent
qu’étouffées les nouvelles de l’approche de l’armée
communiste : nous sommes en pleine guerre civile, et Lu
Wenfu se plaît à décrire avec un humour cinglant la
corruption et l’insouciance des cadres du Guomingdang qui
mènent une vie de luxe et de plaisir, au bord de l’abîme.
Dans ce contexte, les huit étudiants et artistes font figure
de dangereux communistes, partageant, selon la rumeur,
femmes et logis. Ce qui les inquiète le plus, cependant, ce
sont leurs histoires d’amour. Lu Wenfu semble s’amuser à une
satire bien enlevée des romans dits
« de papillons et canards mandarins »
en vogue à la fin des Qing.
|
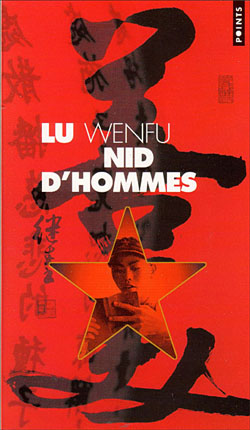
Nid d’hommes, traduction française
(Points 2004) |
|
Mais le thème principal
du roman est la recherche de logement dans un
contexte où il était difficile pour les familles de
se loger – problème primordial souligné par le titre
du chapitre 20 : « D’abord avoir un palais doré »
(先有黄金屋).
C’est ce problème du logement qui suscite les plus
vifs conflits dans la vieille demeure des Xu où se
sont installées diverses familles, au départ
recueillies par bonté d’âme par le patriarche
disparu. L’arrivée des étudiants, réquisitionnant
quelques pièces libérées par l’arrestation d’un «
espion », provoque un regain de tension. Chacun
trame en secret quelque manigance pour parvenir à
mettre la main sur une pièce supplémentaire en
cherchant des appuis ici et là, mais tout en gardant
une grande prudence car on ne sait pas qui va
l’emporter, des Nationalistes et des Communistes, et
ce que le proche avenir réserve.
C’est ce même problème du logement que l’on retrouve
dans la deuxième partie du roman comme source de
manigances et de conflits démultipliés par la crise
causée par la croissance démographique. |
Au niveau stylistique, le roman garde des traces des traits
caractéristiques du roman classique dit « à chapitres » (huí
回), qui attestent de l’évolution du genre à partir de l’art
des conteurs. Comme pour une soirée de conteur, le chapitre
commence par un résumé de ce qui va suivre (limité ici à la
tête de chapitre) et se termine par une phrase ou deux
annonçant la séance suivante et la suite de l’histoire, et
invitant les spectateurs à revenir (huí 回).
A la fin du chapitre 23, par exemple, Wan Qingtian vient de
s’entretenir avec Fei Tingmei des problèmes de l’avenir du
Jardin des Xu, elle lui demande quelle est la solution. Il
n’y en a pas (没有办法), lui répond-il… mais Lu Wenfu termine
par la phrase :
万青田嘴里说没办法,心里的办法却在逐步地完善。
Wan Qingtian prétendait qu’il n’y avait pas de solution,
mais en lui-même la solution était pourtant bel et bien en
train de prendre forme peu à peu.
Le conteur aurait sans doute ajouté : revenez demain, je
vous dirai comment… le récit ménage le suspense.
C’est un texte d’une telle richesse qu’il mérite quelques
éclaircissements et commentaires. Après un aperçu des
personnages, il est intéressant de se pencher sur certains
termes et expressions, et relever tout au long des pages ce
qu’on peut trouver comme références littéraires, poétiques
et musicales qui contribuent à créer l’atmosphère et le
cadre, soulignés aussi par quelques références historiques.
A/ Les
personnages
• Les cinq habitants de la vieille demeure de la famille
Xu (chap. 1, 2 et 3)
Xu Dawei (许达伟), le jeune maître (许家大少爷), dernier héritier
Fei Tingmei (费亭美), sa mère, épouse de Xu Chunwei (许春葳), 3ème
fils de la famille Xu, parti à l’étranger
Wan Qingtian (万青田), dit Troisième oncle (三舅), majordome et
comptable de la famille (许家的总管兼帐房), surnommé Wan le voyou
(万青皮) (voir vocabulaire)
Gao Xiaoti (高孝悌), ami de Xu Dawei, dit Petit frère (小弟), le
narrateur
La mère Hu (胡妈), la vieille domestique de la famille
• Les six amis de Xu Dawei, outre le narrateur,
quatre étudiants, deux collégiens (chap. 4 et 5)
Zhu Pin (朱品), peintre, étudiant aux Beaux-arts,
Xu Yong et Luo Fei (徐永和罗非), étudiants en chimie et physique
(读化学,物理)
Ma Haixi (马海西)
Shi Zhaofeng (史兆丰) et Zhang Nankui (张南奎)
• Les femmes
A Mei (阿妹), nièce de la mère Hu, embauchée par Xu Dawei
(chap. 7 : 乡下的阿妹)
Et accessoirement (chap. 27) : sa belle-mère et son homme de
main A Zhuang (阿戆) [3],
ainsi que le petit mari atteint de bilharziose qui lui est
promis, seulement désigné par « le petit homme au gros
ventre » (半桩子的小男人).
Luo Li (罗莉), sœur cadette de Luo Fei
[4],
Liu Mei (柳梅), jeune veuve habitante du n° 6 (chap. 9 et 11),
ancienne concubine de Jia Boqi (贾伯期), frère de Xu Chunwei
donné à la famille Jia pour qu’elle ait un héritier.
L’épouse de Jia Boqi (chap. 28).
• Les habitants hébergés dans la vieille maison
(chap. 8-10)
- Jiang Renshan (蒋仞山), ancien habitant du n° 4, accusé de
trahison et incarcéré
- La « Grosse Belle-Sœur » du n° 2 (住在二号门里的胖阿嫂), belle-sœur
de personne, surnom tiré de l’expression en dialecte de
Suzhou ou de Shanghai : une sorte de poissarde dévoyée (“白相人嫂嫂”),
de son vrai nom Orchidée blanche (白兰花) – épouse de Geng
Longbiao (耿龙彪) qui avait sauvé la vie du vieux maître de
maison, d’où hébergé au n’° 2 pour surveiller la sœur du
maître, veuve vivant à l’étage, dite « la vieille bouddhiste
» (老佛婆)
- Grande Cui et Petite Cui (大翠,小翠), filles de la Grosse
Belle-Sœur, prostituées comme elle.
- Awu, vendeur de pastèques (卖西瓜的阿五), habitant dans la
cuisine du n°1
- Wu Zikuan (吴子宽), habitant du n° 3, dans sa jeunesse poète
et fondateur avec Xu Chunwei du Cercle poétique de la Pluie
céleste (“天雨诗社”), proche du Guomingdang et de Li Shaobo
(李少波), lieutenant-colonel nationaliste, officiers des
renseignements militaires, libertin et opportuniste
- Xu Yiming (许逸名), oncle de Xu Dawei, opiomane invétéré
(百无一用的鸦片鬼), habitant du n° 3.
- Monsieur Wang (王先生), nommé Wang Zhiyi (王知一) (chap. 29),
auteur du « Miroir universel de l’océan des désirs »
(《欲海通鉴》), et Zhu Yi (朱益), dit le vieux Zhu (朱老头), habitants
du n’° 5, l’un écrivain et violoniste, l’autre brocanteur
- Jiaojiao (姣姣) [5],
fille de Monsieur Wang.
• Deuxième partie, nouveaux personnages
- Wang Yongfu (汪永富), un chef de rebelles (黑头头 : noir,
couleur des gangs de la pègre), surnommé Petit Teigneux
(小瘌痢) (voir présentation chapitre 3)
- Tao Jingen (陶金根), le maître de la boutique de galettes qui
a recueilli Wang Yongfu.
- Tao Lingdi (陶伶娣), sa fille.
- Xu Liang (许亮) et Xu Ming (许明), les fils de Xu Dawei et Liu
Mei.
- Lin Awu (林阿五), l’ancien vendeur de pastèques devenu
responsable du comité de quartier.
- Wang Yushu (王玉树), fille de Wang Zhiyi, la petite Jiaojiao
devenue activiste.
- son ami Zhao Xiaoshan (赵晓山), le « lettré » de la fabrique
de quincaillerie.
- Jin Leshan (金乐山), descendant de la famille Jin et héritier
de sa fabuleuse collection de livres anciens
- Niangniang (娘娘), fille d’un peintre demeurée vieille
fille, et détentrice d’une précieuse collection de peinture.
(Les deux collections sont sauvées par le vieux Zhu, mais
les deux croyant avoir été victimes des Gardes rouges, se
suicident)
- You Jin (尤金), secrétaire de Xia Hailian (夏海连书记),
secrétaire du Parti.
- Chu Fang (褚芳), épouse de Xia Hailian.
- Tong Yun (童芸), épouse restée à Suzhou de Wu Zikuan, parti
à Hong Kong à la veille de la Libération.
B/ Vocabulaire
a) Note sur Wuxi (chapitre 10)
|
Vers la fin du
chapitre, monsieur Wang demande qui pouvait bien
être ce vieux chanteur aveugle obligé de vendre son
violon.
“唏,英雄末路是不会留下姓名的,听口音好像是无锡。”
Ah [lui répond le vieux Zhu avec un soupir], dans
une situation sans issue, le héros ne laisse pas son
nom, mais à son accent il m’a semblé être de Wuxi.
Il s’agit d’une ville du Jiangsu, |
|

La vieille ville de Wuxi |
au bord du lac Taihu. à l’ouest
de Suzhou, et comme cette dernière, ville de canaux. Son
nom, à l’origine, vient des mines d’étain (xī 锡)
qu’il y avait tout autour : la ville s’appelait Youxi (有锡),
qui a de l’étain. Puis les gisements se sont épuisés, vers
25 après J.C. La ville est alors devenue Wuxi (wúxī
无锡) : qui n’a plus d’étain.
On y parle le dialecte de Wuxi, du groupe des dialectes de
Taihu de la langue wu (吴语).
b) Note sur
báixiāng rén
c) Autres notes de vocabulaire
- Un amour pur : « non dilué » (titre du chap. 12) : 不搀水的爱情
搀水 chānshuǐ diluer (搀/攙 chān mélanger, sens
dérivé dénaturer, frelater = 搀假 chānjiǎ)
|
- Sucre au café
Dans ce chapitre, Ma Haixi reçoit la visite du
narrateur et se voit obligé de lui offrir quelque
chose à boire ; on aurait attendu du thé, mais non :
只好从抽屉里摸出一包鹅牌咖啡糖来…
Il fut bien obligé de sortir de son tiroir un sachet
de « sucre au café de la marque Oie sauvage »…
C’est une rareté dans le contexte de la fin des
années 1940 à Shanghai et |
|
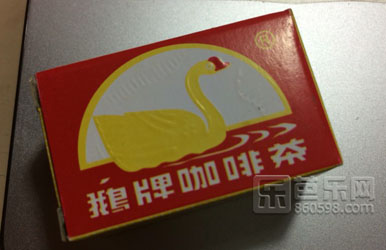
Les sachets de sucre parfumé au café
|
Suzhou. Cela s’appelait en fait
« thé de café » (咖啡茶). On en fabriquait encore en 2017 à
Sanming dans le Fujian (福建三明). C’étaient des sachets de
sucre parfumés au café vendus dans un boîte décorée d’une
oie sauvage
[Le café a été introduit par des missionnaires au Yunnan à
la fin du 19e siècle, mais la production ne s’est vraiment
développée qu’à la fin des années 1980, avec l’aide de la
Banque mondiale. Il est cultivé au Yunnan, dans les mêmes
zones de production que le thé : on a du café Pu’er (普洱咖啡)
comme on a du thé Pu’er (普洱茶). Mais maintenant on a aussi
Starbucks (星巴克), depuis 1999].
- Chapitre 14 : 青皮 qīngpí voyou, surnom de Wan Qingtian
(万青田), jeu de mots sur son prénom.
青皮 qīngpí : peau verte, à l’origine peau d’orange pas encore
mûre, utilisée en médecine traditionnelle depuis la dynastie
des Song ; l’expression désigne les voyous dans le dialecte
de Tianjin comme dans le dialecte de Shanghai. Une
explication (humoristique) est que ces vauriens se rasaient
la tête, et que les poux donnaient à leur crâne une couleur
verdâtre….
2ème partie
- chap. 2 : accomplir les préliminaires
[6]
Avant le dîner, on lisait des citations du président Mao ;
on appelait cela « accomplir les préliminaires » : zuò "
shǒuxiān" (做“首先”) et, ironise Lu Wenfu, c’était
semblable au bénédicité chez les chrétiens.
- chap. 3 : couple éphémère, ou discret, comme la rosée
(lùshuǐ fūqī 露水夫妻)
[7]: sans mariage officiel
- chap. 20/22 : problèmes d’antécédents, bonne origine de
classe
[汪永富]第一次尝到了所谓“历史问题”的滋味,这和无期徒刑是差不多的…
Pour la première fois, Wang Yongfu éprouva ce que
signifiait « avoir des problèmes d’antécédents », c’était à
peu près comme la prison à perpétuité.
Le sort de chacun était conditionné par son histoire
familiale (c’est le sens ici de lìshǐ 历史). Le plus
important était d’avoir une bonne origine de classe (成份).
Voir chapitre 22 :
因此,那些成份好而又没有文化的人,像阿妹这样的人犹如穿了钢盔铁甲,是刀枪不入的。
Ainsi, tous ceux qui, comme A Mei, avaient une bonne
origine de classe et en outre étaient incultes, ils étaient
comme protégés par une armure, rien ne pouvait les
atteindre.
|
- chap. 22 : le titre,
yīyán jiǔdǐng 一言九鼎, est un chengyu qui
dénote l’intégrité.
Il signifie : une parole qui vaut neuf tripodes,
c’est-à-dire une parole qui a énormément de poids.
Les tripodes de bronze, dans l’antiquité chinoise,
étaient symboles de puissance. Les plus célèbres
sont les neuf tripodes qui auraient été fondus par
Yu le Grand (大禹), de la dynastie plus |
|

Une parole de poids (et n’en avoir
qu’une) |
ou moins mythique des Xia (夏朝),
comme symboles des neuf provinces qu’il venait de créer.
C/ Coutumes et
traditions
Chap. 13 : Grand frère, petite sœur : Zhu Ping et A
Mei (阿哥与阿妹)
1. Portraits funéraires
…那年代的照相技术很落后,死人的遗像都是在小照片上用九宫格放大成木炭画,有十二吋、二十四吋、三十六吋不等,一吋一个价钱。老人们都相信画像,不相信照片,认为照片会发黄,保存期不长,因此有些落拓的画家或会涂几笔的人就以此为业,生意还是不错的。
A l’époque, l’art photographique n’était pas encore très
développé. Les portraits des défunts étaient des dessins au
fusain à partir de petites photos agrandies en utilisant la
technique du quadrillage en neuf cases, le prix variant
selon la taille. Les personnes âgées se fiaient aux
tableaux, non aux photos, car elles trouvaient que celles-ci
jaunissaient avec le temps, et donc qu’on ne pouvait les
conserver longtemps. C’est ainsi que des peintres dans le
besoin ou des gens capables de croquer un portrait en
quelques traits de pinceaux en avaient fait leur métier, et
ce commerce marchait pas mal.
胡妈[…]也是按照习俗,过了五十就备棺木,做寿衣,[….] 她的寿衣、寿材都做好了,就差一张遗像还没有备齐…
Passé la cinquantaine, conformément à la coutume, la mère
Hu … s’était fait faire un cercueil et des vêtements
funéraires. [….] Et maintenant que ces préparatifs étaient
terminés, qu’elle avait et les vêtements et le cercueil, il
lui manquait un portrait…
2. Coutumes vestimentaires
她家乡的习俗很特别,女人在夏天要么就是光膀子,已婚的妇女可以不穿上衣。上街、出客可就复杂了,上四下三,要穿七件,手里还要撑一把洋伞。撑洋伞主要的不是为了遮太阳,而是为了挡视线、因为在田岸上踏水车的男人大都光赤条条,女人从他们的面前走过时只好用洋伞挡住视线,装作没有看见。
Les coutumes de chez elle étaient très spéciales. En été,
les femmes restaient parfois torse nu, les femmes mariées
pouvant ne pas mettre de haut chez elle. Mais, si elles
sortaient dans la rue ou recevaient des invités, c’était une
autre affaire : il leur fallait mettre quatre vêtements en
haut et trois en bas, soit sept au total, et qui plus est se
munir d’une ombrelle à la mode occidentale, non pour se
protéger du soleil, mais pour masquer son champ de vision,
car les paysans qui actionnaient les norias dans les champs
étaient tous nus comme des vers ; quand une femme passait
devant eux, elle n’avait donc d’autre alternative que de se
cacher derrière son ombrelle en prétendant ne rien voir.
D/ Références
littéraires, poétiques et musicales
Les références, musicales en particulier, sont essentielles
pour évoquer l’atmosphère de l’époque.
- Chapitre 15 : 城头明月光 Clair de lune sur la ville
Titre calqué sur le premier vers de l’un des plus
célèbres poèmes de Li Bai (李白), in poème sur la
nostalgie du pays natal :
Pensées par une nuit paisible 《静夜思》
床前明月光 chuāng qián mingyuè guāng devant mon lit
brille la lune
疑是地上霜 yíshì dìshàng shuang
dehors la terre gèle sans doute
举头望明月 jǔ tóu wàng mingyuè
levant la tête je vois le clair de lune
低头思故乡 dī tóu sī gùxiāng
et la baissant pense à mon vieux pays
|

Pritnemps dans une petite ville,
promenade sur les murailles de la
ville |
|
Ce poème de Li Bai
évoqué par le titre donne le ton à ce chapitre dans
lequel Lu Wenfu évoque la vieille ville de Suzhou,
ses ruelles et ses anciennes murailles. La
description de celles-ci, désertes et désolées,
évoque par ailleurs celles du célèbre film «
Printemps dans une petite ville » (《小城之春》),
chef-d’œuvre de Fei Mu (费穆) sorti en 1948
[8], dont
l’histoire se passe justement à la même époque que
la première partie du roman de Lu Wenfu, dans les
années qui suivent la fin de la guerre ; on est même
étonné de voir à quel point la description de Lu
Wenfu correspond au film : |
那时候,苏州的人本来就少,最少的地方还不是偏僻的小巷,而是在城墙上,那里简直是个无人之处,是谈恋爱的理想的场所。…
A l’époque, Suzhou comptait en fait peu d’habitants, mais
les endroits où il y avait le moins de monde n’étaient pas
les petites ruelles isolées, mais les murailles de la ville
; totalement désertes, elles offraient un lieu idéal de
rendez-vous pour les amoureux. …
[转过沧浪亭]便是大片的农田和菜地,…有一条弯弯曲曲的小路通到城墙上面。谈恋爱的人真是不畏艰险,这条小路是十分难走的。情侣们也许正是喜爱这样的路,他们可以相互搀扶着,相互搂抱着慢慢地向前。也许会有笑声,也许默默无言…
[après le pavillon…] on se retrouvait dans une vaste étendue
de champs et de potagers … un petit chemin sinueux montait
jusqu’au sommet de la muraille. Les amoureux n’avaient
vraiment pas peur de la difficulté, car le chemin n’était
pas aisément praticable. Mais c’était peut-être justement ce
qu’ils aimaient, ce genre de sentier où ils pouvaient
avancer lentement appuyés l’un sur l’autre, voire enlacés,
en riant ou en silence…
Chapitre 18
1. Allusion au film Yi jiang chunshui xiang dong liu
(《一江春水向东流》) connu en français sous le titre « Les Larmes
du Yangzi » [9].
Il s’agit d’un film en deux parties, coréalisé par Cai
Chunsheng (蔡楚生) et Zheng Junli (郑君里). Sorti en 1947, c’est
l’un des films les plus célèbres de l’après-guerre, ce qui
permet de dater le récit de Lu Wenfu.
- Le slogan de la jeunesse engagée dans les milices à
Chongqing pendant la guerre :
‘一寸山河一寸血,十万青年十万军’
Un pouce de territoire un pouce de sang, cent mille jeunes
cent mille troupes
2. L’air que fredonne Xu Dawei en rejoignant ses amis
[10]: « Penser à
toi toujours », (sìjì xiāngsī 《四季相思》), célèbre
chanson popularisée par Zhou Xuan (周璇)
[11]. Autre version
de « La chanson des quatre saisons » (sìjì gē 四季歌) du
film de 1937 « Les Anges du boulevard » (《马路天使》) de Yuan
Muzhi (袁牧之) [12].
Interprétation moderne (avec paroles en sous-titrage) :
https://www.youtube.com/watch?v=dCSHJU8QFD0
3. Références littéraires :
Alors que le groupe d’amis cherche comment faire comprendre
à Luo
Li les dangers qu’elle court avec Li Shaobo, Lu Wenfu fait
dire au narrateur :
好像罗莉已经是命在旦夕。我还想起了《日出》里的陈白露,《啼笑因缘》里的沈凤喜,就是想不出怎样才能使罗莉明白她自身的危险。
Le destin de Luo Li semblait déjà scellé. Cela m’a fait
penser à Chen Bailu dans « Le Soleil se lève », et à Shen
Fengxi dans « Un destin entre rires et larmes »
|
« Le Soleil se lève
» (《日出》) est une célèbre pièce de théâtre parlé
du grand dramaturge Cao Yu (曹禺), publiée en 1936. La
pièce offre une vision kaléidoscopique de la société
shanghaïenne autour du personnage de Chen Bailu,
courtisane de haut vol au centre de la vie nocturne
d’un hôtel ; Cao Yu en fait un personnage
emblématique de l’exploitation des femmes et des
faibles dans l’ancienne société. La pièce a été
inspirée au dramaturge par le suicide de l’actrice
Ruan Lingyu (阮玲玉) en mai 1935
[13].
« Un destin entre rires et larmes » (《啼笑因缘》)
est un roman de
Zhang Henshui (张恨水)
publié en 1930, caractéristique d’un genre très
populaire d’histoires d’amour reprenant le thème des
amours contrariées entre lettrés et jeunes beautés.
Dans les années 1920,
un jeune garçon nommé Fan Jiashu (樊家树), se rend à
Beiping pour entrer à l’université et tombe amoureux
d’une jeune chanteuse très belle rencontrée |
|
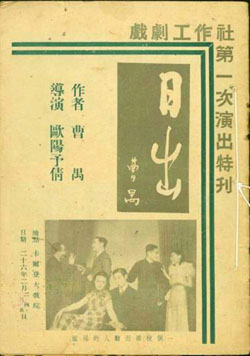
Le Soleil se lève, affiche
de la première mise en scène |
dans la rue, Shen Fengxi
(沈凤喜) ; mais elle est vendue à un seigneur de guerre qui la
maltraite et elle en devient folle. Sur ces entrefaites,
Jiashu rencontre une autre jeune femme qui lui ressemble
étrangement, mais qui est riche. Le roman s’achève sur leur
union.
Le roman a été adapté de nombreuses fois à l’opéra, au
cinéma et à la télévision ; le personnage de Shen Fengxi est
devenu emblématique de la condition féminine dans l’ancienne
société.
4. Autre chanson évoquée dans ce chapitre, quelques
lignes plus bas : Ma Haixi prétend pouvoir convaincre Luo Li
de cesser sa liaison avec Li Shaobo s’il réussit à avoir une
conversation de deux heures avec elle. Mais comment faire ?
这两个钟头怎么争取呢,我们不能去拦吉普车,也不能站在枪口下去唱《爱的波折》。
Comment obtenir ces deux heures ? on ne pouvait pas
arrêter la jeep et rester planté à chanter « Les heurs et
malheurs de l’amour » devant une rangée de fusils.
Il s’agit d’une autre célèbre chanson, interprétée par deux
stars du cinéma de Hong Kong, Li Lihua (李丽华)
[14] et Yan Hua (严华)
; c’est un dialogue (elle : on me dit – lui : on te dit quoi
? – elle : que tu as eu d’autres amours avant moi – lui :
qui a dit ça ? etc.)
Enregistrement de 1941
https://www.youtube.com/watch?v=mNPy8_lbfbc
5. « Les Trois sourires » et le pingtan
Dans ce chapitre (3ème paragraphe), à la recherche de Luo
Li, Ma Haixi se propose d’aller écumer toutes les salles de
spectacle de Pékin, et en particulier celles où se
produisent les conteurs relatant « Les Trois sourires »
(书场里正在说《三笑》).
L’histoire des « Trois sourires » est une histoire d’amour
entre un lettré, Tang Bohu (唐伯虎) et une jolie servante, Qiu
Xiang (秋香), que Tang Bohu finit par approcher après diverses
manœuvres qui lui ont valu « trois sourires » enchanteurs.
Il s’agit à l’origine d’une pièce de théâtre de la période
Yuan, puis l’histoire a été adaptée à l’opéra, et ces opéras
adaptés au cinéma, dont
- à Hong Kong en 1964, par Li Pingqian (李萍倩) ,
- à Hong Kong encore en 1969 par Yue Feng (岳枫) – c’est l’un
des derniers grands films d’opéras huangmei diao
(黄梅调) produits par la Shaw Brothers dans les années 1960
[16].
Trois sourires (extrait du film de 1969)
https://www.youtube.com/watch?v=8rpaEUpWKYY
Lu Wenfu, cependant, se réfère ici à une autre tradition de
Suzhou, le pingtan (评弹), forme de « parler
chanter » ou shuochang (说唱) qui remonte à la dynastie
des Song ; c’est une sorte de narration habituellement
rythmée aux claquettes ou ban (板) et parfois accompagnée par
un instrument à corde (ou deux ) comme le pipa.
« Trois sourires » conté en pingtan (1ère partie)
https://www.youtube.com/watch?v=NFeeu_tr2ko
Chapitre 20
1. Lu Wenfu fait allusion à deux chansons fredonnées
par l’étudiant Xu Yong :
他最近参加了一个乐团,到处去演奏,还在暗中唱什么《古怪歌》和《山那边呀好地方》。那《古怪歌》是嘲讽国民党地区的,说是只许“狗”咬人,不许人打“狗”。《山那边呀好地方》是对共产党地区的一种向往,说那里是无穷富之分,人人凭劳动吃饭、织布穿衣,是大鲤鱼满池塘,年年不会闹饥荒。死读书的徐永从音乐走向社会了,他对山那边有着许多美好的想象。
Il venait d’entrer dans un groupe musical qui donnait des
représentations un peu partout et il chantait en cachette
des chansons du genre « Chanson de l’étrange » et
« Là-bas dans les montagnes, ah que c’est bien ! ». La
première était une satire des zones contrôlées par le
Guomingdang, disant qu’on y laissait « les chiens » mordre
les gens, mais qu’on ne permettait pas aux gens de battre «
les chiens ». L’autre exprimait au contraire le désir
d’aller vivre dans les régions contrôlées par les
Communistes, car on disait qu’on connaissait là un bonheur
sans fin, que la nourriture et les vêtements étaient
attribués en fonction du travail fourni, qu’il y avait
abondance de carpes dans les étangs et qu’on n’y souffrait
pas de faim. C’est la musique qui rapprochait de la société
cet étudiant toujours pongé dans ses livres, et qui faisait
naître en lui des images idylliques de ces régions
montagneuses.
Lu Wenfu offre là une remarque ironique, mais profonde, sur
la valeur évocatrice de la musique et de son rôle essentiel
comme support de l’idéologie.
« Chanson de l’étrange » 《古怪歌》est aussi la chanson
qui accompagne le générique final du film de 1997 « Les
Bureaucrates » (《官场现形记》) adapté du roman éponyme de
l’écrivain de la fin des Qing Li Baojia (李宝嘉) : c’est le
type de thème repris à différentes époques pour critiquer
des régimes différents mais semblables dans le fond) :
Chanson de l’étrange
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3NTkyMzA4.html?refer=seo_operation.liuxiao.liux_
00003311_3000_QfMVj2_19042900&debug=flv
« Là-bas dans les montagnes, ah que c’est bien ! »
《山那边呀好地方》date de 1947. Les paroles sont de Wu Zongxi (吴宗锡),
écrivain de Suzhou connu pour ses pièces de pingtan. Il
venait juste, alors, de sortir de l’université.
Lu Wenfu renvoie à l’expression et à son origine dans la
chanson au chapitre 24, quand il est question de Luo Li :
Shi Zhuofeng explique à Ma Haixi qu’il serait très simple de
l’enlever à Li Shaobo, il suffirait de franchir le Yangzi
(长江) [17] et
d’aller « là-bas dans les montagnes » ; Lu Wenfu précise
pour le lecteur qui a oublié :
那时候我们把解放区和共产党都称作“山那边”,那是从一首歌曲里引过来的。
L’expression « là-bas dans les montagnes » que nous
utilisions à l’époque pour désigner les régions libérées et
le Parti communiste venait d’une chanson…
2. Vers la fin de ce chapitre, les amis sont un peu éméchés,
et finissent la soirée en musique.
- Xu Yong sort son erhu pour interpréter « Belle nuit » (Liáng
xiāo《良宵》), air composé par le musicien Liu Tianhua
pour la soirée du Nouvel An en janvier 1928. Il est repris
dans le film « Liu Tianhua » (《刘天华》), sorti en 2000, qui est
un hommage au musicien disparu prématurément en 1932,
victime de la scarlatine.
Liáng xiāo dans le film Liu Tianhua
https://www.youtube.com/watch?v=NILb4iEwf3w
- Puis Xu Yong joue le chant « Les fleurs sont belles, la
lune est ronde » (《花好月圆》), sur des paroles de Fan Yanqiao
(范烟桥), autre écrivain de Suzhou – chanson, précise Lu Wenfu,
du film « L’Histoire du Pavillon de l’ouest » (Xixiang
ji《西厢记》). Adapté d’une célèbre pièce de théâtre de
l’époque yuan, le film est l’un des trésors du cinéma muet
chinois, réalisé en 1927 à Shanghai et miraculeusement
préservé jusqu’à aujourd’hui. Il est sorti en France, en
1928, sous le titre de « La Rose de Pushui » !
[18]
La chanson, interprétée par Zhou Xuan, enregistrement de
1940
https://www.bilibili.com/video/av973081/
(浮云散,明月照人来 les nuages se dissipent, la lune vient éclairer
le monde, etc. )
- Ils terminent la soirée en chantant « Vive l’amitié ! »
(《友谊万岁》)
生平良朋, Les bons amis dans la vie
岂能相忘, pourrait-on les oublier ?
别后能不怀想?… Même loin d’eux comment ne pas penser à eux ? ….
Lu Wenfu précise à la fin – par le biais du narrateur –
qu’il s’agit d’une chanson en vogue dont les paroles avaient
été écrites par Zhao Yuanren (赵元任) sur l’air, indique la
traduction en français, de « Ce n’est qu’un au revoir ».
Le titre chinois de la chanson (《魂断蓝桥》) est en fait une
référence à un film américain de 1940 : « Waterloo Bridge
», avec Vivien Leigh et Robert Taylor. C’est une
histoire d’amour pendant la Première guerre mondiale,
racontée en flashback, qui a eu un immense succès en Chine
comme au Japon à la fin des années 1940. Remake d’un film de
1931, sorti en France sous le titre « La Valse dans
l’ombre », le film est célèbre pour sa musique, qui a
été primée aux Oscars, et en particulier pour sa « Valse des
adieux » (« Farewell Waltz »), adaptée en valse à trois
temps d’une vieille chanson écossaise, Auld Lang Syne, dont
« Ce n’est qu’un au revoir » est une adaptation française.
Farewell Waltz, Waterloo Bridge
https://www.youtube.com/watch?v=qRfEKZUNl3A
Mais, en citant Zhao Yuanren, c’est encore une autre chanson
qu’évoque Lu Wenfu. En effet, si Zhao Yuanren (1892-1982)
est un linguiste, et poète, qui a fait des études aux
Etats-Unis et a apporté une importante contribution à
l’étude de la phonologie et de la grammaire chinoises, il
était aussi compositeur : l’une de ses chansons, « Dis-moi
comment ne pas penser à elle » (《教我如何不想她》), avec des paroles
de Liu Bannong (刘半农), autre grand linguiste chinois, est
devenue un vrai « tube » à la fin des années 1930 en Chine.
Liu Bannong était le frère aîné du musicologue et
compositeur Liu Tianhua…. ce même Liu Tianhua auquel Lu
Wenfu a indirectement rendu hommage quelques pages
auparavant [19].
Dis-moi comment ne pas penser à elle《教我如何不想她》
https://www.youtube.com/watch?v=UceaEkSnAGk
Chapitre 25
1. Le chapitre commence par un poème du poète des Tang
Bai Juyi (白居易) qui évoque l’atmosphère un peu triste :
une soirée où le ciel laisse penser qu’il va neiger (晚来天欲雪),
incitant à vouloir partager un verre avec l’ami lointain.
2. Puis, pour contrer le rêve de Luo Mei de partir aux
Etats-Unis, Xu Dawei en dénonce l’inanité en invoquant tout
ce qu’il y a à faire en Chine, qui est leur pays, la terre
de leurs ancêtres, contrairement à l’Amérique ; s’ils
partaient, lui dit-il, ils seraient réduits à
…天天吟咏:‘良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院?’
…chanter tous les jours : « Où sont passés les jours
heureux, mon beau pays ? Dans quel jardin retrouver le
bonheur ? »
Il s’agit d’un extrait de l’un des poèmes de la pièce de
Tang Xianxu (汤显祖) « Le Pavillon aux pivoines » (Mudan
ting《牡丹亭》) et de son adaptation en opéra kunqu.
Promenade dans le jardin, le rêve interrompu《牡丹亭‧遊园惊梦.皂罗袍》
https://www.youtube.com/watch?v=DK_27SRDcDs
3. Le projet dès lors est d’aider à « l’éducation pour la
sauvegarde du pays », projets des grands éducateurs du
mouvement du 4 mai, dont deux sont cités ici : Ye Shentao
et Tao Xingzhi (叶圣陶和陶行知). C’était un idéal de vie
recluse à l’écart du monde, dit Lu Wenfu, comme dans la
chanson :
“你把花儿栽,我把鱼儿养,那样甜蜜的好时光……”
Tu plantes des fleurs, j’élève des poissons, et ainsi
quels doux moments…
C’est le pastiche (ironique) d’une autre chanson de Li Lihua
(李丽华) qui évoque le souvenir des jours passés :
“你把琴儿弹, 我把歌儿唱, 那样甜蜜的好时光…”
Tu jouais du guqin, moi je chantais, quels doux moments
avons-nous ainsi passés…
2ème partie, chapitre 18 : le père du roman policier
chinois
Dans un long article, You Jin dénonce les anciens « frères
jurés » du Jardin comme des espions du Guomingdang ; or cet
article fit sensation dans tout Suzhou car, explique Lu
Wenfu avec humour :
因为中国在反右斗争之后,侦探小说已经绝迹。国内侦探小说的鼻祖、苏州的老作家程小青先生已经搁笔,这时间正在被游街,被批斗;也许正捧读着尤金的大作,领略着后生之可畏。
Après la lutte anti-droitiers, les romans d’espionnage
avait disparu [en Chine]. Le père du roman policier chinois,
le vieil écrivain de Suzhou Cheng Xiaoqing avait cessé
d’écrire ; à cette époque-là, on le promenait dans les rues
en l’attaquant ; peut-être avait-il lu la grande œuvre de
You Jin, en appréciant d’avoir un disciple aussi formidable
pour prendre la relève.
Cheng Xiaoqing (程小青) est
célèbre pour ses enquêtes du détective Huo Sang (霍桑), le
Sherlock Holmes chinois. Il est donc connu comme « le Conan
Doyle de l’Est ». Bien qu’étant né dans une famille pauvre à
Shanghai, il est considéré comme l’un des grands écrivains
de Suzhou où il a déménagé en 1915.
E/ Références
historiques
Chapitre 23 - Le prix du romantisme (浪漫的代价) : les
pièces Yuan Shikai.
La mère Hu négocie avec Fei Tingmei le prix à payer par Zhu
Pin pour avoir violenté A Mei (histoire qu’elle a inventée
de toutes pièces) :
“没有田地房产就给钱呗。不要钞票啊,要袁大头。’哪时的钞票一日三跌,银洋还比较保险点。
« S’il n’a ni maisons ni terres, qu’il donne de l’argent.
Mais pas des billets, des pièces, celles avec la grosse tête
de Yuan [Shikai]. » A l’époque, en effet, les billets
perdaient chaque jour de la valeur, les pièces en argent
étaient relativement plus sûres.
|
La fin des années 1940
était une période d’inflation galopante : la monnaie
papier se dévaluait très vite, les pièces en argent
étaient donc privilégiées dans les transactions. Les
pièces en circulation portaient l’effigie de Yuan
Shikai, une grosse tête chauve toute ronde, on les
appelait donc : « les grosses têtes de Yuan » (Yuan
datou 袁大头). Elles avaient la réputation de valoir
des pièces en or. |
|

Une pièce Yuan datou |
Ces pièces ont été émises à
partir de décembre 1914, quand, l’année trois de la
République, c’est-à-dire en 1914, le gouvernement Beiyang a
décidé d’appliquer le système du silver standard et de
mettre fin en même temps à la pléthore de pièces différentes
qui circulaient dans le pays depuis la fin des Qing.
A la fin des années 1940, la monnaie se dévaluait si vite
que les gens changeaient, aussitôt qu’ils en recevaient, les
billets contre des pièces en argent qu’ils gardaient à
portée de main (chap. 27).
Chapitre 26 : les papiers jaunes
Ici il est question des liens familiaux entre la famille Xu
et Jia Boqi, frère du mari de Fei Tingmei, donc oncle de Xu
Dawei ; ceci l’empêche d’épouser Liu Mei, ancienne concubine
de Jia Boqi, comme le lui rappelle Wan Qingtian. Lu Wenfu en
profite pour glisser une explication sur les « papiers
jaunes », libelles qui sont les ancêtres des affiches à gros
caractères de la Révolution culturelle :
居然要和亲叔叔的小老婆结婚,是乱伦,她要叫人写一千张‘黄阴’,贴满苏州的大街小巷,弄得你没脸见人!”
所谓“黄阴”或“黄莺”就是中国古老的大字报或小字报,是写在一种黄纸上,到处张贴,专门揭发别人的隐私以制造某种邪恶的舆论。“文化大革命”中的大字报,和我们古老的文化垃圾是一脉相承,并发挥到登峰造极。
« …Que vous vouliez épouser la concubine de votre oncle,
c’est totalement immoral. Elle [l’ancienne épouse de Jia
Boqi] va faire écrire des milliers de « papiers jaunes » et
les faire coller dans les rues et les ruelles de Suzhou pour
vous faire perdre la face ». Ces « papiers jaunes », encore
appelés « orioles jaunes », désignaient les journaux muraux
d’autrefois, écrits en petits ou gros caractères sur du
papier jaune, que l’on placardait partout pour dénoncer les
secrets de quelqu’un et le livrer à l’opinion publique. Les
affiches à gros caractères de la Révolution culturelle sont
de la même eau que ces ordures de la culture ancienne ;
elles ont juste porté le genre à des extrêmes.
Voir aussi 2ème partie, chap. 6 (Guerre dans le Jardin
大院之战), la reconversion des papiers jaunes en journaux muraux
et affiches à gros caractères – devenant, ironise Lu Wenfu,
« un exemple vivant de l’utilisation du passé pour servir le
présent » (古为今用的极其生动的事例).
Chapitre 28 : et toujours l’opium
Xu Yimin est opiomane. Venus pour lui demander un conseil,
Wan Qingtian (le Troisième Oncle) et Wu Zikuan sont conviés
à partager sa couche à opium (dàyān tà 大烟榻) et fumer avec
lui. Ils ne refusent pas :
那时候,请客人抽鸦片烟就像现在请客人抽香烟似的。
…à l’époque [explique Lu Wenfu] inviter quelqu’un à fumer
de l’opium, c’était comme aujourd’hui lui offrir une
cigarette.
Un peu plus loin dans le chapitre, Lu Wenfu décrit l’état
d’extrême bien-être (浑身舒坦) dans lequel – disait-on – l’opium
plongeait le fumeur en manque qui avait satisfait son
besoin.
2ème partie
Chap. 1 : « Dix-sept années » (十七个年头)
Il s’agit de l’expression consacrée pour désigner la période
1949-1966, c’est-à-dire de la « Libération » au début de la
Révolution culturelle. Ce chapitre est un raccourci des
événements de la période, de la Réforme agraire au mouvement
anti-droitiers et au Grand Bond en avant, avec évocation
elliptique de la fuite du Guomingdang
Suzhou apparaît comme une ville dilapidée, aux ruelles
jonchées de vieux papiers et bouts d’affiches décollées, et
aux murs percés d’orifices ; la ville est marquée par la
surpopulation et la construction désordonnées d’appentis de
fortune pour loger les gens et abriter les produits de la
petite forge créée dans les salles de réception de la
vieille demeure des Xu. Et comme dans le passé, c’est la
course au logement, à tout prix, dans un désordre provoqué
par l’impression soudaine et inédite d’autonomie et
d’indépendance (从未有过的自主感与独立感). Comme l’explique Zhang Nankui
:
…一阵阵的革命浪潮都是冲着房子来的。他们要把你打成反革命,或者把你归入牛鬼蛇神,然后就可以抢占你的房子,扩大他的住地。许达伟说得不错,房子是纷争的根源,是釜底的火焰。
… Les vagues révolutionnaires, l’une après l’autre,
déferlent sur les habitations. Ils font de toi un
contre-révolutionnaire ou un esprit malfaisant pour pouvoir
ensuite s’emparer de ton logement et accroître leur surface
habitable. Xu Dawei n’avait pas tort quand il disait que le
logement était source de disputes, le feu sous le chaudron.
Chap. 5 : groupement de familles
[不知道是谁告的密,说]大饼店里的老板陶金根是当过伪保长的。
[On ne sait trop qui avait révélé que] le patron de la
boutique de galettes Tao Jingen avait été responsable d’un
groupement de familles sous le gouvernement fantoche (du
Guomingdang)
Lu Wenfu fait ici référence au système du bǎojiǎ
(保甲), groupements de familles auto-gérées, dont le chef
était responsable vis-à-vis du gouvernement de la collecte
et du paiement des impôts des familles, mais aussi du
maintien de l’ordre et de l’auto-défense ; c’était en fait
un système d’encadrement de la population à des fins de
contrôle, mais aussi d’efficacité administrative et
militaire. Bien avant Wang Anshi (王安石), le système initial a
été inventé par Guan Zhong (管仲),
ministre du duc Huan de Qi (齐桓公), au 7ème siècle avant
Jésus-Christ, pendant la période des Printemps et Automnes.
Il a été repris sous diverses formes à différentes époques,
jusqu’aux années 1940, sous le gouvernement nationaliste.
|
Chap. 14 : Xishi
(西施), donnée comme exemple de parangon de beauté.
Figure légendaire, qui vécut au 5ème siècle avant
Jésus-Christ, pendant la période des Royaumes
combattants. Le roi Goujian, du royaume de Yue, fut
vaincu par le roi Fuchai du royaume voisin de Wu.
Libéré à la condition de reconnaître Fuchai comme
suzerain, il en resta humilié et jura de se venger.
Il envoya la belle Xishi séduire Fuchai qui,
tellement épris, en oublia les affaires du royaume.
Ecrasé par Goujian, il se suicida. Quant à Xhishi,
on ne sait trop ce qu’elle devint…
Chap. 23 : le IXe Congrès du Parti (九大)
Ce Congrès (1er-24 avril 1969) a marqué un tournant
dans la Révolution culturelle en ratifiant la purge
de Liu Shaoqi et de |
|

Xishi |
Deng Xiaoping. Lin Biao a
prononcé le discours introductif intronisant le slogan de «
révolution continue », qui a été inscrit dans la
Constitution, et il a été désigné comme successeur de Mao.
Aussitôt après fut lancé le mouvement d’envoi des jeunes
instruits à la campagne dont Lu Wenfu décrit les
conséquences pour les personnages de son roman dans les cinq
derniers chapitres. Il le présente comme un mouvement de
préparation à la guerre dans un contexte de psychose
collective : il s’agissait de « nettoyer » les villes
(在城市里“扫垃圾”).
[1] Titre pour une fois traduit
littéralement : Nid d’hommes, tr. Chantal Chen-Andro, Seuil
2002.
[2] Texte chinois, en deux
parties de 31 et 28 chapitres :
http://www.shuku.net:8082/novels/mingjwx/lwfu/rzh.html
[3] Caractère qui peut se
prononcer zhuàng, cad simple et honnête, ou gàng dans
une forme dialectale, auquel cas il signifie stupîde. A
Zhuang, pourrait-on dire, est fort et bête.
[4] Cf traduction p. 82 et 84 :
transformée en fille de jeep (像个吉普女郎似的). « Jeep Girls »,
Expression apparue à Shanghai après la fin de la guerre,
pour désigner des prostituées qui circulaient en jeep en
offrant leurs services aux soldats. C’est l’un des
stéréotypes utilisés à la fin des années 1940, et encore
plus au moment de la guerre de Corée pour protester contre
la présence américaine pendant la guerre froide dans
certains ports chinois, Shanghai mais aussi Qingdao. Cette
propagande anti-américaine a continué jusqu’au début des
années 1970.
Voir le colloque sur la question tenu en juin 2017 à
l’université Fudan, et en particulier le rapport de la
professeure Du Chunmei (杜春媚) sur les Jeep Girls et l’armée
américaine après la guerre (《“吉普女郎”与二战后驻华美军》) :
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1711840
[5] 姣 jiāo jolie
[6] Traduit « faire "l’avant" »
(p. 376)
[7] Traduction « en union
libre », p. 398, n. 7.
[8] Sur ce film et son
réalisateur, voir :
http://www.chinesemovies.com.fr/films_Fei_Mu_Printemps_petite_ville.htm
[9] Traduit littéralement
« L’eau printanière coule vers l’est » dans la traduction
française, p. 180 dans l’édition Points.
[10] P. 187 de la traduction.
[11] Célèbre chanteuse et actrice des années 1930 et 1940,
voir :
http://www.chinesemovies.com.fr/acteurs_Zhou_Xuan.htm
[12] Voir :
http://www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Yuan_Muzhi.htm
[13] Voir la présentation de
l’actrice :
http://www.chinesemovies.com.fr/acteurs_Ruan_Lingyu.htm
[14] Sur Li Lihua :
http://www.chinesemovies.com.fr/acteurs_Li_Lihua.htm
On notera que le premier rôle de Li Lihua a été celui d’une
servante dans une adaptation cinématographique de « Trois
sourires », en 1940.
[15] Sur Li Pingqian, voir :
http://www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Li_Pingqian.htm
[16] Sur l’opéra huangmei,
voir :
http://www.chinesemovies.com.fr/Ressources_Opera_Huangmei.htm
[17] Il s’agit du Yangzi (ou
Yangtsé), traduit fleuve Bleu par Chantal Chen-Andro : nom
donné au fleuve par les Jésuites, pour faire pendant au
fleuve Jaune, traduction littérale de Huang he (黃河) appelé
ainsi en raison de ses eaux chargées de loess. L’appellation
fleuve Bleu n’a pas d’équivalent en chinois et n’a d’autre
raison que d’avoir voulu invoquer une symbolique céleste,
lié au principe yang, en opposition à la terre du huang he.
[18] Sur « La Rose de Pushui »,
voir :
http://www.chinesemovies.com.fr/films_Hou_Yao_Rose_de_Pushui.htm
[19] Liu Bannong est aussi crédité de l’invention du
pronom personnel ta au féminin (她).
[20] Traduction p. 412, n. 8.

