|
|
Jentayu n° 9 : sur
le thème de l’exil !
par Brigitte
Duzan, 12 février
2019
|
L’exil : on ne pouvait trouver sujet plus représentatif
des thèmes qui parcourent notre époque, et la
littérature - exil physique de réfugiés qui affluent et
refluent de tous côtés, mais aussi bien exil intérieur
d’une multitude de gens qui ont du mal à s’intégrer et à
être en phase avec leur temps. Il est frappant de voir
que tous les auteurs représentés dans ce numéro neuf de
Jentayu ont eux-mêmes vécu l’exil, voire le vivent
encore : on a l’impression d’une planète peuplée
d’exilés.
1. Ce nouveau numéro de Jentayu s’ouvre, comme pour nous
mettre en condition, sur deux extraits des « Enfants
du docteur Béthune » (《白求恩的孩子们》)
de
Xue Yiwei (薛忆沩),
qui écrivit le roman au Canada où il est allé s’exiler
après six ans passés à Shenzhen – qui étaient déjà un
exil, pour lui qui est originaire du Hunan. |
|
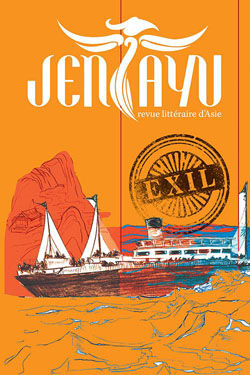
Jentayu n° 9 |
|

Xue Yiwei (薛忆沩) |
|
Le docteur Norman Bethune est un médecin canadien né en
1890, célèbre pour son action humanitaire autant que ses
innovations médicales. Après avoir été médecin militaire
pendant la Première Guerre mondiale et la Guerre civile
espagnole, il est parti en Chine en mai 1937, a rejoint
la Huitième armée de route à Yan’an, puis s’est illustré
sur le front de la guerre contre le Japon en organisant
des antennes mobiles médicales avec du matériel
transporté à dos de mulet et en formant aux soins
d’urgence des infirmiers et des médecins.
En 1939, alors qu’il opère sans gants chirurgicaux, il
se coupe la main ; la blessure s’infecte et entraîne une
septicémie. Il meurt le 12 novembre 1939, devenant
aussitôt une légende. En effet, apprenant sa mort, Mao
l’immortalise en rédigeant aussitôt un hommage : |
« A la mémoire de Norman Bethune ». Xue Yiwei l’a appris à
l’école et en a gardé une vénération pour le personnage. Or, il
en a retrouvé les traces à Montréal quand il est arrivé là. Il a
donc cherché à établir les liens entre la mémoire du Dr Béthune
en Chine et celle préservée au Canada, en écrivant une fiction.
Son roman est construit sous la forme d’une longue lettre
fictive au docteur Béthune, rédigée par un narrateur fictif
double de l’auteur. C’est un hommage à un exilé, par un autre
exilé, et en même temps un tableau de la Chine.
Ce sont les deux premiers textes de Xue Yiwei traduits en
France ; ils sont dédiés à
Sylvie Gentil qui
projetait de traduire le roman et m’en a laissé le legs à sa
mort, autre exil.
|
2. A ce texte chinois répond aussitôt un texte du grand
romancier indonésien
Pramoedya Ananta Toer
(1925-2006), un temps pressenti pour le prix Nobel de
littérature. Son œuvre, nous apprend Jentayu sur son
site, est largement autobiographique, que ce soit sous
forme de souvenirs d’enfance ou de jeunesse, ou de
récits de voyages et de captivité car cet écrivain a été
emprisonné à trois reprises : à l’époque coloniale pour
soutenir la cause nationaliste (1947-1949), sous la
présidence de Sukarno pour soutenir la communauté
chinoise d’Indonésie (de 1960 à1961), mais surtout sous
celle du général Soeharto qui imposa la thèse d’une
tentative de coup d’Etat communiste, l’armée devenant le
sauveur de la nation, et les propriétaires fonciers
déclenchant des représailles dans les campagnes où le
Parti communiste avait réalisé une réforme agraire.
L’écrivain fut incarcéré pour avoir soutenu Sukarno.
|
|

Pramoedya Ananta Toer |
Autant d’événements qui nous en rappellent d’autres, similaires,
intervenus en Chine. De même que ses « Soliloques d’un muet » ou
« Lettres de Buru » - île inhospitalière des Moluques où
l’auteur a été déporté à la veille de l’indépendance de son
pays, en août 1969 - nous en rappellent bien d’autres
d’écrivains chinois ayant subi des détentions arbitraires du
même ordre, que ce soit à la suite du mouvement des droitiers,
ou pendant la Révolution culturelle, dont les débuts se sont
d’ailleurs déroulés à peu près à la même période. Ces Pensées
dérivant au fil de l’eau, traduites par Etienne Naveau, qui
sont une lettre écrite à Buru à sa fille aînée mais jamais
envoyée, évoquent en filigrane cet autre père écrivant à sa
fille, mais lui une fois sorti de camp,
Bei
Dao (北島)…
|
L’illustration de ce texte, enfin, est l’une des plus
réussies de celles de ce numéro, que l’on doit à Olivia
Tang, artiste visuelle de Singapour. Son thème de
recherche est particulièrement bien adapté : les failles
émotionnelles des hommes.
3. La revue poursuit avec un texte turc, traduit par
Sylvain Cavaillès, de Bilge Karasu, « Les
mûriers ». Il s’agit d’une nouvelle qui conclut un
roman, Le soir d’une longue journée, dont
l’histoire se passe à l’époque byzantine, et raconte
l’exil d’un moine fuyant la répression contre son ordre.
« Les mûriers » vient achever ce récit par le récit d’un
autre exil, contemporain celui-là, ou plutôt de deux
exils, l’un évoqué avec une tristesse nostalgique par
une femme elle-même exilée, des exils qui se répondent,
d’Italie en Turquie et en
Argentine… comme si l’exil devenait une figure imposée,
inéluctable, du monde moderne, comme une sorte de flux
permanent détruisant et reconstruisant des destinées.
4. Et comme en clin d’œil vient un récit taïwanais, avec
à nouveau une très belle illustration d’Olivia Tang :
« L’Asie des illusions » de
Kao Yi-feng (高翊峰),
traduit par Gwennaël Gaffric, déjà le traducteur de « La
guerre des bulles » (《泡沫戰爭》)
du même auteur
.
On est bien dans le même univers, encore plus kafkaïen,
même. On ne sait trop si le personnage principal est
encore totalement ivre, ou s’il est éveillé, mais il est
dans un monde qui rappelle « Cube », le film de
science-fiction canadien de Vincenzo Natali où un homme
s’éveille au centre d’une pièce cubique, sans savoir ce
qu’il fait là, ni où il est, ce qui est le cas des
personnes des pièces adjacentes… « L’Asie des
illusions », c’est ça, et en plus il s’agit d’un bunker
dans les égouts… on retrouve le goût de
Kao Yi-feng pour les canalisations qui ne mènent à rien,
celles qui fuient et celles qui sont vides, comme dans
« La guerre des bulles ». Comme exil, c’est plutôt
l’exil angoissant du cauchemar dont on n’arrive pas à
sortir.
5. Le texte qui suit, « Bon à rien », traduit de
l’anglais par Brigitte Bresson, vient d’une écrivaine
originaire de Malaisie :
Preeta Samarasan.
Elle s’y connaît en exil puisqu’elle a vécu quatorze ans
aux Etats-Unis avant de s’installer en France en 2006,
où elle vit aujourd’hui dans un petit village du
Limousin.
« Bon à rien » est un faux entretien, une façon de
raconter son histoire, à la première personne, mais
masculine. On a
donc |
|

Bilge Karasu

Kao Yi-feng (高翊峰)

Preeta Samarasan |
l’impression d’un recul pris par l’auteure avec son
double narrateur. Exil pacifique, au moins en surface.
|
6. Histoire beaucoup moins pacifique, celle décrite par
l’auteur ouzbek Hamid Ismaïlov dans son roman
« La danse des démons » - dont l’extrait choisi est
traduit par Nazir Djouyandov et Filip Noubel : l’hisoire
est celle de l’arrestation en 1938 d’Abdoulla Qodirly,
écrivain ouzbek progressiste et anticolonialiste qui
militait pour un islam éclairé. Hamid Ismaïlov lui-même,
est une autre figure emblématique de l’exil moderne : né
|
|

Hamid Ismaïlov (photo Restless Books) |
au sud du Kirghistan, à l’époque où il
était soviétique, il a fait des études de journalisme, a été
poursuivi pour activisme politique, et s’est réfugié en Europe
dans les années 1990. Il
travaille depuis à
Londres comme rédacteur du service ouzbek de la BBC, mais n’est
pas autorisé à se rendre en Ouzbékistan où ses œuvres sont
interdites
.
On a l’impression d’histoires qui se répètent, avec des nuances,
de langues, d’intonation, de teinte de peau, mais finalement la
même volonté de faire entendre sa voix, contre l’autoritarisme,
l’obscurantisme, religieux en particulier, mais aussi bien
idéologique.
|
7. Ce numéro de Jentayu comporte aussi un texte d’un
auteur tibétain, mais traduit de l’anglais, par Benoîte
Dauvergne, avec pour titre un mot tibétain - phayul
- signifiant patrie, nous explique une note
initiale. L’auteure est une jeune tibétaine, Tsering
Wangmo Dhompa, qui a été élevée par sa mère dans les
communautés tibétaines en exil de Dharamsala, en Inde,
et de Kathmandou, au Népal et qui réside aujourd’hui à
San Francisco. Elle parle couramment plusieurs langues
et dialectes, dont le tibétain, l’hindi et le népalais,
mais choisit d’écrire en anglais « pour exprimer la
nostalgie des Tibétains exilés » : l’exil dans la
langue, mais langue parsemée de termes tibétains comme
si on ne pouvait sans eux évoquer la réalité tibétaine,
celle des pâturages, des nomades et de leurs animaux :
la patrie. |
|

Tsering Wangmo Dhompa |
|
8. Et puis voilà une « Errance dans les mers du sud »,
récit traduit par Pierre Mong Lim d’un auteur chinois
qui a passé son adolescence aux Philippines :
Bai Ren (白刃),
né en 1918 dans le Fujian et rentré en Chine en 1937
pour finir ses études et s’engager comme soldat pour
combattre l’armée d’occupation japonaise. Soldat
peut-être, mais écrivain prolixe malgré tout, de 1936 à
1996, dans les genres et les styles les plus divers.
L’extrait traduit pour Jentayu est un récit
semi-autobiographique tiré du roman éponyme, racontant à
la première personne les errances du jeune Ah Song,
double de l’auteur, parti de sa province comme lui en
1932 à l’âge de quatorze ans. Le roman est considéré
comme « le Bildungroman des Chinois d’outre-mer »
. |
|

Bai Ren (白刃) |
|
9. Après les « mers du sud », le Cambodge, et une
nouvelle traduite du khmer, par Christophe Maquet, « Nul
ne peut faire revivre les morts », de Soth Polin, autre
écrivain qui a lui-même vécu l’exil – il s’est réfugié
en France en 1974, puis est parti vivre aux Etats-Unis
en 1982 après avoir rompu avec sa femme : chez lui
l’exil est particulièrement douloureux. Né en 1943, il a
aujourd’hui soixante-quinze ans et vit seul à Long
Beach ; ces « morts qu’on ne peut faire revivre », ils
commencent avec lui.
10. Ce numéro 9 de Jentayu se termine avec un texte
d’Eileen Chang/
Zhang Ailing (张爱玲)
traduit par Chou Tan-ying et Emmanuelle Péchenart :
« Murmure ». Texte autobiographique où l’écrivaine
décrit les démêlés avec son père, opiomane, de plus en
plus violent, qui finit par l’enfermer dans sa chambre…
dont elle s’enfuit pour |
|

Soth Polin |
rejoindre sa mère. Tentatives d’exil à l’étranger, à Londres,
puis à Hong Kong, qui échouent à cause de la guerre. Ne s’exile
pas qui veut. On comprend au passage comment elle a pu écrire
« La Cangue d’or ».
Le numéro est complété par le désormais habituel reportage
photos, cette fois sur des camps Rohingas au Bangla Desh – des
photos en noir et blanc qui ont la puissance de gravures sur
bois.
Sans oublier les poèmes, trois par trois, du Vietnam, de
Singapour, et d’Inde, ces trois derniers traduits du tamoul !
Notes de lecture et articles complémentaires sur le site de
Jentayu :
http://editions-jentayu.fr/
Le numéro 5 de Jentayu comportait une interview de Hamid
Ismaïlov où il parlait des conflits de cultures en Asie
centrale, et de la diversité des langues et des
croyances de cette région,
|
|

