|
|
Chinese Arts and
Letters :
deuxième numéro 2018 dédié à Jia Pingwa, mais pas
seulement
par Brigitte Duzan, 16 janvier 2019
|
Le deuxième numéro de l’année 2018 de la revue
Chinese Arts and Letters (CAL)
annonce une ouverture dans le choix des auteurs
présentés : comme l’explique le rédacteur en chef Yang
Haocheng (杨昊成)
dans sa note éditoriale, ce ne seront plus désormais
exclusivement des écrivains du Jiangsu, province où se
trouve le siège de la revue
.
L’auteur présenté : Jia Pingwa
Ce numéro ouvre la voie avec
Jia Pingwa (贾平凹),
grand écrivain du Shaanxi, et grand écrivain tout court,
en lui consacrant près de soixante-dix pages sur les
plus de deux cents qu’il compte au total, avec :
- Une
analyse critique de son parcours et de son œuvre, par
Yang Lesheng (样乐生)
[pp. 56-54] ;
- Un
entretien mené par Shu Jinyu (舒晋瑜)
|
|
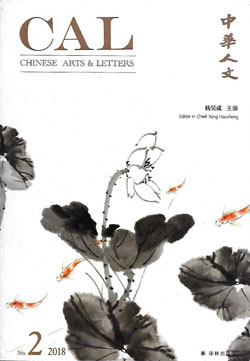
Couverture de ce numéro |
[pp.65-69] qui
montre un Jia Pingwa avare de paroles, plutôt gêné d’avoir à
répondre à des questions : aussi peu disert devant son
interlocutrice que superbe narrateur devant une feuille de
papier – on ne saurait mieux montrer le caractère de l’auteur ;
- Les
traductions de trois textes, en introduction [pp. 7-55], venant
justement illustrer son art narratif :
|
Autumn
(《秋天》)
est le troisième chapitre du recueil « Chien céleste » (Tiangou
《天狗》),
initialement publié en 1986
.
Tiangou est un orphelin, apprenti d’un maître-creuseur
de puits ; à trente-six ans il a largement dépassé l’âge
de se marier, mais il est amoureux de la femme de son
patron, une femme travailleuse et bonne, qu’il vénère
comme un boddhisattva. Or, un jour, le maître est
victime d’un accident alors qu’il est en train de
creuser un puits ; il survit, mais paralysé jusqu’à la
taille. Tiangou le remplace dans la vie quotidienne,
mais sans faillir à son devoir envers son maître,
jusqu’à ce que celui-ci lui offre d’épouser sa femme,
les trois formant dès lors un trio peu ordinaire, auquel
se joint bientôt un fils.
La traduction est de Liu Jun (刘浚),
ex-journaliste et rédactrice du Quotidien du peuple, et
maintenant traductrice freelance chinois-anglais en
Nouvelle Zélande
.
|
|

Tiangou, Chien céleste (rééd. 2015) |
|
The Brick Bed
(《土炕》)
– traduction Denis Mair - conte l’histoire d’une
paysanne du nord du Shaanxi qui, ne pouvant avoir
d’enfant, recueille une femme enceinte, soldate de
l’armée de la 8ème Route qui a perdu son
bataillon. Après avoir donné naissance à une petite
fille, la femme repart en laissant le bébé, que la
paysanne élève comme son propre enfant. Devenue adulte,
celle-ci part pour la ville où elle devient
fonctionnaire. Mais, au début de la Révolution
culturelle, elle envoie sa fille aînée à sa mère
adoptive pour la mettre en sécurité. La jeune fille
repartira une fois la Révolution terminée, et la vieille
paysanne, en fin de compte, mourra seule sur son kang,
qui aura vu passer deux générations.
Trees can’t talk !
(《制造声音》)
– traduction Nick Stember – est l’histoire très simple
d’un vieil homme qui a passé quinze ans de sa vie à
pétitionner pour revendiquer la |
|
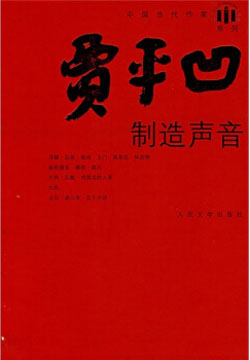
Le recueil Trees Can’t Talk, 1998 |
propriété d’un arbre qu’il a planté en 1948 et qui, dit-il,
« sait parler ». Il finit par obtenir gain de cause, mais quand
on vient lui annoncer la nouvelle, il est déjà mort.
Initialement publié en 1996,
le texte a une sorte de simplicité biblique, très poétique, qui
le rend attachant dès les premières lignes, avec une philosophie
tranquille de la vie renvoyant à Confucius :
朝闻道,夕死可矣
[Analectes,
chapitre IV.8 (《论语·里仁第四》/四之八)
Qui le matin a perçu la vérité / peut le soir mourir sans regret
Culture et classiques
Or, après deux articles de la rubrique Culture & héritage
consacrés au Grand Canal [pp. 70-84], la revue enchaîne avec la
nouvelle rubrique lancée dans le numéro précédent, Echos des
classiques (Echoes of Classics), qui est cette fois
consacrée, justement, aux Analectes.
Le spécialiste et traducteur convoqué n’est autre que Burton
Watson, grand sinologue américain dont la traduction des
Entretiens de Confucius est devenue aussi classique que
l’original lui-même
;
il est décédé en avril 2017 : ces pages sont un hommage mérité.
Des extraits de sa traduction – dans une merveilleuse
présentation bilingue où le texte chinois, en composition
verticale, semble accompagner la traduction comme un poème
ornant un tableau chinois – sont précédés d’une introduction par
Burton Watson lui-même.
Auteurs à découvrir
Ce numéro de CAL propose ensuite trois nouvelles et un essai
d’écrivains à découvrir.
Nouvelles
Auntie Xu
《胥阿姨》
de
Jiang Limin (姜琍敏),
rédacteur en chef de la revue Yuhua (《雨花》)
éditée par l’Association des écrivains du Jiangsu.
Jiang Limin nous conte ici, sans s’apitoyer outre mesure, le
destin amer d’une vieille dame dont on dit, comme souvent, que
tous les ennuis sont venus de son mariage…
On the Plateau
《在高原》
de
Hu
Xuewen (胡学文),
un auteur dont on connaît moins les récits que les films dont
ils sont adaptés. La nouvelle « Sur le Plateau », qui date de
2016, commence comme une intrigue policière, dont le nœud serait
la personnalité même du détective menant l’enquête.
|
I see the Light
《我望灯》
de la romancière
Ge Shuiping (葛水平),
sortie de :l’ombre parce que l’une de ses nouvelles a
été adaptée au cinéma, et le film – « Mountain Cry » (《喊·山》)
de Larry Yang (杨子)
- a été projeté en clôture du festival de Busan en
octobre 2015.
« I see the Light », qui date de 2008, est une histoire
aux confins du merveilleux et du surnaturel, mais tout
en restant réaliste : l’histoire d’un jeune garçon qui
dit avoir vu en rêve l’Empereur de Jade lui confier un
précieux manuscrit…
Essai sanwen
Clamour
《声嚣》
de
Siren (塞壬),
un nom peu courant derrière lequel se cache une
essayiste aujourd’hui réputée, remarquée il y a une
dizaine d’année par le critique littéraire Li Jingzi (李敬泽).
|
|

Siren |
Le texte choisi ici donne envie d’en lire d’autres de la même
plume ; il est tiré d’un recueil publié en 2008 sous le titre de
l’un des cinq essais qu’il contient, « Volte-face » (《转身》). C’est
une peinture de l’environnement de l’auteure/narratrice, et des
personnages au milieu desquels elle vit, à travers les bruits
qui l’agressent de jour comme de nuit, ces bruits définissant en
quelque sorte les gens dont ils émanent. On est frappé, en
terminant la lecture, du silence dans lequel on est soudain
plongé…
|

Cao Yiqiang, State of Mind, p. 203. |
|
CAL offre pour terminer neuf poèmes de Xu Ze (徐泽)
et des réflexions sur les peintures de Cao Yiqiang (曹意强)
– dont l’une des peintures semble refléter l’état
d’esprit du lecteur plongé dans le silence…
|
La nouvelle a été adaptée en opéra puju (蒲剧),
l’opéra du Shaanxi, et l’opéra tourné en
téléfilm, « Deux femmes sur un kang »
(《土炕上的女人》),
diffusé en quatre épîsodes en 2002.
|
|

