|
|
Un nouveau recueil
de nouvelles de Mo Yan traduites en français : « Chien blanc et
balançoire »
par
Brigitte Duzan, 18 mai 2018
|
Il s’agit d’un recueil publié aux éditions du Seuil, de
sept
nouvelles de
Mo Yan (莫言)
initialement parues dans diverses revues entre 1983 et
2004, mais qui, malgré les quelque vingt années de
distance, n’en présentent pas moins une nette unité
thématique et stylistique, les nouvelles plus récentes
renvoyant à la même période historique que celle
couverte par les premières.
Il faut un
prix Nobel pour balayer la farouche défiance des
éditeurs français à l’égard de la nouvelle, et tout
particulièrement la nouvelle courte ; on a même
l’agréable surprise de voir le terme – nouvelles -
affiché en noir et blanc sur la page titre (sinon
sur la couverture qui reste muette à cet égard).
Art consommé
du conteur |
|

Mo Yan |
On ne peut donc que féliciter l’éditeur, et la traductrice
Chantal Chen-Andro, de cette heureuse initiative, mais aussi de
la sélection, faite de main de maître, aussi bien d’ailleurs que
de l’ordre de présentation : chacune de ces nouvelles est un
plaisir de lecture, et elles témoignent en outre du talent de
conteur de l’auteur, celui dont il se prévalait dans son fameux
discours de réception du prix Nobel
à Stockholm, en décembre 2012.
Les conteurs, en chinois, ce sont des gens qui disent des
histoires (讲故事的人),
tout simplement. Et c’est bien ce que fait Mo Yan, mais avec un
art consommé de la construction de son récit qui coule
naturellement comme si de rien n’était, art qui passe par celui
de camper ses personnages, dans leur environnement, voire de les
mettre en scène, avec toutes sortes de tours et de détours et de
détails cocasses. Car tous ces récits sont dits avec un humour
qui donne du sel au moindre de ses personnages, y compris les
animaux, et ici surtout les ânes, sortis d’un bestiaire familier
peuplant ses romans
.
Tous ces récits sont d’autant plus vivants qu’ils sont,
pourrait-on dire, en VO, avec des expressions datées qui font
éclater de rire au détour de la page tellement, placées hors
contexte, ou au contraire parfaitement dans le contexte, elles
laissent soudain entrevoir le monde du village, à l’époque où se
situent les sept nouvelles du recueil.
Deux périodes d’écriture, évocation de la même époque
Cette époque est celle des souvenirs de jeunesse de l’auteur,
l’univers celui de Gaomi, mais finalement tout se fond dans un
passé indistinct qui en fait véritablement un univers de conte,
un univers personnel et vaguement fantasmé, aux confins du
mythe. L’impression est d’autant plus forte que toutes ces
nouvelles, bien qu’écrites à vingt ans de distance, relèvent
malgré tout d’une même unité de thème et de ton.
Les sept nouvelles datent en effet de deux périodes d’écriture :
le début des années 1980 pour les trois premières, le début des
années 2000 pour les trois suivantes, la dernière datant de 1990
et constituant l’apothéose du recueil, en écho à la première
tout aussi remarquable. Il convient ici de féliciter et
remercier l’éditeur et la traductrice d’avoir indiqué en exergue
les titres chinois et dates initiales de publication de chacune
des nouvelles, ce qui donne un supplément de sens à l’ensemble.
1983-1985
|
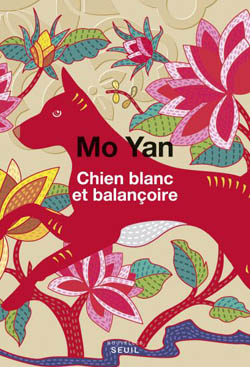
Le recueil |
|
Pour commencer, donc, deux nouvelles de 1985 et une de
1983. La première, « Chien blanc et balançoire »
(《白狗秋千架》),
est un conte cruel, comme le sont finalement, plus ou
moins, tous les récits de Mo Yan, mais celui-ci l’est
particulièrement, de par son style allusif et le ton
détaché avec lequel il est écrit
.
Pour une jolie fille, se retrouver borgne, par un
stupide accident de balançoire, puis mariée à un muet et
avoir trois enfants – des triplés – également muets, ce
n’est pas un sort habituel, mais c’est le sort, dit la
jeune femme. Le garçon responsable de l’accident aura
peut-être à la fin la possibilité de racheter son acte
et améliorer ainsi son karma.
La nouvelle, glaçante, a été écrite avant
« Le
clan du sorgho »,
et en annonce les thèmes et jusqu’à la symbolique, bien
que celui du sorgho ne soit pas exactement le même. Elle
a été adaptée en 2003 au cinéma, mais le film, intitulé
« Nuan » (《暖》),
du nom du personnage principal, a quelque |
peu affadi la fable, en particulier en transformant les trois
enfants en une petite fille qui n’a pas la force symbolique des
trois petits muets de la nouvelle
.
On relit celle-ci en savourant d’autant plus la finesse de la
narration et des descriptions.
|
Des deux nouvelles suivantes, de 1983 et 1985, « Musique
du peuple » (《民间音乐》)
conte un épisode de la vie d’un petit musicien ambulant,
de ceux qui se produisaient dans les campagnes, en
allant de village en village. Celui de la nouvelle est
recueilli, dans un village, par une femme divorcée –
divorcée par amour de la liberté et non parce que son
mari la battait : elle tient une maison de thé et le
musicien lui apporte la fortune, avant de repartir comme
il était venu, libre comme l’air, et comme sa musique.
C’est l’une des premières nouvelles publiées par Mo Yan.
Pas de sentiment, sauf allusion très distanciée, mais
des personnages très bien campés. Elle donne le ton de
celles qui vont suivre, où la musique, d’ailleurs, est
toujours en contrepoint et toile de fond quelque part. |
|

Le film Nuan |
« Trois chevaux » (《三匹马》),
deux ans plus tard, est marqué du sceau de la cruauté. Une
cruauté née de l’impuissance, de la rage née de l’impuissance,
liée à une violence qui semble inéluctable, aussi inéluctable
que le destin de Nuan, et qui laisse tout le monde sidéré :
« Personne ne souffle mot », dit la dernière phrase, reflétant
l’atmosphère lourde qui accompagne le récit.
C’est cette violence, cette atmosphère étouffante, qui sont
ensuite comme allégées par l’humour qui est l’une des
caractéristiques de l’écriture de Mo Yan.
2000-2004
On est étonné de voir « Grande Bouche » (《大嘴》)
dater de 2004
.
Un père a été accusé d’appartenir à un mouvement de
propriétaires fonciers passés en zone contrôlée par le
Guomingdang en 1947 et tentant de revenir sur leurs terres
occupées par les troupes communistes ; ce soupçon d’appartenance
à un mouvement hérétique est repris contre lui au moment d’un
autre mouvement, celui du « nettoyage des classes sociales » (清理阶级队伍的运动).
Du coup, l’histoire de la nouvelle est datée : c’est mai 1968,
deux ans après le début de la Révolution culturelle
.
Le père est accusé, toute la famille en subit les conséquences,
y compris les enfants, dont la « grande gueule » du titre, qui
doit se fourrer le poing dans la bouche pour éviter de dire des
bêtises qui pourraient valoir des ennuis supplémentaires à la
famille.
“你也给我闭嘴!”娘说,“今后无论到了哪里,大人说话,小小孩儿,带着耳朵听就行了,不要插嘴,
听到了没有?”…
« toi aussi tu la fermes » dit la mère, « désormais, où que
tu ailles, quand les grandes personnes parlent, toi, le gamin,
tu écoutes, point. Tu ne te mêles pas à la conversation,
compris ? »
L’affaire prend des proportions telles que le grand frère
paniqué finit par étouffer à moitié le gamin pour l’empêcher de
parler, et rentrer en grâce auprès du responsable du comité
révolutionnaire de la commune :
哥扇了大嘴一巴掌,大喊:“不许说话!”
Son grand frère lui envoya une gifle magistrale et lui
hurla : « Interdit de parler ! »
« Grande Bouche », c’est avant tout cette atmosphère. Une
atmosphère de peur latente sur fond de spectacle d’opéra local
en préparation, qui, quand on lit la nouvelle en 2018, ne laisse
de susciter un léger malaise, ….
« Oreiller en bois de jujubier, moto » (《枣木凳子,摩托车》)
semble plus amène, mais il n’en n’est rien
.
La nouvelle commence par décrire un artisan traditionnel, un
menuisier qui fabrique des oreillers en bois de jujubier –
oreillers qui sont en fait des blocs de bois (littéralement
« tabourets ») servant d’appui-tête depuis la nuit des temps en
Chine. Un métier bien sûr menacé par les oreillers « mous »
venus de la ville, du monde moderne.
L’homme est aussi musicien, joueur émérite et réputé de erhu, le
violon à deux cordes tout aussi traditionnel que ses oreillers.
Il a eu quatre fils, qui sont morts l’un après l’autre, sans que
leur mort l’ait particulièrement attristé : il a pris chaque
fois son erhu et a noyé son chagrin, si chagrin il y eut, dans
la musique.
Puis, à la fin de sa vie, il s’est acheté sa moto, et a arpenté
avec les rues du village, fier comme artaban. Jusqu’à oublier
toute retenue et finir par se fracasser dans un mur. En éclatant
en pleurs…. comme si soudain s’épanchaient d’un coup les larmes
retenues toute sa vie….
« La femme de Commandant » (《司令的女人》),
également de 2000, est une histoire de jeune instruite qui
apparaît un peu comme l’alter ego de la Xiu Xiu (秀秀)
de la nouvelle « Le bain céleste » (《天浴》)
de
Yan
Geling (严歌苓).
On est toujours pendant et aussitôt après la Révolution
culturelle, dont les conséquences n’en finissent pas de se
répercuter dans le destin des personnages
.
L’atmosphère est moins lourde que dans la nouvelle de Yan
Geling, mais la conclusion, dans toute sa terrible imprécision,
laisse planer l’ombre tragique du passé.
1990
Comme pour marquer la transition entre deux époques, les années
1980 et le début de l’ère de la croissance à deux chiffres qui
va transformer le pays, la société et les esprits, la nouvelle
« Graine de brigand » (《野种》)
est une sorte de réflexion désabusée et ironique sur les
sacrifices de toute une génération pour fonder la Chine
nouvelle, et leurs aspirations illusoires à un monde superbe,
l’« avenir radieux » de Zinoviev.
La nouvelle est datée et localisée : début de l’hiver 1948,
canton nord-est de Gaomi. La « graine de brigand » du titre est
une forte tête locale nommé Yu Douguan qui est sur le point
d’être exécuté pour avoir déserté – on est en pleine guerre. Il
s’en sort en prétextant être somnambule, en subtilisant l’arme
de l’instructeur politique de sa compagnie et en prenant sa
place pour remplir la mission de la compagnie : apporter des
sacs de graine à l’armée rouge qui est en train de mener l’une
des campagnes décisives de l’hiver 1948-49. C’est la campagne de
Huaihai (淮海战役),
mentionne Mo Yan en passant, et cela aurait valu une note en bas
de page : c’est la campagne qui a mené à la victoire communiste,
mais aussi l’une des plus meurtrières de la guerre civile. La
nouvelle y prend tout son sens.
Car, sous les ordres de Douguan, la malheureuse compagnie
affronte les pires obstacles en souffrant de la faim pendant
trois jours sans toucher à un grain des céréales qu’elle
transporte pour ravitailler les soldats, mais sans se voir
récompenser de ses efforts en arrivant, ne serait-ce que par une
parole de remerciement… la fin est particulièrement cruelle dans
sa froideur et la nette volonté de non-dramatisation qu’elle
comporte.
Ce qui frappe, c’est l’humour avec lequel toutes ces péripéties
dramatiques sont contées, y compris un épisode atroce où les
soldats sont attaqués par une bande de miséreux crève-la-faim
relevant de la cour des miracles, comme si tout cela ne valait
pas plus, finalement, qu’un immense éclat de rire.
Aventure faussement épique, frôlant le grotesque par la magie de
l’écriture, la nouvelle est particulièrement bienvenue pour
clore ce recueil plein d’ellipses, aux conclusions souvent
énigmatiques, sur une sorte de pied-de-nez, ou de clin d’œil,
typique de l’auteur.
Chien blanc et balançoire, recueil de sept nouvelles, trad.
Chantal Chen-Andro,
Editions du Seuil, février 2018.
|
|

