|
|
Da Fang,
le nouveau magazine littéraire d’Annie Baobei
《大方》,安妮宝贝主编的新型文学杂志
par Brigitte
Duzan, 14 mai 2011
|
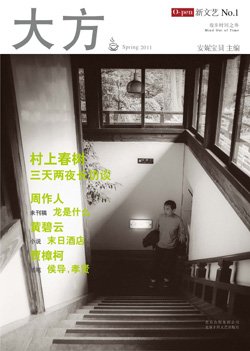
Couverture de Da Fang |
|
Da Fang (《大方》)
est l’un de ces
nouveaux magazines littéraires
qui apparaissent comme une « petite révolution »
(文学杂志“小革命”) dans le monde jusqu’ici tranquille de la
presse littéraire chinoise.
Lancé le 1er mars dernier sous la houlette d’Annie
Baobei, Da Fang s’inscrit dans un mouvement
novateur qui a pour ambition de renouveler les magazines
littéraires tant du point de vue du fond que de la forme,
pour les ouvrir sur un lectorat plus large, plus jeune,
avide de nouveautés et adepte d’images.
Dès le premier numéro, il se présente, comme la plupart
de ses concurrents, comme un magazine ouvert sur
d’autres formes artistiques, complémentaires de la
littérature, mais aussi ouvert sur d’autres littératures
et d’autres cultures. |
Un espace de calme et de réflexion
Da Fang
s’inscrit dans la lignée de précurseurs comme le NEWriting (《鲤》),
de Zhang Yueran, ou le défunt
Party
de Han Han
(《独唱团》),
et fait suite au nouveau bimensuel Tian Nan (《天南》)
lancé par Ou Ning (欧宁)
au début de l’année.
|
Un magazine qui
s’inscrit dans la durée…
Il a cependant une
philosophie et une image qui se veulent différentes. Selon les
termes mêmes d’Annie
Baobei :
《大方》是一本“暂时离开资讯、应景、热闹、时效话题”的杂志。
Da Fang
est un magazine qui
s’éloigne des sujets
d’actualité occasionnels, excitants mais
limités dans le temps.
..目的是要在这个喧嚣的时代倡导一种“敬畏写作、专注阅读”的态度,与时下快节奏、短信息的时代拉开距离。
… l’objectif [du magazine], en cette époque tapageuse, est de susciter
une attitude « de respect envers l’écrit, et d’intérêt pour la
lecture », en
|
|

Annie Baobei |
prenant ses distances de la propension actuelle
aux tempi rapides et messages courts.
Da Fang
veut donc s’inscrire dans la durée, une durée réflexive, privilégiant
des formes plutôt longues : le premier numéro paru comporte des
articles et nouvelles de plusieurs pages pour la plupart. Dans
la même idée, le magazine est trimestriel.
… et dans une perspective interculturelle et
pluridisciplinaire
|

Zhi An |
|
L’une des caractéristiques de Da Fang est de ne
pas se limiter à la littérature chinoise, mais de s’ouvrir sur
la littérature étrangère, ainsi que sur d’autres formes
artistiques, le cinéma en particulier. Son image et sa
philosophie transparaissent de façon subliminale dans le
titre lui-même.
Celui-ci, tel qu’il apparaît sur la couverture du
premier numéro, reprend en effet le terme de wenyi
文艺, qui
englobe à la fois la littérature (文学)
et les arts (艺术),
dans la grande tradition chinoise qui fait de la
peinture comme de la littérature des pendants du trait
calligraphié, tout en l’associant à l’adjectif anglais open, lui
aussi scindé en deux à l’image des deux caractères qui le
précèdent :
《大方·O-pen新文艺》 :
Da Fang. O-pen, nouveaux arts et littérature
|
Le sens qui en ressort est multiple :
- les
deux caractères
大方
dàfang,
d’abord, ont une signification complexe, renvoyant à une
attitude d’ouverture à la fois généreuse et naturelle,
avec une touche de raffinement et de bon goût, celle du
lettré d’antan, celle du siècle des Lumières aussi.
Mais, avec un autre ton,
大方
dàfāng
est un terme plus littéraire qui désigne l’expert, le
connaisseur, et complète le précédent.
- Quant à O-pen, le sens immédiat renvoie bien sûr
à l’ouverture, mais, tel qu’il est écrit, il fait aussi
penser à l’interjection ‘oh pen !’, impliquant la
ferveur littéraire, ou le respect, voire la vénération
de l’écrit (敬畏写作) que le magazine déclare tout de go avoir pour
ambition de promouvoir.
… à l’image de ses concepteurs et
rédacteurs
Da Fang apparaît ainsi beaucoup plus profond qu’on
aurait pu le penser de prime abord. Annie Baobei a su
s’entourer de rédacteurs de qualité, dont les attaches
et activités |
|

Ma Jiahui |
dépassent en outre le seul cadre de la Chine
continentale, s’étendant, selon le terme consacré, « aux deux
rives et trois territoires » (横跨两岸三地),
entendez la Chine continentale, Hong Kong et Taiwan, plus un
rédacteur responsable de la zone Europe-Amérique.
La rédaction est
principalement constituée de trois célébrités du monde
littéraire chinois responsables de leur zone spécifique :
|
-
Zhi An
(止庵)
pour la Chine continentale. Né en 1959 à Pékin, journaliste,
écrivain et chercheur qui écrit depuis 1972, c’est un
spécialiste de Zhou Zuoren (周作人), l’essayiste frère de
Lu Xun,
dont il a compilé et publié un recueil de textes.
-
Ma
Jiahui (马家辉)
pour Hong Kong. Né en 1963, personnalité médiatique du monde
littéraire de Hong Kong, il participe souvent,
|
|

Ye Meiyao avec son époux |
en particulier, à
l’émission littéraire de Phoenix TV Sānrénxíng (三人行)
en tant qu’animateur invité.
-
Ye
Meiyao (叶美瑶)
pour Taiwan. Epouse de l’écrivain Zhang Dachun (张大春),
elle est éditeur en chef de la maison d’édition taiwanaise
grande productrice de bestsellers, Nouvelle culture classique (新经典文化出版社)
, qui, justement, est celle à laquelle est adossé le magazine.
|
On retrouve leur griffe
derrière les textes sélectionnés ou commandés pour ce premier
numéro.
Un premier numéro
éclectique et attrayant
Le premier numéro de
Da Fang reflète bien, en effet, les options de base du
magazine et les personnalités des rédacteurs. Une bonne partie y
est consacrée à la littérature étrangère ; on y trouve par ailleurs,
outre un essai assez long d’Annie Baobei elle-même, un texte
encore inédit de Zhou Zuoren, une nouvelle d’une romancière de
Hong Kong, et un essai sur le cinéma, par Jia Zhangke.
1. Le numéro s’ouvre
sur un long entretien avec l’un des écrivains japonais les plus
populaires aujourd’hui, Haruki Murakami (en chinois
村上春树),
entretien réalisé en mai
|
|

Haruki Murakami |
|
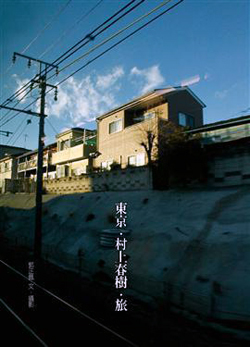
Le Tokyo de Haruki Murakami par Peggy Kuo |
|
2010 pendant trois jours par
Matsuie
Masashi, d’où le titre sur la couverture :
村上春树,三天两夜超级访谈.
Ce n’est cependant pas
un inédit : il avait déjà été publié dans la revue japonaise
Kangaeru Hito (考える人,
“The Thinker”), dans le numéro de l’été 2010. Le texte est
accompagné de photos de Sugano Kenji et a été traduit pour Da
Fang par Zhang Lefeng (张乐风).
L’écrivain y parle de son œuvre, et en particulier de son
bestseller « 1Q84 »,
histoires
parallèles, en trois parties,
d’une tueuse à gage et d'un
professeur rêvant d'écrire des livres (1). Le magazine offre en
complément une virée dans Tokyo de Peggy Kuo (郭正佩),
auteur d’un livre
d’essais-photos sur les lieux de la capitale
japonaise apparaissant dans l’œuvre de l’écrivain. (2)
|
2. L’autre monstre
littéraire qui fait la une de ce premier numéro du magazine est
chinois, et c’est Zhou
|
Zuoren (周作人).
Zhi An a retrouvé un essai inédit de lui écrit au début des
années 1950, intitulé « Qu’est-ce que les dragons ? » (《龙是什么》).
Zhi An explique que l’on trouve des références au texte dans son
journal ; à la date du 27 août 1953, Zhou Zuoren note qu’il a
envoyé les 18 pages de l’essai à « monsieur Pan », c’est-à-dire
Pan Jitong (潘际垌), qui était alors chef du bureau de Pékin du Da Kung Pao (《大公报》) ;
mais l’essai n’y fut cependant pas publié.
Zhou Zuoren en reprit
ultérieurement des passages dans
d’autres publications, mais le
texte était resté inédit. C’est donc un scoop que Da Fang
a largement médiatisé. Ce n’est cependant qu’une étude assez peu
profonde, expliquant sans doute sa non publication, des origines
du dragon, de ses diverses représentations dans la culture
chinoise, ainsi que de ses avatars en Inde et en Occident.
|
|
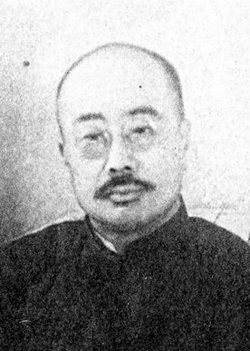
Zhou Zuoren |
L’auteur conclut :
« Nous pouvons conclure que le dragon chinois existait
réellement sous la forme
|

Wong Bik-wan |
|
d’un
grand reptile, une
sorte de lézard qu’il était possible de domestiquer, le plus
proche aujourd’hui étant probablement le dragon de Komodo. Le plus étrange est
cependant que cette créature peu sophistiquée ait exercé une
influence aussi profonde sur la culture chinoise. » Fait
intrigant qui a fait couler beaucoup d’encre depuis (3).
3. Le troisième texte
du magazine est une nouvelle inédite de la romancière de Hong
Kong
Wong Bik-wan (黄碧云),
intitulée « l’hôtel du dernier jour » (《末日酒店》).Née
en 1961,
Wong Bik-wan a été
journaliste freelance et scénariste avant de publier des
collections de nouvelles et d’essais qui l’ont rendue célèbre à
Hong Kong : elle a été couronnée en 1994 d’un Hong Kong Biennal
Award for Chinese Literature, catégorie fiction, pour son
recueil « Tendresse et violence » (《温柔与暴烈》).
|
La nouvelle conte
l’histoire agitée d’une famille de Macao qui y possède un hôtel.
Elle est annoncée comme ayant un style et une atmosphère
rappelant Zhang Ailing.
|
4. Cette nouvelle est
suivie d’une traduction d’une autre nouvelle, « Pharmacy », de
la romancière américaine Elizabeth Strout. Elle est tirée de son
recueil de nouvelles « Olive Kitteridge », qui dépeignent, à
travers le personnage d’Olive Kitteridge, prof de maths et
épouse apparemment très ordinaire du pharmacien d’une petite
ville du Maine, la complexité des relations humaines et les
difficultés de l’existence dans ce petit coin d’Amérique, et
bien au-delà. Le livre a été couronné du prix Pulitzer en 2009.
5. Annie Baobei a
écrit pour l’occasion un long essai intitulé
《一道屏风。一只碗。一本书。》,
en trois parties, comme le titre l’indique, les deux premières
étant des réflexions sur l’existence, la troisième un
développement sur l’œuvre d’un écrivain chinois du 12ème
siècle, Meng Yuanlao (孟元老),
auteur d’un célèbre « Rêve de Hua dans la capitale de
|
|

Elizabeth Strout |
l’Est » (《东京梦华录》)
qui décrit sur un ton raffiné
empreint de tristesse la vie dans la ville de Bianliang/Kaifeng
sous les Song du Nord.
|

Jia Zhangke |
|
6. Le numéro se conclut
avec un essai de Jia Zhangke
(贾樟柯), figure de proue du cinéma indépendant chinois et de ladite ‘sixième
génération’. C’est,
au-delà d’un hommage au grand maître du cinéma taiwanais Hou
Hsiao-hsien (侯孝贤),
un témoignage intime et une réflexion personnelle sur l’art, et
la manière dont chacun le perçoit. C’est aussi la marque de l’option pluridisciplinaire
du magazine.
Au total, si la qualité
du contenu est inégale, les images sont superbes, et Da Fang
se présente bien, comme le voulaient ses créateurs au
départ, comme un espace de calme incitant à la découverte et à
la réflexion dans le tumulte de la vie moderne, non un objet de
consommation rapide, mais un produit à déguster lentement. Son
premier numéro a trouvé des échos et des lecteurs : il a été
tiré, et écoulé, à un millier d’exemplaires.
|
On attend maintenant le
suivant avec curiosité.
Notes
(1) Le livre a été un
incroyable succès d’édition : il s’en est vendu un million
d'exemplaires en un mois. Le titre est une probable référence au
roman « 1984 » de George Orwell : au Japon, on prononce en effet
le "Q" à l'anglaise /kjuː/
et, le "9" se prononçant "Kyū", 1984 et de 1Q84 se lisent de la
même manière.
Le livre est en cours
de traduction en français, et le 1er des trois tomes
devrait paraître chez Belfond en août 2011.
(2) Elle est aussi
auteur de livres sur Paris avec des photos étonnantes, témoin
celles publiées sur son blog :
http://peggy.cc/blog/paris/
(3) Mentionnons à ce
sujet la série de conférences autrement palpitantes données en
ce moment
et jusqu’au 23 mai
au Louvre par Danielle
Elisseeff, « Les hybrides
chinois, la quête de tous les possibles », publiées sous le même
titre par le musée :
http://www.louvre.fr/llv/auditorium/detail_cycle.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198674204361&CURRENT_LLV_CYCLE_AUDIT%3C%3Ecnt_id=10134198674204361&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500960
A lire en
complément :
Présentation de
Wong Bik-wan et des ses
nouvelles
|
|

