|
|
La littérature chinoise au
vingtième siècle
I. 1900-1917 : Transition
Préambule
Le 14 août 1900, Pékin était occupée par l’armée des huit
nations occidentales alliées, entrées en Chine pour mettre fin à
la rébellion des Boxers. Le sac de Pékin et le traité humiliant
que dut signer le prince Qing (庆亲王),
au nom de l’empereur, le 7 septembre 1901, furent pour les
réformateurs une démonstration supplémentaire de la nécessité de
réformes drastiques.
|
L’impératrice douairière,
qui avait étouffé dans l’œuf les réformes de 1898 (1),
fut cette fois obligée d’accepter un vaste programme
qui, de 1901 à 1905, réforma entre autres la
bureaucratie, l’armée et le système éducatif, avec, en
particulier, dans ce dernier domaine, l’abolition des
examens traditionnels pour le recrutement des
fonctionnaires.
Le programme des réformes
de 1898 avait été élaboré par un groupe d’intellectuels,
dont Kang Youwei
(康有为)
et Tan Sitong
(谭嗣同).
L’objectif était de renforcer le système impérial,
l’idéal de Kang Youwei, en particulier, étant
l’établissement d’une monarchie constitutionnelle, sans
renoncer aux fondements confucianistes. Après l’échec de
ces réformes et les événements de 1900-01, cependant, ce
sont les réformateurs plus radicaux qui dominèrent la
scène politique, sous la houlette d’un élève de Kang
Youwei,
Liang Qichao
(梁启超). La
littérature |
|

Liang Qichao |
devint désormais un élément
essentiel, presque déterminant, des réformes socio-politiques.
Liang
Qichao et la « révolution par l’encre »
Au Japon où il était parti après l’échec des réformes pour
échapper à la répression, celui-ci avait été en contact avec les
réformateurs japonais et étudié les textes politiques et
philosophiques européens dont il avait tiré l’idée d’un « état-nation
» où il n’y aurait plus de « sujets » mais des « citoyens »,
mais, comme chez son mentor, sans changer fondamentalement la
structure dynastique. Il appelait ses idées réformistes «
révolutionnaires » - 革命
– terme qu’il avait emprunté à un néologisme japonais, mais dont
l’origine vient du Livre des Mutations où il n’implique qu’un
changement de nom de règne.
Le terme devait avoir une application directe en littérature,
car, chez Liang Qichao, politique et littérature étaient
intimement liées. Il a dit, en citant un passage du Zhuangzi,
que, si son engagement politique lui causait ‘froideurs et
soucis’ (饮冰),
il n’en brûlait pas moins de continuer son œuvre ; il se nomma
ainsi "饮冰室主人"
yǐnbīngshì zhǔrén, l’hôte du bureau des froideurs et
soucis, pour bien marquer que les réformes sociales et
politiques restaient une de ses priorités, la réforme de la
littérature en étant un élément indissociable, voire moteur.
Dès 1896, il se fit l’avocat, avec Tan Sitong, d’une réforme de
la poésie, puis, plus généralement, d’une réforme de la
littérature qu’il mit lui-même en pratique dans ses œuvres,
inaugurant un modèle combinant théorie et création littéraires
qui devait devenir courant chez les écrivains chinois du
vingtième siècle. Egalement pionnier du journalisme en Chine à
l’époque, il en fit le support d’une « révolution par l’encre »,
diffusant ses idées et ses écrits dans son journal, le《新民丛报》 xīnmín
cóngbào (le magazine du nouveau citoyen).
Contrairement à Tan Sitong, pour lequel le « poème nouveau » (新诗)
devait « utiliser le style ancien pour exprimer des conceptions
nouvelles » (以旧风格含新意境
yǐ jiù fēnggé hán xīn yìjìng), il y développa un style
différent du chinois classique alors encore couramment utilisé
dans les écrits sérieux, un style plus proche de la langue orale
tout en conservant encore des éléments de la langue classique,
qui allait devenir en quelques années la base du nouveau langage
utilisé en littérature. C’était le début d’une révolution.
En même temps, ses idées sur la fonction de la littérature dans
la société, inspirées des réformateurs japonais, ouvraient la
voie à des pratiques littéraires totalement nouvelles : dans un
article intitulé « sur les relations entre la fiction et le
gouvernement des masses », publié dans le premier numéro de son
nouveau journal lancé en 1902,《新小说》(le
nouveau roman), il se faisait l’avocat de l’élévation du roman à
un statut nouveau en Chine, celui d’un genre de première
importance pour tout bon gouvernement. Autre révolution, dans un
pays où la fiction était traditionnellement considérée comme un
vulgaire divertissement populaire.
Les
précurseurs du mouvement de la Nouvelle Culture
Pendant la première décennie du vingtième siècle, un flot de
traductions et d’adaptations d’œuvres littéraires étrangères
inondèrent la Chine, apportant théories et influences nouvelles
qui contribuèrent à accélérer les changements en cours. La mort
de l’empereur Guangxu (光绪帝),
en 1908, précipita les événements politiques ; la République de
Chine était proclamée le 1er janvier 1912 avec Sun Yatsen comme
président ; mais il dut céder le poste à Yuan Shikai
(袁世凱), en
échange de l’obtention par celui-ci de l’abdication du dernier
empereur, Puyi.
Or Yuan Shikai, ancien commandant de la meilleure armée de
l’empire, dont il avait fait un instrument de pouvoir personnel,
fut sans doute déterminant dans le coup d’Etat qui mit fin à la
réforme des Cent Jours ; ce n’était pas un démocrate. Il tenta
de restaurer le système dynastique, se proclamant même
|
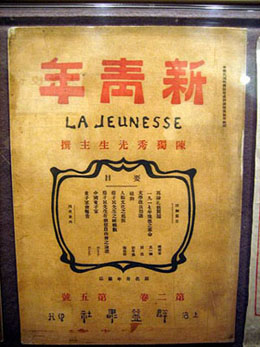
journal “La Jeunesse” |
|
empereur en 1915. A sa mort soudaine en
1916, le pays fut plongé dans l’anarchie, divers
seigneurs de guerre faisant régner une quasi guerre
civile pendant les dix années suivantes. Pourtant cette
décennie fut témoin d’une des plus extraordinaires
transformations intellectuelles de l’histoire chinoise :
comme toujours en Chine en période de division et de
chaos politique, la faiblesse – ou l’absence – de
gouvernement central permit aux écrivains d’œuvrer dans
une relative liberté dans les provinces, dans les
concessions étrangères de Shanghai, et même dans la
capitale.
L’un des esprits les plus influents de
cette période fut Chen Duxiu
(陈独秀),
activiste révolutionnaire, fondateur à Shanghai du
journal “La Jeunesse”
(新青年),
lancé le 15 septembre 1915 et transféré à Pékin en
janvier 1917. Chen Duxiu faisait partie des nombreux
étudiants chinois qui, au début du siècle, partirent
étudier au Japon. Pour |
lui, le confucianisme était le plus grand obstacle au
développement de la Chine ; il proposait de le remplacer par
deux concepts occidentaux : la science et la démocratie. La
science, cependant, était surtout
|
envisagée comme culture fondée sur
l’expérimentation, et favorisant la remise en cause des
idées reçues, tandis que la démocratie n’impliquait
guère plus qu’un suffrage limité à une frange éduquée de
la population.
Comme Liang Qichao, il
accordait une énorme importance à la littérature. Dans
le premier numéro de “La Jeunesse”, il publia un article
dans lequel il incitait les jeunes à lutter contre le
confucianisme par une révolution en littérature :
文学革命论
wénxué gémìnglùn. Il encouragea alors un étudiant
de John Dewey aux Etats-Unis, Hu Shi
(胡适),
à publier dans “La Jeunesse” ses idées de réforme
littéraire. L’article qui les résuma, publié au début de
1917, s’intitula modestement « Quelques tentatives de
suggestions pour une réforme de la littérature chinoise
». Il avançait huit principes qui semblent aujourd’hui
assez banals, tournant autour d’une série de
recommandations pour éviter l’utilisation de clichés, ou
de phrases convenues et sans substance. En revanche, son
incitation à ne plus utiliser la |
|

Chen Duxiu et Hu Shi
|
langue classique, mais
le chinois vernaculaire ou
白话文
báihuà wèn, initia un
mouvement qui devait révolutionner la littérature chinoise.
|

Liu Bannong |
|
Hu Shi lui-même illustra ses idées
théoriques en publiant, dans le même numéro du journal,
quelques poèmes dans le style préconisé, qui furent
suivis dans les mois suivants par d’autres poèmes de
Chen Duxiu et Liu Fu, ou Liu Bannong
(刘复/刘半农).
Ce dernier était par ailleurs linguiste et contribua
activement, par la suite, au développement du baihua et
du système de caractères simplifiés (2).
Il y avait donc eu tout un travail préalable de
recherche et de diffusion d’idées nouvelles sur la
littérature et la langue lorsque
Lu Xun
(鲁迅)
écrivit ce qui est considéré comme le point de départ de
la littérature chinoise moderne :
《狂人日记》,
« Le journal d’un fou », publié dans “La Jeunesse” en
mai 1918. |
L’œuvre allait devenir l’emblème du mouvement du Quatre
Mai, et de celui, qui lui est lié, de la Nouvelle
Culture…
Notes
(1) La réforme dite des « cent jours », inspirée de la réforme
Meiji au Japon : 戊戌变法
wùxū biànfǎ, ou 百日维新
bǎirì wéixīn.
(2) Pour la petite histoire, on lui attribue l’invention du
pronom féminin 她tā, qu’il aurait utilisé pour la première fois
dans un de ses poèmes ; par la suite, l’usage en fut popularisé
en 1930, lorsque son poème《教我如何不想她》
jiào wǒ rúhé bù xiǎng tā (apprenez-moi comment ne plus
penser à elle), écrit en 1920 et mis en musique huit ans plus
tard par l’autre grand linguiste, mais aussi musicien amateur,
Chao Yuanren (赵元任),
devint un air populaire. Les paroles en sont assez simples, il
vaut mieux les écouter déclamées :
http://v.ku6.com/special/show_1989842/MSYjiZLUHl0q4C89.html
Version concert :
http://www.tudou.com/programs/view/O83_-ZSk8SY/
天上飘着些微云, Dans le ciel flottent de légers nuages,
地上吹着些微风。 sur terre souffle une brise légère.
啊! Ah !
微风吹动了我头发,La brise a soulevé sa chevelure,
教我如何不想她? Dites-moi comment ne plus penser à elle.
月光恋爱着海洋, La lune s’est enamourée de l’océan,
海洋恋爱着月光。 Et l’océan de la lune,
啊! Ah !
这般蜜也似的银夜,Cette douceur est celle de la nuit argentée,
教我如何不想她? Dites-moi comment ne plus penser à elle. etc…
|
|

