|
|
Ye Guangqin 叶广芩
Présentation
par Brigitte Duzan, 5 juillet
2013, actualisé 6 mars 2017
|
Ye Guangqin
n’est guère connue hors de Chine ; elle n’est
pratiquement pas traduite. Pourtant, elle jouit en Chine
d’une grande popularité, de par ses origines, par les
histoires qu’elle raconte et les nombreuses adaptations
cinématographiques et télévisées qui en ont été
réalisées, la dernière en date – à la télévision -
datant du début de 2013.
Dans ses romans
et nouvelles, c’est sa patrie d’adoption, le Shaanxi,
que l’on sent vivre, mais aussi sa ville natale, la
vieille ville de Pékin, que l’on sent renaître :
mandchoue comme Lao She, elle a le même amour que lui
des vieux siheyuan où elle a passé son enfance,
et met la même passion à les évoquer.
Ancienne
aristocrate mandchoue |
|

Ye Guangqin |
Née en
1948 à Pékin,
Ye Guangqin (叶广芩) est issue d’une vieille famille de l’aristocratie mandchoue.
Ye est l’abréviation du nom du clan à laquelle la famille
appartenait : Yehe, qui faisait partie de la Bannière bleue à
bordure, ou plus précisément Yehe Nara, le clan ayant été fondé
par un ancêtre mogol
qui s’établit sur les bords du fleuve Yehe
après avoir vaincu les Nara.
Souvenirs nostalgiques du vieux Pékin
Ye Guangqin est une petite nièce de l’impératrice Cixi (慈禧太后)
qui appartenait au même clan. C’est dire combien la vie de la
famille est devenue difficile après l’instauration du régime
communiste, surtout quand le père est mort, peu de temps plus
tard. Restée seule, la mère a dû élever ses quatre enfants en
subsistant comme beaucoup de familles mandchoues à Pékin à
l’époque : en mettant en gage les biens familiaux. A un
demi-siècle de distance, elle partage donc bien des souvenirs
avec
Lao
She (老舍).
Comme
lui, et pour les mêmes raisons, elle garde un souvenir ému de sa
mère, dont l’ombre plane sur nombre de ses récits, liée à la
mémoire du siheyuan familial et de ses habitants (1) :
“母亲是个追求完美与精致的人,这大概与她的家庭背景有关。我对北京城东那座宽展的四合院至今记忆犹新,那是我的姥姥家。母亲在那座院子里出生、成长,那里盛满了叶赫家族的故事,盛满了母亲的记忆。母亲和她的兄长们在这个院里养过鸽子、蛐蛐、蝈蝈、金鱼,糊过风筝,荡过秋千……那个老旧衰落的庭院,那些剥落红漆的廊柱,长满绿苔的墙根,那些挑剔、不合群又满肚子学问的舅舅们让我说不出是喜爱、敬重还是畏惧。…我读母亲的小说,…读出生活与文学的嬗变,十分的微妙,这是我作为母亲作品读者的得天独厚。”
« Ma mère était
quelqu’un de raffiné en quête de perfection, ce qui tenait sans
doute à ses origines familiales. Je garde encore aujourd’hui un
souvenir très net de notre vaste siheyuan de l’est de Pékin qui
était la maison de ma grand-mère maternelle. C’est là que ma
mère était née, avait grandi ; l’endroit fourmillait d’histoires
du clan Yehe, et des souvenirs de ma mère, souvenirs des
pigeons, des criquets, des sauterelles, des poissons rouges,
qu’elle et ses frères y élevaient, des cerfs-volants qu’ils y
fabriquaient et des balançoires sur lesquelles ils jouaient…
Cette vieille cour décrépite, ces corridors aux piliers à la
laque rouge écaillée, ces murs envahis à la base de mousse
verte, et mes oncles, au caractère difficile et peu sociable,
mais incroyablement érudits, je ne sais pas si ce qu’ils
m’inspiraient, c’était de l’amour, du respect ou de la crainte….
A travers les histoires écrites par ma mère, on perçoit des
changements très subtils dans le mode de vie et la littérature ;
c’est pour moi un privilège insigne d’être la lectrice des
récits de ma mère. »
Déracinement brutal
et refuge dans l’écriture
La vie n’était pas
facile pour ces éléments noirs, exploiteurs féodaux, honnis de
la Chine nouvelle, mais la cohésion familiale aidait à survivre.
Tout cet univers vole en miettes avec le lancement de la
Révolution culturelle. En 1968, Ye Guangqin est envoyée « à la
campagne », comme toute sa
génération ; elle doit quitter sa
mère, aveugle et gravement malade, pour partir dans le Shaanxi ;
elle ne la reverra jamais.
|
Elle devient
infirmière. En même temps, les lieux l’inspirent, ils
sont gorgés d’histoire impériale ; elle rêve devant les
tombeaux, et se met à écrire. Sa première nouvelle date
de 1970 : « Un couple » (《夫妻之间》).
Elle a trente deux ans, mais il lui reste encore
beaucoup à apprendre.
En 1983, elle
entre comme rédactrice adjointe au « Journal des
travailleurs du Shaanxi » (《陕西工人报》)
et, la même année, s’inscrit aux cours par
correspondance de journalisme de l’Université du peuple
(人民大学).
En 1990, elle
part continuer se perfectionner au Japon,
à l’université
Chiba. Elle rentre en 1995 en Chine et devient alors
écrivain professionnel, élue vice-présidente
de
l’Association des écrivains de Xi’an en 1999.
C’est donc à
partir du milieu des années 1990 que démarre
|
|
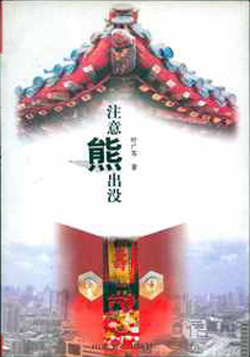
Gare à l’ours |
véritablement sa
carrière, mais elle devient vite un auteur prolifique.
La réalité du
Shaanxi et la mémoire du vieux Pékin
|
Ye Guangqin est
installée à Xi’an depuis plus de quarante ans, le
Shaanxi est devenu sa patrie d’adoption. Ses écrits
reflètent donc son attachement à la culture locale, et à
la culture chinoise traditionnelle, en général.
La culture
pékinoise reste cependant son autre source
d’inspiration, culture liée aux siheyuan, aux
vieux hutong et aux familles mandchoues qui y
vivaient ; ce Pékin embaumé par la mémoire est le thème
vers lequel elle revient régulièrement. En ce sens, on
peut dire qu’elle poursuit dans la même ligne que celle
tracée par
Lao She.
Culture
traditionnelle chinoise revisitée
A ses débuts, c’est la
culture traditionnelle qui est son thème privilégié, mais
toujours illustrée par des histoires de familles. Ainsi, en
1997, la nouvelle "moyenne" « Médecine
|
|
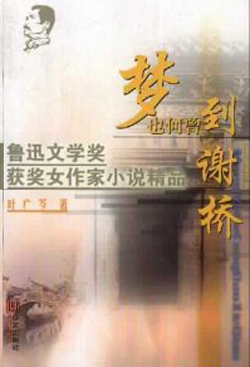
Serait-ce en rêve… |
traditionnelle » (《黄连.厚朴》)
est typique de cette thématique (2). Ye Guangqin y raconte
l’histoire de l’ex-bru d’un vieux praticien de la cour impériale
dont elle est l’élève, Yu Lianfang (于莲舫).
Bien que divorcée, elle continue à résider avec son beau-père et
à se former auprès de lui. Ye Guangqin construit une riche
trame narrative autour d’elle et de la jeune Américaine que son
ex-mari ramène des Etats-Unis, et qui fait des recherches sur
l’ancienne famille impériale…
|
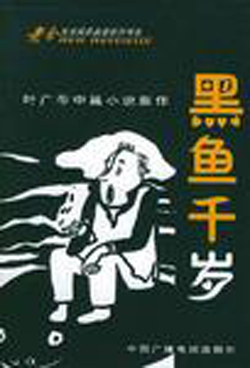
Vive Poisson noir |
|
Son amour de
la culture locale passe aussi par la défense
de
l’environnement et des animaux sauvages qu’elle aime
à
célébrer, témoin sa nouvelle « Le
tigre Da Fu » (《老虎大福》), sorte de conte écologique élégiaque des temps modernes, paru en 2004.
Mais sa plus
belle réussite, dans le domaine de la
préservation de la
mémoire populaire de la région du
Shaanxi, est son roman
« Le
village de Qingmu Chuan » (《青木川》), paru au début de 2008. Elle a passé une dizaine d’années à l’écrire et
il a fait partie de la sélection pour le prix Mao Dun en
2011..
Il s’agit d’un
petit bourg aux confins des trois provinces du Shaanxi,
du Gansu et du Sichuan. Le roman raconte la
vie d'un
brigand légendaire qui y aurait vécu nommé Wei Futang (魏富堂)
et, à travers lui, brosse un tableau vivant |
de ce coin
de terre de la fondation de la République populaire
jusqu’à nos jours, de la vie locale, des paysages, et
des us et coutumes.
|
Ye Guangqin a
commencé par
faire une enquête sur ce personnage, mais s’est vite
rendu compte que ce n’était pas une simple histoire de
brigand. Wei Futang était aussi quelqu'un qui avait fait
construire des ponts et ouvert des écoles dans son
village natal, et y avait fait venir des enseignants. Il
était parvenu à créer un collège moderne au fin fond de
la montagne, où l'on enseignait le russe
et l'anglais.
Bref, c’était autant un bienfaiteur qu’un bandit.
Culture
pékinoise et mandchoue
Tout un autre
pan de son œuvre est constitué des récits concernant
Pékin et ses antécédents mandchous. Ces histoires
reflètent et retracent les multiples
changements qu’ont
vécus les gens autour d’elle, et sa mère avant elle,
pendant un peu plus d’un siècle, en gros de la fin des
Qing et de la Révolution de 1911 à aujourd’hui. Elle se
|
|
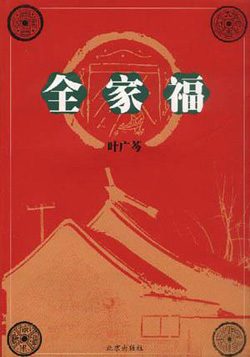
Bonheur familial |
|
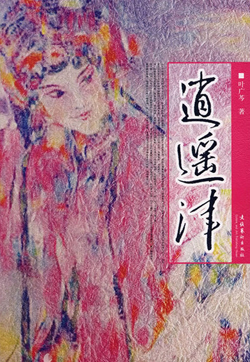
Xiaoyaojin |
|
sert ici aussi, très souvent,
de la forme courante dans la littérature chinoise pour
retracer l’histoire d’une époque sur plusieurs
générations : la saga familiale, comme « Bonheur
familial » (《全家福》)
qui décrit
cinquante ans
de la vie d’une famille et de leurs voisins dans un
siheyuan et a été couronné du sixième prix Mao Dun.
L’un des
meilleurs exemples, dans ce domaine, est sans doute la
nouvelle de taille moyenne « Chronique du lait de soja »
(《豆汁记》),
qui décrit une grande famille pékinoise sur le déclin à
travers la vie de sa cuisinière, arrivée toute
jeune avec une
horrible cicatrice lui barrant le visage, mais
d’extraordinaires dons culinaires.
Elle était en
fait entrée à onze ans au service d’une concubine
impériale, à la fin du dix-neuvième siècle, et avait été
mariée au chef cuisinier du dernier empereur, alcoolique
et opiomane, qui l’avait défigurée et vendue à la
famille pour |
|
rembourser ses dettes, puis était réapparu avec un
enfant. Au début des années 1960, au moment de la Grande
Famine, le mari en question réussit à fournir à la
famille du lait de soja providentiel.
Un autre thème
récurrent dans l’œuvre de Ye Guangqin, concernant Pékin,
est l’opéra jingju, qui lui sert parfois de toile
de fond ou de motif structurel. Ainsi, sa nouvelle « Xiaoyaojin »
ou Gué Xiaoyao (《逍遥津》) fait référence à un opéra éponyme dont l’action se passe pendant la
période des Trois Royaumes, le titre étant le nom d’une
bataille célèbre : craignant que son premier ministre
Cao Cao n’usurpe le trône, Liu Xie, dernier empereur des
Han de l’Est, tente de l’éliminer, mais le complot est
découvert… Pour cette nouvelle,
Ye Guangqin a
été couronnée en 2007 du prix littéraire Xiao Hong.
Ye Guangqin
a annoncé par ailleurs être en train de préparer |
|
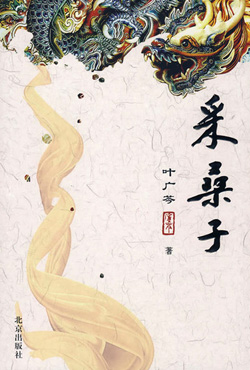
Cai Sangzi |
un roman relatant une centaine d'années d'histoire de la
capitale, où chacun des chapitres portera le nom d'une
pièce d'opéra de Pékin. L'action de ce roman se passe
à
l'extérieur de la porte de Chaoyang (朝阳),
un lieu très connu du vieux Pékin où habitait sa
grand-mère maternelle….
Notes
(1) Modèle
architectural traditionnel datant de plus de deux mille ans et
répandu dans toute la Chine, les siheyuan (四合院)
sont les maisons traditionnelles à cour intérieure typiques du
vieux Pékin. Le siheyuan de la grand-mère de
Ye Guangqin, où elle a
passé son enfance et son adolescence, était situé dans un
hutong à l’extérieur de la porte de Chaoyang (朝阳门).
(2) Le titre
《黄连.厚朴》huánglián
hòupò
désigne un
rhizome et une plante utilisés en médecine traditionnelle
chinoise, qui apparaissent dans le courant de l’histoire.
Adaptations
cinématographiques
Beaucoup d’œuvres de Ye
Guangqin ont été adaptées au cinéma et à la télévision.
|
A la télévision :
- Bonheur familial《全家福》 :
adapté au
théâtre en 2005, puis en feuilleton télévisé de 48 épisodes,
diffusé en janvier 2013.
Au
cinéma :
- 2004 : The Marriage
Certificate / ou Who Cares ?《谁说我不在乎》réalisé par Huang
Jianxin (黄建新)*,au studio de Xi’an, avec Feng Gong (冯巩),
Lü Liping (吕丽萍), Li Xiaomeng (李小萌)
- 1997 :
Our Tradition
《黄连.厚朴》par
Ding Yinnan (丁荫楠)
- 1995 :
Signal Left, Turn Right
《红灯停,绿灯行》 réalisé
par Huang Jianxin *, tourné au studio de Xi’an et
adapté de
la nouvelle « Anecdotes d’une école de conduite »
《学车轶事》
|
|
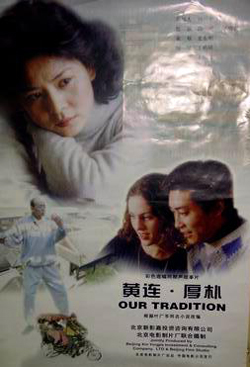
Film Our Tradition |
* sur Huang
Jianxin, voir
www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Huang_Jianxin.htm
Principales œuvres publiées
(les titres donné en français
sont des traductions à titre indicatif)
1970 Un couple 《夫妻之间》
1994 On a les mêmes racines 《本是同根生》
1997 Médecine traditionnelle 《黄连.厚朴》中篇小说集
1998 Gare à l’ours
《注意熊出没》
2001 Le bonheur de toute la
famille 《全家福》
2002 Le pont Xie, un rêve sans
doute 《梦也何曾到谢桥》
2004 Le tigre Da Fu 《老虎大福》
2005 Vive Poisson noir 《黑鱼万岁》
2005 Histoires du Japon 《日本故事》
2007 Xiaoyaojin 《逍遥津》
2008 Le village de Qingmu Chuan 《青木川》
2009 Cai Sangzi《采桑子》
2009 Chronique du lait de soja 《豆汁记》
2010 La vieille ville du district
(édition illustrée)《老县城》 (全彩图文版)
2010 La solitude du Palais d’été
– recueil d’essais 《叶广芩散文选:颐和园的寂寞》
2010 L’hôte du bois, esprit de la
montagne – recueil de nouvelles
《叶广芩短篇小说选:山鬼木客》
2011 L’ennui malgré l’ivresse 《醉也无聊》
2012 L’entremetteuse du lauréat 《状元媒》
2016 La tombe du revenant 《鬼子坟》
Sélection des meilleures nouvelles de l’année 2015 du Bureau de
recherche de l’Association des écrivains
(2015年中国短篇小说精选, 中国作协创研部 pp. 77-100)
Traductions en
anglais
- Back Quarters at
Number Seven 《后罩楼》,
tr. Bruce Humes,
Pathlight June 2014.
Un récit partiellement
autobiographique sur la vie dans un hutong de Pékin, dans une
famille mandchoue, au début de la Chine nouvelle, quand leur
résidence princière est devenue propriété des masses et que s’y
tiennent des activités collectives, réunions de quartier ou
danses populaires.
Introduction et extrait
de la traduction :
http://bruce-humes.com/archives/8079#more-8079
- Rain : the Story
of Hiroshima (《雨》又名《广岛故事》),
nouvelle moyenne tr. Qin Quan’an, in : Old Land, New Tales,
24 short stories by writers of the Shaanxi region of China, ed.
by
Chen Zhongshi &
Jia Pingwa, Amazon Crossing juillet 2014, pp.
181-222.
Un récit à la première
personne, écrit en 2002 à Hiroshima : l’histoire de deux
Japonaises âgées qui ont survécu au bombardement, et n’osent
plus sortir quand il pleut…
-
Mountains Stories,
Valley Press (à paraître juillet 2017)
|
|

