|
|
« La boutique de la famille Lin »
《林家铺子》 :
la nouvelle de Mao Dun (茅盾)
et le film de Shui Hua (水华)
par Brigitte Duzan, 30 novembre 2011
Rarement une œuvre littéraire et son adaptation
cinématographique n’auront été à la fois aussi proches et aussi
différentes. Ecrite pour l’une, réalisée pour l’autre, à moins
de vingt ans de distance, elles reflètent aussi bien le fossé
entre les deux époques que les similarités qui les rapprochent,
au travers de leurs auteurs.
I. La nouvelle.
|
« La boutique
de la famille Lin » (《林家铺子》) fait partie de la série de nouvelles écrites par
Mao Dun (茅盾)
en 1932, sous le titre général de « trilogie rurale » (“农村三部曲”) , dont, en particulier, la première, « Les
vers à soie du printemps » (《春蚕》),
avec
laquelle elle est souvent publiée.
Place dans
l’œuvre de Mao Dun
Les deux
nouvelles forment en effet deux pendants d’une même
histoire, celle de la ruine de deux catégories sociales
traditionnelles en Chine à cette époque, sous les coups
de facteurs conjugués : la situation politique,
intérieure et extérieure, la crise économique qui en
résulte, mais qui tient aussi à l’obsolescence de
structures traditionnelles qui ne peuvent s’adapter pour
résister à la concurrence, surtout étrangère, sans
oublier la corruption généralisée et la déliquescence du
gouvernement. |
|

La nouvelle |
Les deux secteurs sociaux en déshérence sont, dans le cas de la
« trilogie », les petits paysans, dans celui de « La boutique de
la famille Lin », les boutiquiers des petites villes. Le tableau
sera complété en 1933 par le roman « Minuit » (《子夜》) qui forme le troisième
volet de l’analyse de la décomposition de la société chinoise de
l’époque : il concerne cette fois l’industrie métropolitaine, et
en l’occurrence un industriel de Shanghai qui, lui aussi, se bat
vainement contre le mécanisme implacable de l’Histoire.
Fil narratif de la
nouvelle
Achevée en juin 1932, « La boutique de la famille Lin » est en
sept parties : cinq plus une partie introductive et une brève
conclusion. C’est une nouvelle de taille moyenne, mais
relativement courte, écrite dans un style précis et direct,
s’appuyant sur les dialogues, sans descriptions superflues.
1.
Dès la première page, Mao Dun entre de plain pied dans son
sujet en évoquant le contexte politique tendu du début de
l’année où il écrit, alors que le Japon a envahi la Mandchourie
: la jeune Lin, fille unique du boutiquier Lin, rentre chez elle
après ses cours et s’affale sur son lit, attristée par les
critiques dont elle a été l’objet à l’école parce qu’elle porte
des vêtements faits avec des soieries… japonaises, ces mêmes
soieries qui sont en train de ruiner l’industrie locale et,
production de l’ennemi, ont été interdites par le gouvernement.
La
situation est évoquée en quelques lignes dès le troisième
paragraphe : la jeune fille, étonnée que sa mère ne soit pas
venue comme d’habitude quand elle rentre de l’école, prête
l’oreille aux voix étouffées qui viennent de la pièce d’à côté…
林小姐在床上又翻一个身,翘起了头,打算偷听妈和谁谈话,是那样悄悄地放低了声音。
然而听不清,只有妈的连声打呃,间歇地飘到林小姐的耳朵。忽然妈的嗓音高了一些,似乎很生气,就有几个字听得很分明:
——这也是东洋货,那也是东洋货,呃!……
La jeune Lin se
retourna sur son lit, releva la tête et prêta l’oreille,
essayant de déceler avec qui sa mère pouvait bien parler aussi
bas. Mais elle ne réussit pas à entendre précisément ce qui se
disait, seuls lui parvenaient les hoquets intermittents de sa
mère. Puis, soudain, celle-ci éleva la voix, comme si elle était
en colère, et proféra quelques mots très clairs : «-- mais ce
sont des marchandises japonaises, ce sont des marchandises
japonaises, hic !... »
On
a tout de suite un aperçu des caractères et de la mentalité des
trois personnages de la famille : la jeune Lin préoccupée par ce
qu’elle va bien pouvoir mettre à l’école, la mère affolée qui ne
peut comprimer son hoquet nerveux et le père cherchant les
moyens de s’en sortir ; mais cette introduction est aussi une
évocation très précise des difficultés dans lesquelles se débat
monsieur Lin, aux prises avec des affaires en déficit et
l’interdit qui bloque son commerce, fondé sur les marchandises
japonaises importées, interdit qu’il va tenter de contourner en
négociant un pot de vin avec le chef de la guilde des marchands,
pour qu’il ferme les yeux. Tout s’achète, suggère Mao Dun.
2.
La deuxième partie montre monsieur Lin dans sa boutique : le pot
de vin a de toute évidence été accepté, les marchandises
japonaises sont reconverties en marchandises nationales, et la
vitrine arbore une affiche alléchante « en imitation des grands
magasins de Shanghai » (摹仿上海大商店的办法): « Affaires en or, 10% de réduction » (“大廉价照码九折”).
C’est la période des fêtes, une semaine avant le Nouvel An –
détail qui n’est pas anodin, car c’est la période où,
traditionnellement en Chine, on solde ses dettes, matérielles et
morales – période aussi où l’on achète des cadeaux ; mais les
paysans venus de leurs villages faire des emplettes n’ont pas
d’argent pour payer : les ventes de riz sont parties en fumée
pour payer les loyers aux propriétaires et les intérêts aux
usuriers :
这一切,林先生都明白,他就觉得自己的一份生意至少是间接的被地主和高利贷者剥夺去了。
Tout cela, monsieur Lin
le comprenait très bien, une partie au moins de son commerce
était engloutie par les usuriers et les propriétaires.
A
la fin de la journée, en dépit des quelques ventes réalisées,
les comptes restent catastrophiques : entre ce que monsieur Lin
doit à ses fournisseurs de Shanghai et ce que lui doivent les
clients, le total est de deux mille dollars !
Sur quoi arrive un autre personnage important dans l’histoire :
une « vieille femme de plus de cinquante ans » (五十多岁的一位老婆子),
madame Zhu (朱三太), qui entre toute tremblotante dans la boutique (巍颤颤地走进店来),
mais avec son livre de compte – elle a prêté trois cents dollars
à monsieur Lin, c’est la principale source de son capital, et
elle vient réclamer ses intérêts de retard, neuf dollars. C’est
la recette de la journée. Elle repart avec.
Mais monsieur Lin pense à ses deux autres prêteurs, monsieur
Chen et la veuve Zhang, qui ont investi respectivement deux
cents et cent cinquante dollars (陈老七的二百元和张寡妇的一百五十元) :
encore dix dollars d’intérêt qu’il aurait à payer. Plus
l’échéance due au grossiste de Shanghai…
3.
Les deux jours suivants, les ventes marchent bien, mais chacune
est réalisée à perte. Le pauvre boutiquier est pris dans un
tourment intérieur et inquiet d’être la risée de la concurrence
:
偶尔他偷眼望望斜对门的裕昌祥,就觉得那边闲立在柜台边的店员和掌柜,嘴角上都带着讥讽的讪笑,似乎都在说:“看这姓林的傻子呀,当真亏本放盘哪!看着罢,他的生意越好,就越亏本,倒闭得越快!”
Lorsqu’il regardait à
la dérobée le magasin d’en face, il avait l’impression que,
derrière leur comptoir, le propriétaire et les vendeurs
arboraient un sourire railleur, comme s’ils
disaient : « Regardez donc ce pauvre idiot de Lin, il vend à
perte ! Plus il vend, plus il perd, et plus vite il va être
obligé de fermer ! »
Le
chef de la guilde des marchands, de son côté, vient le
féliciter, mais lui suggère de ne pas « oublier » le responsable
local du Guomingdang, le commissaire Bu (卜局长), pour qu’il n’ait pas l’idée d’intervenir « sous la pression des
jaloux ».
Le
pire, c’est que son employé Shousheng (寿生),
envoyé à la campagne tenter de se faire payer les factures
restées impayées, n’est toujours pas revenu. Des rumeurs courent
que son bateau a été attaqué par des pirates… En fait, sa fille
revient avec la nouvelle que Shanghai a été bombardée, le
quartier de Zhabei est réduit en cendres (闸北烧光了) ! (1).
Du
coup, l’envoyé du grossiste de Shanghai veut rentrer au plus
vite avant que les routes soient coupées, et veut être payé
illico avant de partir. Monsieur Lin va plaider un prêt
supplémentaire auprès du banquier local, mais celui-ci lui
demande au contraire de rembourser ce qu’il doit. L’étau se
resserre.
En
rentrant chez lui, il rencontre le vieux Chen qui lui apprend
que les soldats ont extorqué de l’argent à la guilde des
marchands. Il rentre en frémissant, en pensant qu’il va devoir
payer sa contribution…
4.
Il se met à tomber une pluie glaciale qui se tourne en neige et
fait encore plus fuir les clients. Tout dépend désormais de
l’argent que va rapporter Shousheng. Mais quand il arrive,
couvert de boue, l’argent qu’il rapporte ne suffit même pas à
payer la note du grossiste. En fait, le sachant dans une passe
difficile, tout le monde fait pression sur le malheureux Lin, du
Guomingdang aux banquiers et aux créditeurs.
Mao Dun s’arrête alors pour l’une des rares descriptions de la
nouvelle, qui constitue comme l’apogée du destin désormais
inéluctable du boutiquier – avec une logique implacable,
l’auteur a tiré un à un tous les fils de sa narration, il ne
reste plus qu’à amorcer la ‘chute’ - alors, arrivé à ce point,
il fait une pause, comme pour considérer la situation :
雪是愈下愈密了,街上已经见白。偶尔有一条狗垂着尾巴走过,抖一抖身体,摇落了厚积在毛上的那些雪,就又悄悄地夹着尾巴走了。自从有这条街以来,从没见过这样冷落凄凉的年关!而此时,远在上海,日本军的重炮正在发狂地轰毁那边繁盛的市廛。
La neige tombait en
flocons de plus en plus épais, la rue était déjà blanche. Un
chien passait de temps à autre en tremblant de tout son corps,
la queue basse, s’arrêtant au passage pour secouer la neige
accumulée sur ses poils avant de repartir, la queue toujours
entre les pattes. Jamais la rue n’avait connu une saison de
Nouvel An aussi froide et désolée ! Et pendant ce temps, là-bas,
à Shanghai, l’artillerie lourde japonaise était en train de
sauvagement pilonner cette prospère métropole commerciale
(2).
5.
Résultat : après le Nouvel An, vingt huit magasins ferment, y
compris les deux qui devaient trois cent dollars à monsieur Lin
et dont les propriétaires se sont enfuis. Quant à monsieur Lin,
il est sous la surveillance de la banque : toutes ses recettes
doivent aller à payer son découvert.
Pourtant, l’atmosphère s’est améliorée, comme le temps.
Néanmoins, alors que c’est la fête du temple de Guandi (关帝庙)
(2), les marchands ambulants ne gagnent même pas assez d’argent
pour se payer à manger. Les seuls qui font recette sont des
acrobates, note ironiquement Mao Dun :
只有那班变把戏的出了八块钱的大生意,党老爷们唤他们去点缀了一番“升平气象”。
Il n’y eut que la
troupe d’acrobates pour se faire la somme fabuleuse de huit
dollars, ils avaient été engagés par les chefs du Guomingdang
pour contribuer à « promouvoir une atmosphère de paix ».
Dans ces circonstances difficiles, Shousheng arrive avec une
lueur d’espoir : les gens fuient Shanghai, tous ces réfugiés
vont avoir besoin de produits de première nécessité…Monsieur Lin
a alors l’idée d’une vente promotionnelle, toujours « à la
manière des grands magasins de Shanghai », et appelle sa fille
pour préparer une grande affiche : « Grande promotion, tout à un
dollar » (“大廉价一元货”).
Et
les affaires marchent comme escompté. Mais il y a quelques
ombres au tableau : la banque a envoyé un employé collecter 80%
des recettes, et les trois prêteurs ont demandé un remboursement
au moins partiel de leurs avoirs. Monsieur Lin décide d’aller
voir le chef de la guilde pour obtenir son soutien.
Celui-ci transmet alors au malheureux boutiquier un message
fatidique qui va sceller son destin :
“有一件事,早就想对你说,只是没有机会。镇上的卜局长不知在哪里见过令爱来,极为中意;卜局长年将四十,还没有儿子,屋子里虽则放着两个人,都没生育过;要是令爱过去,生下一男半女,就是现成的局长太太。呵,那时,就连我也沾点儿光呢!”
« Il y a une chose que
je veux vous dire depuis longtemps, mais je n’en ai jamais eu
l’occasion. Je ne sais pas où le commissaire Bu a vu votre
fille, mais elle a attiré son attention. Il a quarante ans, et
n’a pas de fils. Il a bien deux femmes, mais aucune n’a
d’enfant. Si votre fille accepte d’aller chez lui, et lui donne
un enfant, garçon ou même fille, elle peut être assurée qu’il
l’épousera. Ah, et alors, même moi en partagerai la gloire ! »
Et
d’ajouter devant l’air consterné de son interlocuteur :
“我们是老朋友,什么话都可以讲个明白。论到这种事呢,照老派说,好像面子上不好听;然而也不尽然。现在通行这一套,令爱过去也算是正的。--况且,卜局长既然有了这个心,
不答应他有许多不便之处;答应了,将来倒有巴望。我是替你打算,才说这个话。”
« Nous sommes de vieux
amis, il est normal de discuter de ce genre de choses. Selon les
anciennes traditions, ce genre d’arrangement ne serait pas bon
pour votre face. Mais aujourd’hui, cela a changé, c’est devenu
commun. En outre, puisque c’est ce que désire le commissaire Bu,
il ne serait pas bon de refuser ; si vous acceptez, en revanche,
vous pouvez espérer en l’avenir. Si je vous dis cela, c’est
uniquement dans votre intérêt. »
Il
rentre atterré chez lui et la nouvelle sème la désolation dans
le ménage. Mais, le lendemain, les affaires marchent mieux que
jamais. Les clients s’arrachent la marchandise. Monsieur Lin
trouve cependant cela étrange, presque inquiétant. Et en effet,
c’est parce que la rumeur s’est répandue qu’il est sur le point
de fermer et qu’il liquide son stock…
Sur quoi deux gendarmes viennent le chercher pour l’emmener au
siège du Guomingdang.
6.
Il y est détenu, officiellement, pour l’empêcher de s’enfuir
avec l’argent qui lui reste, comme rapporte Mao Dun, ici encore
avec ironie :
…然而林先生除有庄款和客账未清外,还有朱三阿太,桥头陈老七,张寡妇三位孤苦人儿的存款共计六百五十元没有保障,党部里是专替这些孤苦人儿谋利益的,所以把林先生扣起来,要他理直这些存款。
… c’est que monsieur
Lin, outre ses dettes envers la banque et son grossiste, devait
aussi six cents cinquante dollars à ces trois malheureux
créanciers, madame Zhu, le vieux Chen et la veuve Zhang, il
s’agissait de les protéger, le Guomingdang était
particulièrement soucieux du sort de ces pauvres gens, alors il
détenait monsieur Lin jusqu’à ce qu’il les ait réglés.
Shousheng va voir le chef de la guilde, mais il s’avère que
c’est le commissaire Bu qui fait pression… Finalement le
boutiquier est relâché moyennant deux cents dollars
supplémentaires, trouvés en vendant une partie du stock au
concurrent d’en face qui a partie liée avec les deux autres.
Désormais perdu, il s’enfuit avec sa fille, secrètement mariée
avec Shousheng, celui-ci restant avec madame Lin pour gérer au
mieux la situation.
7.
La boutique est fermée. La banque et les autres gros créanciers
se disputent ce qui reste. Deux policiers gardent l’entrée.
Arrive madame Zhu, bientôt rejointe par la veuve Zhang en
pleurs, son enfant dans les bras. Le vieux Chen sort de la
boutique : ils se sont tout distribué, dit-il, ils n’ont rien
laissé. La veuve Zhang redouble de pleurs : elle a perdu toutes
ses économies.
La
foule gronde, les pousse à aller se plaindre au bureau du
Guomingdang. Il est gardé par la police, une échauffourée
s’ensuit, les policiers se mettent à frapper les gens qui
fuient dans la plus grande confusion :
朱三阿太老迈,跌倒了。张寡妇慌忙中落掉了鞋子,给人们一冲,也跌在地下,她连滚带爬躲过了许多跳过的和踏上来的脚,站起来跑了一段路,方才觉到她的孩子没有了。看衣襟上时,有几滴血。
“啊哟!我的宝贝!我的心肝!强盗杀人了,玉皇大帝救命呀!”
她带哭带嚷的快跑,头发纷散;待到她跑过那倒闭了的林家铺面时,她已经完全疯了!
La vieille madame Zhu
tomba. Dans sa précipitation, la veuve Zhang perdit une
chaussure, et, bousculée, tomba elle aussi ; elle réussit, en se
faufilant et rampant, à éviter les pieds qui menaçaient de la
piétiner, puis à se redresser et courir un bon bout de chemin,
c’est alors seulement qu’elle réalisa que son enfant n’était
plus là. Baissant les yeux, elle vit qu’il y avait des tâches de
sang sur le devant de sa veste.
« Ah ! Mon trésor !
Fruit de mes entrailles ! Ces bandits l’ont tué, Empereur de
Jade, au secours ! »
Elle se remit à courir
en pleurant et se lamentant, les cheveux en désordre ; quand
elle passa devant la boutique fermée de la famille Lin, elle
avait déjà complètement perdu l’esprit.
Clés de lecture
Mao Dun fait preuve, dans cette nouvelle, d’un remarquable
talent de conteur : le ton est vif et soutenu, avec des pointes
d’humour, il n’y a pas de temps mort, pas de descriptions
inutiles qui viendraient distraire l’attention. Le fil narratif
est tendu à l’extrême pour, en quelques pages, dresser un
tableau satirique des diverses strates de la société d’une
bourgade de province, non loin de Shanghai, et conduire le récit
à sa fin ultime : la folie de la veuve privée de ses économies,
victime indirecte de la faillite de la boutique où elle les
avait investies.
Le
récit a un aspect de pamphlet politique et propagande
anti-nationaliste, avec ses attaques récurrentes et sardoniques
contre la corruption et l’hypocrisie des cadres du Guomingdang.
Il a aussi un côté satire sociale, montrant les pauvres
exploités par les pouvoirs établis et les responsables à tous
les échelons. Et la fin est digne de Victor Hugo.
Ce
n’est cependant pas l’aspect essentiel. « La boutique de la
famille Lin » est un récit quasi allégorique. Mao Dun a pris
soin de n’en préciser ni le lieu ni le cadre précis. On ne sait
pratiquement rien de cette boutique, comme on ne sait
pratiquement rien de l’aspect physique des personnages. Ils sont
typés : la jeune Lin, frivole comme une écolière de son âge, sa
mère affligée d’un tic nerveux et disciple de Guanyin, la
créancière Zhu vieille et tremblotante, et la veuve Zhang en
pleurs, son enfant dans le bras. Quelques traits suffisent à le
présenter : ils sont emblématiques.
Même les événements extérieurs sont juste évoqués : le
bombardement de Shanghai, la destruction du quartier de Zhabei,
et, malgré la difficulté des communications, l’afflux soudain de
réfugiés. Il n’est pas besoin de préciser : quand Mao Dun écrit,
ces événements sont encore très clairs dans les mémoires. Mais
là encore, ils ne sont pas décrits longuement, ce sont juste des
éléments qui concourent à la trame de son récit.
Mao Dun ne décrit pas la faillite du boutiquier Lin pour
elle-même : elle est prise comme symbole de la faillite de toute
la chaîne de boutiques du même genre qui sont condamnées
inéluctablement à disparaître comme les éleveurs de vers à soie
étaient condamnés à disparaître dans « Les vers à soie du
printemps », et comme l’industriel de « Minuit » le sera à son
tour dans le roman que Mao Dun écrira l’année suivante.
Il
s’agit d’une lecture marxiste de l’histoire de l’époque. La
modernité est en marche, la vieille société doit disparaître, et
elle va disparaître inéluctablement, pour laisser place à une
société capitaliste, avec tous ses défauts qui la condamneront à
son tour pour laisser la place, en dernier ressort, à la société
communiste.
Mao Dun trace avec une habileté consommée les contradictions qui
condamnent son petit boutiquier, le réseau de dettes où il
s’enfonce peu à peu jusqu’à en être étouffé, le dernier coup
venant cependant des restes de la vieille société « féodale »
que même Mao aura du mal à éradiquer. Mao Dun démonte le
mécanisme de l’histoire en marche.
Texte chinois en entier :
www.my285.com/xdmj/maodun/05.htm
II. Le
film
|
Le film éponyme
de Shui Hua (水华)
a été réalisé en 1959. C’est une autre époque, appelant
un autre discours. Si le scénario de Xia Yan (夏衍)
est une adaptation fidèle de la nouvelle quant à sa
trame générale, il tire, en revanche, le récit vers le
mélodrame.
Le film est en
cela dans la lignée des mélodrames de la période d’or du
cinéma chinois, ceux du cinéma de gauche des années
1930, dont Xia Yan fut justement l’un des principaux
scénaristes. Il est aussi à replacer dans le contexte de
l’époque de sa réalisation, où il apparaît sous un jour
quelque peu ambigu.
Le contexte de
1959
Lorsque le
film a été réalisé, les Chinois |
|
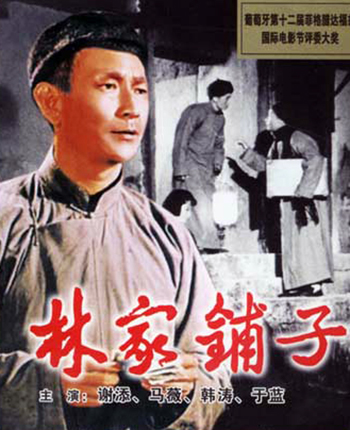
Affiche du film |
avaient déjà connu
dix ans de marxisme, dix années de difficultés, de drames et de
campagnes diverses, culminant dans la campagne antidroitière de
1957. En 1958, avec le Grand Bond en avant, une sorte de délire
s’est emparée de la Chine : il faut rattraper l’Angleterre en
quinze ans ! D’où collectivisation accélérée, création des
communes populaires, etc…
|

Affiche de propagande pour le Grand Bond
en avant, 1959 « Frappez encore plus
fort le tambour appelant au combat
du Grand Bond en avant » |
|
Et ce
délire n’épargne pas le cinéma car Le Grand Bond en
avant nécessite une mobilisation de masse, et les films
sont jugés essentiels pour créer l’enthousiasme
productiviste nécessaire pour gagner la bataille de
l’acier.
Le
mouvement est d’abord quantitatif, comme dans le reste
de l’économie : il faut multiplier les films pour
toucher le public des campagnes dans les coins les plus
reculés, et pour cela multiplier les studios et les
équipe de projection ambulantes. Dans la première moitié
de 1959, dix nouveaux studios voient le jour. C’est
l’équivalent des « hauts fourneaux de village » qui
sortaient de terre un peu partout à l’époque. Le cinéma
répond au slogan en vigueur : « [produire] plus, plus
vite, mieux et moins cher ».
Mais le Parti
dicte aussi le contenu. Il faut donner, ou redonner, foi
dans le régime pour que les Chinois aient le cœur à
l’ouvrage. Et cela passe par la démonstration prouvant
que le régime féodal opprimait et que le
|
capitalisme
conduisait à la ruine du peuple, outre l’éloge de
l’ardeur au travail (collectif). Malgré tout, en 1959, certains
cinéastes apportent quelques corrections au « simplisme
ouvriériste » de l’année précédente (4). Le mouvement du Grand
Bond en avant ne faisait plus l’unanimité, les difficultés
s’accumulaient, le Bureau politique du Parti lui-même était
divisé sur la ligne à tenir.
Le dixième anniversaire de la fondation de la République
entraîne une nouvelle mobilisation des cinéastes, longuement
préparée. Le studio de Pékin, en particulier, apporte une
importante contribution : quatre des sept meilleurs films en
couleur de l’année, dont « La boutique de la famille Lin ». Il
travailla sous l’égide du comité municipal du Parti de la
capitale qui constitua un groupe de spécialistes, du monde
culturel et politique, pour établir une liste de sujets
reflétant l’expérience collective révolutionnaire du peuple
chinois au cours des années 1920 et 1930.
Le rôle de Xia Yan
|
Né en 1900,
Xia Yan était l’un des nombreux intellectuels partis
étudier au Japon aux lendemains du mouvement du 4 mai.
Entré au Guomingdang lors de la visite de Sun Yat-sen en
1924, expulsé du Japon pour ses activités d’extrême
gauche, il revient en Chine, pour rejoindre le Parti
communiste à Shanghai en juin 1926, est un temps
emprisonné par le Guomingdang puis relâché mais rayé des
rangs du parti.
A Shanghai, il
concentre ensuite toute son énergie à développer le
théâtre et le cinéma de gauche. Il est l’un des membres
fondateurs de la Ligue des écrivains de gauche en 1930,
puis de la Ligue des dramaturges de gauche. Il est, avec
Hong Shen (洪深)
et Tian Han (田汉)
(5), l’un des scénaristes les plus influents à Shanghai
au début des années 1930, lorsque les dramaturges du
Parti |
|

Xia Yan |
s’infiltrent dans les studios pour créer le cinéma de gauche ;
on le retrouve au générique des grands films de la Mingxing de
la période, avec Hong Shen.. Comme Hong Shen également, il joue
alors un rôle important dans le développement de l’écriture
cinématographique ; il y a d’ailleurs en Chine un prix Xia Yan
décerné chaque année dans ce domaine.
|

Monsieur Lin dans son magasin |
|
Pendant la
guerre, comme ses collègues, il quitte Shanghai, part
d’abord à Hong Kong, puis, lors de l’occupation de la
ville par les Japonais, en 1941, fuit à Guilin puis à
Chongqing où il écrit des pièces de propagande. Quand il
revient à Shanghai à la fin de la guerre, comme
Mao Dun (茅盾),
il devient alors lui aussi un personnage important du
nouveau régime. Il est nommé vice-ministre de la culture
en 1955.
Il continue à
écrire quelques pièces, mais |
se
consacre surtout au cinéma qui est favorisé par le régime comme
principal outil de propagande. L’un de ses plus célèbres
scénarios de la période est « Le Sacrifice du Nouvel An » (《祝福》),
d’après la nouvelle de
Lu Xun,
mis en scène par Sang Hu (桑弧)
en 1956, trois ans donc
avant « La boutique de la famille Lin ».
|
Ce scénario a
cependant une longue histoire. Xia Yan avait eu l’idée
d’adapter la nouvelle dès qu’elle avait été publiée, en
1933, dans une édition qui comportait également
« Les vers à soie du
printemps »
(《春蚕》),
comme ce
sera souvent le cas par la suite. Mais il dut alors se
contenter d’adapter cette nouvelle, qui fut mise en
scène par Cheng Bugao
(程步高)
(6). |
|
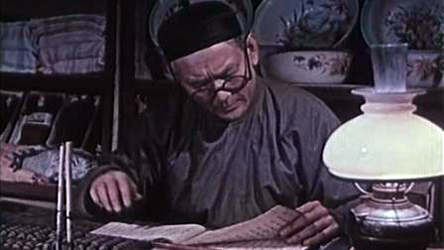
Monsieur Lin épluchant ses comptes |
Lorsqu’il reprend son projet, en plein Grand Bond en avant, il
est obligé de se plier aux contraintes imposées par la ligne
idéologique de l’heure, surtout compte tenu de sa fonction de
vice-ministre. Il reprend donc la trame narrative de Mao Dun en
l’infléchissant vers le mélodrame type années trente, en mettant
l’accent
sur les misères du peuple dans l’ancienne société. Pour Mao Dun,
quand il écrit sa nouvelle, le communisme restait du domaine du
futur ; en 1959, cela fait dix ans qu’il y a en Chine un régime
communiste, il s’agit de le glorifier pour avoir révolutionné la
société.
|

Lin et le vieux Chen |
|
Le film a son
lot de méchants bien trempés, et le petit boutiquier est
présenté comme un marchand peu scrupuleux qui entraîne à
la ruine les trois malheureux qui ont eu le malheur de
lui confier leurs économies gagnées à la sueur de leur
front. Le film s’achève sur une scène de panique et de
massacre bien plus dramatique que dans la nouvelle, le
chef de la police, furieux de s’être fait berner par Lin
qui a réussi à
s’enfuir avec sa fille, faisant tirer sur la foule. |
Le
film annonce d’ailleurs textuellement au début : ceci est
l’histoire « des gros poissons qui mangent les petits, et des
petits poissons qui mangent les crevettes » (“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”),
celle d’une société pré-révolutionnaire où les pauvres et les
sans grade sont les victimes désignées.
|
Pourtant, Xia
Yan garde malgré tout une indépendance d’esprit qui fait
du film une œuvre à part dans la production
cinématographique de l’année. Prendre une famille
petite-bourgeoise comme centre du scénario était déjà
peu orthodoxe à l’époque. Mais, en outre, le boutiquier
n’est pas dépeint de manière entièrement négative ; Xia
Yan laisse planer le doute sur son statut d’exploiteur
ou d’exploité. C’est ainsi qu’il l’a souligné dans une
lettre à Xie Tian (谢添), l’acteur qui interprète le rôle dans |
|

Madame Lin sort ses
économies et
donne sa fille en
mariage à Shousheng |
le film : « On ne peut pas traiter Lin comme un personnage cent
pour cent négatif, ce qui n’est pas une raison non plus pour le
présenter de façon sympathique. » (7)
La réalisation de Shui
Hua
|
Shui Hua (水华)
était un réalisateur très populaire en Chine, et prisé
du régime, depuis le grand succès de son film « La fille
aux cheveux blancs » (《白毛女》),
produit au studio du Dongbei en 1950 (8). Il est ensuite
passé au studio de Pékin (北京电影制片厂)
qui a produit « La boutique de la famille Lin ».
Ce studio était
le fer de lance du régime, tout particulièrement en
matière de cinéma en couleur. Une grande partie
du personnel avait été envoyé en Union soviétique se
former à ces techniques pendant trois ans, de 1953 à
1956. Et c’est justement « Le Sacrifice du Nouvel An »
qui marque, en 1956, le résultat concret de cet
apprentissage au studio de Pékin, le studio de Shanghai
ayant pour sa part sorti deux ans auparavant le premier
film en couleur, réalisé sur pellicule Sovcolor, « Liang
Shanbo et Zhu Yingtai » (《梁山伯与祝英台》),
de Sang Hu. |
|

Shui Hua |
« La boutique de la famille Lin » confirme l’avancée du studio
de Pékin dans ce domaine, avec des couleurs atténuées comme dans
le film de Sang Hu. Mais le film reflète aussi l’art de la
mise en scène de Shui Hua, avec en particulier des plans
généraux de foule dans la rue, de marchandises exposées sur les
étals, de tables dans les salons de thé, filmés à distance avec
la caméra montée sur grue. Le film invente des images pour
illustrer une nouvelle qui en est avare, et s’appuie sur des
acteurs parfaitement choisis pour le faire. Chaque œuvre utilise
les ressources propres à son art spécifique.
|

Beijing Film Studio, logo |
|
Ces images,
cependant, ont tendance à brouiller le message
idéologique annoncé textuellement dans la légende
initiale, reprise en voix off : le film est censé
représenter le pays « gémissant sous la triple
oppression de l’impérialisme, du féodalisme et du
capitalisme des compradors ». Comme s’il était besoin,
justement, de bien le dire pour que ce soit bien clair.
A posteriori,
le film apparaît comme « le |
mélodrame d’une crise existentielle », selon les termes de
Stephen Teo, qui est aussi bien celle de la société des années
trente dans la nouvelle, que celle du régime au bord de
l’asphyxie à l’apogée du Grand Bond en avant, à la fin des
années 1950.
Des lendemains
difficiles
Cette ambiguïté, qui fait toute la richesse du film, le
desservit ensuite au moment de la Révolution culturelle. En
1966, il fut parmi la cinquantaine de films à être nommément
interdits, pour afficher trop de sympathie envers les
capitalistes. Xia Yan fut le premier en ligne de mire, sans
doute à cause de ses mauvaises relations avec Jiang Qing ; il
fut emprisonné et torturé.
Il
fit son autocritique au 4ème congrès des écrivains et
artistes en 1978. Il attaqua ensuite les jeunes dramaturges et
cinéastes pendant la campagne contre la pollution spirituelle,
en 1983, mais exprima son inquiétude devant la montée de la
répression en 1987, pour finir par soutenir le mouvement pour la
démocratie en 1989.
« La boutique de la famille Lin », déjà, reflète l’ambiguïté
d’une position incertaine, et du refus de trancher sommairement
entre le noir et le blanc.
Notes
(1) Il s’agit de la « première bataille de Shanghai » (28
janvier-3 mars) : à la suite de l’agitation anti-japonaise à
Shanghai, cinq moines japonais sont attaqués par la foule, l’un
d’entre eux est tué ; les Japonais attaquent Shanghai et
bombardent la ville chinoise ; l’incident se termine par un
cessez-le-feu instauré sous l’égide de la Société des Nations.
(2) Mao Dun utilise le terme
市廛
shìchán,
littéralement
‘ville-marché’.
(3) Il s’agit de l’empereur Guan, ici plutôt divinité taoïste,
celle « qui soumet les démons des trois mondes et dont la
puissance ébranle les cieux de son éclat » (
三界伏魔大神威远震天尊关圣帝君).Petit
trait de couleur locale.
(4) Selon les
termes de Régis Bergeron, in
Le cinéma chinois,
1949-1983, L’Harmattan, 1983, 1er tome, p. 250.
(5) Sur Hong Shen, voir
:
www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Hong_Shen.htm
(6) Sur ce réalisateur, voir
:
www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Cheng_Bugao.htm
(7) Cité dans : Le cinéma chinois, sous la direction de
Marie-Claire Quiquemelle et Jean-Loup Passek, Centre Georges
Pompidou, 1985, p.223.
(8) Sur ce réalisateur, voir :
www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Shui_Hua.htm
|
|

