|
|
Cao Naiqian 曹乃谦
Présentation
par Brigitte Duzan, 20 mars 2012
|
Ecrivain
profondément ancré dans la réalité brute de son Shanxi
natal, Cao Naiqian est une découverte relativement
récente bien qu’il ait commencé à écrire en 1986.
Les
publications de ses œuvres se multiplient depuis 2006 en
Chine même. Ses sujets le rattachent à une lignée
d’auteurs
prestigieux, peintres de la réalité de leur terre
natale, comme
Shen Congwen (沈从文)
et
Wang Zengqi
(汪曾祺), dont il apparaît comme un disciple et héritier ; son style, en
revanche, lui est propre et le met résolument à
l’écart de tout courant.
Enfant du
Shanxi
Cao Naiqian (曹乃谦)
est né en 1949, le jour de la fête des Lanternes, dans
le village de Xiamayu (下马峪村),
dans le district de Yingxian, au Shanxi (山西应县).
|
|
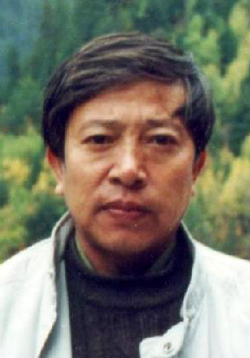
Cao Naiqian |
Tout petit, il est enlevé ; élevé plus ou moins en cachette par
sa mère adoptive à Datong, la capitale de la province, il trouve
chaleur et affection à la campagne auprès de sa grand-mère
(adoptive) avec laquelle il passe toutes ses vacances. Après une
première éducation rudimentaire, il entre en 1962 au collège à
Datong.
|

L’entrée de la mine de Jinhuagong |
|
Il termine le
lycée en 1968 et commence alors à travailler : il
devient mineur de fond dans la principale mine de
charbon de Datong, la mine
de Jinhuagong
(晋华宫)
(1). Mais il se fait remarquer par ses talents de
musicien : il joue du erhu, du tympanon (扬琴)
et même du violon. Or nous sommes en pleine Révolution
culturelle, à un moment où se multiplient partout les
troupes de chant et de danse : en 1969, il est affecté à
celle du Bureau des mines de Datong (大同矿务局文工团)
dont il devient membre de l’ensemble musical.
|
Sa vie change à nouveau en octobre 1972 : il est transféré au
Bureau de la Sécurité publique de Datong (大同市公安局).
Il est d’abord chargé de l’état civil, puis passe à la police
criminelle. Il est aujourd’hui membre de l’équipe de
« propagande politique » du Bureau.
Ecrivain par
hasard
Cao Naiqian est
venu à la littérature par hasard, à la suite
d’un pari avec
un ami : une invitation au restaurant contre une
nouvelle. Il gagne son pari, et se trouve en même temps
une vocation nouvelle. C’était en 1986, il avait
trente-sept ans.
|
Ses premiers
textes sont publiés dès juin 1988, dans la revue
mensuelle « Littérature de Pékin » (北京文学).
Il s’agit de cinq récits très courts dont la publication
est accompagnée de louanges chaleureuses de
Wang Zengqi
(汪曾祺)
qui était alors à la rédaction de la revue. Ils font
partie des trente textes regroupés sous forme de roman,
aujourd’hui traduit en français sous le titre
« La nuit quand tu me manques,
j’peux rien faire » (《到黑夜想你没办法》)
(2).
La nuit quand
je pense à toi…
Ce roman a
d’abord été publié à Taiwan, puis en Chine continentale
en 2007 ; il est à la base de la redécouverte récente de
son auteur. Constitué de courtes vignettes qui procèdent
par effet cumulatif pour dresser le tableau d’une
communauté rurale dans le Shanxi des années 1970, il
offre une vision à valeur emblématique et loin des
clichés habituels. C’est le sens du sous-titre : «
Panorama du village des Wen » (《温家窑风景》)
(3).
|
|
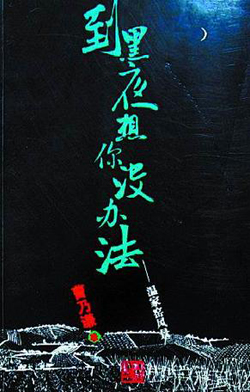
La nuit quand tu me
manques
(original chinois)
|
C’est d’abord
Wang Zengqi qui a attiré l’attention sur un auteur dont
on a fait depuis l’un de ses héritiers et successeurs ;
il a souligné en quelques mots les deux caractéristiques
principales de l’œuvre de Cao Naiqian - le ton général
et le style :
“他的小说贯穿了一个痛苦的思想:无可奈何……他的语
言带有莜麦味儿……”
« Ses récits sont traversés par une pensée douloureuse : celle d’une
totale impuissance … La langue qu’il utilise a la saveur
de l’avoine… »
Le
ton général de ce roman est concis et caustique, comme empreint
de l’atmosphère de désolation qu’il décrit ; il nous dépeint une
communauté paysanne réduite à une vie misérable, frustrée dans
ses aspirations, bridée à la fois par les coutumes
traditionnelles et les réseaux d’obligations et réglementations
imposés par le régime communiste, et subsistant dans une
tentative désespérée
d’assouvir les deux besoins fondamentaux qui lui restent dans ce
désert affectif et moral : la nourriture et le sexe.
Le
premier récit donne le ton : en deux pages, il raconte comment
un paysan, incapable de payer la dot de sa belle-fille, doit
accepter, pour compenser, de « prêter » sa femme à son beau-père
un mois par an. Dans les pages qui suivent, les hommes tentent
de « partager » les femmes des uns et des autres (« partager la
marmite »), et les femmes ne sont pas en reste, pratiquant
allègrement la polyandrie : « la femme est comme une charrette
que l’homme tire, dit l’une d’elles. II vaut mieux qu’il y ait
deux bêtes pour tirer, plutôt qu’une seule, la charrette avance
plus facilement… »
C’est un monde brutal, sauvage, où les animaux semblent faire
preuve de plus d’humanité que les hommes eux-mêmes, mais aussi
un monde clos et sans espoir : l’homme est un « papillon
malheureux », fait dire l’auteur à l’un de ses personnages,
dérisoire papillon qui n’a d’autre but que de se brûler les
ailes à la flamme délétère de ses fantasmes féminins. Nous
sommes à des années lumières de ce monde, et pourtant, Cao
Naiqian nous le dépeint avec tant de chaleur, tant d’humour
aussi, qu’on se sent pris par son récit, qu’on y adhère. Et cela
tient en grande partie à son style, à la langue imagée qu’il
utilise, qui est celle du terroir, de la vie au ras du sol qu’il
nous fait découvrir.
Cao Naiqian est un « cul terreux » (乡巴佬
xiāngbalǎo),
a dit amicalement de lui son traducteur suédois, Göran
Malmqvist, qui a largement
contribué à sa découverte en Occident (4). Mais c’est un
cul terreux qui sait remarquablement manier le dialecte
local, avec ses savoureuses expressions imagées, en
l’intégrant dans son texte, et surtout dans ses dialogues. En ce
sens, il participe de tout un mouvement de réappropriation des
dialectes locaux qui marque également le cinéma chinois dans son
évolution récente et qui n’est pas sans rappeler, aussi, les
recherches linguistiques de
Han Shaogong (韓少功).
Le
réalisme y acquiert là une dimension nouvelle, une authenticité
à la fois immédiate et profonde, qui passe aussi par la
répétition à l’identique de bouts de phrase, comme si les mots
étaient si rares, si comptés, qu’on ne pouvait que répéter ceux
que l’on a trouvés pour s’exprimer. La langue de Cao Naiqian est
d’un minimalisme primitif, comme les êtres qu’il dépeint, mais
capable en même temps d’une étincelle soudaine, pleine d’humour,
au détour d’une image fortuite, l’homme gardant au fond de lui
la formidable capacité de rire.
Le
roman se rapproche d’une autre tendance actuelle, valable
également dans le domaine du cinéma, qui tend à s’éloigner des
thèmes étroitement ou directement politiques pour privilégier la
peinture de la nature humaine sous un aspect plus universel, à
la manière de Faulkner ou García Márquez : en approchant du
mythe.
Une foison de nouvelles
à découvrir
|
Cao Naiqian n’est cependant pas l’auteur de cet unique roman. Il
a écrit de nombreuses nouvelles qui, toutes, portent la marque
de son amour de sa terre natale et de la même primordiale
concision, et dont les titres mêmes constituent un exercice
lexical de termes ruraux locaux qui fleurent bon l’avoine, eux
aussi.
Citons,
parmi les nouvelles courtes : « Dans les meules de paille
d’avoine » (《莜麦秸垛里》yóumài
jiēduò lǐ),
« Les pommes de terre » (《山药蛋》shānyaodàn), « Les lis sauvages » (《山丹丹》shāndāndān) (5), « La louche de laiton accrochée sur le bord de la jarre » (《铜瓢瓮上挂》tóngpiáo
wèngshàng guà)
ou encore « Trente-trois grains de sarrasin, quatre-vingt
dix-neuf arêtes » (《三十三颗荞麦九十九道棱》).
Là encore,
mises bout à bout, elles constituent un tableau de la vie sur le
plateau de loess, vie qui semble
|
|
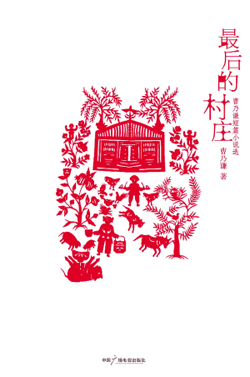
Le recueil de nouvelles « L’ultime
village » |
immémoriale,
au contact de la
nature, et réglée par coutumes et traditions. Elles sont
complétées de nouvelles plus longues, dont le recueil qui porte
le titre de la plus connue : « La solitude du Bouddha » (《佛的孤独》),
ainsi que de textes relevant de ce qu’on appelle « la
littérature de reportage » (报告文学),
le tout édité en Chine à partir de l’année 2006.
C’est la date de publication de son principal recueil de
nouvelles courtes, « L’ultime village » (《最后的村庄》),
qui marque donc sa redécouverte récente. Il comporte vingt et
une nouvelles. La première, « Jujube sauvage » (《野酸枣》yě
suānzǎo), a
été traduite par Noël Dutrait sous le titre « Jujube la
sauvageonne », traduction que l’on peut lire en ligne, sur le
site « Impressions d’Extrême Orient » de
l’équipe « Littérature chinoise et traduction » de l’université
de Provence :
http://ideo.revues.org/78
Les autres restent à découvrir….
Notes
(1) La mine de
charbon de Jinhuagong est la plus importante de Datong, située à
12 kilomètres à l’ouest de la ville. L’exploitation a commencé
en 1956, et la mine est aujourd’hui ouverte aux touristes. On la
voit sur le côté gauche de la route quand on va aux grottes de
Yungang.
(2) La nuit quand tu me
manques, j’peux rien faire, traduit du chinois par Fu Jie et
Françoise Bottéro, éditions Gallimard/Bleu de Chine, octobre
2011.
(3) Le caractère
窑
yáo
du sous-titre désigne les habitations
troglodytes du Shanxi. Dans un sens dérivé et dialectal, il
désigne aussi un bordel. On ne peut pas exclure le clin d’œil
dans le contexte du roman.
(4) La traduction en suédois est parue dès 2006, suivie d’une
traduction en anglais :
There’s Nothing I Can Do
when I Think of You Late at Night, traduit du chinois par John
Balcom, Columbia University Press, avril 2009.
(5) Ce sont des « lilium pumilum » ou lis corail. C’est aussi le
titre d’un chant populaire révolutionnaire qui sous-tend
l’atmosphère de la nouvelle : les fleurs de lis s’ouvrent,
écarlates… (山丹丹花开红艳艳).
A lire en
complément :
《老银银》 (曹乃谦) « Vieux-Lingot » (Cao Naiqian)
|
|

