|
|
Jentayu
n°5 :
au-delà des fourneaux et marmites, la cuisine en littérature,
poésie et métaphore
par
Brigitte Duzan, 11 février 2017
|
Onze récits
,
six poèmes, un petit documentaire photographique, dix
traducteurs, et une infinie variété de voix pour dire
les traditions culinaires de chaque aire culturelle et
surtout les souvenirs et émotions qui leur sont liés, de
l’Inde à la Thaïlande et à la Malaisie, de la Chine
continentale et Taiwan à l’Indonésie et Singapour, avec
un merveilleux détour par la grande tradition orale du
Kirghizistan (mais dans une traduction de l’ouzbek et du
russe).
Ce nouveau numéro de Jentayu montre bien, une fois de
plus, les correspondances et parallèles entre des
cultures que l’on a coutume de désigner du vaste vocable
d’orientales. Mais ce sont les variations sur le thème
général, qui, comme en musique, sont intéressantes.
Que manger un mérou puisse permettre de communier
directement avec l’âme d’un ancêtre noyé près de
l’endroit où l’animal a été pêché, aucun Chinois ne s’en
étonnerait, |
|
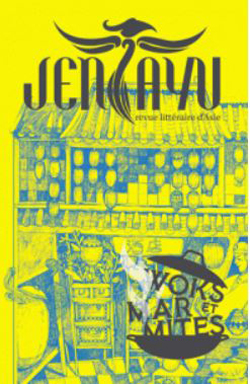
Jentayu n° 5 |
mais l’histoire est de Singapour (p. 7). Il n’y a pas qu’en
Malaisie que le durian laisse des souvenirs durables, et pas
seulement pour son odeur (p. 43). Et bien des paysans chinois
compatiraient avec les fermiers de Singapour obligés
d’abandonner l’élevage de porcs et de se reconvertir par décret
d’en haut comme ceux du carnet de photos d’Ore Huiying, dont le
nom d’ailleurs fleure la campagne chinoise (p. 121).
|

Une photo d’Ore Huiying |
|
On est étonné de trouver l’une des nouvelles les plus
« chinoises » de ce numéro sous la plume d’une
journaliste … singapourienne, mais qui a vécu sept ans
en Chine où elle a travaillé pour l’agence Associated
Press : Audra Ang (p. 121). Son récit d’un restaurant
bio à Hangzhou, pionnier dans le domaine, est non
seulement documenté, mais en outre illustré de dictons
traditionnels annotés en bas de page, avec les
expressions en caractères. |
|
Les récits indiens semblent plus éloignés, mais, quand
on y réfléchit, les travailleurs migrants, les
mingong des grandes villes chinoises aujourd’hui
n’ont pas un statut tellement différent de celui des
dalits, les hors castes, les exclus du système dont
nous parle Shahu Patole qui, justement, en fait partie
(p. 25).
Ce numéro 5 réserve quelques belles surprises, qui ne
seront sans doute |
|
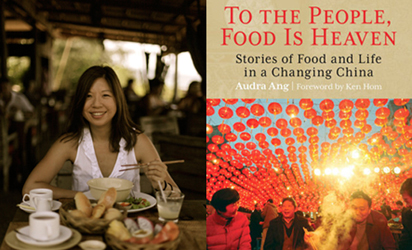
Le livre d’Audra Ang |
pas les mêmes pour chacun des lecteurs. Pour quiconque
s’intéresse tout particulièrement à la culture et à la
littérature chinoises, l’heureuse surprise vient d’abord des
trois poèmes pleins de sensibilité et d’humour du grand écrivain
hongkongais
Leung Ping-kwan (梁秉鈞)
qui nous a quittés il y a quatre ans.
Le poème initial, « La moule et l’identité culturelle » (p. 21),
présente la moule comme une métaphore de la culture
hongkongaise, mais, au-delà, aussi bien comme une métaphore du
monde moderne tel que le présente Jentayu, justement, un monde
moderne métissé en quête d’une identité incertaine et fuyante.
Le « discours sur le porc » qui suit (p. 58) semble répondre
avec humour aux préoccupations des fermiers d’Ore Huiying…
Quant au troisième des poèmes de
Leung Ping-kwan,
« Alcool fraîchement distillé » (p. 41), il semble, lui,
partager l’un des thèmes de la courte nouvelle de Cao Kou (曹寇) :
elle dépeint les relations de deux amis qui passent
régulièrement par le partage du même sempiternel repas dans la
même gargote, mais il leur manque, pour arriver à une parfaite
entente, d’avoir trinqué ensemble (p. 89). Car boire est un lien
social, mais, comme nous le décrit si bien
Feng Jicai (冯骥才),
avec son art consommé du portrait des petites gens, boire est
aussi ce qui reste pour vous égayer la vie un bref moment quand
on n’a plus rien d’autre, et c’est alors un art de vivre en soi
(p. 35).
| |
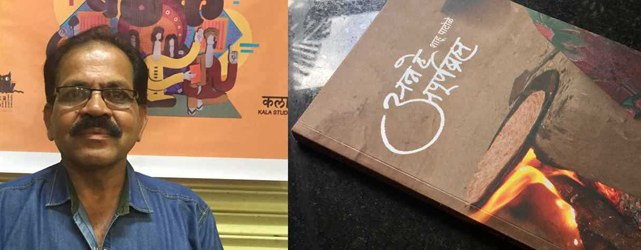
Shahu Patole et son livre sur la cuisine
dalit |
|
|

Un manastchi contant l’épopée à Karakol |
|
Si l’histoire de
Zhang Yueran (张悦然)
est délicieusement équivoque (p. 51), c’est celle de
Kan Yao-ming (甘耀明)
qui réserve sans doute l’une des plus belles surprises
de ce numéro, côté chinois, à travers toute l’émotion
que peuvent susciter les souvenirs liés à un bol de riz
au lard (p. 73) ; on a là un bel exemple de l’art subtil
d’un jeune écrivain taïwanais qui est aujourd’hui l’un
des auteurs les plus en vue à Taiwan, et encore peu
traduit en France.
Je garde cependant l’un de mes étonnements pour la fin,
comme l’a fait Jentayu, avec l’extrait du roman intitulé
Manastchi (p.155). Ce titre fait référence aux conteurs
de Manas, la grande épopée orale qui est l’une des
grandes sources identitaires du peuple kirghize dont
elle raconte les origines mythiques. Or, dans le roman
en question, la paix d’un village est menacée lorsque
des ouvriers … chinois d’un |
chantier de construction d’un tunnel à la frontière entre
Kirghizistan et Tadjikistan sont kidnappés par un groupe
d’islamistes sous la coupe d’un imam local. On va chercher un
conteur de Manas pour tenter de ramener la paix dans le village.
|
C’est une
histoire extrêmement plausible, le genre de scénario à
faire frémir le gouvernement chinois. Mais l’histoire
prend un tour ironique quand on pense que le thème
principal de la fameuse épopée de Manas est la lutte
pour l’indépendance des nomades kirghizes contre les
Chinois sous la dynastie mongole. Pourtant, cette épopée
est l’une des trois grandes épopées orales, avec
l’épopée tibétaine du Roi Gésar et l’épopée mongole de
Jangar, à avoir récemment été traduite en chinois dans
le cadre d’un vaste projet de traduction lié au
programme de la Nouvelle Route de la Soie. Or, les
traductions en chinois ont été assimilées à la
littérature chinoise dite « de minorités » et en tant
que telles incluses dans une
« Encyclopédie
de l’héritage culturel immatériel de la Chine » dont le
premier tome est paru en juin 2015.
|
|
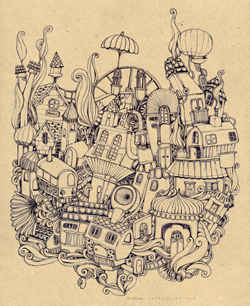
Un dessin typique de Sith Zâm |
Le texte de Jentayu semble être un clin d’œil ironique à ce
vaste projet un rien mégalomaniaque.
A noter : pour chaque auteur du numéro, Jentayu donne sur son
site un résumé biographique complété par un entretien.
A noter aussi : les illustrations du graphiste vietnamien Sith
Zâm, né en 1988 et vivant à Saïgon, dont les dessins fouillés,
d’apparence baroque, sont faits d’une multitude de traits et
d’arabesques très fins représentant souvent des cités
imaginaires ou des éléments végétaux tout aussi délirants.
http://editions-jentayu.fr/
|
|

