|
|
Chan Koonchung
陈冠中
Présentation
par
Brigitte Duzan, 31 mai 2014, actualisé
11
avril 2025
| |

Chan Koonchung |
|
Né à Shanghai,
dans une famille originaire de Ningbo, Chan Koonchung a grandi à
Hong Kong, puis est venu vivre à Pékin après un détour par
Taiwan. Il est donc difficile à classer selon les nomenclatures
ordinaires. Il pourrait être défini comme écrivain « des deux
rives et trois territoires » (兩岸三地).
Disons tout simplement : écrivain de langue chinoise.
On le dit
auteur de science-fiction ; il l’est autant que George Orwell
écrivant « 1984 ». Disons qu’il est l’auteur d’un roman
d’anticipation, ou de politique-fiction, qui, publié à Hong Kong
et Taiwan en 2009, et aussitôt traduit en anglais et en
français, lui a valu une soudaine célébrité. Celle-ci a été
accrue récemment avec la publication d’un nouveau roman qui est
une satire féroce de l’évolution de la société et de la
mentalité chinoises, vue par un Candide tibétain. Tous les
ingrédients étaient réunis pour en faire un succès de librairie.
Sauf bien sûr en Chine.
Mais on finit
par en oublier ce que Chan Koonchung avait fait et écrit
auparavant...
Citoyen
et écrivain de Hong Kong d’abord
Chan Koonchung
est né en 1952 à Shanghai, mais ses parents ont déménagé à Hong
Kong quand il avait quatre ans. C’est donc à Hong Kong qu’il a
grandi.
Journaliste
et éditeur de presse
Il a commencé
ses études universitaires à l’Université de Hong Kong, puis,
après un BA, a continué à l’Université de Boston.
De retour à
Hong Kong, il débute comme reporter pour un tabloïde local.
Puis, en 1976,
avec trois
autres écrivains, Qiu
Shiwen (丘世文),
Deng Xiaoyu (邓小宇) et Hu
Junyi (胡君毅),
il fonde
le City Magazine,
ou "Numéro spécial" (Haowai《号外》),
qui devient l’un des magazines culturels les plus branchés de
Hong Kong.
| |
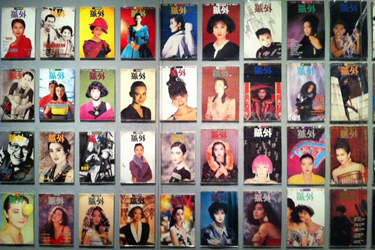
Haowai, une histoire de la
culture de Hong Kong |
|
Puis
Chan Koonchung s’intéresse au cinéma ; il passe quelques années
à écrire des scénarios et investir dans la production
cinématographique. Il joue même en 1991 dans le film « King
of Chess » (《棋王》)
adapté
de la nouvelle éponyme d’A Cheng,
commencé par Yim Ho et terminé par Tsui Hark :
c’est lui qui interprète le rôle du professeur
Liu Yuebai.
Au début des années 1990, il travaille comme éditeur, à Hong
Kong, pour la revue littéraire du continent Dushu (读书),
puis part à Taiwan en 1994, pour six ans. Il y lance l’une des
premières chaînes de télévision par satellite de la République
de Chine, super TV, vendue à Sony Entertainment à la fin de la
décennie.
Chan Koonchung
a accumulé une richesse suffisante pour ne pas se préoccuper des
ventes de ses livres et se permettre d’écrire des romans bannis
sur le continent, dont il alimente lui-même la diffusion piratée
sur internet.
Ecrivain de Hong Kong
Il commence à écrire en 1978, des réflexions sur Hong Kong, son
histoire, sa culture, la politique et la société. Son premier
texte publié s’intitule « Un
rêve de crème solaire » (《太阳膏的梦》) ;
il est publié en 1986 sur internet, sur le site
booyee
(博益) ; il témoigne d’une période où la
crème solaire était devenue la grande mode à Hong Kong, symbole
d’une vie saine, naturelle, au soleil.
| |
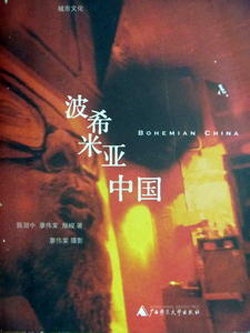
La Chine bohême |
|
Ce texte court formera la première partie de « La trilogie de
Hong Kong » (《香港三部曲》),
publiée en 2004, qui retrace vingt-cinq années d’histoire de la
ville. De la vie naturelle en plein air, on est passé à un
réquisitoire contre la pollution et les dérives de la croissance
urbaine.
Chan Koonchung
est membre de Greenpeace.
| |

La trilogie de Hong kong |
|
En 2005, il
revient sur son expérience personnelle, et, en 2007, publie un
recueil d’essais
sur la culture hongkongaise des années 1970. En 2008, avec
« Neuf chapitres sur la ville » (《城市九章》),
il livre une série d’essais sur plusieurs métropoles qu’il met
en parallèle : Hong Kong, Taipei, Shanghai, Pékin…
| |
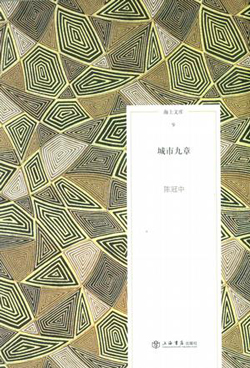
Neuf chapitres sur la ville |
|
Mais, entre-temps, il s’est installé à Pékin et son observation
s’est tournée vers la Chine continentale.
La trilogie de Pékin
C’est à la fin des années 1990 qu’il a tourné son attention vers
la Chine populaire. Il fait partie des élites
taïwano-hongkongaises venues investir dans les « industries
culturelles » du continent. Il lance une société internet, des
magazines et produit des séries télévisées. Il s’installe à
Pékin en 2000.
Ce sont alors les changements socio-politiques, et surtout
l’évolution des mentalités qu’il constate à partir de 2004-2005
qui l’incitent à prendre la plume pour témoigner de ses
inquiétudes. Le premier livre qu’il publie sur ce sujet sort en
2009, il marque un tournant dans son écriture.
Les Années fastes
Ce livre est le roman traduit en français
« Les
Années fastes »
(《盛世》),
avec dans le titre chinois une précision : « la Chine en 2013 »
(《中国2013年》).
C’est en effet un roman d’anticipation, mais de très peu puisque
le livre a été écrit en 2008. C’était dans la foulée de la
grande mutation qu’a connue la Chine à partir des Jeux
olympiques, mais qui s’amorçait déjà depuis plusieurs années.
| |
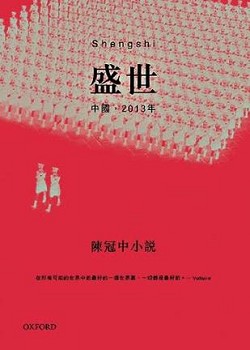
Les années fastes |
|
Ce qui est frappant, c’est que le pouvoir totalitaire et la
société euphorique que décrit et analyse Chan Koonchung
s’appliquent tout aussi bien à la situation de 2025 qu’à celle
de 2013. Son roman est une réflexion sur les mécanismes du
pouvoir totalitaire, et tout particulièrement du régime chinois,
en s’interrogeant sur ce qui paraît une énigme autant qu’un
défi : comment un régime qui a affronté crise sur crise, lancé
campagne sur campagne, provoqué catastrophe sur catastrophe, a
pu non seulement se perpétuer mais encore réussir à se forger
une image de sauveur et de bienfaiteur du peuple, en en
recueillant le soutien. C’est faute de mieux, certes, et la
discussion inaboutie sur la démocratie à la fin du roman le
montre bien, mais on en est d’autant plus sidéré, au sens
propre.
Dans « La
mauvaise herbe » (《野草》),
Lu Xun
(魯迅),
déjà, avait critiqué la tendance nationale à se nourrir de
nostalgie collective pour un passé glorifié, et à préférer se
réfugier dans ce passé en oubliant l’enfer qu’il avait pu être,
« le bon enfer perdu » (失掉的好地狱),
plutôt que d’avoir à affronter un présent dont l’enfer est bien
réel. Chan Koonchung poursuit la réflexion de Lu Xun en montrant
que la nostalgie du passé s’est muée en sentiment euphorique
tout aussi fallacieux, car fondé sur un paradis artificiel.
L’histoire de Champa
Chan Koonchung a aussitôt récidivé dans la satire sociale
corrosive avec son roman suivant, au titre ésotérique :
Luoming (《裸命》).
A travers l’histoire et le regard du jeune Tibétain Champa, il
dresse un constat sévère des travers inquiétants de la société
chinoise actuelle, entre xénophobie et matérialisme triomphant.
Nous ne sommes plus dans une politique-fiction de façade, mais
dans le réalisme le plus direct.
| |

Luoming《裸命》 |
|
Chan Koonchung a choisi son sujet en connaissance de cause. Il a
commencé à s’intéresser au Tibet en 1992 car il a alors réalisé
des recherches pour un film que voulait réaliser Francis Ford
Coppola. Depuis lors, il a vu la proportion de Han dans la
population de Lhassa augmenter régulièrement, les touristes
chinois se multiplier tandis que les touristes occidentaux se
faisaient plus rares, faute de visas. A l’origine, il voulait
conter l’histoire d’un jeune Tibétain tel que le Nyima qui
croise la route de Champa dans son roman. Mais il a finalement
opté pour une autre optique : faire jouer à son personnage un
rôle d’observateur à la Candide.
| |

The Second Year of Jianfeng |
|
Champa est le chauffeur, à Lhassa, d’une femme d’affaires
chinoise aisée dont il est également l’amant – ce qui nous vaut
d’entrée quelques scènes très chaudes. Il est content de sa vie,
Champa, car il pense pouvoir réaliser son rêve : aller vivre à
Pékin. Il parle chinois, il est civilisé, ou le croit. Le
problème, c’est que sa maîtresse n’a rien à faire de lui, à
Pékin, et que, au passage, il perd sa virilité et toute ardeur
au lit, devenant un objet inutile et encombrant. Même la fille
de sa patronne, de visite à Lhassa, le traite avec mépris.
En l’absence des deux femmes, il vole la voiture et part seul
pour Pékin, le trajet faisant figure de voyage initiatique qui
commence à éroder sa vision éthérée de la Chine, formée auprès
des touristes à Lhassa. A Pékin, Champa doit vite déchanter. La
première à lui offrir un job est la fille de la patronne, une
bisexuelle qui milite pour le sauvetage des chiens volés pour
être vendus comme chair à pâté. Champa transporte un temps des
chiens « libérés » jusqu’au centre où ils sont recueillis, mais
l’affaire est de courte durée.
Il se met en quête d’un travail, pour réaliser que personne ne
veut employer un Tibétain comme lui : le seul job qu’il trouve
est gardien de prison, mais même pas une prison ordinaire - une
de ces prisons illégales où sont détenus les braves paysans
victimes de la corruption ambiante et montés à la capitale pour
« faire pétition » et tenter d’obtenir justice, aussitôt
poursuivis par les sbires des autorités provinciales. Han ou non
han : les damnés de la terre en Chine, la face cachée d’une
société peu amène envers les trublions dangereux pour
l’ « harmonie » nationale.
Chan Koonchung force le trait à plaisir. Mais il est indéniable
que son constat a du vrai. Le roman n’a été publié qu’à Hong
Kong et à Taiwan, mais il a circulé sur internet en Chine, dans
une version en caractères simplifiés, et y a suscité des débats
animés avant d’être effacé. Il est d’autant plus féroce qu’il ne
s’adresse pas seulement aux rapports entre Han et Tibétains, la
satire est bien plus profonde : elle aborde le problème de la
montée en Chine d’une inquiétante mentalité xénophobe, non
seulement à l’égard des étrangers, mais aussi à l’égard des
éléments considérés comme allogènes au sein de la population.
The Second Year of
Jianfeng: An Alternative History of New China
Dans ce
troisième volet de la « trilogie de Pékin », Chan Koonchung a
imaginé une Chine qui n’aurait pas été communiste, sous forme
d’un roman qui construit un monde « alternatif »,
une uchronie mêlant personnages fictifs et personnages
authentiques, en reprenant leurs déclarations réellement
prononcées, mais en les replaçant dans un contexte différent. Le
modèle est ouvertement Taiwan : c’est l’évolution du système
politique et économique taiwanais – et même ce qu’on peut bien
appeler les succès d’un système devenu démocratique - qui
constitue le critère de base pour imaginer ce qu’aurait pu être
la Chine si elle n’avait pas été « libérée » en 1949.
Nous sommes le
10 décembre 1979. Soit la Deuxième année de Jianfeng
(建丰二年)
parce que c’est la seconde année du « règne » de Chiang
Ching-kuo, fils de Chiang Kai-chek – Jianfeng était son nom « de
courtoisie ».
Chan Koonchung implique donc dès le départ une continuité avec
le système impérial, il n’y a pas de rupture.
La Chine est
une alliée des Etats-Unis depuis que les forces nationalistes
ont vaincu les communistes à la fin de la guerre civile, en
1949. La capitale chinoise est toujours Nankin, le Dalaï Lama
toujours à Lhassa, et Hong Kong toujours colonie britannique. La
Chine est répressive, certes, mais prospère car il n’y a eu ni
lutte des classes, ni purge de propriétaires fonciers,
ni collectivisation, ni campagne anti-droitiers, ni Grand Bond
en Avant, ni famine, ni Révolution culturelle.
| |
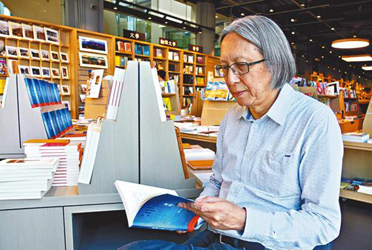
Chan Koonchung présentant son
livre |
|
Ce que Chan
Koonchung a voulu montrer, dans cette histoire uchronique, c’est
que, même si tout n’aurait pas été rose si les nationalistes
avaient été victorieux et pris le pouvoir, en particulier à
cause de leurs tendances dictatoriales et leur corruption
endémique, la Chine serait devenue prospère bien plus tôt sans
régime communiste ; sa thèse est que les trente années de régime
maoïste, avant les réformes de Deng Xiaoping, ont été une
dramatique perte de temps, d’énergies et de ressources, un
détour historique sans nécessité et d’un énorme coût humain.
Le roman est
une construction très subtile, qui repose sur un double niveau
narratif. Parmi les nombreux personnages réels repris par Chan
Koonchung, l’un des plus importants est Zhang Dongsun (ou Chang
Tung-sun
张东荪),
un philosophe démocrate qui a refusé de prendre parti pour les
communistes ou les nationalistes et est mort en prison à Pékin
en 1973. Dans le roman, il choisit de s’exiler à Hong Kong, où
la liberté relative qui règne dans la colonie britannique lui
permet d’écrire un livre intitulé « Toutes les fleurs vont se
faner quand je m’épanouirai : que se serait-il passé si les
Communistes avaient pris le pouvoir en Chine ». C’est donc le
monde réel qui devient la fiction opposée au monde uchronique
posé en monde réel.
| |
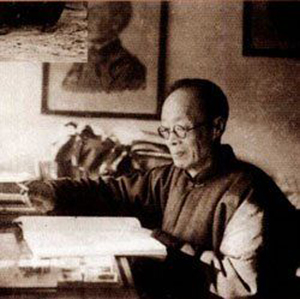
Zhang Dongsun (1886-1973) |
|
Parmi les
réussites de la Chine de 1979 imaginée par Chan Koonchung figure
… la littérature. Des écrivains comme
Zhang Ailing (张爱玲)
n’ont pas été poussés à l’exil et ont poursuivi leur œuvre.
Comme il n’y a pas eu de Révolution culturelle,
Lao
She (老舍)
ne s’est pas suicidé – ou disons : n’est pas mort dans des
circonstances inexpliquées - et il a continué à écrire. Il a
terminé son ouvrage « Sous la bannière rouge » (《正红旗下》),
en réalité laissé inachevé en 1966 ; il est devenu le premier
prix Nobel chinois, dans les années 1960 !
Après
l’élection récente à la présidence de Taiwan, qui marque l’un
des grands succès de cette démocratie, « The Second Year of
Jianfeng » fait réfléchir. Il est tentant de se laisser
convaincre.
2020 :
Pékin kilomètre zéro
En mai 2020,
alors que la vie reprend peu à peu après le pire du confinement,
dans le monde entier, on apprend la publication prochaine, début
juin, d’un nouveau roman de Chan Koonchung qui pourrait bien
être un volet supplémentaire de sa trilogie de Pékin, désormais
donc quadrilogie : « Pékin kilomètre zéro » (《北京零公里》).
Il s’agit du point symbolique d’où partent toutes les routes et
tous les trains, marqué sur le sol au centre de la capitale, qui
renforce donc le symbolisme de Pékin comme centre du pouvoir.
| |
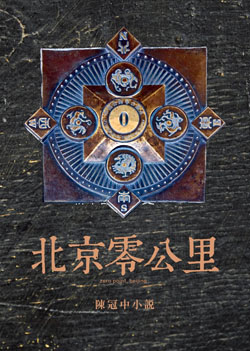
Pékin kilomètre zéro
(Oxford University Press)
sur la couverture : la marque
du km zéro sur le sol de Pékin |
|
C’est de là
que le narrateur du roman raconte son histoire. Ce narrateur est
un jeune étudiant de 14 ans qui a été tué sur la place
Tian’anmen le 4 juin 1989. Son crâne a volé en éclat, et il
s’est retrouve dans l’au-delà, d’où il tente de reconstituer les
huit cents ans d’histoire de Pékin, pour essayer de comprendre.
Le roman est
en trois parties, présent, passé et histoire secrète, les deux
dernières venant en complément de la première. Le jeune
narrateur reconstitue l’histoire de la capitale, avec toutes les
injustices, cruautés et absurdités qui s’y sont déroulées au
cours de ces huit cents ans ; il tient comme un registre de tous
les disparus célèbres, morts pour avoir défendu une cause en
laquelle ils croyaient, ou exécutés pour avoir refusé de se
soumettre :
-
Li Dazhao
(李大钊),
cofondateur du Parti communiste en 1921, participant en 1924 à
l’établissement du Front uni entre les Nationalistes et les
Communistes, puis arrêté pendant l’Expédition du nord par le
seigneur de la guerre Zhang Zuolin (张作霖)
et exécuté par pendaison dans le district de Xicheng en
avril 1927;
-
le
réformateur Tan Sitong (谭嗣同),
l’un des « six gentilhommes de la réforme des Cent Jours » (戊戌六君子),
arrêté au Guildhall de Liuyang (浏阳会馆)
le 24 septembre 1898 après avoir refusé de fuir au Japon, et
décapité sans procès sur ordre de Cixi le 28 septembre à l’âge
de 33 ans, sur la place d’exécution de Caishikou (菜市口刑场),
à l’extérieur de la porte Xuanwu (宣武门)
;
- ou encore
Wen Tianxiang (文天祥),
dernier premier ministre des Song du sud, capturé et emprisonné
par Kubilai Khan pour finalement, au bout de trois ans de refus
de se rallier à la dynastie des Yuan, être décapité dans le
district de Dongcheng en 1283, à l’âge de 46 ans….
Tous ces morts
planent comme des ombres, ou des fantômes, sur l’histoire de
Pékin. Le jeune narrateur leur rend hommage tout en essayant de
comprendre où est la vérité historique, si cela a encore un
sens. Il passe ses jours et ses nuits à lire et dépiauter les
journaux, les manuels d’histoire, la littérature historique,
mais finalement se demande quel est le sens de telles recherches
puisque de toute façon il ne pourra pas communiquer ce qu’il
aura trouvé, à cause de la censure de plus en plus draconienne,
mais aussi tout simplement parce que plus personne ne
s’intéresse à l’histoire, plus personne ne veut savoir.
| |
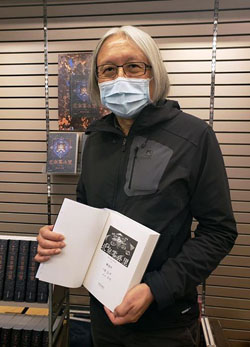
Chan Koonchung présentant son livre |
|
Malgré tout,
Chan Koonchung rejoint le petit groupe d’auteurs chinois qui se
préoccupent de revenir à la source pour tenter de retrouver la
vérité historique, aussi élusive soit-elle. Il s’agit, dit-il,
de rétablir les faits pour sauver l’histoire de l’emprise de
l’idéologie. En ce sens, « Pékin kilomètre zéro » vient bien
compléter le roman précédent portant le sous-titre wūyǒushǐ
(乌有史 ),
histoire inexistante, dont qu’il s’agit, justement, de
reconstituer le récit alternatif.
Principales œuvres publiées
2020
Pékin
kilomètre zéro / Zero Point Beijing
《北京零公里》
2015
The Second Year of Jianfeng: An Alternative History of New China
《建豐二年:
新中國烏有史》/
《建丰二年:
新中国乌有史》
2013
Luoming《裸命》ou
“
The Unbearable Dreamworld of Champa the Driver”
2012 Hong Kong et le concept chinois de Royaume céleste《中国天朝主义与香港》
2009 Les
Années
fastes / The Fat Years《盛世:中国2013年》
2010 Il ne s’est rien passé
《什么都没有发生》
2008 Neuf chapitres sur la ville《城市九章》
2007 Et après : annales de culture locale《事后:本土文化志》
2005 Moi, Hongkongais d’aujourd’hui : succès et fiascos《我这一代香港人:
成就与失误》
2004 La trilogie de Hong Kong《香港三部曲》
2003 Liao Weitang, Yan Jun, la bohême chinoise《廖伟棠、颜峻.
波希米亚中国》
2001 Hong Kong, expérience inachevée《香港未完成的实验》
2000 Notes d’une ville métisse《半唐番城市笔记》
1996 L’histoire du président《总统的故事》
1986 Un rêve de crème solaire《太阳膏的梦》
(publié
sur internet, sur le site booyee
博益)
Traduction en français
Les Années
fastes (《盛世》),
traduit du chinois par Denis Bénéjam, éditions Grasset, janvier
2012, 415p.
Traductions en anglais
The
Fat Years (《盛世》),
traduit du chinois par Michael S. Duke, préface de Julia Lovell,
Doubleday Books, juillet 2011, 320 p.
The Unbearable
Dreamworld of Champa the Driver (《裸命》),
traduit du chinois
par Nicky Harman, Doubleday, mai 2014, 192 p.
Note
sur le titre :
Le titre est difficile à traduire, mais mérite une
tentative d’explication ; en deux caractères, il
synthétise de façon subliminale le message du roman par
les significations qu’il suggère.
-
裸
luǒ
signifie nu, mais a pris depuis quelques années
un sens dérivé suggérant la corruption, comme
dans
luǒ guān
裸官
qui désigne les fonctionnaires qui transfèrent leur
argent à l’étranger et y envoient femmes et enfants,
restant donc nus dans la capitale.
- Quant au second caractère
命
mìng,
il désigne la vie, et les deux caractères
裸命
luǒ
mìng
sont
homophones de l’expression cantonaise
攞命,
elle-même synonyme de
要命
yào
mìng,
qui
signifie littéralement ‘qui en veut à la vie’, donc
dangereux.
Le
titre pourrait donc être traduit : Nu et vulnérable (à
Pékin).
Merci
à Bruce Humes pour cette explication. Son analyse du
roman est d’ailleurs tout aussi
intéressante :
http://bruce-humes.com/archives/558
Le
terme utilisé par Chan Koonchung est
wūyǒushǐ
乌有史 :
l’histoire non-existante, qui n’a jamais existé. Ce
n’est cependant pas un pur fruit de l’imagination car
cette reconstruction de l’histoire repose sur un modèle
réel.
|
|

