|
|
A lire : « Le show de
la vie », traduction d’un roman de Chi Li
par Brigitte Duzan, 11 janvier 2011
|
« Le show de
la vie » (《生活秀》),
paru le 5 janvier dernier, est le neuvième titre (1) de
Chi Li (池莉)
traduit en français, par les éditions Actes Sud, dans leur collection
« Lettres chinoises » dirigée par
Isabelle Rabut.
Depuis que Chi
Li a commencé à publier des nouvelles, en 1982, elle a
en effet écrit, dans un style simple et réaliste, un
nombre considérable de nouvelles et romans qui, en
formant comme un kaléidoscope de portraits
essentiellement féminins, dessinent une image au ras du
sol de la vie quotidienne des citadins ordinaires dans
la Chine d’après Mao.
Wuhan comme
si vous y étiez
Comme la
plupart de ses autres livres, « Le show de la vie » (《生活秀》)
se passe à Wuhan, la grande métropole du Hubei
représentative des grandes conurbations de
l’intérieur de
la Chine, où Chi Li a grandi et vit encore, et qui
constitue la toile de fond et l’âme de ses récits.
|
|
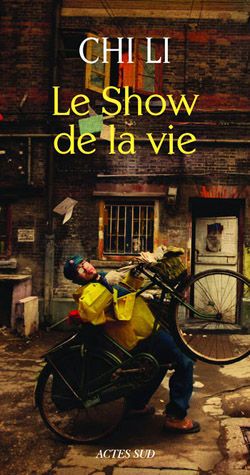
Le show de la vie |
Pour être plus
précis, l’histoire se passe dans une vieille rue de Wuhan devenue
célèbre depuis la parution du livre, en 2000 : la rue Jiqing (吉庆街),
artère typique de petits restaurants en plein air qui s’animent
la nuit. Le personnage central du roman est une femme, Lai
Shuangyang (来双扬),
qui tient, justement, l’un de ces petits restaurants ; le sien
est spécialisé dans les cous de canards, et elle lui a donné le
nom de son plus jeune frère : le restaurant de Jiujiu (久久饭店).
(2)
La Chine du miracle
économique vue au ras du sol
Lai Shuangyang est
typique de l’univers de Chi Li, c’est-à-dire des classes
populaires des grandes villes chinoises : une femme du peuple,
donc, qui a commencé à travailler à quinze ans pour nourrir ses
deux frères et sa plus jeune sœur lorsque son père a abandonné
sa mère pour aller vivre avec une autre femme, chose courante.
Mais Shuangyang avait le sens des affaires, elle a été la
première, dans la rue, à ouvrir une petit échoppe, juste au
moment où Deng Xiaoping lançait la politique d’ouverture, et
encourageait les Chinois à monter leurs propres affaires et à
s’enrichir. Son destin avait rendez-vous avec celui de la Chine.
|
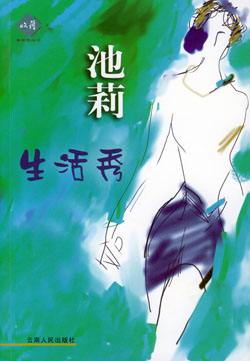
Edition chinoise 2002 |
|
Elle a réussi,
Shuangyang, elle est devenue une célébrité dans la rue,
et grande gueule comme il se doit dans ces
circonstances. Elle n’est pourtant pas au bout de ses
peines, que Chi Li semble multiplier à plaisir : son
petit frère Jiujiu, drogué, est dans un centre de
désintoxication, sa plus jeune sœur, pigiste à la
télévision, œuvre à la fermeture des gargotes du
quartier pour en éliminer les nuisances sonores, son
frère est marié avec une prétentieuse au chômage qui ne
rêve que de faire fortune en bourse, et lui laisse leur
fils chaque fois qu’elle a à faire ; quant à la maison
familiale, qui a été au fil du temps, pièce après pièce,
‘affectée’ à des étrangers, elle est difficile à
récupérer.
Sous la plume
de Chi Li, cependant, l’accumulation des soucis de
Shuangyang paraît on ne peut plus normale, éclipsant ses
problèmes affectifs, et devient même une image parfaite
du type de problèmes que rencontre le |
citadin moyen dans la
Chine du miracle économique. Les solutions, cependant, n’ont
rien de miraculeux : la simple perpétuation des traditions
d’antan. Pour rabaisser la morgue de sa belle-sœur, rien de tel
que de la prendre à partie sur la place publique, et, pour
récupérer la maison familiale, la voie idéale est de marier une
de ses jeunes employées au fils un tantinet anormal du chef de
section du Bureau du Logement – tout le monde y gagne, y compris
la jeune fille qui n’avait guère d’autre possibilité de sortir
de sa condition paysanne.
Toute la Chine moderne
est là, la Chine profonde, celle qui avance à grands pas dans
les statistiques, mais à tout petits pas dans les mentalités.
Adaptations
Le roman a connu un
immense succès en Chine, comme tous les livres de Chi Li. Il en
existe une version beaucoup plus longue, en cinquante et un
chapitres, avec une foison de personnages supplémentaires, qui a
servi de base au scénario d’un feuilleton télévisé en vingt cinq
épisodes, diffusé fin 2001. Chi Li a également vendu les droits
d’adaptation pour en faire une pièce de théâtre, et même un
opéra.
Il existe par ailleurs
une remarquable adaptation cinématographique : le film éponyme
est fidèle à la trame du roman et à son atmosphère tout en
dégageant une subtile différence. L’analyse comparée du roman et
du film permet de faire ressortir les qualités réciproques des
deux œuvres.
Lire en complément :
« Le show de la vie » (《生活秀》) :
roman de Chi Li (池莉) et film de Huo Jianqi (霍建起)
Notes :
(1) Il s’agit en fait
non vraiment d’un roman, mais d’une nouvelle ‘de taille moyenne’
(中篇小说).
(2) Le traducteur,
Hervé Denès, s’est trouvé devant un redoutable problème
d’homophonie dans la transcription des prénoms : le frère aîné
de Shuangyang et sa sœur cadette s’appellent tous les deux
Shuangyuan en pinyin non accentué qui est la transcription
habituelle ; la différences est dans les tons : shuāngyuán
双元
pour l’un,
shuāngyuàn
双瑗
pour l’autre.
Hervé Denès a donc opté pour la traduction des noms, en essayant
de coller à la signification des caractères tout en conservant
une logique de prénoms, voire en jouant sur les assonances,
comme dans le cas de Jiujiu, traduit Eternité, et contracté en
Tété…
|
|

