|
|
Brève histoire du
wuxia xiaoshuo
I. Origines : des
Royaumes combattants à la dynastie des Tang
I.1 Naissance et évolution de l’image du xia
par Brigitte Duzan, 24 novembre
2013
Le wuxia xiaoshuo
(武侠小说),
nouvelle puis roman de wuxia, est l’un des genres les
plus populaires de la littérature chinoise, l’un des plus
anciens aussi, et le seul de la littérature traditionnelle qui
ait survécu à la chute de l’Empire et soit encore vivant
aujourd’hui. Son histoire est intimement liée à
celle du xiaoshuo
lui-même dont il a partagé l’évolution.
Alliant les qualités
martiales dénotées par le terme à connotations militaires wu
(武)
aux valeurs héroïques et chevaleresques du xia (侠),
personnage empreint de noblesse d’âme et d’esprit de sacrifice,
le wuxia est intraduisible (1) : il se réfère à une
tradition et une culture typiquement chinoises. Il ne se définit
que par la personnalité particulière du xia tel qu’elle a
évolué au cours de l’histoire.
Origines de la
tradition et de la symbolique du wuxia
Origine du terme de
wuxia
Le terme même de
wuxia est relativement récent, puisqu’il date de la fin de
la dynastie des Qing, soit du tout début du 20ème
siècle. Comme beaucoup d’autres, il a alors été importé du Japon
où le néologisme bukyo avait été inventé à la fin de la
période Meiji (dans le titre d’un roman) : bu désignant
le samouraï et kyo dénotant un caractère viril. La
transcription chinoise de wuxia fut rapportée en Chine
par les jeunes intellectuels qui étaient partis étudier au
Japon, dans l’espoir que leur pays adopterait les valeurs de
modernité scientifique et militaire que le terme véhiculait et
qui avaient permis au Japon de devenir une grande puissance.
Au 19ème
siècle, auparavant, ce genre de littérature était désigné en
Chine par le terme de xiayi (侠义)
qui mettait donc l’accent sur le yi (义),
c’est-à-dire la droiture et le sens de la justice inhérents au
personnage du xia. Le nouveau terme, lui, soulignait ses
qualités chevaleresques de pourfendeur de torts à la pointe de
l’épée impliquées par la substitution de wu à yi.
Le terme de wuxia
est ensuite devenu courant et populaire au début des années
1920, avec une formidable expansion de ce type de littérature,
doublée d’un non moins formidable engouement pour les films de
wuxia vers la fin de la décennie.
Le xia, associé
au wu, cependant, a une longue histoire, qui remonte à la
période des Royaumes combattants (403-221 avant JC).
Origines du xia
|
Les références
les plus anciennes que l’on a trouvées proviennent du
Han Feizi (《韩非子》),
écrit à la fin de la période des Royaumes combattants.
Outre un condensé de la pensée légaliste, l’ouvrage
contient nombre d’observations et anecdotes sur
l’époque, celle qui précède l’instauration du Premier
Empire, donc marquée de conflits incessants. C’est dans
ce contexte que Han Fei critique ceux qu’il désigne par
le terme de xia en leur reprochant de
transgresser les lois en recourant à la violence – wu
.
Il le fait dans
un texte célèbre intitulé « Les cinq poisons » (五蠹)
(2) où il critique de la même manière les lettrés et les
xia, en rapprochant le wen et le wu
que la culture chinoise oppose normalement :
儒以文乱法,侠以武犯禁,而人主兼礼之,此所以乱也。
les
lettrés utilisent leurs écrits (文)
pour perturber les lois, les
xia recourent à la violence (武)
pour transgresser les
interdits, et comme le
souverain les tolère, le désordre
règne. |
|
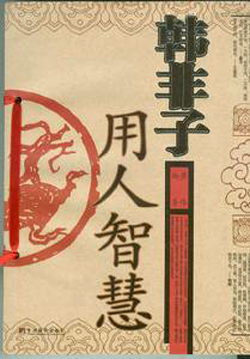
Le Han Feizi |
Et si les xia
sont respectés au lieu d’être châtiés, ajoute Han Fei un peu
plus loin, c’est parce qu’ils mettent leur épée au service de
causes privées. On voit donc se profiler l’image de mercenaires
parcourant les royaumes en guerre pour s’offrir à qui veut bien
les recruter, des youxia (游侠)
ou « chevaliers
errants » selon la traduction courante. Errants certes, mais
très peu chevaliers.
Le concept de xia
évolue avec Sima Qian (145- ?? avant JC) .
Le xia selon Sima
Qian
|
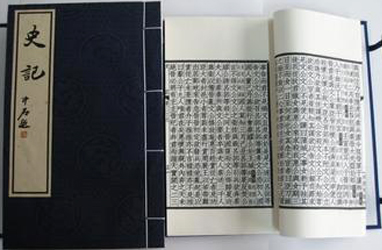
Les Mémoires historiques |
|
Dans ses « Mémoires
historiques » (《史记》),
achevées en 91 avant JC, Sima Qian (司马迁)
consacre le chapitre 124 de ses biographies aux
youxia : « Biographies
de chevaliers errants »
(《游侠列传》),
selon la traduction de Jacques Pimpaneau. Il s’agit en
l’occurrence de deux personnages présentés comme des
exemples-types de xia :
Lu Zhujia (魯朱家)
et Guo Jie (郭解).
|
Mais il faut y
ajouter les six biographies du chapitre 86 : « Biographies
d’assassins » (《刺客列传》),
assassins qui sont en fait des héros :
Cao Mo (曹沫),
général du duc Zhuang de Lu qui força le duc Huan de Qi à rendre
les territoires conquis, Zhuan Zhu (专诸),
assassin du roi Liao de Wu, Yu Rang (豫让)
qui vengea son maître d’un geste symbolique avant de se
suicider, Jing Ke
(荆轲),
auteur
de la tentative ratée d’assassinat du futur Premier Empereur et
Nie Zheng (聂政)
(3).
|
Nie Zheng est
en fait le cinquième dans l’ouvrage de Sima Qian car les
« assassins »
y sont classés
par ordre chronologique,
mais c’est un
modèle du genre. Pour échapper à ses ennemis, Nie Zheng
s’était réfugié, avec sa mère et sa sœur, dans l’Etat de
Qi (齐国)
où il
devint l’ami de Yan Zhongzi (严仲子)
qui était poursuivi par le premier ministre de l’Etat de
Han (韩国),
Xia Lei (侠累).
Nie Zheng assassina Xia Lei, puis se suicida, mais, pour
que sa sœur Nie Rong (聂荣)
ne soit pas inquiétée, il se défigura au préalable.
Personne ne sachant qui était |
|

Nie Zheng |
l’assassin, le souverain de Han
fit exposer le
corps en public ; Nie Rong reconnut son frère, et dévoila son
identité pour que son grand mérite fût connu de tous.
Cette biographie de
Nie Zheng
combine les principales caractéristiques qui font la noblesse du
xia : esprit filial, ici envers la mère, fidélité à ses
amis, loyauté envers ses maîtres, lutte contre l’injustice et
les persécutions, esprit de sacrifice, et ici non seulement du
xia mais de sa sœur aussi. Sima Qian cite bien Han Fei au
début de son chapitre, mais son propos est opposé : loin de
dénoncer le xia comme fauteur de troubles, il professe
son admiration pour son courage et son intégrité ; si ses
actions sont un défi au pouvoir établi, et peuvent donc
représenter un danger pour l’ordre public, il est toujours du
côté des opprimés et des victimes d’injustices, qu’il défend au
mépris de sa propre existence.
De toutes ces qualités,
c’est sans doute la loyauté qui prime : loyauté envers l’ami, ou
loyauté
envers celui qui a su
reconnaître sa valeur et l’emploie à son service (zhijizhe
知己者)
- et l’on ne
peut s’empêcher de
penser que c’est là une idée très personnelle de Sima Qian.
Comme le dit Yu Rang :
士为知己者死,女为说己者容。
L’homme meurt
pour celui qui a reconnu sa valeur,
comme la femme se pare
pour celui qui apprécie sa beauté.
Zhuangzi lui-même – dans son célèbre texte, chapitre 30 du Zhuangzi, « Convaincre
par l’épée » (《说剑》)
- avait loué
l’efficacité des armes dans les cas où les formes
traditionnelles de persuasion prônées par Mencius, celles
fondées sur le langage, se heurtaient à une fin de non recevoir
(4). Convaincre par l’épée, c’est la solution qu’avait adoptée
Cao Mo… Pour agir sur un souverain ne connaissant que sa volonté
de domination et ses désirs de conquête, et sourd aux conseils
de modération de ses ministres, la violence devenait le seul
recours contre la violence.
Les xia ont
cependant été pourchassés pendant toute la première période de
la dynastie des Han (220 avant JC-23 après JC) et les historiens
postérieurs à Sima Qian sont revenus à l’opinion négative de Han
Fei. En même temps, cependant, l’imagination populaire
s’emparait de l’image de « nobles assassins » transmise par les
Mémoires historiques, mais en élaborant peu à peu une tradition
que l’on trouve déjà traduite en termes littéraires à l’époque
des Six Dynasties (222–589).
Les chuanqi des
Tang
C’est cependant sous la
dynastie des Tang, lorsque les contes et récits extraordinaires
de la période
des Six Dynasties se
transforment en véritables œuvres de fiction et que naissent les
contes fantastiques ou chuanqi (传奇),
que se développe en même temps toute une tradition littéraire
autour d’une image
idéalisée et romancée du xia.
L’image abstraite
du xia en poésie
Les poèmes de l’époque
peuvent être de simples versifications d’ouvrages historiques,
mais certains sont des portraits de xia, dont l’image
devient alors liée au port de l’épée. Le xia devient
bretteur et spadassin, jianxia (剑侠),
ou jianke (剑客).
C’est le titre d’un
poème de Jia Dao (贾岛)
- « Le spadassin » (《剑侠》)
– considéré comme symbolisant l’esprit du xia (5) :
十年磨一剑
voilà
dix ans que j’affûte mon glaive
霜刃未曾试
sa lame
acérée n’a pourtant point subi d’épreuve
今日把似君
aujourd’hui, seigneur, je la mets à votre service
谁有不平事
pour
aider ceux qui souffrent d’injustice.
|
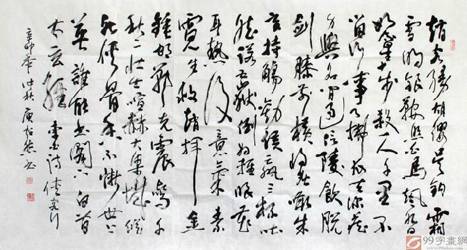
Li Bai Xiakexing |
|
Mais le poème
le plus célèbre dans ce registre reste celui du grand
poète Li Bai (李白) :
« La voie du xia »
(《俠客行》).
On a dans ce poème une série d’allusions à des
personnages devenus légendaires, et une application du
principe énoncé par Zhuangzi dans son texte « Convaincre
par l’épée ». Le ton est satirique, mais plutôt
laudatif. Le titre
|
du poème a
été repris par
Jin Yong (金庸)
pour son douzième roman, en 1966, preuve que le modèle est
devenu emblématique.
Le xia dans les
chuanqi
En même temps, le genre
des contes fantastiques, ou chuanqi, se développe à
partir des recueils de récits de manifestations surnaturelles de
la période des Six Dynasties. L’idée n’est plus d’édifier le
lecteur mais de donner
libre cours à l’imagination et au talent littéraire. La plupart
des œuvres sont des histoires d’amour complexes où se mêle le
merveilleux, traduisant la fascination de l’époque pour le
surnaturel et l’insolite.
Les histoires de xia
y gagnent deux nouvelles caractéristiques qui vont être
indissociables du genre : un élément de fantastique et un
élément féminin, souvent combinés dans les personnages
d’héroïnes martiales ou nüxia (女侠)
qui forment
l’aspect le plus intéressant des nouvelles créations de la
période. Le modèle-type, tiré des Printemps et Automnes de Wuyue
(《吳越春秋》),
date de la période des Han orientaux, mais il est
développé au neuvième
siècle comme personnage de fiction : c’est la Belle de Yue ou
Yuenü (越女),
à laquelle est par ailleurs consacrée la dernière œuvre de
Jin Yong.
|
Deux autres
figures féminines symboliques qui inspireront
de nombreux
cinéastes émergent vers la fin du neuvième siècle :
l’une est
Nie
Yinniang (聂隐娘),
et l’autre Hongxian (红线),
dont les histoires sont attribuées respectivement à Pei
Xing (裴铏)
et Yuan Jiao (袁郊).
La première,
fille de général, est kidnappée par une nonne
qui la forme
aux arts martiaux et à la pratique de la magie, puis la
fait entrer au service d’un gouverneur militaire qu’elle
doit défendre contre les assassins envoyés par un rival,
avant de
partir, une fois sa mission accomplie, sur un
âne blanc vers
une destination inconnue. La seconde, servante d’un
autre gouverneur militaire, accomplit des exploits tout
aussi extraordinaires, dans un récit conté avec élégance
et maîtrise du mystère.
Ces deux
héroïnes reprennent la trame dessinée par les histories
d’assassins de Sima Qian, mais en fusionnant les
|
|
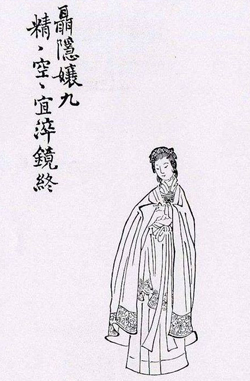
Nie Yinniang |
personnages du
valeureux xia et de l’élégante beauté que Sima Qian avait
associés dans les propos de Yu Rang à des fins d’analogie.
|
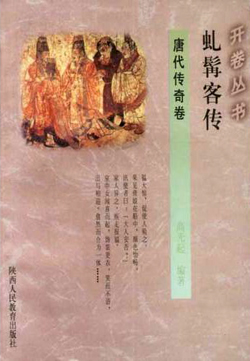
L’histoire de l’homme à la barbe frisée |
|
L’imaginaire
fantastique, dans ces récits, s’oppose à la narration
précédemment tirée de la réalité historique. Une
génération plus tard, l’art narratif du chuanqi
atteint un sommet dans le récit de Du Guangting (杜光庭),
l’un des plus célèbres de l’époque Tang : « L’histoire
de l’homme à la barbe frisée » (《虬髯客传》).
A la fin de la
dynastie des Sui, un certain Li Jing (李靖)
remarque
une jeune et jolie servante du nom de Hongfu (红拂),
employée chez un fonctionnaire auquel il a rendu visite.
Elle le rejoint
ensuite dans l’auberge où il est descendu, et
lui demande de
l’emmener avec elle car elle a lu en lui un avenir plein
de promesses. Dans une autre auberge, peu de temps
après, ils rencontrent un étranger à l’allure martiale
et à la barbe
frisée auquel Li Jing présente l’une de ses
connaissances, du nom de Li Shimin (李世民).
En le
voyant,
l’étranger déclare reconnaître en lui un futur empereur,
et renoncer donc lui-même à l’empire qu’il voulait
|
conquérir, puis
disparaît. Dix ans plus
tard, ministre de la nouvelle dynastie des Tang fondée par Li
Shimin, Li Jing entend parler d’un royaume conquis dans les mers
du sud-est : il sait que l’étranger a réalisé ses ambitions dans
un autre pays.
Du Guangting utilise
habilement le contexte historique de la fondation de la dynastie
des Tang pour dresser une double narration de fondation
dynastique à thème patriotique : le xia étrange à la
barbe frisée valide le mandat du ciel du fondateur des Tang tout
en réalisant lui-même une fondation en miroir dans un royaume
plus ou moins fantastique.
Ces thèmes propres aux
chuanqi vont ensuite alimenter une littérature
vernaculaire de wuxia de plus en plus élaborée sous les
Song et les Yuan, puis sous les Ming, où les récits abandonnent
la forme courte pour passer à la forme du roman à épisodes.
Le développement
des récits de wuxia des Song aux Ming
Histoires de xia
dans les huaben des Song
|
Au début de la
dynastie des Song, nous dit
Lu Xun dans sa
« Brève histoire du roman chinois » (《中国小说史略》)
(6), « les contes extraordinaires se voulaient
« crédibles », aussi ce genre allait-il désormais
s’engager sur la voie du déclin ». Dans le chapitre sur
les écrits de type chuanqi de l’époque Song, il
nous parle d’un Mémoire en trois volumes sur des « personnages
hors du commun dans les vallées du Yangzi et de la Huai »
(《江淮异人录》),
écrit à la fin du dixième siècle par un certain Wu Shu (吴淑).
L’ouvrage comporte en particulier un chapitre sur des
redresseurs de tort errants (侠客),
magiciens (术士)
et prêtres taoïstes (道流)
impliqués dans des événements insolites.
Lu Xun
souligne que Wu
Shu serait le premier à consacrer
un ouvrage
entier bâti autour « des évolutions de tout
un peuple
imaginaire d’étranges protagonistes, dans un univers
chimérique. » C’est cet ouvrage qui fut ensuite
copié à
l’époque Ming et lança la mode des « histoires de
bandits d’honneur aux prouesses miraculeuses », autant
de récits influencés par les croyances taoïstes en la
magie et aux esprits. |
|
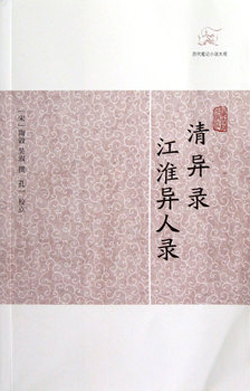
Personnages hors du commun
du Yangzi et de la Huai |
Mais les plus
intéressants développements littéraires, à l’époque des Song, ne
sont pas à rechercher du côté des lettrés, ils se passaient sur
la place publique. C’est là en effet que s’est développée une
littérature en langue populaire, sous forme de livrets appelés
huaben (话本),
utilisés par les bateleurs et conteurs, où étaient annotées des
trames ou des ébauches de récits oraux, souvent colportés par
ouï-dire. Or ces conteurs étaient divisés en écoles, que
plusieurs documents des Song du Sud cités par Lu Xun classent en
quatre catégories (7) ; dans la première, celle des conteurs de
xiaoshuo, on trouve les histoires d’amour habituelles,
ainsi que celles de monstres et de prodiges, mais aussi les
histoires de brigands, de xia et de combats martiaux,
auxquelles sont joints cas judiciaires et enquêtes.
L’important ici est la
différence d’approche narrative, liée à l’oralité : les
huaben n’ont plus rien de la concision de la langue
classique procédant par allusions, mais sont au contraire
prolixes et riches en développements mélodramatiques, voire
burlesques, aptes à captiver un auditoire populaire. Au
croisement de ce nouveau genre, la tradition des récits de
xia prend un tour nouveau, où l’héroïsme se teinte d’humour
populaire. On n’est pas très loin des personnages incarnés au
cinéma par Jacky Chan.
Parmi les récits
populaires des huaben de l’époque, on trouve ainsi
quelques histoires qui forment comme une légende dorée de
l’empereur Taizu avant la fondation de la dynastie des Song : il
y apparaît comme un xia martial et impulsif – mais un
tantinet excessif - à la fois digne descendant des xia
des Royaumes combatttants et précurseur des bandits d’honneur du
jianghu dont la légende commence aussi à se former à
l’époque.
Ainsi, dans « Zhao
Taizu enfourche le dragon » (《赵太祖飞龙记》),
le
futur empereur est figuré, déjà, en conquérant, mais
dans « Zhao
Taizu escorte Jingniang sur mille lis » (《赵太祖千里送京娘》),
l’image tourne à la caricature de foire : il
insiste
noblement pour ramener chez elle une jeune paysanne qui a été
enlevée par des bandits, et recueillie dans un monastère à des
milliers de lieues de chez elle ; mais il fera tant et si bien
qu’il la conduira au suicide. L’histoire sera reprise par Feng
Menglong (冯梦龙)
dans son deuxième recueil, à la fin des Ming, mais dans un
esprit différent.
Les
huaben perpétuent aussi la tradition des chuanqi des
Tang, en particulier en brodant sur les personnages féminins de
xia. On en trouve des échos dans les huaben des
Ming, comme, par exemple, le récit intitulé « Cheng Yuanyu paie
la note de quelqu’un à l’auberge, la Onzième sœur discute de
xia sur le mont Yungang » (《程元玉店肆代偿钱,十一娘云冈纵谭侠》),
développé dans un recueil de Ling Menchu (凌濛初),
écrit en 1627, à la toute fin des Ming.
A la fin des Song du
Sud, les spectacles populaires subirent une éclipse ; en même
temps les conteurs se firent plus rares, mais les huaben
subsistèrent, avec la tradition qu’ils avaient établie, et ils
inspirèrent les écrivains ultérieurs.
Premier récit du
jianghu sous les Yuan
Sous les Yuan, les
récits des chuanqi et huaben ont alimenté le genre
prévalent de l’époque : le théâtre. Mais les récits de xia
n’y sont pas une source d’inspiration fréquente.
|
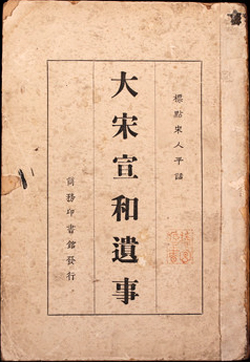
Vestiges de l’ère Xuanhe |
|
En revanche,
c’est dans un livre vraisemblablement écrit
sous les Yuan
(mais repris de textes antérieurs) que l’on trouve le
premier récit sur la rébellion des marais de Liangshan
(梁山泺聚义)
qui va donner sous les Ming l’un
des récits
fondateurs du roman de wuxia. Le livre est
intitulé « Vestiges
de l’ère Xuanhe des Song » (《大宋宣和遗事》) ;
c’est une compilation de textes qui retracent les
événements survenus depuis les souverains mythiques Yao
et Shun jusqu’à l’établissement de Gaozong à Lin’an
(Hangzhou) en 1127.
Il est en dix
parties ; la quatrième raconte comment, après deux
autres rebelles, Song Jiang (宋江)
est obligé de se retirer dans le temple de la déesse
noire Xuannü (玄女庙)
après avoir tué Poxi (婆惜),
et comment, alors que les soldats qui le poursuivaient
se sont retirés, un rouleau tombe du ciel, sur lequel
sont inscrits les noms de trente six généraux sommés de
se soumettre à lui comme chef suprême |
et protecteur des
justes causes, « afin de répandre l’honneur et la justice et
d’anéantir les méchants et les fourbes ».
Les rebelles pillent,
brûlent et assassinent. L’empereur ordonne de les capturer, mais
un général réussit à les pacifier, ils reçoivent des postes
d’inspecteurs, et Song Jiang finit gouverneur militaire (节度使).
On a là l’ébauche du
grand classique « Au bord de l’eau » (《水浒传》) compilé au quatorzième siècle. Le texte est un récit populaire
inspiré par des événements historiques, qui fournit un modèle
de xia émergeant de son isolement pour prendre la tête
d’une bande de hors-la-loi ; formant une communauté, il initie
par là même tout un système de codes d’honneur et de loyauté qui
vont devenir des règles du genre. Le xia n’est plus un
individu isolé ; il est en outre immergé dans l’histoire.
C’est aussi un être
moral qui finit par se rallier au régime. Il s’agit d’une
idéalisation typique des personnages de xia : en fait,
les rebelles autour de Song Jiang furent capturés et passés par
les armes. Mais les événements survenus après que les rebelles
se soient rendus ne sont pas rapportés dans les annales, la
rumeur publique et l’imagination populaire ont donc pu s’en
emparer et les enjoliver à volonté.
On est là à une période
charnière dans l’évolution de la littérature de wuxia. Le
genre va prendre une forme beaucoup élaborée sous les Ming,
grâce au développement du roman à épisodes (章回小说).
II. Développement
sous les Ming et les Qing
(à venir)
Notes
(1) On le trouve
parfois rendu par "roman d’arts martiaux", ce qui entraîne un
amalgame avec le kungfu, qui n’en est qu’un dérivé, ou
par "roman de chevaliers errants", qui induit une confusion avec
une tradition moyenâgeuse très différente – ne serait-ce que
parce que le xia n’est pas issu d’une élite nobiliaire.
Le terme le plus proche de la réalité du xia serait
"redresseur de torts" ; c’est le terme retenu par Jacques
Pimpaneau dans sa traduction des Mémoires historiques de Sima
Qian, bien qu’il le couple à celui de chevalier.
(2) Han Feizi, livre
XIX, chapitre XLIX :
五蠹.
Le texte en chinois classique et sa traduction en anglais :
www2.iath.virginia.edu/saxon/servlet/SaxonServlet?source=xwomen/texts/hanfei.
xml&style=xwomen/xsl/dynaxml.xsl&chunk.id=d2.49&toc.depth=1&toc.id=d2.20&doc.lang=bilingual
儒以文亂法,俠以武犯禁,而人主兼禮之,此所以亂也。
(3) Le texte chinois du
Shiji :
www.guoxue.com/shibu/24shi/shiji/sjml.htm
Les biographies
d’assassins :
www.guoxue.com/shibu/24shi/shiji/sj_086.htm
(4) Voir : Persuasion à
la pointe de l’épée, l’imagination thérapeutique en action,
étude et traduction du Shuo Jian 《说剑》,
chapitre 30 du Zhuangzi 庄子,
par Romain Graziani
www.afec-etudeschinoises.com/IMG/pdf/Graziani.pdf
Le texte chinois :
www.douban.com/note/248594645/
(5) Ces quatre vers du
poète Jia Dao (779–843)
ont été élevés
au rang de symboles par le professeur James J.Y. Liu dans :
The Chinese Knight Errant,
University of Chicago Press, 1967.
(6) Brève histoire du
roman chinois (qui est en fait l’histoire du xiaoshuo, et
pas seulement du roman), traduit par Charles Bisotto,
Gallimard/Connaissance de l’Orient, 1993, pp 128 sq.
Texte chinois :
www.tianyabook.com/LUXUN/zgxs/index.html
(7) Brève histoire du
roman chinois, p 143.
|
|

