|
|
Hong Ying
虹影
Présentation
par
Brigitte Duzan, 7 janvier 2012
|
Bien que des
traductions de trois de ses romans aient été publiées en
France, Hong Ying y reste largement méconnue.
C’est pourtant
une romancière qui a connu une brusque célébrité lorsque
parurent, au tournant du millénaire,
d’abord son
autobiographie, puis son roman sur les aventures en
Chine de Julian Bell, neveu de Virginia Woolf.
Ce fut, il est
vrai, une célébrité légèrement tapageuse, entachée d’un
scandale médiatisé, qui reste associée au nom de la
romancière. Et c’est dommage car c’est au détriment de
ses autres écrits, et ses nombreuses nouvelles, en
particulier.
Fille de
batelier en quête des origines
Hong Ying
(虹影)
est née à
Chongqing (重庆)
en 1962, sur les bords du Yangzi. Son grand-père
maternel y était coolie, |
|

Hong Ying |
son père
batelier ; nombre de ses nouvelles sont nourries et colorées des
souvenirs du fleuve, tout comme son autobiographie :
我的家在长江南岸。
南岸是一片丘陵地,并不太高的山起起伏伏,留下一道道沟坎。如果长江发千古未有的大水,整个城市统统被淹,我家所居的山坡,还会象个最后才沉没的小岛,顽强地浮出水面。这想法,从小让我多少感到有点安慰。
Nous habitions sur la rive sud du Yangzi.
C’est
un endroit vallonné, dont les collines assez modestes dessinent
des successions de crêtes et de vals. Les années de grandes
crues comme il y en a eu dans le passé, toute la ville est
submergée ; parce qu’elle est située à flanc de colline, la
maison semble alors le dernier îlot à devoir être englouti, et à
émerger encore obstinément des eaux. Dans mon enfance, cela m’a
souvent donné un sentiment de sécurité.
Elle
décrit ensuite la montée pénible d’une vingtaine de minutes pour
parvenir du débarcadère du bac, sur le bord du fleuve, jusque
chez elle, et nous fait parcourir du regard la vue sur le fleuve
que l’on apercevait du seuil. Autant d’images et de souvenirs
aujourd’hui effacés : c’était avant le barrage des Trois-Gorges.
Mais la
sécurité dont elle parle est toute relative…
Enfance pauvre
|
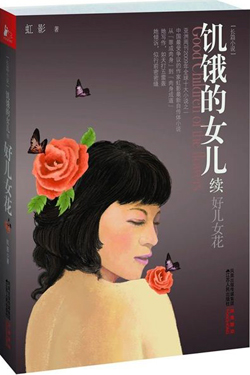
Fille de la faim (autobiographie) |
|
Hong Ying est la sixième enfant de la famille. Ils
vivent dans la plus grande pauvreté, aggravée par les
conditions difficiles des lendemains du Grand Bond en
avant et de la famine qui en a résulté.
Ses parents étaient arrivés là au début de 1951, avec un
enfant. Mais la politique de Mao Zedong, à l’époque,
raconte-t-elle d’un ton accusateur, était résolument
nataliste, l’accroissement démographique étant un des
éléments de sa volonté hégémonique. Ils se sont
finalement retrouvés avec six enfants (deux autres étant
morts prématurément) ; son père est bientôt atteint de
cécité, sa mère doit aller travailler comme coolie pour
nourrir la maisonnée. La faim est un autre des souvenirs
d’enfance de Hong Ying, qui hante son autobiographie, et
explique son titre : « Fille de la faim » (《饥饿的女儿》).
Grandir
dans les années 1960
dans un
quartier déshérité de |
Chongqing, noyé dans une misère sordide tout autant qu’un
brouillard persistant, n’est pas sans laisser de traces. Peu de
mentions de la Révolution culturelle dans ses écrits : la toile
de fond, ou plutôt le leitmotiv, est la lutte pour la survie,
une lutte serrée pour une survie spirituelle et morale autant
que physique.
La
maison n’a qu’une pièce pour les huit personnes de la famille,
mais, pour couronner le tout, la sœur aînée se marie trois fois
et divorce trois fois, après avoir eu trois enfants ; à chaque
divorce, elle revient vivre chez ses parents, ce qui engendre,
forcément, des disputes sans fin avec leur mère, jusqu’à ce que,
n’y tenant plus, elle reparte au bout de quelques jours.
L’atmosphère invivable s’ajoute au dénuement pour donner à Hong
Ying un sentiment de culpabilité : celui d’être la bouche
supplémentaire à nourrir, celle dont on aurait bien pu se
passer.
L’existence de Hong Ying est en outre voilée d’un autre
brouillard, aussi omniprésent que celui de Chongqing, et que son
sentiment de culpabilité : des zones d’ombre comme autant
d’énigmes sur
elle-même, ses parents et sa famille, nourrissant des
interrogations qu’elle n’a eu de cesse de raconter, nimbées de
fantasmes, dans ses premiers écrits, ses poèmes d’abord, puis
ses nouvelles et ses romans, y revenant sans cesse dans une
tentative que l’on sent désespérée, mais aussi un tantinet
exhibitionniste, d’exorciser le passé.
Qui est
cet homme qui la suit à la sortie de l’école ? Pourquoi y a-t-il
une ‘anomalie’ dans le dossier officiel de son père, ce dossier
où étaient enregistrés les faits et gestes de chacun et qui
tenait lieu de carte d’identité dans la Chine d’alors ? Pourquoi
les voisins sont-ils hostiles ? Et pourquoi a-t-elle le
sentiment tenace d’être une étrangère dans sa propre famille ?
Adolescence meurtrie
Autant
de questions qui la rongent. Ses poèmes, alors, parlent de
désespoir et d’attente, attente d’un amour qui puisse lui
changer la vie, mais elle n’y croit guère. Elle dira qu’elle
avait l’impression que le noir de la société lui avait envahi le
cœur. Elle lit Tsvetaieva, s’identifie à la poétesse russe elle
aussi victime de la famine, à Moscou, après la révolution
d’Octobre, elle aussi victime d’une société bloquée où elle ne
trouve pas sa place, d’un système politique répressif qui la
pousse à l’exil et, une fois revenue en Union soviétique, à se
pendre…
En fait,
Hong Ying a un
confident : son professeur d'histoire. Il a vingt ans de plus
qu’elle et lui ouvre de nouveaux horizons, et en particulier
l’incite à penser par elle-même, hors du discours établi. Ils
font l'amour, un soir, et ne se reverront plus. Aussitôt après,
en effet,
Hong
Ying apprend que
l'homme mystérieux qui la suivait est son vrai père : il a connu
sa mère pendant que son père était en prison, et c’est cette
liaison, interrompue à sa naissance, qui a contribué à jeter
l'opprobre sur la famille. Il a cependant obtenu le droit de
rencontrer sa fille le jour de ses 18 ans, en 1980.
C’est un choc pour Hong
Ying qui tombe malade et ne va plus aux cours pendant quelques
jours. Quand elle revient en classe, elle apprend que son
professeur d'histoire s'est pendu, victime des pressions et
intimidations que lui valait son esprit indépendant et frondeur.
Elle se retrouve enceinte, obligée
d’avorter, sans
anesthésie.
Suivent quelques années
chaotiques, loin des siens, pendant lesquels elle parcourt la
Chine en écrivant poèmes et nouvelles.
A partir
du début des années 1980, elle publie quelques poèmes, pour elle
c’est une aubaine. Elle a raconté qu’elle a touché trente yuans,
la première fois ; elle a emmené une amie au restaurant, cela
lui en a coûté six, elles ont chanté des poèmes et bu du mauvais
vin. Le reste de la somme lui a permis de ne pas crever de faim
jusqu’à la fin du mois. Ses poèmes lui servent ensuite de
pare-faim épisodique.
Puis elle décide de
partir pour Pékin. Avant son départ, elle rend visite à ses
parents et apprend que son vrai père est mort, trois ans
auparavant. Sa mère lui remet un petit paquet : l'argent qu'il
avait épargné pour sa fille, toutes ces années-là…
Découverte de Pékin
et désillusion
Elle arrive à Pékin en
février 1989, et suit des cours d’écriture à l’académie Lu Xun (北京鲁迅文学院),
avant d’aller étudier à l’université Fudan, à Shanghai (上海复旦大学).
Pékin, elle en avait
rêvé. C’était la ville où se trouvait le « soleil en or » comme
Versailles était la résidence mythique du Roi soleil. Et puis,
aussitôt après son arrivée, ou presque, c’est le fameux
« Printemps de Pékin » qui se terminera noyé dans le sang place
Tian’anmen. Elle est là, au milieu des étudiants. Pour elle,
comme pour les autres, c’est au début une merveilleuse occasion
de s’exprimer, de se sentir libérée, avec cette étrange
sensation que tout pouvait brusquement changer, son destin comme
celui de la nation.
Mais, a-t-elle raconté
plus tard dans « L’été des trahisons » (《背叛之夏》),
tout avait dégénéré, était allé beaucoup trop vite, la
démocratie ne pouvait être instaurée du jour au lendemain, et
beaucoup ont ensuite profité de la sympathie éveillée à
l’étranger… La trahison politique s’était ajoutée à toutes les
autres trahisons dont elle avait été victime.
Elle reste encore deux
ans à Shanghai, mais rien de ce qu’elle écrit n’est publiable.
Elle a dû penser à Tsvetaieva qui se désespérait de voir ses
poèmes s’empoussiérer dans les bibliothèques : ils « seront
dégustés comme les vins les plus rares, quand ils seront
vieux », dit-elle dans un poème.
Alors Hong Ying décide
de partir.
Départ à Londres et
immersion dans l’écriture
Elle quitte la Chine
pour Londres, en 1991. Et là, elle découvre la joie de pouvoir
écrire librement, d’avoir son propre bureau, et la joie de
s’installer enfin à deux dans l’existence.
C’est le
genre d’existence dont on dit que c’est un roman. Hong Ying en a
fait toute une œuvre. Sa page d’écriture lui a tenu lieu de
divan de psychanalyse. Elle a raconté qu’elle écrivait par
terre, dans la minuscule maison de son enfance à Chongqing, sur
une pierre posée sur le sol ; elle n’a jamais, alors, songé
qu’elle pourrait avoir un jour une table à elle pour écrire, et
encore moins cette « room of one’s own » dont Virginia Woolf a
fait un des éléments essentiels de la libération de la femme, au
moins dans sa dimension d’écrivain.
La
réalité la plus triviale, la plus terrible et la plus crue, a
longtemps nourri sa fiction, comme condition préalable de
survie. Loin de chercher une solution dans la fuite par
l’écriture, elle y a consigné ses cauchemars comme autant de
papillons de nuit épinglés sur un mur.
Une œuvre d’où émergent poèmes et nouvelles
Hong
Ying a commencé à publier des poèmes dès 1983, mais c’est de son
arrivée à Londres que datent ses premières publications de
fiction. Elle se met alors à écrire avec une frénésie qui laisse
pantois. Elle dit : ma vie consiste à couvrir des feuilles de
papier de caractères.
A
room of her own
|
Ce qui a certainement exercé une immense influence sur
sa ‘production’ d’écrivain fut son mariage, à son
arrivée à Londres. Elle épouse alors un professeur de l’Oriental
School de l’université de Londres :
Zhao Yiheng (赵毅衡).
Ils
s’étaient connus en Chine dans les années 1980 :
Hong Ying commençait à publier des poèmes et lui était
critique littéraire. Quand elle le retrouve
à Londres, il fait des
traductions et des recherches sur la littérature
chinoise contemporaine ; on lui doit nombre d’études
publiées en Angleterre et aux Etats-Unis (en particulier
sur
Yu Hua).
Il apprécie ce
que Hong Ying écrit et l’encourage. Il inclura deux
nouvelles d’elle dans une anthologie de nouvelles,
poèmes et essais publiée aux Etats-Unis en septembre
2001, « Fissures,
Chinese writing today » (4) : « Preparing his
|
|
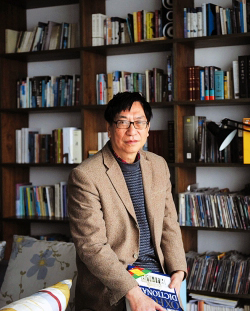
Zhao Yiheng |
biography » et « The Snuff Bottle », où elle montre comment une
histoire se transforme en circulant.
A 29
ans, elle a enfin une chambre à elle, un bureau où écrire, et
une certaine sécurité, matérielle et affective.
De
« L’été des trahisons » à « Fille de la faim »
Dès
1991, elle écrit son premier roman, « L’été des trahisons »
(《 背叛之夏》). Elle est arrivée à Londres au début de l’année, elle commence à écrire
le livre au mois d’août, elle le termine en trois mois ; le
récit a jailli de sa plume. C’est un témoignage (personnel et à
peine romancé) sur ce qu’elle a vécu deux ans plus tôt, le
Printemps de Pékin. Par le biais d’une jeune poétesse de fiction
à laquelle elle prête ses propres poèmes, elle y décrit
l’enthousiasme des étudiants, la découverte de la liberté
d’expression, une sorte de griserie contagieuse, dégénérant bientôt en
hystérie collective, et en un bain de sang.
La trahison est double,
politique et sentimentale, son personnage, après avoir fui la
place Tian’anmen ensanglantée, retrouvant son amant au lit avec
l’épouse dont il avait promis de se séparer. C’est assez typique
des romans de Hong Ying : la blessure affective est toujours
latente chez ses personnages, et le corps féminin érigé en
symbole du désir de libération.
Mais
« L’été
des trahisons »
est surtout sur l’après-Tian’anmen, sur la reconstruction d’une
existence après un tel fiasco. Le désespoir amoureux qui est
venu doubler le désespoir politique va prendre le pas pour
devenir une force. Le temps n’est plus à l’espoir collectif,
tout le monde panse ses plaies ; sa poétesse retourne à la
solitude de son enfance misérable. L’utopie politique n’ayant
plus cours, et dans un monde où les anciens rebelles rentrent
dans le rang pour sauver leur peau, elle tente l’autre utopie,
la libération sexuelle, comme autre forme de résistance et de
révolte, individuelle celle-là.
Le roman a été publié
en septembre 1992 à Taiwan. Il a évidemment rencontré un succès
quasi immédiat dans la plupart des pays occidentaux, le sujet
s’y prêtait. On lit, il est vrai, avec intérêt ses déclarations
sur les étudiants, leur idée illusoire de la démocratie à tout
prix et tout de suite, sa dénonciation indignée de l’incroyable
barbarie du pouvoir politique et des compromissions ultérieures,
de tous côtés. Mais ces dénonciations politiques et son histoire
sentimentale rappellent beaucoup d’autres écrits et films sur le
même sujet (1). Le roman est bien plus intéressant, au niveau
littéraire, par
l’éclairage qu’il donne
de son auteur. Son personnage est fictionnel, mais si peu !
Lors d’une interview à
Libération lors de la sortie de la traduction du roman en France
(2), elle a dit de son personnage :
« Elle est
étudiante, comme moi, elle vient d'une ville au bord du fleuve
et d'une famille pauvre. Elle a un ami, qui ne veut pas qu'elle
aille sur la place Tian’anmen, j'avais le même. La nuit du 3 au
4 juin, elle est dans la rue, elle est sauvée de la même manière
que je l'ai été, elle se cache comme je me suis cachée. La
différence, c'est que je suis ici, et qu'elle est peut-être en
prison. »
|
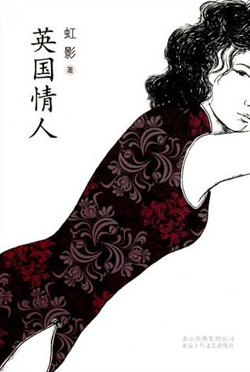
K (The English Lover) |
|
La différence
est de taille. Hong Ying n’en finit pas de se raconter
pour tenter de trouver un sens à ses tribulations, et
surtout une issue qui leur donnerait un sens, justement.
C’est le cas de son second roman, paru à Taiwan
également, en 1994, c’est tout le sujet, surtout, de son
autobiographie, « Fille de la faim », parue en
1997 : elle y décrit avec poésie et une certaine
nostalgie les lieux de son enfance, puis dévoile avec
une incroyable franchise, voire impudeur, les aspects
sordides de cette enfance mais surtout de son
adolescence.
Là encore, ce
n’est pas seulement pour se libérer du poids du passé,
mais pour montrer qu’il y a une issue possible et que la
lumière est au bout du tunnel. Mais cette sortie du
tunnel passe chez elle forcément par une vie affective
et sexuelle comblée : ces premiers personnages sont des
femmes qui se veulent sexuellement libérées, à la
recherche |
d’un amour, sinon de
l’amour. C’est une matrice fictionnelle de base chez elle.
|
Le scandale
de « K » ou comment devenir célèbre
Deux ans plus
tard, en mai 1999, toujours à Taiwan, elle publie un
roman sulfureux qui va déclencher un scandale en
Angleterre : « K ». Elle y décrit avec force détails
l’aventure amoureuse vécue par Julian Bell pendant son
séjour en Chine, fin 1935.
Poète mineur
mais neveu de Virginia Woolf, Bell est arrivé en Chine à
l’automne 1935 pour enseigner l’anglais à l’université
de Wuhan. Il a 27 ans, une gueule d’archange, on
l’appelle « le jeune apôtre ». Il n’achève pas son
contrat et part en Espagne, comme ambulancier dans la
guerre civile espagnole. Il est tué en juillet 1937 lors
d’un combat, laissant parmi ses papiers des lettres
écrites à Wuhan à une jeune femme qu’il désigne de la
lettre "K" pour dissimuler son identité car elle était
mariée : onzième lettre de l’alphabet pour celle qui
était sa onzième amante. |
|
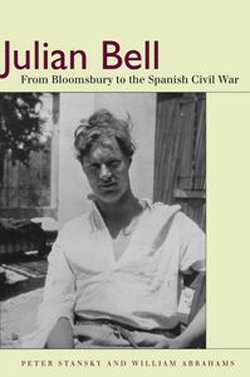
Julian Bell |
|

Ling Shuhua lors de son mariage |
|
L’identité
véritable de "K" est toujours contestée, mais il semble
probable qu’il s’agit de Ling
Shuhua (凌叔华), romancière née en 1900 qui nous a laissé de superbes nouvelles. Elle
avait épousé en 1927 l’un de ses éditeurs, Chen Yuan (陈源),
professeur d’anglais à l’université de Pékin, qu’elle
avait ensuite, en 1929, accompagné à Wuhan lors de sa
mutation à l’université de cette ville.
Hong Ying tombe
sur des lettres et des photos de Bell et de sa mère à la
bibliothèque de Londres, s’empare de l’histoire, la
passe au prisme de la sienne et de ses fantasmes, et en
fait un best-seller aussitôt comparé à « L’amant de Lady
Chatterley », avec un garde-chasse qui serait féminin et
chinois, mais des scènes érotiques tout aussi
explicites.
Une petite
fille de Ling Shuhua prend la mouche, dénonce le livre
comme étant « insupportablement pornographique » et
traîne Hong Ying au tribunal. Non point en Angleterre,
il n’y a plus de loi britannique dont se prévaloir,
mais… en Chine ! Il y a en effet une loi chinoise qui
punit toute personne coupable d’avoir porté atteinte au
« droit à la
réputation |
d’un
défunt » (死者名誉劝),
l’action en justice pouvant être intentée au nom dudit défunt
par ses descendants à la troisième génération.
|
C’est
effectivement ce qui s’est produit, en oubliant que la
loi avait été initialement conçue dans un but politique,
pour défendre les « droits à la réputation » … des
grands personnages de la révolution chinoise. Ironie
mise à part, Hong Ying est condamnée en 2002.
Imperturbable, elle réécrit son livre en l’édulcorant
quelque peu, le réédite en 2003 en le rebaptisant
« L’amant anglais » (《英国情人》)
et en fait un autre succès d’édition. Comme une revanche
sur son enfance et tout ce qu’elle a subi.
Elle enchaîne
ensuite les romans : elle revisite encore les lieux de
son enfance avec « The Peacock Cries » (《孔雀的叫喊》),
en 2002, pour regretter la perte d’un patrimoine
millénaire en racontant une autre histoire de trahison
amoureuse, avec pour cadre la construction du barrage
des Trois-Gorges dont les eaux de retenue vont engloutir
la maison natale du personnage principal ; elle revient
sur certains épisodes particulièrement durs de sa propre
|
|
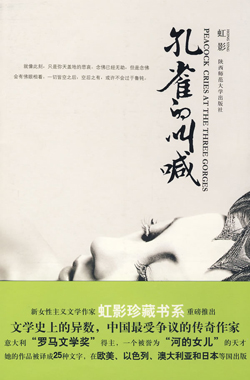
The Peacock Cries |
|
tragédie
familiale avec « Good Children of the Flowers » (《好儿女花》)
; mais les trois romans précédents, regroupés sous le
titre « la trilogie de Shanghai », sont plutôt une
réflexion sur l’histoire, celle de Shanghai avant 1949.
Il faut bien reconnaître que tous ces romans n’ont pas
la force des premiers.
Elle parvient
cependant, entre deux romans, à publier aussi des
recueils d’essais, de poèmes et de nouvelles, et c’est
là, malgré tout, le plus intéressant, les nouvelles
surtout.
Une
floraison de nouvelles
C’est dans ces
formes courtes que Hong Ying excelle. C’est là
qu’émergent les plus sensibles de ses souvenirs, le plus
profond de sa réflexion, dans un style forcément bien
plus soigné que dans ses romans. C’est là que l’on sent
vraiment son talent, et beaucoup moins son désir de
marquer des points. Reste sa rage de vivre et l’art de
le dire.
|
|

La trilogie de Shanghai |
|
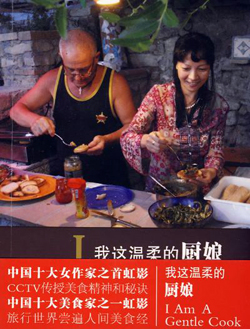
Son livre de cuisine |
|
Dans un de ses
rares entretiens où l’on sent vibrer sa fibre de poète
(3), elle a expliqué :
« Tous les
jours, je m’assois à mon bureau avec joie… Lorsque
d’étranges oiseaux viennent chanter sur les trois vieux
arbres que je vois par la fenêtre, un flot de caractères
se met à couler de ma plume. Il y a un miroir
sur
mon bureau, dans lequel j’observe mes yeux : j’y vois
revivre d’anciennes histoires. Le lendemain matin, quand
je me réveille, je vois parfois un esprit facétieux
danser au milieu des caractères, mais, bien plus
souvent, je ne trouve qu’un tas de stupidités, inspiré
par un démon qui
m’observe
dans mon dos.
Je jette
alors très vite tout cela au feu.
Lutter contre
ce démon est ma pire épreuve quand
j’écris. |
|
Plus de
temps passé à écrire signifie moins
d’amis. Ma
maison est entourée de terres désertées que l’on dit
hantées… Dans cette ville pluvieuse [Londres], on a le
sentiment de vivre dans un monde de spectres qui n’ont
pas besoin de contact humain… Ce sont en fait des gens
en conflit avec le monde des vivants. Chacun vit dans
son île personnelle, et je vais leur rendre visite en
bateau. La plage de sable est mon papier, et les traces
de pas mes caractères. »
|
|
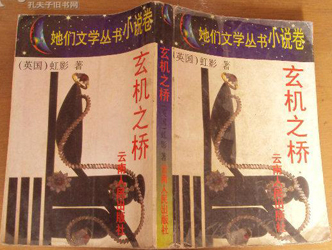
Le pont du mystère《玄机之桥》(édition 1995) |
|
C’est ainsi que
l’on doit également lui rendre visite. Chaque nouvelle
est un accès à une île différente, peuplée de ses
souvenirs et d’ombres surgies du passé. La plupart de
ces récits attendent d’être traduits.
Et
maintenant ?
Hong Ying n’a
pas supporté l’exil. A Londres, elle avait la liberté,
mais il lui manquait le public chinois ; elle aimait la
culture occidentale, mais avait du mal à s’y intégrer.
« Je me sens tout le temps étrangère, je flotte, »
a-t-elle dit. Finalement, quelques éditeurs chinois ont
commencé à éditer ses écrits, en 1999, et elle est
rentrée en Chine en 2001. |
|
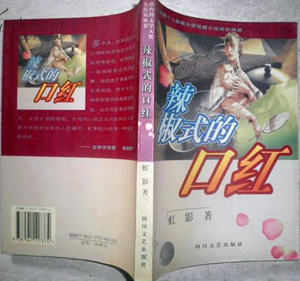
Red Lipstick (édition 1999) |
|

The Little Girl |
|
Elle a divorcé
en 2006.
En août 2009,
elle s’est remariée avec l’écrivain britannique Adam
Williams dans le petit village de Force, dans les
Marches, en Italie centrale, où le couple a une maison.
D’une famille avec une longue histoire en Chine,
Williams a
travaillé pendant vingt ans à Pékin ; il est l’auteur de
trois romans sur fond d’histoire de Chine, inspirés de
l’histoire de sa famille :
The Palace of Heavenly Pleasure,
The Emperor’s Bones
et
The Dragon’s Tail.
Elle vient de
publier, en octobre 2011, un recueil de 57 nouvelles
très brèves sur son enfance, à nouveau, mais cette fois
en duo avec sa petite fille, Sybil, née en 2006. Le
recueil s’intitule
« The Little
Girl » (《小小姑娘》),
c’est encore l’histoire de la petite fille qu’était Hong
Ying, mais illustré par la petite fille qu’est
maintenant sa propre fille.
Hong Ying sera
à la foire du livre à Taipei en février 2012. Elle
continue à avoir des liens privilégiés avec les premiers
éditeurs qui ont bien
voulu la publier. |
Note
(1) En particulier le
film de 2006 de Lou Ye (娄烨)
« Une jeunesse chinoise » (《颐和园》)
a beaucoup de points communs avec son livre.
(2) Interview réalisée
en mai 1997. Voir ci-dessous les traductions en français des
romans de Hong Ying.
(3) Entretien d’avril
2001.
(4) Zephyr Press,
septembre 2001. Zhao Yiheng est l’un des co-éditeurs, et les
textes sont tirés de la revue littéraire Jintian (今天).
Principaux romans
1992 Summer of
Betrayal 《背叛之夏》
1994 Far Goes the Girl《女子有行》
1997 Daughter of the
River 《饥饿的女儿》,
autobiographie
1999 K: The Art of
Love 《K》
réédité en 2003 sous
le titre
《英国情人》 (The
English Lover)
2000《神交者说》
2001 Ananda
《阿难》(阿难:我的印度之行)
2002 The Peacock Cries
《孔雀的叫喊》
2003 Lord of Shanghai
《上海王》*
2004 The Green Platye
《绿袖子》
2005 Death in
Shanghai 《上海之死》*
2007
The Magician from
Shanghai
《上海魔术师》*
2009 (Moi, douce aide
cuisinière) 《我这温柔的厨娘》
2010 Good Children
of the Flowers《好儿女花》
(suite de son
autobiographie)
*
Les droits
d’adaptation de ce roman ont été achetés en 2003 par le
réalisateur
Sherwood Hu (Hu Xuehua
胡雪桦).
Il a annoncé en 2007 préparer un film qui s’appellerait
« Shanghai 1976 », mais le projet semble avoir été abandonné.
Les trois
livres de 2003, 2005 et 2007 ont été réédités ensemble en 2009
sous le titre « la trilogie de Shanghai » (《上海三部曲》).
Principaux recueils
de nouvelles
(小说集)
Septembre 1994
《你一直对温柔妥协》
(tu vas droit vers un compromis à l’amiable)
Août 1995
《玉米的咒语》
(les incantations de Yumi)
《玄机之桥》
(le pont du mystère)
Février
1996
《 双层感觉》 (impression
de double épaisseur)
《带鞍的鹿》
(le cerf à la selle)
;《六指》 (six
doigts)
Mai 1997
《风信子女郎》
(une jeune fille nommé Jacinthe)
1998
A Lipstick Called Red Pepper: Fiction About Gay and Lesbian Love
in China
1993–1998,
recueil de nouvelles publiées en anglais en Allemagne.
Puis
publié en chinois :
Janvier
1999
《辣椒式的口红》 (du
rouge à lèvres comme du piment rouge)
Avril 2003
《火狐虹影》
(Hong Ying et le renard fauve)
Janvier
2005
《康乃馨俱乐部――虹影中短篇小说精选》
(Carnation Club, nouvelles choisies)
Juin 2005
《大师,听小女子说》
(maître, écoutez la jeune fille parler)
Février
2007
《我们时代的爱情》
(l’amour de notre temps)
Octobre 2011
《小小姑娘》The
Little Girl
Traductions en français
:
L’été
des trahisons, traduction Sylvie Gentil, Seuil, avril 1997
Une
fille de la faim, traduction Nathalie Louisgrand, Seuil,
septembre 2000
Le livre
des secrets de l’alcôve, traduction
Véronique
Jacquet-Woillez, Seuil, janvier 2003
A lire en
complément :
《小小姑娘》(虹影) « The Little Girl » (Deux
extraits) (Hong Ying)
|
|

