|
|
Chinese Arts and
Letters 2018 (1) : Ye Mi à l’honneur
par Brigitte
Duzan, 26 août 2018
|
Le premier numéro de l’année 2018 de la revue
Chinese Arts and Letters (CAL)
apporte son lot de nouveautés et de surprises.
Classiques revisités
Comme l’explique le rédacteur en chef Yang Haocheng (杨昊成)
dans sa note éditoriale, parallèlement à une rubrique
Culture et héritage dont le premier article, par
Yang Haocheng lui-même, traite de la calligraphie, ce
numéro lance une nouvelle rubrique : Echos des
classiques (Echoes of Classics). Il s’agit
des grands classiques de l’histoire littéraire chinoise,
des Analectes de Confucius aux chefs d’œuvre de la
littérature du 4 mai en passant par ceux, connus et
moins connus, des grandes périodes historiques, œuvres
des Sept Sages de la Forêt de bambous (竹林七贤),
drames de la période Yuan, fiction des Ming et des Qing,
la liste est longue. |
|
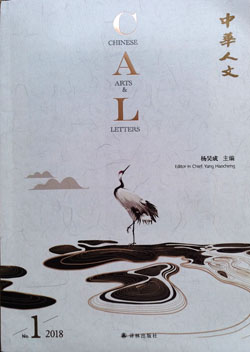
CAL 2018.1 |
La rubrique commence avec le Daodejing ou
« Livre de la Voie et de la Vertu » (《道德经》)
selon la traduction de référence de Stanislas Julien
.
C’est un ouvrage abondamment traduit, en français comme en
anglais, dont le texte est tellement elliptique, tellement beau
dans sa simplicité, qu’on le redécouvre à chaque traduction qui
en est en fait, notes et commentaires à l’appui, une nouvelle
interprétation.
|

Bill Porter / Red Pine (photo Jordan
Smith) |
|
La traduction en anglais choisie pour ce numéro de CAL
n’est pas la plus connue ; c’est celle de Bill Porter,
nom de plume Red Pine (赤松),
spécialiste des textes bouddhistes et taoïstes qui
aurait pu figurer parmi les Sept Sages mentionnés plus
haut. L’anglais de son « Taoteching »
a paru correspondre le mieux à l’esprit du texte, tout
en étant d’une fluidité propre à le rendre accessible au
lecteur moderne. Précédé de quatorze pages d’Introduction
à Laozi et son Daodejing, les seize extraits de la
traduction sont superbement présentés en regard du texte
chinois en vertical. |
Ye Mi à l’honneur
|
Ces pages du Daodejing sont particulièrement
bienvenues après celles consacrées à l’écrivaine à
l’honneur dans ce numéro de la revue et que les lecteurs
de chinese shortstories auront plaisir à
retrouver :
Ye Mi
(叶弥).
Bienvenues, car Ye Mi – et son œuvre – évoluent dans un
monde en marge qui s’apparente à celui de Lao Zi, un
monde qui était autrefois celui des ermites et des
reclus dans les montagnes. Elle est elle-même une ermite
du monde moderne, qui vit à l’écart, à la campagne, en
élevant une cohorte d’animaux et en « cultivant son
jardin » comme disait Voltaire.
Les deux essais qui accompagnent les traductions des
trois nouvelles sélectionnées soulignent ce trait de
caractère et ce mode de vie qui éclairent l’écriture de
l’écrivaine. Le premier (pp. 63-80) est de Zhang Xuexin
(张学昕),
un spécialiste de la nouvelle que l’on a déjà rencontré
dans les pages de CAL. Son analyse part de la première
nouvelle "moyenne" publiée |
|

Ye Mi avec ses chiens en novembre 2016
(entretien avec Zhang Xuexin, Wenhuibao) |
par Ye Mi, en 1997 - « Métamorphose », ou littéralement
« grandir, c’est muer » (《成长如蜕》)
– en soulignant que ce récit ouvre la voie à une série d’autres
sur le thème de la croissance, mais en traitant ce thème sous
l’angle de la complexité de destins soumis aux répercussions de
circonstances historiques dramatiques. Ye Mi a cependant un art
particulier de la narration, qui ne suit aucune tendance des
décennies traversées. Elle reste elle-même, et si influences il
y a, elles viennent de temps reculés, dans sa manière de
transmettre la beauté.
L’interview qui suit (pp. 81-93), de Jin Ying (金莹),
retrace avec détails et anecdotes les particularités de la
jeunesse de Ye Mi qui ont influé sur son écriture : les
nombreuses lectures, et une vie instable, de maison en maison
(quatre familles différentes quand elle était à l’école
primaire), où la lecture, justement, constituait un élément à la
fois d’ancrage et d’évasion. Ce sont ces lectures précoces qui
ont contribué à former son mode de pensée, et une tendance à la
distanciation du monde ambiant qui est aussi source de tensions.
Elle est l’un des rares auteurs à avoir échappé à la
médiatisation qui suit une adaptation d’une œuvre à l’écran, et
pourtant, dans son cas, le réalisateur n’était autre que Jiang
Wen (姜文)
.
Elle continue – depuis 2008 - à vivre dans un endroit rural
isolé, où pendant longtemps on pouvait observer la lune, la
nuit, sans être gêné par l’éclairage urbain – la lune revient
comme un leitmotiv dans ses nouvelles. Mais, dit-elle à la fin
de l’entretien, « je n’aime plus cet endroit, il devient trop
bruyant, trop animé ; on n’y entend plus le coassement des
grenouilles, il n’y a plus de rizières, il ne va bientôt même
plus y avoir de jardins potagers. La nuit, les lumières
électriques ont obscurci la lueur de la lune. Mais je ne sais
pas où je vais maintenant pouvoir aller – sur une île isolée
peut-être… »
CAL a sélectionné pour ce numéro trois nouvelles représentatives
des publications récentes de Ye Mi, les deux premières traduites
par Ella Schwalb, la troisième par Natascha Bruce (pp. 7-62) :
- Le
Monastère de la Clarté lunaire (Bright Moon Temple
《明月寺》),
2003
- Méditation
sur les flocons de neige (Snowflake Meditation
《雪花神》),
2015
- Le
mont Xianglu (Mount Xianglu
《香炉山》),
2009.
Et aussi….
Avant de conclure avec un essai de Shen Li (沈黎)
sur les peintures de Lin Fengmian (林風眠),
ce numéro est complété :
|
- par
une nouvelle de Pang Yu (庞羽),
jeune écrivaine présentée comme l’un des espoirs de la
génération post’90 : « Wealth, Blessings and Longevity »
(《神禄寿》).
C’est encore une écriture très verte, qui fonctionne
plus selon le principe du coq à l’âne que de l’ellipse,
et dont on attend avec curiosité de voir comment elle va
évoluer (p. 155-176) |
|

Fei Zhenzhong |
- par
deux essais de Fei Zhenzhong (费振钟)
: « Les allées pavées de pierre bleue » (《青石小街》)
et « La pluie dans le vieux village » (《小村的雨》)
(pp. 177-184 )
- et
par des poèmes de Hu Xian (胡弦)
présentés en version bilingue chinois/anglais (pp.185-194).
Tao te king - ou le livre de la Voie et de la Vertu traduit
par Stanislas Julien (en 1842) et annoté par Catherine
Despeux, Éditions Mille et une nuits, 1996 (édition
bilingue)
|
|

