|
|
« René Leys »,
roman « vécu » de Victor Segalen
par Brigitte Duzan, 4 août 2020
|
« René Leys » est un roman de
Victor Segalen
écrit à Pékin « du 1er novembre
1913 au 31 janvier 1914 » comme il l’a lui-même
indiqué à la fin de l’ouvrage.
Il paraît une première fois en 1921, soit deux ans
après la mort de l’auteur, dans quatre numéros de la
Revue de Paris, de fin mars à début mai, mais c’est
une version expurgée intitulée « D’après René
Leys ». Le roman est ensuite publié en 1922 aux
éditions Georges Crès, avec sur la couverture une
célèbre illustration du grand ami de Segalen, le
peintre, graveur |
|

Couverture de l’édition de 1922,
illustrée par Georges-Daniel de
Monfreid |
et sculpteur Georges-Daniel de Monfreid, ami et confident de
Gauguin.
Cette édition n’était pas sans retouches et corrections, de même
que celle de 1971 chez Gallimard, reprise en 1995 dans les
Œuvres complètes publiées dans la collection Bouquins de Robert
Laffont. Il y a en fait deux versions manuscrites du roman, la
première de 1913-1914 et l’autre de 1916, précisément daté,
ainsi qu’un dossier de notes préparatoires, le tout conservé au
département des manuscrits de la BnF. Le deuxième et dernier
manuscrit abonde de notes et questionnements dans les marges et
les interlignes ; s’agissant d’un ouvrage interrompu par son
auteur, il est proche d’une version définitive, mais celle-ci
reste du domaine du virtuel.
Une roman « vécu »
|
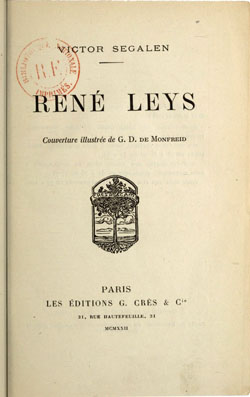
L’édition de 1922, page titre |
|
Ce qui intrigue, dès l’abord, c’est que Segalen
paraît délibérément créer une fiction autour de
l’écriture de ce roman, la courte période de trois
mois, précisément délimitée, induisant une
impression d’écriture rapide, sous la pression de
l’inspiration et d’une sorte d’urgence, comme un
roman-feuilleton. Or divers témoignages et indices
montrent que l’ouvrage était déjà en préparation au
début de 1913.
Le manuscrit A porte la mention « Roman vécu »
(apposée sur une maquette de page de titre, comme le
rapporte Madeleine Micheau dans son
« Enquête
sur la genèse de René Leys »
) :
mention qui renvoie aux relations « vécues » de
Segalen avec Maurice Roy, ce jeune Français de 19
ans rencontré un an après son arrivée à Pékin, en
juin 1910, et devenu son professeur de chinois.
Personnalité complexe, ce personnage mystérieux
l’initie à la vie à Pékin et dans la Cité interdite,
en lui faisant des révélations où Segalen peine à
faire la part de l’authentique et de l’affabulation.
|
Segalen, en effet, est fasciné par la personne de l’empereur
Guangxu (光绪帝),
reclus dans son palais avec ses concubines et ses eunuques, et
mort quelques mois avant l’arrivée de Segalen (en novembre 1908)
dans des circonstances non élucidées.
|
Segalen conçoit le projet d’un roman qui serait
l’histoire secrète de Guangxu contée par son
Annaliste et l’intitule « Le Fils du Ciel ». Alors
que personne n’a accès à l’intérieur du palais,
Maurice Roy prétend être un intime des lieux, et de
l’impératrice Longyu désormais douairière (隆裕太后),
la veuve de Guangxu. Il connaît Pékin comme sa poche
et parle un étonnant mandarin pour quelqu’un d’aussi
jeune, arrivé à Pékin fin 1905 avec son père, nommé
receveur principal de la Poste de Pékin
.
Dans une lettre datée du 20 novembre 1910, Segalen
écrit à son ami George-Daniel de Monfreid qu’il
s’est lancé dans l’écriture du roman « Le Fils du
Ciel » et que, pour cela :
« …J’ai
mis la main sur un merveilleux collaborateur : un
jeune Français de dix-neuf ans, à Péking depuis
quatre ans, qui parle chinois comme feu chinois
lui-même et m’épargne des années de recherches… »
|
|
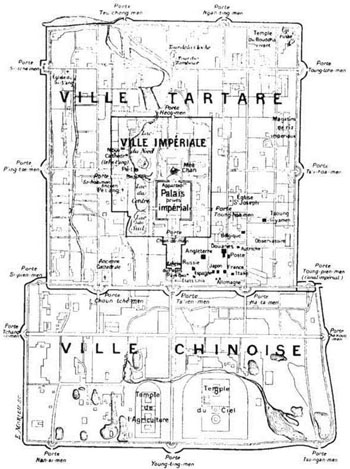
Le plan de la ville de Pékin au début
de René Leys |
Le jeune Maurice fascine Segalen au point qu’il décide de noter
ce qu’il lui dévoile : ce sont les « Annales selon Maurice
Roy ». Et peu à peu, au milieu de ses doutes sur le personnage
et ses dires, mais aussi aux prises avec une fascination que
l’on devine grandissante, il conçoit un roman inspiré de tout
cela : à l’automne 1913, il entreprend l’écriture de ce qu’il
appelle initialement « Jardin mystérieux » et qui deviendra
« René Leys ». A ce moment-là, il semble s’être lassé de cette
relation qui paraît n’avoir été qu’un engouement passager, comme
l’indique une lettre à Jean Lartigue datée du 25 octobre 1912
:
|

Victor Segalen dans son bureau à
Pékin en 1910
(c’est là qu’il prendra ses leçons avec Maurice Roy) |
|
« J’ai eu à son sujet quelque négligence […] le
tutoiement qui restait naturel tant que Maurice
était seul, vif, entrain, sincère et très jeune,
m’ennuie maintenant. […] Ce fut peut-être du
laisser-aller sentimental… »
Le roman est donc bien « roman vécu », au sens où
l’on dit de quelqu’un que sa vie est un roman, mais,
au-delà de cela, il est création poétique et
romanesque, reflétant l’attrait du mystère et de
l’étrange et l’ambiguïté de la réalité sur fond de
lutte entre réel et imaginaire. Il s’achève, comme
les grands romans d’amour, par la mort de l’un des
deux protagonistes. |
Une genèse difficile à établir
L’écriture même de ce roman, sans cesse interrompu et remis sur
le métier, est difficile à appréhender, au-delà des trois mois
indiqués par l’auteur. La date finale est sûre : le 31 janvier
1914, Segalen note rapidement des idées pour conclure car il
part le lendemain pour sa seconde grande expédition à travers la
Chine qui sera interrompue en août par l’annonce de la guerre,
l’obligeant à rentrer. C’est de retour à Brest que Segalen
rédige l’épilogue, daté 26 novembre.
Hormis cet épilogue, le roman a été soigneusement préparé et
composé, puis rédigé en trois mois, tambour battant, à un rythme
de roman-feuilleton. Il avait cependant été précédé d’ébauches
antérieures. Ainsi son ami Jean Lartigue, qui était en Chine
avec Segalen en 1913 et participera à l’expédition de 1914, note
dans son propre journal en date du 20 mai 1913 : « Après le
dîner, Victor me lit trente pages de Jardin mystérieux.
C’est très amusant, d’un ton de vivacité ironique très
nouveau. » Ces trente pages, il a dû les écrire alors que,
pendant le printemps 1913, de mars à mai, il travaillait à une
première version du « Combat pour le sol », réponse au « Repos
du Septième Jour » de Claudel, et commençait aussi les « Odes ».
Il aurait donc repris en novembre une ébauche de texte
préexistante, ou plusieurs ébauches, alors que le projet de
« Fils du Ciel » s’était enlisé et qu’il hésitait sur la forme à
donner à son roman. Les dates 1er novembre 1913-31
janvier 1914 apparaissent bien comme des éléments de fiction :
la fiction de l’écriture du roman, dont Segalen est le
personnage principal.
Quant au manuscrit B, il est la réécriture du A, réalisée à
Brest du 13 avril au 29 août 1916. Le texte passe de 413 à 334
pages, les suppressions témoignant de l’effort de concision
apportée lors de cette révision. Segalen n’est plus à Pékin ; la
distance aidant, il élague et discipline son texte, en en
gommant une partie de l’aspect spontané, « vécu » ; il en est
plus percutant. Il garde cependant les marques de son
inachèvement, qui sont aussi la marque de la mort de l’auteur
qui en a figé l’ultime version, mais sans qu’il y ait eu
auparavant, dans les trois années qui courent de la réécriture
du manuscrit à la mort, manifestation d’en reprendre le projet
et d’en achever l’écriture.
Début 1917, alors que Segalen est de retour à Pékin, détaché de
la marine pour recruter des travailleurs chinois dans le Yunnan,
il profite de ce nouveau voyage en Chine pour compléter ses
travaux en vue de son grand ouvrage « Chine, la Grande
Statuaire » : il n’est pas question de René Leys, même quand il
rencontre par hasard Maurice Roy qui travaillait alors au Crédit
foncier d’Extrême-Orient. Dans une lettre à sa femme du 1er
mars 1917, Segalen mentionne brièvement la rencontre :
« Vu Maurice Roy, engraissé, changé, genre Homberg ou
commis-banquier. Les joues débordent les yeux qui n’ont plus
d’éclat… »
Et le 4 mars :
« Nous avons, Roy et moi, dîné à la chinoise… dîner en tête à
tête assez morne… Il est très gêné dès qu’on parle de ses amis
mandchous, du Régent. Il a « cessé complètement de les voir… Il
n’a pas vu quatre chinois en un an. » Je n’ai d’ailleurs rien
essayé de tirer de lui. Il aura un congé d’un an après la guerre
et ne parle que de sa future augmentation…
En somme, insipide, gentil, fini… »
René Leys n’est plus à l’ordre du jour : fini, comme son modèle.
Un projet de roman populaire
Le modèle de René Leys est donc Maurice Roy dont Segalen a noté
les confidences dans un journal écrit en 1910-1911, désigné par
le titre humoristique « Les Annales secrètes d’après MR ».
Cependant, ces notes étaient prises en préparation d’un roman
historique commencé dès l’arrivée de Segalen en Chine en 1909,
auquel il a donné des titres différents, dont « Le Fils du
ciel » ou « Les Annales Guangxu », mais qui est finalement resté
en plan.
Ce sont ces « Annales » inabouties qui sont devenues la matière
première de « René Leys », lequel n’est finalement qu’un pendant
du grand projet du « Fils du Ciel », une « consolation » selon
Madeleine Micheau, un divertissement sans importance par rapport
à ses autres projets, selon Segalen lui-même. Dans une lettre à
Jules de Gaultier du 11 janvier 1914
,
à vingt jours de partir en expédition, il fait le point de ses
projets d’édition et d’écriture en cours, dont :
« … je ne sais quel roman simili-policier de la vie pékinoise
qui, ayant « vécu » voici trois ans, par nous-mêmes, est venu
s’imposer avant le départ. Ça s’appelle « Jardin mystérieux » et
ça se vendra honteusement au dixième mille ou bien le
public n’est plus le public. Enfin, j’y déverse une fois pour
toutes ma gourme d’écrire jamais un roman d’aventures. »
|
Ce
caractère joyeux de roman populaire transparaît dans
les titres qu’il envisage au départ : « Le Mystère
de la Chambre violâtre », « Le Jardin mystérieux »
,
etc. Il avait bien dans l’idée d’écrire une sorte de
roman-feuilleton, comme il dit dans une lettre à
Henry Manceron, datée du 5 avril 1916 : il y parle
des retards dans l’édition de Peintures et
l’écriture d’Orphée, et ajoute « Je me mettrai sans
désemparer à mon feuilleton d’aventures, René
Leys… »
.
C’est aussi ce que montre la prière d’insérer du
manuscrit A
:
« Toutes les qualités depuis longtemps reconnues au
roman d’aventure (qui est bien notre épopée moderne)
se retrouvent ici… »
Segalen
relit Paul Féval, « Les mystères de Londres » lui
inspirant sans doute ceux de Pékin
,
mais de très loin : il s’agit juste d’établir une
généalogie. Segalen a d’ailleurs écrit un essai
malheureusement resté à l’état d’ébauche « Sur une
forme nouvelle du roman »
qui montre bien
l’importance qu’il attachait au roman
|
|

Les Mystères de Londres,
de Paul Féval (1844) |
populaire comme mythologie. Une mythologie que l’on pourrait
rattacher à celles de Barthes.
Un roman-feuilleton plein d’humour
L’histoire de « René Leys » se passe du 28 février au 22
novembre 1911, c’est-à-dire pendant les mois critiques qui
mènent à l’abdication de l’empereur et à la prise du pouvoir par
Yuan Shikai, le 19 novembre.
Un roman-feuilleton
|

L’empereur Guangxu avec les eunuques
de la cour |
|
Victor Segalen
s’amuse à dépeindre la vie pékinoise avec un
semblant d’intrigue policière, son narrateur ayant
pour unique objectif de découvrir les secrets du
palais impérial. Il tente en fait d’établir la
vérité sur la mort de l’empereur Guangxu (光绪帝),
disparu le 14 novembre 1908 dans des circonstances
mystérieuses, après dix ans de détention dans le
nouveau Palais d’été suite à l’échec de la Réforme
des Cent Jours. |
Le narrateur piétine dans son enquête jusqu’à ce qu’il rencontre
un jeune Belge vivant à Pékin, René Leys, qui prétend avoir été
l’ami de l’empereur défunt, être celui du Régent (le propre père
de Puyi, Zaifeng
载沣)
et le chef de la police secrète. Il prétend aussi être au cœur
des intrigues et fréquenter même le lit de l’impératrice, veuve
de Guangxu. Mais Leys meurt avant d’avoir fourni les preuves de
ses dires. Reste un manuscrit difficile à publier car la vérité
est fuyante. Le narrateur le referme finalement en déclarant ne
rien vouloir savoir de plus : « Je ne saurai donc rien de plus.
Je n’insiste pas, je me retire… »
Le roman semble, en ce sens, préfigurer l’échec des tentatives
de faire le jour sur la propre mort de l’auteur, en 1919, dans
des circonstances tout aussi mystérieuses que celles de la mort
de l’empereur, après plusieurs mois d’une maladie dont on n’a
jamais réussi à définir la nature.
Mais ce qui prime, dans l’intérêt suscité par le texte, c’est
l’humour qui s’en dégage et qui en est la caractéristique
principale, ce « ton de vivacité ironique » dont parle Jean
Lartigue.
Vivacité ironique et distanciée
On a vu que Segalen était revenu dès 1912 de sa fascination pour
le jeune Maurice Roy, en se demandant comment il avait pu se
laisser entraîner dans ce qu’il appelle lui-même « un
laisser-aller sentimental » dans une confidence à Jean Lartigue
censurée par sa femme. C’est donc avec une certaine
distanciation qu’il écrit son texte, avec un regard ironique sur
Pékin et la cour impériale, mais aussi sur lui-même à travers
son narrateur.
Car il y a une distanciation par le simple biais de ce
narrateur, qui évite le récit à la première personne, intime et
direct. On se rappelle, à ce propos, que la thèse de Segalen
portait sur « L’Observation médicale chez les écrivains
naturalistes », mais qu’il s’intéressait plus à la littérature
qu’à la médecine et qu’il avait proposé initialement comme sujet
« le dédoublement de la personnalité », question qui parcourt
toute son œuvre, d’une manière ou d’une autre.
Il s’amuse du nom chinois dont on l’a affublé : Xiè Gélán
(谢阁兰),
qu’il traduit, outre le nom de famille, « orchidée du Pavillon
des vierges » ; je prise davantage, dit-il, mon « Épi de
seigle » breton. Il est à son meilleur quand il décortique les
généalogies de la famille impériale, en feignant de rapporter
les propos de son professeur qui est aussi celui « du neveu du
prince Lang », en fait le onzième de sa douzaine de neveux. Or,
à un dîner, rien ne se passe car on attend le principal convive,
« l’oncle du neveu du prince Lang », d’où l’on pourrait conclure
que l’oncle en cause est le prince, mais il n’en est rien : le
énième neveu en question « a autant d’oncles que le prince a de
neveux » … bref entre un vieillard qui n’a rien à voir avec le
prince.
Segalen s’amuse de tout et a un tel don de la formule que son
roman est un régal que l’on dévore d’une traite. Une
représentation d’opéra, par exemple, est l’occasion d’un tableau
très drôle de la foule qui s’y presse et des coutumes du lieu.
Ainsi les conversations se poursuivent :
« …parmi le va-et-vient des domestiques inondant les tables de
thé, lançant à dix mains tendues des serviettes chaudes qu’on
attrape et qu’on renvoie au vol, après essuyage de la sueur,
d’un geste élégant comme un coup d’aile ou d’éventail. »
Et vers la fin, quand nous sont décrits le coup d’Etat de Yuan
Shikai et l’abdication forcée de l’empereur, Segalen nous offre
un véritable tableau d’opérette, avec comme acteur principal le
« régent qui monte » et qu’il dépeint en connaissance de cause
puisqu’il a été à son service plusieurs mois, le temps de
soigner son fils tombé de cheval, au sens propre. La chute de
l’empire est aussi le moment où le narrateur s’est mis à douter
de son jeune professeur, entraînant sa chute à lui aussi.
Les dernières pages sont magistrales car elles nous ramènent,
par anticipation, à la mort de l’auteur lui-même : le narrateur
spécule sur une possible utilisation par son jeune ami de
feuilles d’or pour se suicider, ce qui était, explique-t-il, la
mort impériale : la feuille d’or qui seule ne tue pas, mais,
enrobant l’opium, y parvient… on se prend à penser au corps
inanimé de Segalen, trouvé dans la forêt de Huelgoat, le 23 mai
1919….
On referme le livre à regret. Victor Segalen était un écrivain
capable de réussir le pari d’écrire un roman populaire sans
quitter tout à fait le domaine de la sinologie. C’est cette même
capacité à trouver les formules qui captivent le lecteur qui
fait de ses écrits sur la statuaire ou ses recherches
archéologiques des monuments littéraires passionnants.
« Enquête
sur la genèse de René Leys de Victor Segalen »,
in
Genesis (Manuscrits-Recherche-Invention),
numéro 15, 2000. pp. 67-79.
A lire en ligne :
https://www.persee.fr/doc/item_1167-5101_2000_num_15_1_1159
Madeleine Micheau tente d’établir un historique des
différentes versions et éditions. Mais elle décrit
aussi, avec émotion, la beauté du manuscrit A conservé à
la BnF, écrit, dit-elle, en partie à la plume d’oie sur
des feuilles de papier Morin translucide, avec une encre
(chinoise) d’une densité variable de brun – manuscrit
écrit en Chine, puis relié à Brest en 1917, couvert de
corrections et remaniements invitant finalement à
réécriture.
|
|

